|
L'INTÉRÊT SOCIOLOGIQUE
DE NOTRE HISTOIRE
AU LENDEMAIN DE LA CONQUÊTE
Léon GÉRIN
de la Société royale.
EXTRAIT DE LA
REVUE TRIMESTRIELLE CANADIENNE
Mai 1915
Bureaux de la Revue : 56, Côte Beaver Hall
MONTRÉAL
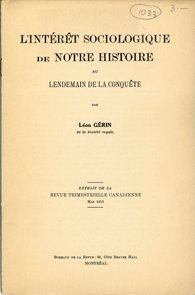 [3] [3]
Le siècle qui a suivi la cession du Canada à l'Angleterre forme la période la moins étudiée peut-être de notre histoire. C'est pourtant celle dont l'intérêt, sinon humain du moins sociologique, est de beaucoup le plus grand. Plus nettement qu'à aucune autre époque, on y observe l'action et la réaction les uns sur les autres de groupements sociaux très divers. Au sein de la Race et de la Religion, grands groupements amorphes, du type le plus ancien et le moins spécialisé, et dont l'influence reste la moins changeante et toujours sourdement impérative, on voit poindre des groupements moins compréhensifs, mieux adaptés aux besoins actuels, et aussi plus dépendants de la volonté et de l'intelligence humaines, ceux, par exemple, qui se rattachent à l'organisation économique ou politique du pays.
Trois éléments figurent invariablement dans la composition de toute société, de tout type social ; et suivant qu'ils s'y combinent en telle ou telle proportion, ou s'y manifestent sous telle ou telle forme, permettent de les distinguer facilement : conditions physiques (ou géographiques, ou anthropologiques) ; traditions, contraintes, pratiques plus ou moins communautaires du groupe ; actions plus ou moins importantes, plus ou moins énergiques, des individus. Nous avons ainsi, dans l'ordre de complexité croissante, des sociétés procédant surtout de la Nature, des sociétés s'inspirant surtout de la Coutume, et des sociétés caractérisées surtout par l'initiative particulière.
Les Indiens du Canada nous fournissent un bon exemple du premier de ces trois types de sociétés. Ils n'ont qu'un petit nombre de groupements spécifiques : la Famille y est en même temps Atelier de travail et, avec le Clan et la Tribu, pourvoit à tous les besoins de la vie publique ou de la vie privée. Et ces groupements, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, sont en correspondance étroite, d'une part avec la nature du lieu, d'autre part avec la conformation physique de la race. A la fois l'homme et l'organisation sociale y paraissent dominés par l'ordre naturel ambiant. La structure [4] anatomique tant de l'homme que des institutions n'est en quelque sorte qu'une simple transposition des caractères du milieu physique. Le Peau-Bouge ne réagit que faiblement contre les influences du Lieu ; il se contente pour sa nourriture des productions que ce lieu lui offre spontanément ; il ne se protège guère, par le vêtement et l'habitation, contre les agents atmosphériques. Il est lui-même comme une dernière production spontanée du pays, et dès qu'on l'en déracine, ou qu'on l'isole de la grande nature, il dépérit et il meurt. Aussi bien, d'institution sociale il ne connaît que les groupements fondés sur la consanguinité, qu'elle soit réelle, ou qu'elle soit fictive.
On observe, d'autre part, des sociétés dans lesquelles les impulsions de la Nature, pour n'être pas absentes, sont fortement encadrées par les croyances, les usages, les contraintes émanant de la vie sociale elle-même. Régies par des coutumes fort anciennes et respectées, ces sociétés ne donnent pas, comme les groupes de primitifs, l'impression d'une étroite communion avec la Nature, mais elles produisent l'illusion de la fixité, de l'immobilité. Telles furent ces sociétés du Moyen Âge, formées par les progéniteurs directs des colons du Nouveau Monde ; et même tels étaient au début, à beaucoup d'égards, les groupes de population rurale de la Nouvelle-France et de la Nouvelle-Angleterre, épris de tradition plutôt que de nouveauté.
Il est un troisième type de sociétés où le facteur dominant n'est plus la Nature, n'est plus la tradition communautaire, mais bien plutôt la personnalité humaine, et c'est là un caractère qui distingue particulièrement les sociétés modernes. Il n'y a pas ici le mystère, la fatalité, qui se dégagent de l'étude des sociétés primitives antiques : des groupements nouveaux se constituent sous nos yeux. Il n'y a plus l'imposante immobilité des sociétés fondées sur la coutume : les groupements s'adaptent avec célérité aux exigences nouvelles, et se modifient en vue de multiples besoins, au gré de multiples caprices. En revanche, si la société nouvelle a perdu l'attrait du mystérieux et le prestige de l'immuable, elle a l'intérêt dramatique qu'inspirent toujours le mouvement, la vie, l'action consciente et ordonnée de grands organismes.
À la suite de son occupation par les Anglais, la Nouvelle-France présente le spectacle d'une société encore toute pénétrée de traditions et d'usages séculaires qui, presque à son insu, est entraînée dans la voie du changement et de l'imprévu ; de groupes de population qui, avant même d'avoir perdu le souvenir de leurs origines ethniques diverses, sont mis en concurrence sur le même sol, bien plus, sont appelés à coopérer en vue de la constitution [5] de groupements d'un ordre nouveau, que les ancêtres n'avaient pas connu, et n'avaient pu prévoir : les institutions d'une colonie à gouvernement libre et autonome.
* * *
Français et Franco-canadiens, d'une part, Anglais et Anglo-américains, de l'autre, avaient alors entre eux plus d'un point de ressemblance. Par exemple, chez les uns comme chez les autres, on observait, allié à certains caractères physiques définis et persistants, ainsi qu'à des survivances de traditions et de coutumes très anciennes, un notable développement de l'initiative privée, quoique pour des objets et dans des sens divers. Tous, au dire des historiens, avaient des origines ethniques communes, les divergences à partir de la souche première étant de date assez récente. Tous résultaient de la rencontre et de la combinaison d'influences surtout celtiques, romaines, germaines et normandes. Le Breton des îles britanniques est le congénère du Gaulois, comme le Saxon est le congénère du Franc, et les uns comme les autres ont connu la domination romaine et subi le joug normand. Enfin, tous, classe pour classe, étaient à peu près au même degré de culture et de civilisation.
Mais aussi chacun de ces quatre types avait acquis et retenait certains traits distinctifs. Dans l'Ancienne France, l'initiative se donnait carrière surtout dans l'ordre militaire et administratif. Déjà César, dès avant l'ère chrétienne, signalait l'existence dans les Gaules d'un régime bien tranché de classes et de factions. La paysannerie, qui formait la masse de la nation, n'y jouissait d'aucune considération, et n'avait point part à la direction des affaires publiques, que se réservaient les chevaliers et les druides. La période suivante, celle du Franc et du Féodal, fut féconde en merveilleux progrès. Elle fixa au sol cette population jusque-là flottante ; elle vit s'opérer le défrichement de la France, et le développement d'une vie locale intense. Mais dans une troisième période, ce beau mouvement fut enrayé, et on assista à la constitution, aux envahissements graduels, puis à l'irrémédiable décadence de la grande monarchie militaire et centralisée des Capétiens, des Valois et des Bourbons.
La France, grandie par les efforts persévérants de nombreuses générations de travailleurs est alors relativement populaire et riche, mais son organisation sociale est médiocre. Sa classe de paysans, repliée sur elle-même, ne cherche pas à s'élever, et dès [6] lors n'exerce aucun contrôle effectif sur sa classe dirigeante, et ne comble pas les vides qui se produisent dans ses rangs. Celle-ci d'autre part, s'est détachée de la vie rurale, a renoncé à la direction des arts usuels, applique et gaspille de plus en plus son énergie à l'accaparement, et parfois à l'exercice, des charges de l'État, comme à la recherche des plaisirs de la Cour.
Les distinctions s'accentuent entre classes de dirigeants et classes de dirigés, et aussi les défiances. Il se produit une recrudescence du régime en vogue chez les Gallo-romains, sorte de régime de clans rivaux et très instables, parce qu'ils reposent entièrement sur des rapports de personne à personne, que le Féodal avait remplacés par des rapports de domaine à domaine. Or ce régime de classes et de factions, fâcheux pour la Gaule, l'est infiniment plus pour la France de Louis XIV et de Louis XV, à cause de l'agglomération des habitants, de la complexité et de l'importance des intérêts à régir.
La Nouvelle-France était, à beaucoup d'égards, un duplicata de l'Ancienne. Comme celle-ci elle se composait essentiellement d'une population de paysans, gouvernée de haut par une noblesse et par un clergé. Dans la colonie, comme dans sa métropole, la classe dirigeante vivait en très grande partie des subventions, des faveurs, des privilèges accordés par l'État, au gré des factions qui assiègent le pouvoir. Sans doute, dans ce pays neuf, le paysan s'était quelque peu émancipé, il était devenu coureur de bois, et de son côté, le gentilhomme s’était parfois frotté d'aventures, était devenu chef d'expéditions de traite ou de découvertes lointaines. Mais ni l'un ni l'autre, sous le régime de réglementation administrative institué par Richelieu et Louis XIV, n'avait perdu sa formation ancienne. C'était souvent un paysan avisé et débrouillard que l'Habitant canadien, mais ce n'était que très exceptionnellement qu'il s'élevait au-dessus de cette condition, du moins sans sortir de la culture ; et, dans l'administration des affaires du pays, son rôle était purement passif. C'était souvent un soldat et un navigateur admirable que le gentilhomme canadien, mais sans fortune, et sans les aptitudes pratiques pour s'en amasser.
Toute la colonie vivait directement ou indirectement du commerce des fourrures, organisé administrativement. Dans ces conditions, le trait le plus marquant de l'ordre social, c'était l'enchevêtrement des intérêts et des attributions en matière politique, religieuse, économique. Le Conseil supérieur, où siégeaient, à côté du gouverneur, de l'intendant et de plusieurs conseillers laïques, l'évêque de Québec et le supérieur des Jésuites, se chargeait, — sauf le contrôle [7] éloigné, l'intervention intermittente, de la métropole, — de tout régenter, de tout réglementer : la justice et la police, l'agriculture et l'industrie, et aussi la religion. On sait assez quelle place tiennent dans l'histoire de la colonie française les conflits d'autorité entre le gouverneur et l'intendant ou les conseillers, entre les fonctionnaires civils ou militaires et les dignitaires ecclésiastiques, et souvent à propos de puériles questions de préséance.
* * *
La société anglaise, séparée de la société française par un simple bras de mer, composée d'éléments ethniques assez semblables, ayant subi à peu près les mêmes influences, n'en a pas moins de très bonne heure évolué dans un tout autre sens. Tandis qu'en France la masse gallo-romaine, sous l'impulsion du dominateur franc et du seigneur féodal, ne s'est transformée qu'à demi, et a conservé beaucoup de traits de communautaire et d'instable, en Angleterre, le particulariste saxon a refoulé ou asservi le communautaire breton, premier occupant du sol, a supplanté le communautaire germain (angle ou mercien), et finalement a évincé l'envahisseur danois. Déjà au temps d'Alfred le Grand et d'Édouard le Confesseur s'affirme la supériorité du Saxon et se dessinent les grandes lignes de la constitution sociale du peuple anglais, fondée sur le libre jeu de l'initiative particulière dans la vie privée comme dans la vie publique, et que plusieurs siècles de domination normande ne parviendront pas à déformer. Le beau livre d'Henri de Tourville, l'Histoire de la formation particulariste, jette une vive lumière sur toutes les phases de cette épopée sociale.
Ce double souci de la liberté individuelle et de la liberté politique, de l'indépendance de la vie privée et du contrôle effectif des pouvoirs publics, se manifeste à toutes les époques de l'histoire d'Angleterre, mais jamais plus énergiquement qu'au sortir du Moyen Âge, à la suite de l'émancipation des serfs, de l'éclosion de l'industrie, de la navigation et du commerce international, des grandes découvertes d'outre-mer, de l'invention de l'imprimerie, du mouvement de la Réforme. On vit alors apparaître en Angleterre (il n'est ici question ni du pays de Galles, ni de l'Écosse, ni de l'Irlande) une société où les liens fondés sur la nature ou la tradition étaient faibles, relâchés en comparaison de ceux noués de date récente par l'initiative particulière, en vue de nécessités actuelles et pratiques.
Tandis que le clergé catholique et le clergé anglican, son spoliateur, se voient désertés par leurs ouailles, qui multiplient les [8] sectes comme à plaisir, les grands propriétaires accapareurs de champs, destructeurs de villages, ne trouvent plus pour cultiver leurs réserves, pour tirer parti de leurs domaines, que des journaliers de passage, que des fermiers qu'aucun lien durable ne rattache à eux. Le bordier, le petit paysan, ont émigré pour la plupart : les uns vont recruter la population industrielle des villes, les autres sont allés fonder des domaines indépendants en Amérique ou ailleurs. Entre temps, le commerce, la fabrication, les transports s'organisent de toute part, donnent naissance à de grandes villes, accumulent d'énormes richesses. Toute l'ancienne société s'est effondrée, remplacée par une efflorescence de groupements nouveaux.
C'est partout une sourde, mais intense fermentation sociale. Dans tous les ordres de la vie publique ou de la vie privée, les dirigeants, dès qu'ils faiblissent ou dégénèrent, sont dépossédés au profit des sujets d'élite de la classe sous-jacente. À la Cour, au Parlement, à l'armée, aux affaires, mais aussi dans l'agriculture, l'industrie et le commerce, c'est une lutte constante, une active concurrence, entre particuliers, où de nouvelles couches se font jour périodiquement, pendant qu'au sommet de l'échelle, la classe politique dominante s'applique sans relâche à restreindre les prérogatives de la Couronne et de la Chambre haute, au profit des attributions de la Chambre des communes.
Or, même dans ces conditions, l'Angleterre reste une société de type aristocratique, où l'indépendance de la vie privée et la liberté de la vie publique existent et sont maintenues surtout par l'entremise et au profit d'une classe privilégiée. Par contre, les colonies anglaises de l'Amérique, peuplées au début en forte proportion de groupes d'émigrants qui avaient quitté la métropole en révolte contre la situation de faveur et l'autorité reconnue au souverain et aux grands, appliquèrent sous une forme nettement démocratique les principes du self-help et du self-government.
Les colonies esclavagistes du Sud, il est vrai, s'organisèrent suivant un type rappelant celui de l'Angleterre, avec le grand propriétaire rural comme agent directeur de l'activité économique, et le comté comme maîtresse pièce de l'organisme public local. Mais dans le Nord, dans la Nouvelle-Angleterre surtout, la clé de tout le système fut le "farmer", petit propriétaire exploitant de ses mains, mais en général plus entreprenant et mieux renseigné que le paysan ; de plus, très apte à l'administration du township, circonscription en général moins étendue que le comté, mais plus vaste que la paroisse. Et n'a-t-on pas prétendu que c'est grâce à l'activité administrative des townships de la Nouvelle-Angleterre que le Yankee a pu triompher [9] de la bureaucratie anglaise ? Mais il ne faudrait pas perdre de vue le caractère urbain de beaucoup de ces townships, et le rôle prépondérant joué dès le début par l'élément commerçant et industriel.
En somme, nous avons trois types en présence. La société française (dont la société franco-canadienne n'est qu'un décalque, avec en plus les rivalités entre Français et Canadiens), est saine, excellente sous bien des rapports ; mais la liberté individuelle y est plus ou moins gênée, et la liberté politique n'y existe pas. La société anglaise est encore quelque peu férue des traditions du régime autocratique des Tudors et des Stuarts ; elle se complaît dans le faste du souverain et des grands ; elle souffre de distinctions et de rivalités de classes. Mais de longue date déjà l'initiative individuelle s'y donne librement carrière dans l'agriculture, le commerce et l'industrie, et on y jouit d'une large mesure de liberté politique, en dépit des privilèges que les mœurs, plutôt que les lois, reconnaissent aux nobles et aux bourgeois. Quant au type américain ou yankee, il est précisément très occupé, au point où nous sommes rendus, à préparer les voies pour une transformation radicale dans le sens de ses propres habitudes et de sa propre mentalité, de la constitution politique et sociale importée de sa métropole.
* * *
Rien n'est intéressant comme de noter, dans les documents contemporains, comment s'est opéré le premier contact de nos trois types en pays canadien. Les deux forts volumes de pièces, de mémoires et de lettres sur l'histoire constitutionnelle du Canada, publiés ces années dernières par le bureau des archives du Dominion, grâce à l'initiative de MM. Short et Doughty, nous renseignent abondamment sur les faits de cette période.
Ce qui frappe de prime abord chez les officiers anglais que la capitulation de Québec (1759), la capitulation de Montréal (1760) et le traité de Paris (1763) laissent maîtres de la Nouvelle-France, c'est leur ferme volonté de se concilier les nouveaux sujets du roi d'Angleterre, en leur témoignant une entière confiance, en les invitant à coopérer à l'administration de la colonie et en se garant des fautes commises et des gênes imposées inutilement par leurs prédécesseurs. Le placard d'Amherst, publié quinze jours après la capitulation de Montréal, est particulièrement instructif à cet égard. Il autorise les gouverneurs des trois villes principales à nommer aux emplois vacants dans la milice, entre tous autres, ceux qui jouissaient [10] de tels honneurs sous Sa Majesté Très Chrétienne. Il charge l'officier de milice commandant dans chaque paroisse de connaître les différends et d'en juger en première instance. Il est ordonné aux troupes "de payer tout ce qu'elles achètent de l'Habitant argent comptant et espèces sonnantes". Le commerce est déclaré "libre et sans impôt à un chacun". Pareille proclamation devait avoir un prodigieux effet sur le colon de la Nouvelle-France, qui n'avait pas été habitué à tant d'égards et de considération de la part de ses propres gouvernants.
Le rapport de Murray, gouverneur de Québec, en date du 5 juin 1762, est aussi très éclairant. Sans doute, il faut faire la part de ses préventions d'Anglais et de protestant ; mais à côté de cela, comme les intentions sont bienveillantes, comme les vues sont larges et s'inspirent en général d'une juste et saine appréciation des conditions de la prospérité sociale ! S'il se méfie de la classe seigneuriale, et du haut clergé, s'il se montre assez mal disposé envers les Jésuites et les Récollets, comme il sait reconnaître les qualités de l'Habitant, la vigueur physique de la race, sa moralité, sa sobriété. C'est dans cette classe de paisibles campagnards que les gouvernants anglais, suivant lui, devront chercher leur principal appui. Qu'ils se l'attachent au moyen d'un traitement équitable et généreux, qu'ils encouragent le séminaire de Québec, parce qu'il dotera le pays d'un clergé canadien. Qu'ils habituent cette population à se suffire à elle-même et en toutes choses à se passer des Français et des Américains.
Il n'y a pas lieu de trop s'étonner si les militaires anglais, chargés d'organiser le pays immédiatement après la conquête, font preuve de préoccupations d'intérêt public et d'un réel souci du bien-être des classes populaires. On sait que les règnes des deux premiers souverains de la maison de Hanovre, Georges 1er (1714 1727) et Georges II (1727-1760), furent une époque de grand relâchement de l'autorité royale et d'accroissement des attributions de la Chambre des communes et de l'influence des masses. On sait que William Pitt, devenu premier ministre en 1757, et qui, en 1759, chargeait Wolfe de la conduite des opérations contre Québec, s'était en quelque sorte imposé à Georges II en exploitant les défiances du populaire anglais à l'endroit de cette dynastie étrangère. Il avait désigné Wolfe pour commander l'expédition, au mépris des droits de l'ancienneté et des préjugés aristocratiques. De même pour obtenir que Guy Carleton fît partie de l'état-major de Wolfe, il dut forcer la main au souverain, auprès de qui Carleton n'était pas en faveur, pour avoir dénigré les troupes hanovriennes.
[11]
Si les chefs militaires anglais dépêchés vers les bords du Saint-Laurent dans les dernières années du règne de Georges II, surent, grâce surtout à la justesse et à la libéralité de leur conception politique, — puisée dans le milieu social anglais de leurs jeunes années, et quelque peu aussi au contact du milieu américain, — s'imposer au respect et même gagner les cœurs de beaucoup de Canadiens, il en fut tout autrement, au début, d'une autre classe de gens de langue anglaise, qui vinrent à leur suite s'abattre sur la colonie. Sortis, pour la plupart, des villes de la Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-York, se recrutant presque tous dans les classes commerciales et ouvrières, ils représentaient assez bien le type anglo-américain d'alors, avec ses qualités et ses défauts, excellent au fond, mais qui, à ce moment particulier de son histoire, violemment tendu vers la conquête de la liberté politique complète, était d'un abord rude, désagréable, et se montrait intolérant pour tout ce qui pouvait l'empêcher d'atteindre son but.
Bien qu'ils ne fussent qu'une poignée au Canada, ces Yankees avaient la prétention d'y tout mener. Ils manifestaient en toute occasion leur antipathie pour les croyances des catholiques, pour les coutumes françaises, pour le régime seigneurial des terres et le mode de transmission des biens. Avec la courte vue de petites gens qui n'ont l'habitude de la conduite que de leurs intérêts particuliers, sans avoir à tenir compte des autres, ils auraient voulu supprimer tout cela du jour au lendemain, et réclamaient hautement pour eux seuls, à l'exclusion de la population française et catholique et même des fonctionnaires anglais, l'administration de la chose publique. Leur action allait avant longtemps se faire sentir de plus énergique manière.
* * *
Avançons de dix ou douze ans la période d'observation. La situation est un peu changée, mais n'en met que plus fortement en relief les faits et les lois d'ordre sociologique. Nous avons ici pour éclairer notre étude, outre la précieuse collection indiquée ci-dessus, la série des mémoires réunis par les soins de l'abbé Verreau, tous de caractère intime et monographique et qui nous remettent vivement et sans déguisement sous les yeux l'état d'âme de nos compatriotes à ce moment.
Les colonies anglaises de l'Amérique du Nord, le Canada excepté, ont résolu de se séparer de l'Angleterre, et, en 1775, dirigent une armée contre Montréal et une autre contre Québec. L'aléa de cette [12] invasion agit à la façon d'un dernier dissolvant sur cette société canadienne dont les pièces, en l'absence de tout lien et de tout pouvoir social fort, ne tiennent que très lâchement l’une et l'autre. Elle se résout en ses groupements originels : les diverses classes se groupent à nouveau suivant les tendances sociales et les intérêts collectifs de chacune d'elles.
On distingue facilement huit groupes au sein de cette masse indécise. Deux de ces groupes ont une attitude plutôt passive, bien que le résultat en définitive dépende d'eux. C'est, au premier chef, le groupe des anciens colons canadiens-français formant le fond de la population rurale ; et, en second lieu, ce sont les Indiens, ceux de l'Ouest, pourvoyeurs de la traite des fourrures, et ceux domiciliés parmi les blancs, entre autres les Iroquois du Sault-Saint-Louis.
Or Canadiens français et Indiens étaient fortement sollicités du côté des Américains par les émissaires du Congrès : soldats français restés après la conquête, Bostonnais que les Iroquois du Sault-Saint-Louis avaient adoptés, et surtout marchands anglais fixés au Canada, en relations suivies avec leurs correspondants de la Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-York.
Pour défendre un immense pays contre les forces supérieures du Congrès américain, le gouverneur Carleton, assisté d'un petit nombre de fonctionnaires civils et militaires, ne dispose que de deux régiments et de quelques canonniers. Mais il espère que la population canadienne lui restera fidèle, et même lui prêtera main-forte pour repousser les envahisseurs. Murray, au moment de la cession, mettait sa confiance plutôt dans l'Habitant et le clergé des campagnes. Carleton, douze ans plus tard, paraît vouloir s'appuyer avant tout sur la noblesse, que, par une loi constitutive de l'année précédente, dite Acte de Québec (1774), il a rétabli ou confirmé, ainsi que le clergé, dans la jouissance de la plupart des privilèges anciens.
N'oublions pas que depuis 1760 Georges III occupe le trône d'Angleterre. A la différence de Georges 1er, qui ne parlait que l'Allemand, et de Georges II, qui parlait fort mal l'anglais, Georges III est franchement anglais de langue et d'éducation, sauf qu'il est bien résolu à reprendre, au profit du souverain, les attributions que lui ont dérobées sous les règnes précédents la Chambre des communes et la bourgeoisie anglaise. La haute aristocratie tory et le clergé anglican, ravis des égards dont ils sont l'objet auprès du nouveau roi, à la suite de l'effacement subi sous les deux règnes précédents, lui donnent un cordial appui. De là un regain de prestige et d'influence pour le pouvoir monarchique et les classes privilégiées.
[13]
Et puis, dans l'intervalle, la gentilhommerie coloniale française s'est aperçue qu'elle n'avait plus guère à faire fond sur la cour de France, et de bonne grâce elle s'est retournée vers les nouveaux gouvernants. Il s'est découvert de grandes affinités entre la classe des militaires et fonctionnaires français et celle des militaires et fonctionnaires anglais. Il se contracte même des alliances matrimoniales entre les deux classes.
Dans ces conditions, la tendance de la gentilhommerie canadienne est de se confondre avec la classe des gouvernants anglais. Mais au fur et à mesure qu'elle cède à cette tendance, elle voit la masse de la population canadienne s'éloigner d'elle, et son action utile au cours de cette période critique en sera grandement entravée. Le zèle outré et malavisé de quelques-uns des jeunes gentilshommes chargés de recruter des soldats ou d'organiser la défense aboutit à des soulèvements que les autorités anglaises doivent s'interposer pour réprimer.
Le clergé canadien, lui aussi, soutient fermement le gouvernement anglais, mais en y mettant plus de tact et de modération que la noblesse. Si, du fait de sa formation française, et encore imprégné des traditions absolutistes du grand règne, le clergé canadien, comme la noblesse, est parfois porté à user largement de procédés autoritaires, le peuple suspecte beaucoup moins les motifs de pasteurs dont les moyens d'existence ne sont pas directement à la merci du pouvoir, et accepte dans un meilleur esprit les injonctions de prêtres respectés dont l'autorité toute morale est dépourvue de la sanction de peines infligées par le pouvoir public. Aussi bien, ce sont les curés, beaucoup mieux que les seigneurs, qui ont retenu le peuple canadien dans les bornes de la neutralité, et même finalement l'ont fait se ranger du côté des gouvernants anglais.
Deux autres classes de la société canadienne ont joué, au cours de cette invasion, un rôle plus effacé, mais qui ne mérite pas moins de nous arrêter, à cause de l'importance que ces classes ont acquise depuis : c'est la classe des marchands canadiens, représentée dans les documents de la collection Verreau par les Guy et les Baby, et ce sont les membres des professions libérales, dont Simon Sanguinet, à Montréal, et Jean-Baptiste Badeaux, à Trois-Rivières, sont d'excellents types. Ils sont franchement du côté des gouvernants anglais et des dirigeants canadiens, et détestent cordialement le parti anglo-américain. Mais ils réservent leur droit de critiquer les gens en place au Canada. Sanguinet, par exemple, avocat de Montréal, ne manque pas une occasion de critiquer le conduite du gouverneur Carleton, de son lieutenant Cramahé, de son brigadier Prescott, comme de la [14] plupart des fonctionnaires, gentilshommes et seigneurs. Il n'épargne guère que le clergé et la classe des marchands canadiens ; il a même des éloges pour celle-ci, qui est aussi un peu la sienne.
* * *
À la suite de cette guerre, et un peu à cause d'elle, il se produit au Canada une sensible modification du régime des classes. Les Américains n'ont pas réussi à s'emparer du Canada, mais du moins ils ont assuré (l'indépendance des États-Unis, et ils sont à l'abri des entreprises de Georges III et de ses fonctionnaires. Ils ont porté un rude coup aux tenants de l'ancien régime autocratique dans le monde entier.
Huit ans après le traité de Versailles, qui consacre la victoire des Américains, l'organisation politique du Canada est remaniée dans le sens populaire. Aux termes de la loi constitutionnelle de 1791, l'ancienne province de Québec est divisée : on aura désormais le Haut et le Bas-Canada, chacun avec sa chambre élective. Par suite de l'établissement du gouvernement représentatif, la situation des fonctionnaires et seigneurs canadiens se trouve diminuée (quelques-uns des gentilshommes s'étaient même ouvertement déclarés hostiles au projet) ; la situation de l'Habitant et de son conseiller, le curé, se trouve grandie dans la mesure correspondante ; et aussi celle des négociants et des membres des professions libérales. Cette dernière classe notamment sera désormais sur le pavois. C'est en se rattachant à elle, et par elle à la politique et au pouvoir, que les derniers descendants de la gentilhommerie conserveront quelque prestige.
C'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Les anciens détenteurs irresponsables du pouvoir vont être graduellement dépouillés de leurs prérogatives au profit de la chambre élective et de son groupe directeur, le cabinet. Mais avant que ce résultat ait été pleinement atteint, près de soixante ans se seront passés.
Léon GÉRIN
de la Société royale.
|

