[145]
Léon GÉRIN
sociologue et économiste canadien-français, 1863-1951
NOTRE MOUVEMENT
INTELLECTUEL
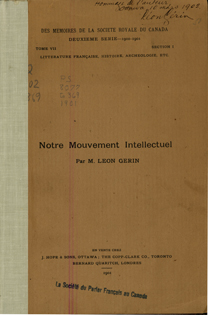
Mémoires de la Société Royale du Canada, deuxième série — 1900-1901, tome VII, section I : Littérature française, histoire, archéologie, etc., pp. 145-172, 1901. (Discours prononcé le 23 mai 1901.)
- I. — Ceux que nous venons de perdre. [145]
- II. — Notre Production récente. [149]
- III. — Nos journaux et nos écoles. [167]
Ne m'en veuillez pas trop, messieurs, de vous infliger ce discours. L'article 16 des statuts de la société royale dit entre autres choses :
Il sera du devoir du président de chaque section de préparer pour la réunion annuelle un discours sur les matières relevant de cette section.
À la lecture de ce règlement très explicite, j'ai pensé que je serais excusable d'inviter mes confrères de la section française à faire avec moi la revue rapide du mouvement intellectuel chez nos compatriotes. Même, je me suis persuadé qu'il y aurait un certain intérêt à nous remémorer les survenances notables de ces derniers temps dans le domaine des lettres, des sciences et des arts, au Canada français ; à dégager les traits saillants de notre production littéraire récente ; enfin à nous rendre compte de la marche du progrès intellectuel au sein de notre classe populaire.
I. — Ceux que nous venons de perdre.

Dans le cours de l'année dernière, la société royale a perdu trois de ses membres : George Mercer Dawson, Félix-Gabriel Marchand, l'abbé Hospice-Anthelme Verreau. Les lettres canadiennes-françaises ont perdu Arthur Buies.
Dawson, géologue, naturaliste, ethnographe, explorateur, n'était pas de notre section ; mais l'éminence de ses talents, l'intérêt général qui s'attache à son œuvre, et le souvenir des bons rapports qu'il m'a été donné d'avoir avec lui en ces dernières années, me font un devoir de mentionner au moins son nom et de lui rendre ce dernier hommage.
Félix-Gabriel Marchand, notaire, journaliste, homme politique, n'écrivit que peu, à de longs intervalles, et pour charmer ses loisirs. Sa psychologie littéraire se dégage nettement des conditions de sa vie sociale et politique ; existence paisible et bien ordonnée, dans une petite ville prospère, carrière faite de faciles succès. Fils d'un commerçant aisé de Saint-Jean d'Iberville, au sein de ce beau pays agricole de la rivière Richelieu, il effectua son entrée dans la vie sous des auspices singulièrement favorables. À la suite d'un cours d'études au collège de Saint-Hyacinthe, il retourna se fixer dans sa ville natale, où bientôt il trouva bonheur, biens et honneurs. Marié à vingt-deux ans (1854), [146] il était admis l’année suivante à l'exercice du notariat. En 1860, il fondait à Saint-Jean un journal politique, le Franco-Canadien. Colonel de milice en 1866, député à la chambre provinciale, 1867, il mettait au jour sa première œuvre littéraire, Fatenville, en 1869, puis Erreur n'est pas compte, trois ans plus tard. Ministre dans le cabinet Joly, en 1878-9, membre de la société Royale, dès l’année de sa fondation, 1882, il écrivait, en 1884, Un bonheur en attire un autre, et l’année suivante, Les faux Brillants. Puis il est président de l’assemblée législative de Québec de 1887 à 1892 ; chef de l'opposition, de 1892 à 1897 ; premier ministre de la province à partir de 1897, et président général de la société Royale, cette même année.
Or, voyez comme la vocation littéraire de Marchand fut favorisée, comme le caractère même de ses écrits fut en grande partie déterminé par les conditions de son milieu et par les influences de sa profession. La petite ville, le centre rural, où ses relations de famille lui faisaient de prime abord une situation assurée, lui donna, en même temps que l'aisance, certains loisirs et la tranquillité que ne lui aurait pas laissés le séjour dans la grande ville. La variété de ses occupations (notariat, journalisme, milice, politique) le mit en rapport constant avec toutes les classes de la société. Dès lors, lorsqu'il voulut écrire, ce fut naturellement pour peindre ces divers types qu'il trouvait sur son passage, qu'il voyait s'agiter devant lui. La forme dramatique qu'il adopta de préférence devait aussi se présenter naturellement à la pensée d'un homme d'action, familiarisé avec les combinaisons et les intrigues de la vie politique. Marchand connaît donc sur le bout du pouce sa société canadienne, et à ses moments de repos, il aime, pour son plaisir et pour l'amusement de ses amis, à la faire parader sous sa plume. Il raille les petits travers et les petits ridicules de cette société, mais il le fait sans amertume. Comme l'écrit très justement M. DeCelles, dans sa préface aux œuvres de Marchand : "Un souffle élevé traverse toutes ces pages qui témoignent d'une conception bienveillante de notre société et de ses travers, raillée avec une verve doucement ironique. On y chercherait en vain ces coups de fouet sanglants qui tombent impitoyables." En effet, la satire de Marchand n'est pas méchante ; il se moque sans déchirer, comme il convient chez un homme pour qui la vie a été douce.
Notez le contraste avec Buies. Celui-ci encore au berceau a été assailli par des malheurs de famille qui ont aigri sa jeune âme et frappé son tempérament d'un cachet indélébile. Au collège même il se signale par son humeur fantasque, son esprit réfractaire à toute discipline. Il va terminer ses études en France ; il s'enrôle quelque temps à la suite de Garibaldi, et c'est au contact de la jeunesse des écoles de [147] Paris, et plus tard à celui des "chemises rouges", que se complète sa formation.
Intellectuel doublé d'un condottiere, ce grand garçon à la chevelure ondoyante, à l'œil embrasé, revient au Canada, y lance un petit journal, la Lanterne, et pendant quelques mois (1868-9) crible de traits acérés les usages, les croyances, les institutions, la hiérarchie religieuse, de son pays. Dans les années suivantes, revenu quelque peu de son ardeur première, il fait paraître des chroniques, d'un esprit moins mordant et moins frondeur, pétillantes de verve et brillantes de style. Marchand fut avant tout homme de profession et homme politique ; il ne fut écrivain que par occasion et par surcroît. Buies, au contraire, sacrifia tout aux lettres ; il voulut se faire une carrière de la littérature. Au Canada, c'était se condamner d'avance à la misère. À ce régime, ce fils de Voltaire et de Murger, égaré sur les bords du Saint-Laurent, devint un écrivain de race ; il acquit un brio et une touche qui manquent à la plupart de nos hommes de lettres, mais ce fut au prix de son bien-être matériel : il resta désespérément bohème.
Buies n'eut pas, seulement la veine légère et satirique ; il eut aussi une veine sérieuse. Dès 1874, entre deux volumes de chroniques, il donne une conférence sur une entreprise de chemin de fer. Dans les années suivantes, il traite devant des auditoires québécois ou montréalais de la Presse canadienne-française, des Améliorations de Québec, de l’Ancien et du Futur Québec, de la Question franco-canadienne. À partir de 1880, il met au jour une série d'ouvrages descriptifs des pays de colonisation de la province de Québec, Le Saguenay et la Vallée du lac Saint-Jean, L’Ottawa supérieur, Le Portique des Laurentides. On y trouve de fort beaux tableaux, des descriptions tracées de main de maître, au cours desquelles, l'esprit satirique et léger des anciens jours éclate parfois inopinément. Ses derniers ouvrages sur La Province de Québec et sur Les Animaux à fourrure et les Poissons du Canada, furent préparés à la demande de nos gouvernements, à l'occasion de l'Exposition de Paris.
Entretemps, Buies, sous l'égide du brave curé Labelle, s'était réconcilié tant bien que mal avec les autorités religieuses et l’ordre social. Il s'était marié, même était devenu fonctionnaire ; et c'est à la manière du commun des bourgeois que s'est éteint notre Paul-Louis Courier, notre Rochefort canadien. [1]
L'abbé Verreau nous présente un troisième type différent à la fois de Buies et de Marchand. Il n'est pas tant écrivain (il a très peu [148] publié) que chercheur consciencieux, passionné de notre histoire. Nous lui devons la publication d'un volume de pièces relatives à l’Invasion du Canada, en 1775 (comprenant le Journal de Sanguinet, le Mémoire de Badeaux, des extraits du Mémoire de Berthelot, le mémoire de Lorimier, Mes Services ; enfin une collection de lettres écrites pendant l'invasion américaine). Nous avons, en outre, de lui un rapport assez étendu sur les archives européennes relatives au Canada, des annotations à diverses publications de la société Historique de Montréal, quelque dix ou douze articles sur des sujets d'histoire, parus dans la Revue de Montréal, le Journal de l'Instruction publique et les Mémoires de la société Royale.
C'est assez peu, si l'on considère la grande réputation de l'auteur et son incontestable érudition en matière d'histoire du Canada. Le cas de l'abbé Verreau est assez semblable à celui de nombre d'hommes de lettres en ce pays, détournés de la poursuite de leurs études de prédilection par les exigences de la vie pratique, empêchés par le travail professionnel de donner à leur œuvre le développement et la perfection qu'ils avaient rêvés pour elle. Il écrivait en 1873 : "Il y aura bientôt dix ans que les premières pages de cette collection (L’Invasion du Canada) ont été imprimées. Il serait peu intéressant pour le lecteur de connaître toutes les raisons qui peuvent justifier ce retard. La principale est que je n'ai pu économiser sur mes heures de repos assez de temps pour terminer mon travail tel que je l'avais compris. Placé à la tête d'une institution importante, chargé à la fois de la direction et d'une partie de l'enseignement, je n'avais pas la liberté de disposer de tous mes instants, même dans l'intérêt de la science……... Que les personnes étrangères à ces sortes de travaux ne soupçonnent pas toujours combien ils demandent de temps, on ne saurait en être très surpris. Ce qui étonne, c'est de voir que ceux dont les talents et les connaissances pourraient être utiles à notre histoire, sont les premiers à s'excuser sur leurs occupations pour ne rien faire. Cependant, ils blâment vivement ce qu'ils appellent les lenteurs de leurs confrères qui ont au moins le mérite de consacrer leurs rares loisirs à faire quelque chose."
Ceux d'entre nous qui ont éprouvé la chaleur du jour comprendront toute la tristesse de cette plainte. Certes, libéré de ses fonctions d'éducateur et de la préoccupation absorbante de son école normale, l'abbé Verreau nous eût laissé bien d'autres monuments de son labeur et de son érudition. S'il a été empêché de le faire, ne le regrettons qu'à demi, puisque c'est au profit du développement de l'instruction publique que son activité a été ainsi détournée.
[149]
II. — Notre Production récente.

"Suivant le proverbe, il est bon de savoir ce qui se passe sur le versant opposé de la montagne", me disait l'autre jour mon ami l'astronome Otto Klotz, bibliothécaire de l'Ottawa Literary and Scientific Society, grand apôtre de la fraternité des hommes de lettres. Le proverbe et M. Klotz ont raison : en général nous nous tenons trop renfermés dans nos propres conceptions, dans notre propre spécialité littéraire ou scientifique. Nous voudrions que l'univers entier s'intéressât à notre œuvre, et nous dédaignons de connaître ce que pense et ce qu'élabore notre confrère d'à côté. L'avantage d'une société comme la nôtre est précisément de nous forcer en quelque sorte à sortir de notre coquille pour nous promener quelques instants dans le jardin du voisin.
Je suis donc allé voir ce qui se passait sur l'autre versant de la montagne, et j'en reviens un peu fatigué peut-être (car la course a été plus longue que je ne m'étais attendu), mais, en somme, enchanté de mon voyage. Sans doute, je n'ai pas tout vu ; encore moins ai-je la prétention de parler savamment de tout ce que j'ai vu. Mais ce que je vais dire aura au moins le mérite de la franchise ; et si l'on me trouve par trop incomplet dans mes renseignements, ou injuste dans mes appréciations, mes successeurs à la présidence de la section, seront à même de combler les lacunes ou de corriger les jugements.
Savez-vous bien que depuis un an ou deux nos compatriotes ont mis au jour près de cent écrits (volumes, articles ou pièces de quelque importance) ?
Poètes. — La muse des aînés de nos bardes a été presque silencieuse : LeMay, Fréchette, Poisson, Beauchemin, Tremblay, Chapman n'ont publié que des fragments, des morceaux détachés. Mais une nouvelle génération de poètes a surgi. A l'École littéraire de Montréal, sous la présidence de M. Wilfrid Larose, quelques jeunes ont affirmé leur réputation, d'autres ont révélé leur talent poétique. Le volume paru sous les auspices de la société, Les Soirées du Château de Ramezay, ne manque pas d'intérêt. Outre le troisième acte d'un drame en préparation de M. Louis Fréchette, Veronica, on y trouve plusieurs morceaux de M. Gonzalve Desaulniers, entre autres, La Fille des Bois, Le Roc percé, Les Pins, La Chevrette. M. Desaulniers s'attache surtout à nous peindre la nature sauvage, à nous entretenir des grands bois et de leurs habitants, bêtes ou humains. Il se complaît dans le genre descriptif et y excelle.
Charles Gill, peintre doublé d'un poète, est plutôt lyrique. L'Aiglon et Stances aux Étoiles sont à mon sens de fort belles pièces. Hector
[150]
Demers affectionne le genre dramatique et sonne haut la note de patrie. Albert Ferland se distingue par un sentimentalisme amoureux qui, assez curieusement, paraît s'inspirer à des sources bibliques et religieuses. Outre les pièces contenues dans Les Soirées du Château de Ramezay, nous avons eu de lui, en 1899, Femmes Rêvées, une jolie toute petite plaquette, avec illustrations de Georges Delfausse et préface de M. Louis Fréchette. Les principales pièces sont intitulées : Litanies de la Femme, Chants d’Amour, tirés du Cantique des Cantiques, Préceptes de l’Amour (imité des Commandements).
Dans Les Soirées du Château de Ramezay, l'effusion sentimentale et galante est en évidence chez Massicotte, Bussières, A. Pelletier, Trémaudan. La tristesse domine chez Jean Charbonneau, Henri Desjardins et souvent chez Émile Nelligan. Germain Beaulieu et Albert Lozeau peuvent difficilement se caractériser d'après les quelques extraits que nous en avons ; mais le genre descriptif semble les attirer davantage. M. Massicotte et M. Beaulieu ont le goût des sciences naturelles ; espérons qu'à leur sensibilité de poète joignant l'exacte observation du naturaliste, ils nous reviendront un de ces jours avec un riche butin de choses charmantes et vraies, saisies sur le vif, volées à la nature.
On voit que le culte des muses a encore ses fervents parmi nous. S'il m'était permis de donner un conseil à nos jeunes poètes, je leur dirais : Un peu moins de sentimentalité, s'il vous plaît ; un peu moins de tristesse ; moins de misanthropie, moins de ces tirades contre le sort et contre l'humanité. Il n'y a pas de carrière pour le poète au Canada, et il serait cruel de nourrir vos illusions à cet égard. Mais si vous avez résolu de chanter quand même, alors ne vous faites pas l'écho des décadences d'outre-mer. Soyez Canadiens et soyez vous-mêmes. Parlez-nous de notre pays, de sa grande nature, de sa flore, de sa faune, de ses groupements humains, de sa vie sociale. Observez, apprenez à voir toutes ces choses à travers votre propre tempérament et non pas à travers la mentalité des maîtres que vous admirez. Et puis, que vos vers ne distillent jamais ni la mollesse ni la désespérance ; qu'ils stimulent le courage, qu'ils éveillent l'initiative ; exaltez la noblesse du travail libre et intelligent. Nous avons eu des poètes qui ont chanté les gloires du passé ; vous, préparez l'avenir. Soyez les bardes d'une race jeune et fière marchant à la conquête du sol, des industries, de l’éminence sociale.
Conteurs et Romanciers. — Il a paru quelques volumes de contes : La Noël au Canada, par M. Louis Fréchette ; La Chasse-galerie et autres contes, par M. Honoré Beaugrand ; Contes vrais, par M. Pamphile LeMay ; Carabinades, par le docteur Choquette. En ces dernières années, notre poète lauréat a presque délaissé les vers pour la prose, et autour de la fête de Noël, il vient de grouper quelques-uns de ses récits [151] caractéristiques du Canada français. En des pages très vécues et souvent pathétiques, il nous transporte des plaines froides et neigeuses du grand Ouest, au foyer de l'artiste urbain, de la chaumière du rude paysan de la montagne à la cambuse du batelier laurentien, ou encore au chantier du bûcheron de l'Ottawa ou de la Gatineau. M. Fréchette, dans La Tête à Pitre, Tom Caribou, Titange, Le Loup-garou ; M. Beaugrand, dans La Chasse-galerie, Le Loup-garou, La Bête à grand'queue, savent revêtir d'un attrait particulier les histoires de "voyageurs", les légendes, les vieilles superstitions de nos gens. L'un et l'autre écrivent surtout pour le grand public des villes. Leurs volumes d'une belle typographie, éditions de luxe, destinées à figurer sur la table du salon, ont paru simultanément en anglais et en français. Ils feront les délices des compatriotes du docteur Drummond, comme aussi les nôtres.
M. LeMay est différent. Comme M. Fréchette il a déserté les vers pour le conte en prose. Mais ses Contes vrais, d'un apprêt plus modeste que les collections précédentes, paraissent bien par le ton et la substance s'adresser plutôt à l'habitant de la campagne. Le May a moins d'art que Fréchette : il s'attache moins que celui-ci à reproduire exactement les expressions pittoresques, les conceptions originales de l'homme du peuple. Mais d'autre part, il met dans ses récits plus de lui-même ; et maintes fois, il interrompt ses histoires de revenants pour dogmatiser à la manière d'un théologien ou pour moraliser à la façon d'un bon vieux curé. Nous devons nous féliciter de ce que des écrivains de talent se soient ainsi appliqués à nous conserver la mémoire de croyances populaires et de types sociaux, produits d'un autre âge et d'un autre milieu, et que les conditions nouvelles ont déjà presque fait disparaître.
Trois romans à signaler : L'Oublié, par Laure Conan, en cours de publication dans la Revue canadienne ; Claude Paysan, par le docteur Choquette, avec illustrations par Leduc ; Florence, par M. Rodolphe Girard, avec illustrations par Delfausse. L'Oublié, c'est Lambert Closse, un héros des commencements de Montréal. On sait le charme pénétrant qui s'attache à cette colonie de Villemarie, poussée en pleine nature sauvage sous la chaude inspiration d'âmes pieuses et de généreux fondateurs, la Dauversière, le baron de Fancamp, Olier, Mme de Bullion ; et avec l'aide d'hommes et de femmes aux larges dévouements et aux aptitudes les plus variées : Maisonneuve, Jeanne Mance, d'Ailleboust, Marguerite Bourgeoys. Mais le charme natif de cette épopée coloniale s'intensifie dans le livre de Mlle Angers de toute l'exquise sensibilité féminine et religieuse de l'auteur, de l'ardeur de son âme française, de son habileté d'écrivain. La vérité historique y est respectée ; l'annaliste méticuleux trouverait peu de chose, je pense, à relever dans ces pages ; mérite rare dans les ouvrages de cette nature.
[152]
Le docteur Choquette, qui avait écrit précédemment Les Ribaud, épisode de 1837, nous a donné Claude Paysan. L'auteur a quelque chose d'Alphonse Daudet, dont il évoque la mémoire dans sa dédicace ; et Claude Paysan rappelle à certains égards Fromont jeune et Risler aîné, la première manière du romancier français. L'un, drame navrant de la bourgeoisie parisienne ; l'autre drame tout aussi navrant de la campagne canadienne-française. Claude Paysan est un jeune cultivateur pauvre, de Saint-Hilaire, épris de Fernande Tissot, fille d'un bourgeois de Montréal dont la famille vient chaque été en villégiature sur les bords de la rivière Richelieu. Socialement un abîme sépare les deux jeunes gens, et le malheureux Claude se consume dans son amour. Toute la trame du livre consiste dans les phases de ce désespoir amoureux, présentées par le menu en une succession de petits tableaux, écrits d'un style charmant, mais dont la tristesse finit par nous paraître monotone. L'histoire qui s'est ouverte sur la mort foudroyante du père de Claude, se termine par le martyre de Fernande, atteinte de phtisie, et par le suicide tragique de Claude. J'aurais préféré autre chose.
J'aurais aimé voir Claude, sous l'aiguillon de cette passion ambitieuse, cherchant à s'élever dans son métier, réformant ses méthodes de culture, arrondissant sa terre, puis au contact du père Tissot, acquérant peu à peu le sens des affaires, se faisant petit à petit une situation maîtresse sur son domaine, et finalement épousant Fernande, mais dans des conditions de parfaite égalité. Et d'autre part, j'aurais aimé voir Fernande dans sa nouvelle vie, cessant bientôt d'être cette petite femme frêle et "bonne à rien du tout", introduisant au foyer de Claude ces habitudes de confort, ces pratiques d'hygiène, cette culture intellectuelle, qui sont si souvent absentes, ou négligée chez l' "habitant" même aisé. Il y aurait eu là un précieux enseignement pour notre société canadienne-française, avec sa classe rurale trop insouciante et routinière, et sa classe dirigeante entièrement détachée de la pratique des arts usuels.
Pour échapper sans doute à la tristesse obsédante de Claude Paysan, le docteur Choquette a écrit les Carabinades, un joli recueil de contes "pour lire, la nuit, en attendant les sauvages". Histoires de carabins et de médecins, comme on en pourra juger par quelques-uns des titres : le lit n° 88 ; mes disséqués ; 'premiers cas ; souvenir d'hôpital ; une drôle d'opération ; vengeance de carabin, etc. Le livre commence par une pièce de vers du docteur Drummond The Country Doctor, dans le genre connu de l'auteur de The Habitant, et il se termine par une post-face de la plume du docteur Nérée Beauchemin. Si Claude Paysan est triste, les Carabinades, lorsqu'elles ne tombent pas dans le genre naturaliste ou macabre, sont gaies, très gaies même, d'une gaieté à faire rougir parfois les jeunes filles. Au reste, bien enlevées, ces histoires.
[153]
Florence, drame qui se déroule .au Canada en 1837, et que son auteur qualifie de "légende historique, patriotique et nationale". M. Girard est encore "à l'âge des fleurs ; à peine compte-t-il vingt printemps", écrit dans la préface, M. Firmin Picard, qui lui-même nous paraît être excessivement jeune. La jeunesse de M. Girard se trahit par l'exubérance du style, comme aussi parfois par l'exagération des idées. Dans son récit, le ciel n'est jamais bleu : il est "cobalt", ou bien il est "indigo" ; il n'est jamais couvert ou sombre : il est "manganèse". L'héroïne, Florence, a le front " poli comme un marbre de Carrare ", les cheveux d'un "blond fauve", des yeux "violets qui tournent au gris" et qui parfois ont "la transparence des ondes crystallines du ruisseau reflétant le sombre feuillage de la rive"…...Quant au héros, Hubert Rolette, il se meut "avec la rapidité du cerf qui franchit les montagnes poursuivi par le trait du chasseur". Il arrive invariablement juste à point pour arracher Florence de l'étreinte d'infâmes ravisseurs ou pour sauver le père de Florence d'une mort certaine. Il n'aime pas les Anglais et il les accable d'injures. Il nous représente "le lion britannique se vautrant continuellement dans le sang de l'humanité qui crie vengeance"……. "L'Angleterre a pris naissance dans le sang intoxiqué et la bave immonde de l'ange que Jehova d'un regard précipita dans l'abîme." Et cela encore est bien pâle à côté de l'imprécation que le vieux Drusac lance sur la tombe de Florence et de Rolette. D'autre part, il faut noter certaines qualités réelles. Le langage est correct, l'action bien conçue et rondement menée, et certains passages témoignent d'une fine observation.
Chroniqueurs et Conférenciers. — M. Ludovic Brunet a réuni en un volume les écrits de son ami Edmond Paré, avocat et journaliste de Québec, décédé il y a peu d'années à l'âge de quarante ans. Ces écrits consistent en quelques compositions de collège reproduites dans l’Abeille du séminaire de Québec, en quelques lettres écrites de Paris, et en une série de chroniques et de boutades parues dans l’Union libérale. Ils se font remarquer par la correction du langage, la vivacité du style, beaucoup d'esprit d'observation, joint à beaucoup d'ironie et parfois de verve satirique. Avec un peu plus de temps à lui, Paré aurait fini peut-être par écrire son nom à la suite de nos chroniqueurs de la première génération, Hector Fabre, Évariste Gélinas, Arthur Buies. "Son érudition littéraire, écrit M. Brunet, était énorme. Il n'y a pas un bouquin de nos bibliothèques publiques qu'il ne connût pas. Il pensait qu'un homme de lettres devait être au moins doublé d'un savant. Aussi ses lectures étaient-elles des plus variées." Bien que son penchant fût plutôt pour la littérature d'imagination, "Vico, Herbert Spencer, Figuier, Renan, Bacon, Joseph de Maistre, Macaulay, Augustin Thierry, Taine, [154] semblaient parfois être ses auteurs favoris". Ce grand liseur était atteint "d'un scepticisme qu'il ne cachait pas". C'était "une nature essentiellement française, ou plutôt parisienne ; vivre de la vie de Paris était son rêve continuel. Il en parlait presque tous les jours, et quelques mois avant de mourir, il faisait le projet d'un long séjour en France." Lui-même dans une de ses chroniques a écrit "que la campagne n'est agréable que pour un jour ou deux ; plus longtemps elle est royalement ennuyeuse".
Cette psychologie d'Edmond Paré est intéressante en ce qu'elle nous signale un état d'âme assez commun chez notre jeunesse lettrée. Il est malheureusement vrai que chez nous la haute culture intellectuelle n'a pas pour résultat ordinaire la formation d'hommes de fortes convictions et de grande force de caractère. Chose déplorable particulièrement en un pays encore neuf, où la masse est peu adonnée aux choses de l'esprit, les études chez nos sujets les plus remarquables aboutissent bien souvent au dilettantisme, sinon à la neurasthénie intellectuelle et morale. La faute n'en est-elle pas, pour une part du moins, à notre système d'éducation ? N'avons-nous pas trop développé le côté littéraire, sentimental, artistique, historique et abstrait de l'enseignement, au détriment de son côté scientifique, moral et positif ? Le produit d'un tel enseignement n'est-il pas, de toute nécessité, une classe d'intellectuels brillants plutôt que sérieux, attirés vers les villes par leur besoin de sociabilité, de jouissances littéraires et artistiques ; absorbés dans la contemplation du passé, mais désintéressés du présent et insouciants de l'avenir ? En d'autres termes, étant donné le caractère actuel de l'enseignement, ne devons-nous pas nous attendre, à mesure que nos rapports avec les grands centres de culture intellectuelle de l'Europe deviendront plus intimes, à voir beaucoup de nos jeunes gens donner dans le dilettantisme, se mandariniser ? Ne serait-il pas sage de notre part de prévenir ce danger en développant le côté positif et pratique de l'enseignement ?
Les conférences données à Québec, l'hiver dernier, sous les auspices de l'université Laval, ont été publiées et forment un volume de 400 pages. Des treize conférences que renferme la collection, il n'en est que deux dont le sujet soit à proprement parler littéraire. L'une est de M. Thomas Chapais et a pour titre Sur les Chemins de la Croyance. Il s'agit du retour à l'Église du poète François Coppée, et de l'adhésion donnée, ces années dernières, aux doctrines catholiques par le directeur de la Revue des deux Mondes, M. Ferdinand Brunetière. Mais à propos de la conversion de ces écrivains, le conférencier nous parle de leur œuvre, et même il nous met sous les yeux certains aspects du mouvement littéraire moderne en France. Comme d'habitude il nous captive et nous [155] entraîne. Les citations tirées de la polémique de Brunetière avec Jules Lemaître, des critiques d'Émile Faguet, des morceaux choisis de Coppée, sont bien amenées et intéressantes. M. Chapais il y a deux ans a publié un volume de Discours et Conférences, pièces toutes vibrantes d'inspiration chrétienne et nationale. Dans la Revue canadienne, il fait chaque mois la chronique des événements politiques et religieux. Il est le porte-voix sympathique et distingué de l'idée religieuse et patriotique sous la forme un peu exclusive et communautaire qu'elle affectionne dans notre province.
La même série de Conférences de l'université Laval renferme un travail intéressant de M. Adjutor Rivard, professeur d'élocution à la faculté des arts, Du Rythme dans la Langue française.
J'ai passé quelques heures agréables à lire le volume des Conférences et Discours de M. l'abbé Gustave Bourassa. Petit-fils du grand Papineau, fils de l'artiste distingué qui décora nos sanctuaires et composa Jacques et Marie, frère du brillant député de Labelle, M. l'abbé Bourassa est d'une famille où l'on manie avec charme et dextérité la parole et le pinceau, l'ébauchoir et la plume. Dans son livre de plus de 300 pages, l'auteur traite d'un style toujours alerte les sujets les plus divers. On y trouve de simples sermons (Panégyrique de sainte Cécile, Sainte Anne modèle d'Humilité, etc.), à la suite d'études sociales (Les Corporations ouvrières en France au Moyen Âge, L'Écolier chrétien), et d'études historiques (Mme Gamelin, etc.) ; des sujets surtout littéraires comme La Jeunesse de Montalembert, L'Hôtel de Rambouillet, Les Fables de La Fontaine, à côté de morceaux patriotiques, comme M. Chauveau et l’Idée nationale. Au reste, l'idée de race et de religion surgit à presque toutes les pages ; comme chez M. Chapais, elle est persistante, dominante. En ces derniers temps, M. l'abbé Bourassa s'est adonné plus particulièrement à des travaux d'apologétique.
En mars dernier, M. Jules Tardivel, directeur de la Vérité, auteur de La Situation religieuse aux États-Unis et du roman Pour la Patrie, a lu devant l'Union Catholique de Montréal une conférence, reproduite dans la Revue canadienne et publiée depuis en brochure sur la Langue française au Canada. L'auteur exploite, en y ajoutant quelque peu, le fonds de renseignements contenus dans les ouvrages antérieurs sur la question. Après M. Sulte, il fait l'historique des circonstances qui permirent à la langue française de se maintenir dans la province de Québec à la suite de la cession du Canada à l'Angleterre. Comme M. Sulte, il s'applique à démontrer que la langue française telle qu'on la parle au Canada n'est pas un patois. Il y a quelques années, M. l'abbé Casgrain exhumait la vieille grammaire française de Restaut, pour établir que la prononciation de nos campagnards est celle qui était [156] en usage dans la bonne société française du dix-huitième siècle. M. Tardivel corrobore cette opinion au moyen de citations de ce même Restaut et d'autres grammairiens de l'époque, Buffier, Mauvillon. Il donne d'intéressants extraits du glossaire du Centre de la France, préparé par le comte Jaubert. Ce glossaire renferme de nombreuses expressions canadiennes. L'Habitant n'a ajouté au vieux langage français qu'un petit nombre de locutions de son cru, et celles-là toutes très relevées. M. Tardivel est d'opinion que c'est le langage des Canadiens-français instruits qui laisse le plus à désirer, en ce sens qu'il est plus mêlé d'anglicismes ; et il nous exhorte en terminant à éviter les tournures de phrases anglaises et l'emploi fautif de mots français dans le sens de mots semblables de la langue anglaise.
Légendaires et Descriptifs. — Plaçons ici trois ouvrages d'un caractère mixte, c'est-à-dire, par la forme et par le fond, littéraires autant qu'historiques ; les Trois Légendes de Mme Sainte Anne, par notre collègue, le P. Charland, de l'ordre des frères prêcheurs ; en second lieu Noëls anciens de la Nouvelle-France, par M. Ernest Myrand ; et en troisième lieu, Québec et Lévis à l’Aurore du vingtième Siècle, par M. Routhier. M. Myrand avait déjà fait paraître plusieurs ouvrages, notamment, Une Fête de Noël sous Jacques Cartier, et Sir William Phipps devant Québec. Imaginatif, enthousiaste, il s'attache surtout à mettre en relief le côté romantique et pittoresque de notre histoire. Son dernier volume n'est pas un simple recueil de cantiques anciens (paroles et musique) ; l'érudition historique, la critique littéraire et musicale y tiennent beaucoup de place, présentées en un style toujours vivant et parfois très vif.
Québec et Lévis à l’Aurore du vingtième Siècle, grand ouvrage descriptif et historique, sorti des ateliers de la maison Desbarats, à laquelle nous sommes redevables déjà de fort belles éditions d'ouvrages canadiens. L'exécution typographique et artistique de l'ouvrage est excellente, et tout en parcourant ces belles pages ornées de gravures très nettes, on se demande comment il a été possible, dans notre coin d'Amérique, de mettre au jour dans des conditions payantes un livre d'aussi grand luxe en langue française. Hélas, la réponse ne se fait pas attendre : elle se trouve dans la dernière partie du volume, dans cette série de Biographies et Monographies, où s'étale le procédé yankee du portrait et de la notice. Et c'est ainsi qu'on voit figurer à la suite des gloires idéalisées de la Nouvelle-France, en la compagnie de notabilités de la vieille cité de Champlain, des personnages dont le mérite (réel dans certains cas) est d'un ordre surtout pécuniaire. Le mélange est trop disparate pour ne pas froisser le sens de la convenance littéraire et artistique, et nous en voulons à l'éditeur de nous faire ainsi brutalement sortir de notre rêve.
[157]
Dans la Revue canadienne de décembre dernier, M. DeCelles a signalé en termes élogieux l'apparition de cet ouvrage et rendu hommage au talent de M. Routhier. [2]
Dans la publication officielle Les Femmes du Canada préparée à l'occasion de l'exposition de Paris, je trouve une étude mi-littéraire, mi-historique intitulée Les Femmes canadiennes dans la Littérature. L'auteur en est Mlle Barry, mieux connue sous le nom de "Françoise", dont elle a signé tant de charmantes chroniques.
Historiens. — Les écrits historiques proprement dits ont été très nombreux, à tel point qu'il va falloir dans la plupart des cas me borner à une simple mention : généalogies, histoires de famille, histoires de paroisses, de seigneuries, de comtés, de diocèses, contributions à l'histoire littéraire, professionnelle, militaire, et surtout à l'histoire religieuse et politique de la Nouvelle-France et du Canada français.
Ce goût prononcé que nous avons pour la généalogie, l'histoire de famille, est bien caractéristique de notre formation sociale, quasi patriarcaux invétérés que nous sommes. M. Ernest Gagnon, de Québec, publiait il y a deux ans, une notice sur sa famille, issue de l'aîné de ces trois frères qui dès avant 1640 vinrent de la petite province française du Perche se fixer à la côte de Beaupré, et dont les descendants se sont répandus par tout le Canada.
Notre collègue M. Joseph-Edmond Roy, qui en 1897 avait donné Nicolas LeRoy et ses Descendants, publiait deux ans plus tard l'histoire de La Famille de René de La Voye (ancêtre de l'auteur du côté maternel). Dans cette monographie de famille tirée à cent exemplaires seulement, on pourrait s'attendre à ne trouver qu'un simple enchaînement de noms et de dates, sans intérêt pour d'autres que les membres de cette famille. Mais M. Roy y a semé à pleines mains les renseignements historiques. À propos des incidents de la vie de l'un ou de l'autre de ses ancêtres, il nous met sous les yeux un inventaire très curieux de la première moitié du dix-huitième siècle ; il nous parle savamment des établissements de la côte de Beaupré et des seigneuries du bas du fleuve (Rimouski, Métis, LaMolaye) ; il décrit les moyens d'existence des populations riveraines, pêche aux marsouins, fabrication du goudron ; enfin il fait connaître les conditions de vie des pilotes dans les deux derniers siècles et le mouvement de la navigation au commencement du dix-neuvième siècle.
M. François Lesieur-Desaulniers, ancien député de Saint-Maurice, a occupé ses loisirs, ces années dernières, à compulser les archives de sa paroisse natale en vue de reconstituer la lignée des principales familles. Tanguay au petit pied, il a repris en sous-œuvre pour ce qui [158] regarde Yamachiche, les recherches nécessairement incomplètes de notre vénérable collègue. Le premier volume des Généalogies des Familles d'Yamachiche a paru en 1898, précédé d'une pièce de vers du poète local, M. Nérée Beauchemin, et d'une introduction de M. Eaphaël Bellemare. Le deuxième volume a paru l’année suivante, avec introductions de M. Raphaël Bellemare et de M. Benjamin Sulte. Enfin, le troisième volume vient de paraître, avec préface de M. Omer Héroux. En tout plus de 800 pages de texte, donnant la généalogie de quelque trente familles souches, avec portraits. [3]
La liste, déjà longue des Histoires de paroisses, s'est augmentée de quelques nouveaux noms. Après l’Histoire du Sault-au-Récollet, publiée en 1898, par M. l'abbé C.-P. Beaubien (bel octavo de 500 pages), nous avons eu l’Histoire du Cap-Santé, par l'abbé F.-X. Gatien, continuée jusqu'à nos jours par M. l'abbé David Gosselin ; l’Histoire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, par notre collègue, le docteur Dionne ; l’Histoire de Sainte-Anne-des-Plaines, par M. l'abbé Dugas ; l’Histoire de Saint-Luc, suivie de l'histoire de la famille Moreau, par M. l'abbé S.-A. Moreau. [4]
L'histoire de Sainte-Anne-des-Plaines, paroisse du voisinage de Montréal, peuplée en grande partie par des émigrants détachés du groupe vigoureux des colons percherons et normands de la côte de Beaupré, proche Québec, nous fournit une nouvelle preuve de la force d'expansion de ce groupe et de son importance fondamentale dans le peuplement de la colonie. L'ouvrage de l'abbé Dugas mentionne, mais d'une manière trop succincte, la carrière de cet homme remarquable, l'abbé Louis Le Page, fils d'un seigneur du bas Saint-Laurent, lui-même seigneur de Terrebonne, fondateur de paroisse, chef d'industrie et de colonisation L'Histoire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière contient des renseignements curieux sur les commencements du collège fondé par l'initiative de M. Painchaud. Mais en somme toutes ces histoires ont un grave défaut : elles se confinent trop exclusivement dans l'histoire religieuse de la paroisse. Le côté agricole, industriel, économique, social est oublié ou négligé.
[159]
Vers le même temps où je donnais à la Literary and Scientific Society, d'Ottawa, et à la British Association for the Advancement of Science, la monographie sociale du Huron de Lorette [5] et où je publiais dans le dernier volume des Mémoires de la société Royale, une étude sur la Seigneurie de Sillery et les Hurons de Lorette, M. l'abbé Saint-G. Lindsay commençait dans la Revue canadienne, une série d'articles sur Notre-Dame-de-Lorette en la Nouvelle-France. Des pièces historiques anciennes y sont reproduites et nombre de faits intéressants y sont mis au jour.
Voici maintenant de la plume de M l'abbé Leleu, l’Histoire de Notre-Dame-de-Bonsecours, l'histoire d'un vieux sanctuaire de Montréal. Beaucoup trouveront que le surnaturel y entre trop souvent en jeu. Une œuvre plus considérable et d'un caractère plus positif, c'est l’Histoire ecclésiastique du Diocèse d'Ottawa, par le P. Alexis, de Barbezieux, publiée sous les auspices de l'archevêché. L'auteur, capucin de la maison d'Ottawa, esprit cultivé, chez qui les voyages lointains ont développé le talent d'observation, a eu en outre l'occasion de visiter la plupart des endroits dont il parle. Aussi trouve-t-on dans ces deux volumes, un peu arides dans l'ensemble et hâtivement écrits, des pages d'un intérêt réel, qui nous donnent au moins un aperçu de la nature des divers milieux physiques, de la condition sociale des divers groupes, du mouvement de la colonisation dans les diverses parties du diocèse. Pour l'exposé historique général qui commence le livre, l'auteur a eu l'avantage de pouvoir puiser dans le bagage des notes manuscrites de M. Sulte.
Le Diocèse de Montréal à la Fin du dix-neuvième Siècle, ouvrage
publié avec l'approbation de Mgr Bruchesi, et "renfermant de nombreux portraits du clergé, héliogravures et notices historiques des églises et presbytères, institutions d'éducation et de charité, sociétés de bienfaisance, œuvres de fabriques et commissions scolaires", volume de 800 pages, précédé d'une préface de M. Raphaël Bellemare. Un album de photographies, une collection de matériaux, plutôt qu'un livre dans le sens littéraire du mot.
Mme Jetté consacre un in-12 de 450 pages à la mémoire de la Mère d'Youville, fondatrice des sœurs Grises de Montréal ; et un volume d'égale importance, avec préface de M. l'abbé Bourassa, est consacré par une religieuse de son institut à la Mère Gamelin, fondatrice des sœurs de Charité de la Providence. Notons aussi, dans la Revue canadienne de 1899, 1900 et 1901, une série d'articles anonymes donnant l'histoire intéressante de la fondation de l'Hôpital général de Saint-Boniface en 1844 ; l'apparition du troisième volume de l’Histoire des Ursulines de [160] Trois-Rivières, par une religieuse de la communauté, et la publication d’une Petite Histoire populaire de l’Église au Canada, par M. l'abbé David Gosselin.
Dans le livre des Femmes du Canada, Mme Jette a fait L'historique des institutions de charité et des confréries religieuses ; Mlle Angers, celui de nos communautés enseignantes de femmes.
Mais l'historiographe en chef de l'Église du Canada, c'est sans contredit notre collègue, M. l'abbé Auguste Gosselin. Chaque année il s'enfonce pour un temps dans les archives de M. Brymner à Ottawa, ou dans celles de l'archevêché de Québec, et il en sort avec les matériaux d'un nouveau livre ou d'une nouvelle étude. Il traite ses sujets avec une largeur de vues et un franc-parler qu'on ne rencontre pas toujours dans les ouvrages de cette sorte. L'auteur de la Vie de Mgr de Laval, de Mgr de Saint-Vallier et son Temps et du P. de Bonnécamps, nous a donné, ces années dernières, Québec en 1730, Le Clergé canadien et la Déclaration de 1732 (articles parus dans les Mémoires de notre société), ainsi que deux conférences à l'université Laval de Québec, publiées dans le volume mentionné plus haut, l'une sur Bonaparte et Pie VII, l'autre sur le Concordat de 1801.
On voit que M. l'abbé Gosselin n'a pas trop souffert des coups de boutoir donnés à droite et à gauche par le P. Camille de Rochemonteix, dans son livre Les Jésuites et la Nouvelle-France. Sa fécondité n'en a pas été diminuée. On pourrait dire la même chose de M. Benjamin Sulte, qui a publié récemment un récit circonstancié de la Bataille de Châteauguay ; une Histoire de la Milice canadienne-française, très développée ; une collection de passages choisis des Lettres de la Mère Marie de l’Incarnation, les premiers chapitres d'une Histoire du Comté de Nicolet, dans la Revue canadienne, ainsi qu'une étude sur The Unknown, roman canadien du commencement du siècle dernier. M. Sulte se désigne quelquefois le "teneur de livres" de l'histoire du Canada, et l'appellation me semble assez juste. Elle convient bien à l'homme qui a employé ses loisirs depuis des années à consigner dans ses registres les faits grands ou petits de notre existence nationale, et qui périodiquement tire de son grand livre un volume, un article, un renseignement utile pour celui-ci ou celui-là.
Si M. Sulte est le teneur de livres de l'histoire du Canada, M. J.-Edmond Roy en est bien le notaire en titre, le protonotaire, ou mieux encore, le notaire royal. On sait avec quel zèle il exhume de la poussière des vieux greffes, les pièces qui feront revivre sous nos yeux la vie intime de nos ancêtres. De lui nous avons eu récemment, outre la notice sur la famille de René de La Voye, dont j'ai parlé plus haut, une étude développée sur le Baron de La Hontan, parue dans les Mémoires de [161] la société Royale, une plaquette sur Kalm et son Voyage au Canada en 1749 ; une conférence à l'université Laval sur la Légende napoléonienne au Canada, puis une Histoire de la Seigneurie de Lauzon, dont le troisième volume est à la veille de paraître (l'ouvrage complet en aura quatre) et dans laquelle il prodigue les trésors de son érudition historique de première main. N'oublions pas non plus son Histoire du Notariat, en cours de publication.
L'épigraphe de l’Histoire de la Seigneurie de Lauzon est empruntée à Montaigne et vaut bien la peine d'être reproduite ici : "Souvienne-vous de celuy à qui, comme on demanda à quoy faire il se peinoit si fort en un art qui ne pouvoit venir à la cognoissance de guère de gens, "J'en" ay assez de peu, répondict-il. J'en ay assez d'un. J'en ay assez de "pas un." Voilà bien l'esprit dans lequel doivent écrire tous ceux qui se mêlent de tenir la plume au Canada. N'en sommes-nous pas restés à certains égards de l'époque de Montaigne ? En effet, par suite du faible développement numérique du groupe français et de la diffusion encore plus faible de la culture littéraire au sein de cette masse de rudes bûcherons, de pauvres défricheurs et d'âpres paysans, l'ouvrier de la pensée chez nous ne peut espérer tirer de son travail la récompense matérielle. Voir même, il n'est pas bien assuré de trouver ce petit cercle d'auditeurs ou de lecteurs fidèles pour l'encourager de la voix et du geste. Il travaille dans l'isolement.
Notre collègue, le docteur Dionne, auteur de plusieurs ouvrages historiques sur le Canada, a repris, dans les Mémoires de la société Royale, ce qui avait été publié ici et en Europe sur le compte de Roberval, et a cherché (sans trop y réussir toutefois,) à éclaircir le mystère qui entoure bien des épisodes de la carrière de cet explorateur. M. Ernest Gagnon, qui ces années dernières avait publié un volume sur le Château Saint-Louis, cette ancienne résidence de Québec, a donné dans la Revue canadienne, une série d'articles très attachants sur Louis Jolliet, type de ces "voyageurs" et explorateurs de la Nouvelle-France d'il y a deux siècles, dont la hardiesse et l'endurance font encore aujourd'hui notre étonnement. À sa suite, nous nous transportons des bords du Saint-Laurent à ceux du Mississippi, des plaines du grand Ouest américain, pays du bison, aux rivages glacés de la baie d'Hudson, et de là encore à l'île froide et sauvage d'Anticosti. À la lecture de ces articles, on se rend compte à quel point la traite des fourrures pendant cette période dominait toute la vie sociale et politique de la colonie française.
La Revue canadienne de juin 1900 renferme une étude sur la Traite et la Compagnie de la Baie d'Hudson avant La Vérendrye, par M. le juge Prudhomme.
[162]
M. le juge Girouard a compulsé avec patience les volumineux recueils de la Correspondance générale déposés au bureau des Archives canadiennes et il en a tiré la substance d'une étude sur l'Expédition de Denonville (1687). On se rappelle que dans cette circonstance, d'après les instructions, ou du moins avec la connivence, de la cour royale, le gouverneur et l'intendant attirèrent à Cataracoui, sous prétexte de pourparlers de paix et de festin, un certain nombre d'Iroquois, qu'ils firent prisonniers et déportèrent en France, où ils furent mis aux galères. L'article a pour but d'établir la part des responsabilités de chacun dans cette trahison.
De M. le juge Baby, nous avons une brochure sur l’Exode des Classes dirigeantes à la Cession du Canada. L'auteur s'attaque à nos premiers historiens, Bibaud père, Garneau, Ferland, pour avoir répandu la notion qu'à la suite de l'occupation anglaise, les classes dirigeantes du Canada quittèrent le pays pour retourner en France. Il publie des listes imposantes de beaux noms pour établir que la grande majorité des seigneurs, des gentilshommes, des hommes de loi et de science, des négociants, demeurèrent dans la colonie. Certains faits n'en restent pas moins acquis. C'est que, 1° à la suite des capitulations de Québec et de Montréal et du traité de Paris, une proportion notable des familles dirigeantes, fonctionnaires surtout, repassèrent définitivement en France. 2° D'autres familles après être repassées en France revinrent au Canada pour n'avoir pu obtenir dans la mère patrie les pensions ou les emplois qu'elles sollicitaient, et de retour dans la colonie se mirent au service des gouverneurs anglais. [6] 3° La plupart des anciennes familles dirigeantes demeurées au Canada ne jouèrent plus, si ce n'est à la guerre, qu'un rôle très effacé, et perdirent rapidement toute influence. M. Baby n'est pas loin d'admettre cette dernière conclusion.
La vérité c'est que toute cette gentilhommerie souffrait d'un vice radical : elle avait été dressée à vivre principalement de fonctions civiles ou militaires, de pensions ou de privilèges (rentes seigneuriales, congés de traite) accordés par l'État. Et lorsqu'au moment de l'occupation anglaise, l'appui des pouvoirs publics manqua aux gentilshommes coloniaux, s'ils ne quittèrent pas le pays, du moins pour la plupart tombèrent-ils dans une obscurité assez profonde pour donner à l'historien honnête et scrupuleux l'idée qu'ils étaient bien partis.
M. F.-J. Audet, des archives du Secrétariat d'État, a fourni une contribution utile à l'étude du Clergé protestant de la période qui a suivi immédiatement la cession du Canada à l'Angleterre. De M. Philéas Gagnon, bibliophile et archiviste de Québec, nous avons eu une notice sur [163] St. Ursula's Convent, œuvre d'imagination due à la plume de Julia Beckwith, publiée à Kingston (Haut Canada) en 1824, et que M. Gagnon appelle le premier Roman canadien. Et M. Sulte qui se félicitait d'avoir découvert ce premier roman dans The Unknown de William Fitz-Hawley, publié à Montréal en 1831 ! Au moins se console-t-il en proclamant que The Unknown a beaucoup plus les caractères du roman que l'œuvre exhumée par M. Gagnon.
Deux des nôtres, M. P.-B. Casgrain, de la Literary and Historical Society of Québec, et sir James LeMoine, ancien président général de notre société, ont donné chacun un travail historique en langue anglaise : M. Casgrain, une contribution au débat relatif au champ de bataille des plaines d'Abraham ; sir James, une brochure ayant pour titre : The Annals of the Port of Québec. M. Cléophas Auger, de Lévis, a publié l'histoire du Pilotage du Saint-Laurent de Québec à Montréal.
La fièvre de littérature napoléonienne, après avoir sévi en Europe, a passé sur Québec, où je vois que M. Évariste Prince a fait, à l'université Laval, deux conférences sur le Maréchal Ney, vers le même temps où l'abbé Gosselin et M. J.-Edmond Roy y traitaient des sujets se rattachant à la même période. M. Alphonse Gagnon, dans la Revue canadienne, a publié quelques pages sur des sujets d'archéologie.
On conçoit que nous ne pouvons songer à faire ici la revue des études relatives à l'histoire du Canada qui ont paru dans les journaux quotidiens sous la signature d'Ignotus ou sous le nom de M. DeCelles ; non plus que des nombreux articles, quelques-uns d'un réel mérite, publiés dans le Bulletin des Recherches historiques, sous la direction de M. P.-G. Roy, ou dans le Courrier du Livre, sous la direction de M. Raoul Renault.
Sociologues et Economistes. — Précédemment je signalais certains ouvrages qui fournissent une transition presque imperceptible des œuvres purement littéraires aux travaux historiques proprement dits ; et maintenant j'ai sous la main quelques volumes qui font pour ainsi dire la chaîne entre les écrits historiques et les études sociales et économiques. Tel est, par exemple, le livre de M. le sénateur Poirier, notre vice-président, Le P. Lefebvre et l’Acadie : un bel ouvrage vigoureusement écrit par quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Le P. Lefebvre, prêtre canadien de l'ordre de Sainte-Croix, a été le fondateur du collège de Memramcook, dans le Nouveau-Brunswick, et la fondation du collège de Memramcook a été dans la vie sociale des Acadiens l'événement le plus considérable de ce siècle, puisque il leur a fourni le point de ralliement qui leur manquait. Le biographe du P. Lefebvre se trouve ainsi amené tout naturellement à traiter de l'histoire sociale et des caractères sociaux [164] des Acadiens, ou de leurs cousins du Canada. Il a notamment à se prononcer sur cette question sociale par excellence de l'éducation, et il le fait en des pages d'un intérêt vif et soutenu. On peut bien ne pas partager toutes les opinions de l'auteur, trouver ses critiques trop sévères ou son ton parfois trop acerbe. Mais on ne peut s'empêcher d'applaudir à sa virile indépendance, à sa franchise, servies par une plume fortement trempée.
M. Paul de Cazes, dans le dernier volume des Mémoires de notre société, a un travail sur l’Instruction publique dans la Province de Québec. La première partie est consacrée à faire l'historique de notre système scolaire ; la seconde à la description des diverses pièces de son mécanisme administratif ; la dernière à la nomenclature des écoles des divers degrés et des diverses catégories de l'enseignement ; le tout fortifié de statistiques officielles récentes. C'est un rapport à peu près complet et suivant toutes les formes.
Le même volume des Mémoires de la société Royale renferme une belle étude de M. DeCelles sur les Constitutions politiques du Canada. L'auteur commence par bien établir que les libertés dont nous jouissons dérivent de trois sources principales : "Le droit des gens nous a valu nos droits civils et nos coutumes ; les capitulations de Québec et de Montréal (ratifiées par le traité de Paris) nous garantissent le libre exercice de notre religion ; et enfin nous tenons de notre qualité de sujets anglais nos droits politiques." Suit un exposé rapide et intéressant des luttes qui ont accompagné chez nous l'établissement du régime représentatif. Partout on retrouve les qualités distinctives de l'ancien rédacteur de la Minerve : connaissance parfaite des hommes et des choses de notre politique, fermeté dans la revendication de nos droits jointe à une sage modération. Beaucoup de nos jeunes gens lancés dans la politique feraient bien de lire attentivement cette étude de M. DeCelles.
Le livre canadien qui a le plus attiré l'attention en ces derniers temps est sans contredit celui de mon ami Edmond de Nevers, L'Âme américaine. Je dis "livre canadien", car s'il a été publié à Paris, s'il y a eu pour parrain un homme de la réputation de Brunetière, son auteur n'en est pas moins franchement des nôtres. Un tendre, un délicat, hélas un maladif aussi, ce garçon aux traits fins, à tempérament d'artiste, mais cachant sous un masque d'ironie un ardent patriotisme, une faculté remarquable d'observation et d'assimilation, une veine de philosophie douce et résignée. Et on le retrouve tout entier dans ses écrits, dans L'Âme américaine, comme dans L'Avenir des Canadiens-français, pages riches d'érudition historique, d'aperçus nouveaux, et pleines de la poignante crainte de voir un jour notre petit groupe français submergé par le flot montant de l'anglo-saxonisme américain.
[165]
Cinq des conférences données à Québec sous les auspices de l'université Laval, l'hiver dernier, traitaient de questions sociales. Mgr Laflamme a parlé de l'Église orthodoxe russe en deux conférences destinées à servir en quelque sorte d'introduction à l'étude de cette société géante, à cheval sur l'Occident et l'Orient. M. l'abbé S.-A. Lortie, professeur à la faculté de théologie de l'université, en trois conférences, s'est attaché à faire l'histoire du Socialisme, du Communisme, de l’Anarchisme, du Collectivisme et du Socialisme agraire. C'est un signe non équivoque de l'intérêt croissant qui s'attache aux études sociales que la large place qui leur est faite dans la série des conférences publiques de notre université provinciale.
Mme Dandurand, fille du regretté Félix-Gabriel Marchand et elle-même écrivain prolifique, a contribué au livre des Femmes du Canada une dissertation sur les Mœurs canadiennes-françaises. Mlle Bélanger a donné quelques pages sur la Colonisation.
Avec M. Errol Bouchette, qui a publié récemment une brochure intitulée Emparons-nous de l'Industrie, et qui nous présente aujourd'hui une étude très soignée sur le développement industriel du Canada français, nous sommes de plein pied dans le domaine de l'économie politique et sociale. Nous devons voir d'un bon œil nos compatriotes s'engager en plus grand nombre dans l'étude de ces questions d'une importance vitale pour nous, et que nous avons par trop négligées jusqu'aujourd'hui.
Le département de l'Agriculture de la province de Québec a publié un volume de 350 pages (de la plume de M. Buies, si je ne me trompe) qui donne une description générale de la province, et renferme, dans un ordre un peu confus, une masse de renseignements sur le domaine public, l'exploitation forestière, la colonisation, l'agriculture, l'industrie de la pulpe, les pêcheries, les chemins de fer, le commerce et la navigation, les mines, le climat, l'instruction publique, le système politique et administratif de la province. [7]
Naturalistes, géologues, physiciens. — M. l'abbé V. Huard, rédacteur du Naturaliste canadien, de Chicoutimi, a accompagné son évêque dans une visite pastorale le long de cette immense côte du Labrador, et il est revenu avec les matériaux d'un gros volume : Labrador et Anticosti. C'est à tort peut-être que je place cet ouvrage dans la catégorie des sciences naturelles, car si l'auteur nous parle de la géographie physique, de la flore et de la faune du pays qu'il traverse, il s'attache surtout à nous faire connaître les groupes de populations rencontrées sur son chemin, leurs moyens d'existence, leur manière de vivre. L'intérêt de son livre est surtout social, et cet intérêt est très grand.
[166]
M. Henri de Puyjalon, qui a passé une grande partie de sa vie dans cette région sauvage, intransformable du Labrador canadien, a écrit une Histoire naturelle d'un charme tout particulier. Les mœurs des fauves, grands et petits, qui parcourent ces vastes solitudes, y sont décrites en détail par un homme qui a vécu je dirais presque dans leur intimité, loin du bruit du monde. M. Buies, de son côté a préparé une plaquette sur les Animaux à fourrure et les Poissons du Canada. Dans ces trois ouvrages, plus particulièrement dans le premier et le second, le mot pour rire revient fréquemment mêlé à la description scientifique. C'est comme si l’écrivain se rendait compte que son lecteur est mal préparé à le suivre dans une dissertation sérieuse et demande qu'on lui détende de temps à autre l'esprit.
Mgr Laflamme, dans le dernier volume de la société Royale, a deux notes sur les éboulements qui se sont produits il y a quelques années sur les rivières Sainte-Anne et Champlain. M. l'abbé Henri Simard, à l'université Laval, a donné une conférence sur les Courants électriques alternatifs de haute Tension et de grande Fréquence, au cours de laquelle il fait la revue des dernières découvertes de Tesla.
Je ne puis que mentionner ici pour mémoire les rapports officiels préparés par les fonctionnaires, spécialistes, savants à l'emploi du gouvernement fédéral ou de celui de la province de Québec, ainsi que les articles parus dans le Journal d'Agriculture, ou dans l'Enseignement primaire, sous la direction de M. J.-C. Magnan.
Légistes et Praticiens. — M. Rodolphe Lemieux, agrégé à la faculté de droit de l'université Laval, de Montréal, a publié Les Origines du Droit franco-canadien. M. Honoré Gervais, professeur à la même faculté, a publié une conférence ayant pour sujet l'étude comparative de la Procédure civile de la Province de Québec. Mme H. Gérin-Lajoie (née Lacoste, fille du juge en chef de la cour d'appel) a préparé pour le livre des Femmes du Canada un travail soigné sur la Condition légale de la Femme dans la Province de Québec. MM. Mathieu et Bernard ont publié un manuel de Droit administratif et international :MM. Dorais, un Formulaire de Procédure. On reconnaîtra que je fais preuve d'une sage prudence en ne m'aventurant pas plus loin que le titre dans l'examen de ces ouvrages.
Artistes. — Encore moins puis-je rendre compte dignement de notre mouvement artistique, des œuvres mises au jour, du travail exécuté pas nos musiciens, nos peintres, nos sculpteurs. Qu'il me suffise de rappeler que cette année sera celle de l'inauguration de la statue de la reine Victoria, exécutée à la demande du gouvernement canadien par notre compatriote, M. Philippe Hébert. Fort belle conception, digne à mon sens de figurer à côté de son monument de Maisonneuve qui orne [167] la place d'Armes de Montréal, et de sa statue de Frontenac, au palais législatif de Québec. Tout le numéro de janvier dernier de la Revue canadienne est consacré à l'œuvre de M. Hébert. L'article, fort bien illustré, est de M. Jean-B. Lagacé, jeune artiste et littérateur, qui devient à son tour le sujet d'une étude de la plume de M. l'abbé Auclair dans le numéro suivant de la Revue.
Pour conclure ce chapitre, notre production ces années dernières a été presque toute purement littéraire ou historique ; les études économiques ou sociales, les travaux scientifiques, ont été peu nombreux. Ceux de nos écrivains qui ne s'absorbent pas dans l'étude du passé, s'adonnent de préférence pour la plupart à la littérature légère ou d'imagination. Peu d'entre eux ont le goût de l'observation, des études positives. Il y a là, semble-t-il, dans le développement de notre classe instruite un manque d'équilibre que nous aurions grand intérêt à corriger.
Indépendamment des genres : œuvres d'imagination, études historiques ou sociales, toute notre production écrite est visiblement inspirée, pénétrée, dominée, par une idée maîtresse, celle du groupement communautaire, que ce groupement soit la famille, la paroisse, le clan politique, la religion ou la race. Mais avant d'insister davantage sur ce point, jetons un coup d'œil sur le mouvement intellectuel de notre classe populaire.
III. — Nos journaux et nos écoles.

La revue que nous venons de faire de la production livresque récente (littéraire, historique, sociale ou scientifique) du Canada français nous a permis de nous rendre compte dans une certaine mesure du mouvement intellectuel de notre classe instruite ou supérieure. Mais il est un aspect de la question beaucoup plus important que celui-là par ses effets sociaux : c'est le mouvement intellectuel de la classe populaire. Afin de pouvoir juger de l'activité et de la direction de ce mouvement, considérons deux de ses manifestations les plus saillantes : le journal et l'école.
Nos journaux. — Nous ne manquons pas de journalistes habiles, polémistes vigoureux, économistes renseignés, chroniqueurs ou chroniqueuses alertes. Il me suffira de donner quelques noms : Dansereau, Tarte, DeCelles, Royal, Fréchette, Sulte, Pacaud, Bernier, Chapais, Nantel, Barthe, Helbronner, Stanislas Côté, Tardivel, Chicoyne, Langlois, Sauvalle, Marion, Prince, Masson ; Tonnancour, Laflamme, Famelart, T. Saint-Pierre (aux États-Unis) ; Mme Dandurand, Léon Ledieu, Sylva Clapin, Chartrand, Mlle Barry, Flavien Moffet, Tremblay, Picard, Prévost, Gascon, d'Hellencourt, Magnan, Mlle Bélanger, Jean Dumont, Amédée Denault, Montigny, Hector Garneau, Omer Héroux, Mlle Gleeson.
[168]
Le caractère de nos journaux est en train de se modifier. Dans les villes, notamment, des anciens organes de parti, à format réduit, à faible tirage, vivant de la politique, de l’annonce locale, du fait-divers local, les uns sont morts d'inanition, les autres ont dû se transformer. Chez ces derniers la politique tient encore une large place, mais de plus en plus ils tendent à devenir de.grands organes de publicité et de renseignements, embrassant les sujets les plus variés, journaux à départements qui s'adressent à toutes les classes de lecteurs. C'est ainsi que les feuilles importantes de Montréal et de Québec ont toutes aujourd'hui leur colonne ou leur page de matières particulièrement destinées aux femmes. Et ç'a été une des nouveautés de notre journalisme en ces dernières années que son envahissement par nombre de femmes écrivains.
D'autre part nos grands quotidiens paraissent avoir renoncé pour le moment à cette recherche du fait-divers sensationnel dont se repaissait jadis la curiosité puérile ou morbide d'une certaine catégorie de lecteurs. La part est faite de plus en plus large à la bonne littérature, aux renseignements utiles, à l'agriculture. Bien que les violences de langage et les diatribes personnelles y tiennent encore trop de place, on peut dire que la forme, comme le fond, s'est améliorée ; le langage est plus correct, l'expression plus claire, plus directe, plus française.
Mais notre peuple lit-il assez les journaux ? Si vous ouvrez l'Indicateur des journaux canadiens pour l'année 1901, compilé par l'agence McKim, de Montréal, répertoire le plus complet que je connaisse, vous constaterez que nous sommes loin d'avoir notre quote-part des publications trimestrielles et mensuelles, des feuilles hebdomadaires ou quotidiennes publiées dans le pays. Ainsi dans la province de Québec, sur un total de 194 journaux, 97 sont de langue française et 97, de langue anglaise. Songez, les 300 mille Anglais de notre province ont le même nombre d'organes que nous qui y sommes 1,300 milles. Mais, me direz-vous, si nos journaux ne sont pas plus nombreux, au moins ont-ils un plus grand nombre de lecteurs. Encore ici, détrompez-vous. Il est vrai que c'est un journal canadien-français, la Presse, de Montréal, qui de tous les quotidiens du Canada fait montre du plus fort tirage. Mais dans l'ensemble le tirage des journaux anglais de la province de Québec excède d'à peu près un tiers celui des journaux français.
Prenez maintenant la province anglaise voisine de la nôtre, l'Ontario. Avec une population de 2,180,000 habitants, dont 162,000 de langue française, elle compte 677 journaux, dont 4 seulement de langue française. La population française de Québec, grossie du groupe français de l'Ontario, s'élève à près de 1,500,000 âmes et soutient 101 journaux. La population anglaise de l'Ontario, grossie du groupe anglais de Québec, s'élève à un peu plus de 2,300,000 âmes et soutient 770 journaux. [169] Les Anglais des deux provinces réunies n'excèdent que d'un tiers le nombre des Français, et pourtant ils ont sept fois plus de journaux que ceux-ci. Les Anglais comptent un journal pour un peu moins de 3,000 habitants ; les Français, un journal pour un peu moins de 15,000 habitants.
Si nous examinons séparément les diverses classes de journaux, nous dégagerons quelques considérations intéressantes. Dans la classe des périodiques littéraires, artistiques, des revues de médecine, de droit, et autres semblables, nous tenons bien notre rang. On compte, en effet, dans Québec 22 ou 23 publications françaises de cette classe, contre 8 de langue anglaise dans la même province et 28 de langue anglaise dans l'Ontario. Déjà dans la classe des publications religieuses, nous faisons moins bonne figure. Nous avons 11 périodiques religieux ; les Anglais de l'Ontario et de Québec en ont 64, c'est-à-dire de 5 à 6 fois plus. De même ils ont 4 à 5 fois plus de journaux d'agriculture, 7 fois plus de journaux d'éducation, 10 fois plus d'organes de la catégorie politique-publicité-annonces, et enfin, presque 20 fois plus de journaux de la spécialité commerce-finances-industries-transports. Des 15 journaux quotidiens de la province de Québec, les Anglais en ont 8 ; et des 55 journaux quotidiens de la province d'Ontario, les Anglais en ont 54. Des 97 journaux de langue française de la province de Québec, 48 sont publiés à Québec ou à Montréal.
La conclusion c'est que, en comparaison des groupes qui nous entourent et nous font concurrence, nous ne lisons pas assez, que notre classe ouvrière, rurale, principalement, ne lit pas assez, que surtout elle ne lit pas assez les journaux d'agriculture et de commerce, qu'elle ne se tient pas assez au courant du mouvement des affaires et de la marche des événements dans le monde.
Et si notre classe populaire lit peu, si elle néglige par-dessus tout ce genre d'écrits qui lui enseigneraient comment améliorer ses conditions de vie et l'aideraient à soutenir la concurrence des autres races, c'est que sans doute elle y a été mal préparée par les influences diverses de son milieu social, et notamment par la petite école.
Nos écoles. —Vous vous rappelez sans doute que le recensement de 1891 (tome II, chapitre xiii) donnait la statistique des illettrés. Il donnait cette statistique non seulement pour l'ensemble de la population, mais pour les divers âges : 10 à 19 ans, 20 à 29 ans, 30 à 39 ans, 40 à 59 ans, 60 ans et plus. On y trouvait aussi le nombre des illettrés à la fois pour l'ensemble du pays, pour chacune des provinces prises séparément, et, à l'intérieur des provinces, pour chaque comté ou ville. De ces statistiques officielles, deux constatations principales se dégageaient relativement à la province de Québec. En premier lieu, à la [170] simple comparaison des chiffres donnés pour les diverses catégories d'âges, on était frappé de la diminution rapide et continue dans la proportion pour cent des illettrés à mesure que Ton passait des anciennes générations aux nouvelles. On avait ainsi la preuve palpable que révolution commerciale et industrielle ne s'était pas faite en vain, que le travail de l'administration depuis quelque cinquante ans n'avait pas été en vain, que les jeunes générations de la province de Québec étaient sensiblement en progrès sur leurs aînées.
D'autre part ces statistiques nous mettaient vivement sous les yeux cette vérité très dure que, de toutes les provinces de la Confédération (à l'exception de la Colombie-britannique dans certaines catégories d'âges), Québec était celle qui renfermait de beaucoup la plus forte proportion d'illettrés. Ainsi, par exemple, pour le groupe des adolescents (10 à 19 ans), la proportion d'illettrés dans Québec était d'à peu près 17 pour 100, tandis quelle n'était que de 4.5 pour 100 dans l'Ontario, de 7.6 pour 100 dans la Nouvelle-Écosse, de 4.2 pour 100 dans l'Île-du-Prince-Édouard et de 5 pour 100 dans le Manitoba. La publication de ces faits fut le signal d'une discussion très vive dans la presse, et la question de l'instruction populaire, occupa quelque temps l'attention publique. [8]
La compilation du recensement de 1901 est à peine commencée et nous ne savons pas exactement à l'heure présente quel est le degré d'instruction des divers groupes de la population canadienne. Mais il est fort probable que ce recensement, comme celui de 1891, tout en constatant une avance sur la période précédente, montrera que nous sommes encore assez loin en arrière des groupes anglophones en ce qui est de la diffusion de l'instruction élémentaire. Il ne paraît pas, en effet, que l'Habitant, ces années dernières, se soit corrigé dans une mesure appréciable de son indifférence et de sa parcimonie à courte vue pour la petite école, indifférence, parcimonie, qui sont l'obstacle fondamental à tout progrès en la matière. L'arrêté récent du conseil de l'instruction publique dont l'objet était de fixer un minimum d'appointements de cent dollars par année pour tout instituteur ou toute institutrice dans la province de Québec, a dû être révoqué, les autorités reconnaissant après coup qu'il ne leur serait pas possible d'obtenir l'exécution de la mesure. De toute cette agitation, de cette bruyante discussion, qui s'étaient faites au sujet des écoles, il n'est en somme sorti rien de tangible ou de pratique.
Pendant ce temps, aux États-Unis et dans les parties anglaises du Canada, on travaille activement, efficacement, à l'amélioration des écoles [171] communes. L'initiative, les dons de particuliers riches et clairvoyants, viennent seconder, stimuler, féconder le zèle des commissions scolaires et des fonctionnaires publics. On introduit des procédés nouveaux et énergiques de développement intellectuel, comme le Manual training (éducation de la main et de l'œil), les Nature studies (étude et observation des phénomènes naturels les plus simples). On y prépare la fusion et la concentration des écoles rurales en vue de les mettre sur un meilleur pied.
Certes, l'amélioration des petites écoles chez nous n'est pas sans présenter de sérieuses difficultés. Il faudra lutter contre l'apathie populaire, le manque d'esprit public, la mesquinerie et dans certains cas la pénurie des contribuables. Toutefois, il n'est aucun de ces obstacles qu'il ne soit possible de surmonter, aucun de ces défauts qui ne puisse être corrigé par un travail patient de propagande. Les pessimistes déclarent qu'il est bien inutile de chercher à réformer nos écoles, puisque cette réforme ne pourrait se faire que moyennant une plus forte dépense de deniers publics et que l'Habitant ne consentira jamais à se taxer plus qu'il ne le fait aujourd'hui pour cette fin. Mais cette double proposition est assez contestable. L'habitant se taxera de toute la somme requise pour la construction et l'aménagement de bonnes écoles ainsi que pour le subventionnement d'instituteurs ou d'institutrices habiles, le jour où ses conseillers ordinaires, et notamment le curé, lui auront fait comprendre toute l'importance de la chose. Et puis, est-il bien sûr qu'il faille plus d'argent ? Ne pourrait-on pas se contenter au début de tirer meilleur parti des cotisations que l'habitant paie actuellement ? Ne pourrait-on, par exemple, dans certaines localités, déterminer la fusion des arrondissements, qui aurait pour effet de remplacer cinq ou six écoles médiocres par une école centrale mieux aménagée, sous la direction d'instituteurs mieux rémunérés et plus compétents ?
Mais cette réforme ne pourra s'effectuer qu'à deux conditions : la première c'est qu'il y ait à Québec, sous la haute direction du conseil de l'instruction publique, un homme (le surintendant ou tout autre) qui, chargé d'une large part de responsabilité et disposant d'une certaine liberté d'action, ait pour fonction spéciale d'accélérer le mouvement. La seconde condition, c'est que cet homme ait la coopération active et sympathique du clergé. Après le curé fondateur de collèges classiques, après le curé colonisateur et défricheur, nous aurions le curé apôtre de l'instruction usuelle, de l'éducation populaire. Ne serait-ce pas un fleuron de plus pour l'Église du Canada ?
Résumons en quelques lignes les conclusions principales qui se dégagent de cette étude trop longue peut-être. Nous avons vu que le mouvement intellectuel de notre classe supérieure (suffisamment actif) [172] n'est pas parfaitement équilibré, ne se fait pas dans le sens le plus utile. Abstraction faite des ouvrages professionnels ou officiels, notre production écrite est presque toute de sentiment, d'imagination et de légèreté. Elle touche, elle flatte, elle charme, elle amuse, plus qu'elle n'instruit, plus qu'elle ne forme l'esprit, plus qu'elle ne fortifie la volonté, plus qu'elle ne porte à l'action. D'autre part, le mouvement intellectuel de notre classe populaire n'est pas suffisamment actif. La proportion d'illettrés, même chez les jeunes gens, est encore trop forte. Notre peuple ne lit pas assez, ne se tient pas assez au courant par la voie du livre et du journal. Et pourtant dans les conditions actuelles d'existence, la diffusion des connaissances usuelles au sein de la classe populaire serait un facteur beaucoup plus puissant de stabilité et de prospérité sociale que la formation d'un groupe de littérateurs ou d'hommes de professions libérales. Sachons, messieurs, regarder la situation bien en face, sachons la voir telle qu'elle est, sans nous en exagérer inutilement le danger, mais aussi sans nous en dissimuler la gravité. N'imitons pas la folie du négociant qui refuse de faire son bilan, de crainte d'y lire la banqueroute. N'ayons pas le faux patriotisme de ceux qui voudraient faire le silence sur ces questions, ou nous bercer d'illusions. Nous avons la légitime ambition de nous perpétuer comme groupe distinct de langue française sur ce continent. Mais ce n'est pas la vaine complaisance de nous-mêmes qui nous aidera à atteindre ce but. Observons ce qui se fait autour de nous. Ne craignons pas au besoin de nous inspirer des méthodes qui réussissent à nos compatriotes de langue anglaise. Ne fermons pas les yeux sur nos défauts ; travaillons hardiment plutôt à nous en corriger. Nous le pouvons, nous le devons.
[1] M. Charles Ab Der Halden a parlé excellemment de Buies dans une conférence très attachante sur la Littérature canadienne-française, faite à Paris, en mars 1900, sous les auspices de l'Alliance française, et reproduite dans la Revue canadienne d'octobre suivant.
[2] Voir aussi l'étude que lui consacre M. l'abbé Élie-J. Auclair dans le numéro de juin 1901 de la Revue canadienne.
[3] Un trait remarquable de cette paroisse d'Yamachiche c'est l'attachement et l'intérêt qu'elle continue d'inspirer à ceux de ses enfants qui ont dû s'en éloigner. Au moment de livrer ce manuscrit à l'imprimeur, je reçois du vieil ami de mon père, M. Raphaël Bellemare, vétéran du journalisme canadien, un fort volume, très documenté, paru sous les auspices de la société Historique de Montréal, et qui a pour titre Les Bases de l'Histoire d'Yamachiche. (Note de novembre 1901.)
[4] Encore trois Histoires de paroisses qui nous arrivent au dernier moment : celle de Saint-Jean-Baptiste-de-Québec, celle de Notre-Dame-de-Bonsecours-de-l'Islet, celle de Sainte-Julie-de-Somerset, toutes trois compilées par M. Pierre-Georges Roy, directeur du Bulletin des Recherches historiques.
[5] Aujourd'hui en cours de publication sous une forme nouvelle dans la Science Sociale, de Paris. (Note de novembre 1901.)
[6] Voir dans le livre de l'abbé Daniel, sur la Famille de Léry, la correspondance échangée entre le chef de cette famille et son parent Repentigny.
[7] M. Fabien Variasse, ancien député d'Yamaska, a commencé la publication d'une revue mensuelle, l'Économiste canadien, dont quelques numéros ont paru.
[8] Pour de plus amples détails, voir trois articles de nous parus dans la Science Sociale, juin et novembre 1897 et juin 1898, sous le titre : La Loi naturelle du Développement de l'Instruction populaire ; les Causes sociales de la Répartition des Illettrés au Canada.
|

