|
Ernst TROELTSCH
“L’époque de la Restauration
au début du XIXe siècle.”
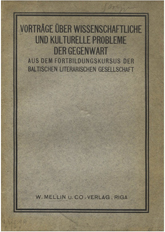 Note du traducteur : Note du traducteur :
Ce texte d’Ernst Troeltsch, qui a pour titre allemand « Die Restaurationsepoche am Anfang des 19. Jahrhunderts », a paru initialement dans Vorträge über wissenschaftliche und kulturelle Probleme der Gegenwart aus dem Fortbildungskursus der Baltische Literarischen Gesellschaft im Jahre 1913 [Conférences sur certains problèmes scientifiques et culturels du présent, prononcées dans le cadre des Conférences de la Société littéraire balte destinées à la formation continue, année 1913], Riga, Mellin, 1913, p. 47-71. Il fut à nouveau publié au volume quatre des Gesammelte Schriften [Œuvres complètes] d’Ernst Troeltsch, édité par Hans Baron sous le titre particulier Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie [Écrits sur l’histoire intellectuelle et la sociologie de la religion] (Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1925, p. 587-614). Traduit de l’allemand par Lucien Pelletier (Université de Sudbury, Ontario, Canada). Traduction achevée le 29 mai 2017.
Dans cette dernière édition (à laquelle nous renvoyons par l’abréviation « GS IV »), Hans Baron a intégré un ajout que l’auteur avait lui-même apporté dans la marge de son exemplaire de l’édition originale. Notre traduction tient compte des deux versions, en signalant en note la modification apportée par la seconde. La pagination de la première édition est insérée dans le texte en caractères gras; celle de la deuxième édition est elle aussi insérée dans le texte, en caractères italiques.
[47]
GS = [587]
L’ÉPOQUE DE LA RESTAURATION
AU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
[49]
Un des principaux éléments qui distinguent le xixe siècle du xviiie est ce qu’on appelle la Restauration. Si l’on veut se faire une idée de la manière dont cette Restauration en est venue à s’imposer, à l’encontre de l’esprit du xviiie siècle toujours agissant et toujours engendrant de nouvelles formes, on n’a qu’à lire les Épigones d’Immermann, un des grands romans à avoir su dépeindre leur temps et ses aspirations suprêmes. [588] En comparant ce roman au Wilhelm Meister et aux romans de formation que le romantisme a produits dans le sillage de ce dernier, on saisira concrètement la différence entre les deux époques. Déjà, l’esprit rationaliste y décline et se mue en mouvement d’opposition démocratique et en esprit d’entreprise capitaliste. L’individualisme humanisé de tendance romantique et classiciste s’y maintient davantage. Mais derrière tout cela, les anciens rapports de pouvoir et de rang refont surface, eux qui avaient été non pas anéantis mais seulement affaiblis, et la structure de pouvoir et de puissance des monarchies militaro-bureaucratiques passe à l’avant-plan, en lien avec une restauration opportuniste du confessionnalisme des Églises chrétiennes. Avec ces diverses puissances pour décor, le roman déploie le fantastique destin de son héros qui, comme dans le bon vieux temps, aspire encore et surtout à se former personnellement (du reste, soit dit entre nous, ce roman sait captiver son lecteur par d’étonnants revirements de fortune, comme les vieux romans d’aventure).
Il s’agit là, en somme, d’une image de la Restauration en Allemagne. Mais à bien des égards, les choses ont été semblables dans tous les pays. C’est avec cette Restauration que s’est amorcé le xixe siècle. L’esprit moderne s’est opposé à elle et il en a donc été affecté dans ses diverses tendances, soit que celles-ci se soient développées plus fortement et radicalement ou encore qu’elles aient subi toutes sortes de contacts et de contaminations avec les forces engendrées par la Restauration. C’est cette Restauration qui a détruit l’impression qu’avait eue le xviiie siècle d’avoir trouvé au problème de la civilisation moderne une solution définitive en produisant un monde idéel soit rationaliste et unitaire, soit humaniste et classiciste. Les uns ont été effrayés, déçus, épouvantés, ils ont vu dans la Restauration une régression inouïe; [50] les autres se sont mis à douter, sous son influence, du caractère définitif de la nouvelle culture scientifico-esthétique et rationnelle. La Restauration s’est interposée entre nous et cette époque d’une manière telle que nous ne pouvons plus simplement prolonger celle-ci ou renouer avec elle.
Ce seul fait suffit à se demander si la Restauration fut vraiment une simple régression, comme une gelée dans une nuit de printemps, ou si n’y avaient pas plutôt part des forces plus profondes, durables et essentielles qui, dans l’époque antérieure, n’avaient pas été pleinement prises en compte mais qui à présent s’exprimaient, en vertu d’une nécessité interne des choses. [589] Ceux pour qui la Restauration évoque avant tout la Sainte-Alliance, le rétablissement de l’absolutisme, le renouveau de l’orthodoxie protestante et du catholicisme romain centralisé et jésuite, les tribulations de l’Allemagne et de l’Italie, les Bourbons, Metternich et Nicolas Ier, seront enclins à n’y voir qu’une régression. Mais ce ne sont là que les pointes politiques et ecclésiales du mouvement, pas tout le mouvement lui-même. En outre, celui qui croit que dès le milieu du siècle, avec la révolution de 48, la Restauration aurait de nouveau été anéantie devra pourtant reconnaître que dans les grands États, dans les États qui sont aujourd’hui constitutionnels, un élément centralisateur et militariste apparenté à l’absolutisme est demeuré et que l’uniformisation et la dogmatisation des Églises s’est affirmée et accrue, et ce, même au sein d’un monde entièrement métamorphosé. On voit déjà que nous n’avons pas affaire ici à un simple rétablissement des anciens intérêts dynastiques, féodaux et sacerdotaux. Les forces fondamentales qui ont animé tout le mouvement se trouvent plus profond encore. Certes, le retour des choses anciennes a été inattendu et en partie frivole et forcé, mais il ne fut possible que parce qu’en vérité, l’ancienne situation reposait sur un pouvoir plus profond que ne l’avait cru l’idéologie du grand siècle et parce que la Restauration n’était que la pointe momentanée d’un mouvement plus englobant, général et profond.
Le grand siècle fut l’époque de l’individualisme idéologique. Cet individualisme, l’État renforcé pouvait le tolérer, en tant que luxe spirituel que s’offraient les élites dans la littérature et dans leur vie privée, sans que la structure sociale en fût changée. L’État était d’ailleurs redevable à cette production scientifique rationnelle de toute une série de pensées excellentes et très fécondes qui, en particulier, lui permirent d’unifier selon des principes rationnels son territoire, encore aussi morcelé qu’au Moyen Âge. Les transformations sociales contenues implicitement dans cet individualisme étaient encore peu significatives extérieurement et les perspectives théoriques de son expansion générale demeuraient encore à l’état de simples théories éthiques et philosophiques, qui [51] n’eurent tout au plus d’impact pratique que sur le droit civil et le droit pénal. La constitution anglaise, beaucoup admirée depuis Montesquieu, présentait un compromis relativement conservateur entre l’individualisme moderne et la stabilité des institutions étatiques. La superstition théologique s’était envolée, [590] il restait une morale chrétienne humaine, une confiance en la vie à laquelle tous pouvaient se rallier et qui rendait la vie plus douce, aimable et féconde. Déjà, certes, la littérature classiciste néo-humaniste et la littérature romantique lézardaient cette unanimité mais, en définitive, le classicisme défendait une rationalité et une normalité apparentées à l’Aufklärung et il pouvait être perçu comme l’anoblissement de celle-ci. Seuls la littérature sentimentale, puis le Sturm und Drang et finalement le romantisme présentaient un subjectivisme potentiellement inquiétant; mais ces courants purent eux aussi, dans un premier temps, se percevoir comme l’expression d’un droit qui nous est inné et que briment les conventions historiques.
Or le développement pratique de cet individualisme a donné lieu à un courant radical en ce qui concerne la formation de l’État et de la société, c’est-à-dire d’une part à la Révolution française et au napoléonisme, et d’autre part au déploiement du romantisme en un subjectivisme dépourvu de règles et de consistance; il a donné lieu à la crise des idées et à un jugement nouveau porté sur les formations et les forces sociales existantes, à de nouvelles théories sur la société et l’organisation.
En ce qui a trait à la Révolution française et à Napoléon, il n’est pas besoin d’un commentaire détaillé. Toutes les idées concernant une société érigée à partir de l’individu, une volonté étatique construite à partir des volontés individuelles et devant servir le plus possible leur liberté et leur égalité, une fondation de l’État sur le contrat social, c’est-à-dire sur une formation intégralement rationnelle de la volonté générale à partir des volontés individuelles – tout cela accéda ici à une réalisation pratique radicale, après que les constitutions américaines en eussent donné un exemple enthousiasmant (mais loin d’être aussi révolutionnaire dans les dispositions de détail). Le contrat étatique ne signifiait plus que le pouvoir central assurait sa position à l’encontre de ses composantes particulières, les unifiant et se les assujettissant; il n’équivalait plus à une fondation rationnelle et à un prolongement des droits historiques positifs des peuples; il n’était plus le canon d’une réforme et d’un développement devant se rapprocher le plus possible de l’idéal. Il signifiait que l’État et la constitution devaient être fondés de façon purement rationnelle, conformément aux exigences de la raison; il signifiait la réalisation de la démocratie. Or cette idéologie entraîna du même coup des conséquences pratiques extrêmement radicales sur les plans politique, économique et ecclésial, [591] elle transforma et rationalisa toute [52] l’organisation de l’État, elle fit surgir du sol une armée populaire en armes afin de propager les droits de l’homme et elle se présenta aux États voisins comme leur sauveur et libérateur. Tout cela aboutit certes à l’empire napoléonien qui, à bien des égards, réaffirma la conception irrationnelle du pouvoir; mais même là, par son origine plébiscitaire, par son administration rationaliste uniforme et utilitaire, par la constitution démocratique de son armée, cet empire comportait encore bien assez d’idées nouvelles pour transmettre aux pays conquis l’esprit d’un État individualiste et rationaliste. Mais le reste de l’Europe prit peur face aux développements pratiques ultérieurs de ces idées. Les penseurs et les poètes qui avaient salué la Révolution américaine et le début de la Révolution française s’en détournaient à présent avec effroi. Kant, lui-même militant du droit rationnel, n’avait toujours considéré ce dernier que comme une règle pour un développement calme et légitime sous la conduite de l’intelligentsia. Schiller mettait maintenant son espoir dans une éducation esthético-culturelle des peuples, une éducation intérieure, préalable à toute formation de l’État rationnel, ce qui aboutissait pareillement à ce que l’aristocratie cultivée prenne la direction. Goethe, qui avait l’expérience personnelle du pouvoir, voyait maintenant le salut, plus encore qu’avant, dans un gouvernement rationnel et humain, et il tempêta toute sa vie contre la représentation populaire, la liberté de presse et la démocratie. Il s’ensuivit une désaffection générale de Rousseau, qui avait été jusque-là l’idole de la littérature. Là même où, pour reprendre l’expression de Gleisenau, on empruntait à l’arsenal de la révolution ses idées pratiques de réforme, on les associait en même temps, comme on va voir à l’instant, à des conceptions historiques conservatrices et aristocratiques complètement opposées, et c’est seulement ainsi conjuguées et réfractées qu’on leur accordait une valeur. En Angleterre, le gouvernement tory entreprit sa grande guerre contre la révolution, qui lui semblait mettre en péril toute la situation de l’Angleterre dans le monde. Les vieux États, notamment l’État frédéricien de l’absolutisme éclairé et l’Autriche issue du joséphisme, entreprirent une lutte continentale contre la révolution. L’issue victorieuse de la guerre remit partout à flot les puissances antirévolutionnaires [592] et alors commença la guerre interne de l’absolutisme renouvelé contre l’esprit de la révolution et du droit rationnel, pour laquelle on usa de toutes les tactiques de l’État policier et mit à contribution l’Église et l’armée qui, jusqu’aujourd’hui, sont avec l’administration les soutiens de ce qui reste de l’absolutisme. Pour les patriotes allemands et italiens, en particulier, commença l’époque des tribulations. Le nouvel ordre étatique antirationaliste craignait par-dessus [53] tout l’union de ces deux nations. Mais cela n’a pas besoin d’être exposé davantage. Ce sont des choses bien comprises et connues et les peuples européens tremblent encore d’indignation au souvenir de cette époque.
Ce qui est généralement moins connu et moins compris, toutefois, est le sens de la crise interne qu’a subie le romantisme et qui l’a fait s’inverser en son contraire. Par nature, le romantisme n’est nullement un principe de restauration: il est plutôt le sommet de la pensée proprement moderne et seule une dialectique très particulière a pu l’amener à tirer de lui-même des idées qui, selon les circonstances, ont plus ou moins soutenu la Restauration. Il prend racine dans le sentimentalisme qui était apparu dans tous les pays civilisés aux côtés de l’objectivité rationaliste; plus particulièrement, il s’enracine dans les intuitions poétiques relativistes de Herder et des écrivains du Sturm und Drang, dont le classicisme a repris une partie significative; ce sont ces intuitions qui, de temps à autre, ont fait éclater les limites de ce classicisme, donnant ainsi voix à une aspiration à l’immédiateté du sentiment esthétique. Dans tous les domaines, un subjectivisme et un relativisme effrénés furent ainsi introduits. La sensibilité esthétique redevint l’affaire du sujet génial et s’ouvrit à toutes les impressions présentes sur la surface de la terre. Elle se déplaçait entre l’Orient et l’Occident, entre l’Antiquité et le présent, avec une finesse des sens et une empathie infinies. Seuls subsistaient comme critères la génialité et la pureté de goût du critique, l’horizon de l’histoire universelle et l’éclairage qu’en reçoit l’individu. La partialité classique était surmontée; on raillait Schiller, on voyait en lui une régression à un étroit moralisme bourgeois et à demi rationnel; on théorisait Goethe en tant que génie universel, en tant que cosmos dans lequel tous les matériaux de la culture trouvent ordonnance; la génialité du sujet et l’étendue de la culture étaient des absolus. Cette agitation provoquée par l’esthétique du génie, [593] à laquelle se rallia la philosophie romantique du jeune Schelling, ne laissait plus aucune place pour le monde trivial des soucis politiques et sociaux. L’aristocratie de l’esprit jouissait d’elle-même et de son mépris pour la médiocrité petite-bourgeoise et les conventions. C’est en ce sens que Friedrich Schlegel a célébré la Révolution française, le Wilhelm Meister de Goethe et la doctrine de la science de Fichte – interprétée, certes, de façon tout à fait imaginaire en tant que sommet de l’individualisme souverain –, voyant là les trois grandes tendances du siècle. L’Athenäum des jeunes romantiques – qui, certes, n’avait paru que trois ans – était une revue authentiquement et véritablement révolutionnaire, avec toutes les audaces et toutes les irrévérences propres à l’esprit révolutionnaire. Mais ce relativisme et ce subjectivisme, [54] que seuls tempéraient une culture et un goût communs à tous ces auteurs, ne se confinèrent pas à l’esthétique et à la littérature: ils firent aussi incursion dans la morale et ils finirent par se découvrir une mission religieuse. On trouve là, de façon analogue à Nietzsche qui est beaucoup apparenté aux romantiques, une complète transvaluation de toutes les valeurs, un persiflage et un rejet de toutes les conventions, une morale aristocratique et esthétisante du génie, sise par-delà le bien et le mal, sans toutefois disposer encore comme Nietzsche de fondements darwinistes. Cette morale est un individualisme intégral: quelques-uns y accueillirent encore un peu du rigorisme et de l’universalisme kantiens, mais les autres congédièrent en tant que convention bourgeoise même la conduite de vie toute personnelle, entendue comme manifestation spéciale et esthétisante de la raison. Mais c’est avec Novalis et Schleiermacher que cet individualisme s’est fait le plus intransigeant, car ils firent passer même la religion sous la coupe de la pensée nouvelle. On célébrait ici l’état d’âme religieux, son pouvoir tout à fait personnel et indicible – un pouvoir immédiat, en vérité, qui ne s’exerce sur autrui que par suggestion; cet état d’âme peut bien s’accommoder de toutes sortes de symboles artistiques et de petits cercles de recueillement personnel, mais en aucun cas de dogmes rationnels généraux et d’une constitution générale bourgeoise, ou Église. Il est évident que Schleiermacher songe à l’idéal de l’ordre ecclésial que lui présente la Révolution américaine. Mais il va aussi bien au-delà. La religion est complètement intériorisée, spiritualisée et individualisée, et cela va jusqu’à la suppression de tout culte commun, de tout dogme et de toute doctrine, de toute Église et de toute constitution. Elle est évidemment séparée aussi de la [594] morale et ne se manifeste que comme fondation métaphysique d’un individualisme radical qui proclame la liberté et la particularité morales. On ressuscite les vieux spiritualistes, un Jakob Boehme et les néo-platoniciens, on renouvelle les symboles poétiques de la mystique christique et mariale en tant que s’opposant à toute doctrine rationnelle et générale. La religion doit être dénuée de toute attitude bien-pensante, elle est la poésie de la poésie, un sens et un goût de l’infini, la métaphysique de l’individualisme absolu, elle fait de chacun un théâtre où l’esprit du monde se révèle à lui-même, elle manifeste à chacun son essence absolument propre. L’histoire du monde et de la littérature devient tout entière un arsenal de motifs religieux servant à la formation du goût. Le christianisme devient la religion des religions, c’est-à-dire une force jamais achevée qui élabore tous ces motifs et instaure une médiation entre l’esprit infini et l’esprit fini, en un contact personnel toujours neuf; cela prend des accents davantage enfantins, poétiques et religieux chez Novalis, davantage abstraits, philosophiques et toniques chez Schleiermacher. Sous tous les rapports, on a là [55] une révolution totale, non pas cependant de type politique et utilitaire, mais une révolution éthico-poétique, ce qui en vérité la rend infiniment plus individualiste – il s’agit même, de façon générale, de la première expression véritable et plénière de la pulsion individualiste de vie, voulue pour elle-même, sans égard à des fins pratiques secondaires et à l’utilité. Elle est pour cette raison d’autant moins capable d’intervenir positivement dans la vie pratique, mais aussi, en vérité, elle se révèle infiniment plus dissolvante et destructrice pour l’État, la société et la famille, l’Église, la religion et la moralité – elle n’est donc pas sans effets pratiques importants, et surtout des effets potentiels.
C’est le pressentiment de ces conséquences qui a poussé tous les principaux romantiques de la première génération à corriger ou même à inverser cet individualisme. Ce processus, nul ne le donne mieux à voir que Novalis: sensible à l’effet dissolvant et destructeur, il crut trouver un remède dans le renouveau d’un Moyen Âge poétisé. Ce remède lui semblait s’offrir spontanément dès lors qu’on donnait une extension religieuse à l’historicisme et à l’individualisme romantiques: ceux-ci, en effet, paraissaient révéler au sein du sentiment religieux l’aurore d’un nouveau pouvoir unifiant. Novalis reconnut explicitement [595] l’absence de toute force sociologique de récollection et de façonnement au sein de la civilisation moderne, et, dans son essai « La Chrétienté, ou l’Europe », il opposa à cela le Moyen Âge et le catholicisme. Celui-ci lui paraissait non seulement plus religieux et plus poétique que le classicisme néo-païen, mais aussi et surtout plus organisateur. Ici résonne déjà un thème qui sera si souvent repris par la suite, celui de la division et de l’absence d’organisation, du prosaïsme et de l’extériorité des temps modernes. Mais c’est du sein même de cette grave crise que naît aujourd’hui le nouveau. « L’anarchie véritable, dit-il, est l’élément natal de la religion. C’est du sein de la destruction de toute croyance positive qu’elle relève sa tête glorieuse et recrée un univers. L’homme s’élève au ciel tout naturellement dès que plus rien ne le bride, les organes supérieurs émergent les premiers, et comme d’eux-mêmes, du mélange général et uniforme, de la complète dissolution de toutes les facultés et de toutes les forces humaines, et forment le noyau originel d’un nouvel organisme terrestre. » [1] Et afin que l’on n’associe pas cela simplement à l’anarchie de la révolution, il poursuit en se référant clairement au romantisme : « Il semble que s’éveille de toute part un puissant pressentiment de ce que sont la liberté créatrice, la grandeur sans bornes, l’infinie diversité, l’originalité sacrée et l’aptitude universelle [2] de l’être humain. [3] Tout cela n’est encore qu’à l’état d’indications incohérentes et sommaires, mais elles trahissent au regard de l’historien une individualité universelle [4], une [56] histoire nouvelle, une humanité nouvelle, la suave étreinte d’une jeune Église surprise et d’un Dieu aimant, la conception intime d’un nouveau messie dans les mille membres de cette Église à la fois. Qui donc ne ressent la douce honte d’avoir été fécondé ? » [5] Comme Schleiermacher, Novalis découvre dans le romantisme le remède contre ses propres périls apparentés à ceux de la révolution. Ainsi, un lien international qui unirait tous les peuples ne lui semble possible que dans l’Église, et celle-ci, avec son symbolisme et sa poésie, lui paraît apte à concilier l’individualisme le plus personnel avec la plus vaste universalité. Tout conflue dans cette direction : l’universalisme historique du romantisme, qui a redécouvert à côté de l’Antiquité et du classicisme la poésie du Moyen Âge et l’ordonnancement médiéval de la vie; l’aspiration à la mystique religieuse et à son expression poético-symbolique; le [596] sens historique et les instincts conservateurs, nourris de la science de l’histoire; le sentiment d’opposition à la culture moderne d’entendement et d’utilité; le besoin d’un support sociologique pour l’éthique et la religion, sans dogmatisme et sans moralisme. À l’époque, cet article parut douteux à Goethe et il déconseilla sa publication dans l’Athenäum; ce texte n’a donc pas eu d’effet public. Mais il était symptomatique des tendances internes du cercle romantique. Friedrich Schlegel, le plus hardi de ces révolutionnaires, passa peu à peu au catholicisme et se fit le défenseur de la Sainte-Alliance. Sous l’effet de la catastrophe de l’État prussien, Schleiermacher transforma son individualisme religieux en une reconnaissance résolue de l’Église populaire, cadre indépassable des variations individuelles; pour ce qui est de l’État et de la société, une organisation et un ordre stables lui parurent ici indispensables et il réclamait que l’individu s’y sacrifie généreusement. Mais la transformation dont témoignaient ces très visibles représentants se produisit également en secret chez d’innombrables individus. La pensée historique, la doctrine de l’esprit du peuple et de l’esprit commun qui produit les mœurs et le droit, la théorie mystico-organique de la société selon laquelle l’individu provient de l’esprit général et y retourne en s’y vouant consciemment, la conception selon laquelle toute culture déploie l’esprit général d’une manière non pas artificielle et consciente mais plutôt organique et nécessaire, le recours à l’idée mystique de l’unité de l’Église et aux idées médiévales d’association – toutes ces théories sociologiques antirationalistes et antirévolutionnaires encore à l’œuvre aujourd’hui ont pris naissance sur ce sol. Elles pouvaient, comme déjà l’avait fait la [57] théorie sociale organique du Moyen Âge, se présenter comme étroitement apparentées à des idées d’allure démocratique ou du moins fortement individualistes, elles pouvaient également professer que l’esprit général se réalise au sein de l’individu, et appeler à sa réalisation; un même fil conducteur va ainsi de la démocratie mystique du jeune Görres jusqu’aux imaginations des associations d’étudiants radicales. Mais les mêmes pensées pouvaient être interprétées dans le sens de l’esprit commun qui domine et conditionne toutes choses; [597] elles étaient alors au service d’un État conçu comme incarnant la raison, ainsi que l’avaient pensé naguère Platon et Aristote, ou d’une conception de l’Église selon laquelle le corps mystico-symbolique de la communauté de foi confère à toute la société son unité intérieure et son organisation extérieure de vie. [6] C’est ainsi que Chateaubriand a dépeint « l’esprit » du christianisme, dans un écrit parallèle à l’« Europe » de Novalis : une auto-analyse poétique très raffinée de la conscience s’y mue en découverte de la conscience commune et des puissances irrationnelles apparentées généralement à cette mystique; il n’y a là nulle restauration du catholicisme ancien, mais l’espérance d’un catholicisme nouveau. Partout, ce faisant, l’esprit moderne était préservé : l’individu demeurait toujours actif dans la constitution de l’esprit général, et celui-ci était pensé dans son mouvement vivant; cependant, tout prenait racine dans le transsubjectif et l’irrationnel, dans le préconscient et le sous-conscient, dans les forces de communauté prévalant sur tout calcul individuel. De là, on passe au socialisme d’État de Rodbertus, au concept d’association que Gierke a magnifiquement développé et subtilement distingué de l’idée rationaliste et individualiste de corporation, ainsi qu’à la doctrine historique des idées de Leopold von Ranke. Tout ce qu’on range sous le vocable d’« école historique » en théorie de l’État et du droit a pris naissance sur ce sol. Il est clair également que l’antirationalisme mystique sous-jacent à cette pensée « organique » a pu se donner libre cours, affirmer encore davantage l’irrationalisme et l’associer à la volonté divine, à la révélation naturelle et surnaturelle. La philosophie de l’État et du droit de Julius Stahl a refait surface, avec la doctrine conservatrice irrationaliste concernant l’essence du pouvoir, redonnant ainsi vie à de vieilles idées luthériennes; tout cela n’était nullement dicté par le seul intérêt des anciens rangs sociaux, mais découlait des conséquences de la pensée antirationaliste en sociologie. Dans le même sens, la plume brillante du diplomate Maistre dépeignait l’absolutisme et, en rapport à cela, la monarchie papale universelle comme étant [598] la conséquence logique de l’idée d’organisation. Partout disparut la théorie du contrat, tenue désormais pour un misérable modèle [58] d’afféterie. On en prit congé même dans sa grandiose version kantienne, en tant qu’idéal régulateur pour les formations sociales issues d’abord de l’intérêt et de l’appétit de pouvoir. Partout se fit jour une disposition et une pensée nouvelles relativement au problème du rapport entre l’individu et la communauté.
Outre les deux grands mouvements mentionnés jusqu’ici, d’autres doivent également être pris en considération à cause de leur contribution plus ou moins directe à l’émergence d’un nouvel esprit. Le moindre, ici, n’est pas l’idéal de nationalité des grands réformateurs prussiens, en particulier la conception de l’État et l’éthique étatique du baron von Stein. Cette conception n’a absolument rien à voir avec le romantisme et, en dépit de recours considérables aux institutions françaises nouvelles, elle a également peu à voir avec les idées françaises. Elle est originale et prend plutôt sa source dans des études historiques, dans une admiration pour l’Angleterre, dans l’expérience administrative et dans les convictions éthiques de Stein lui-même. Ici aussi, un concept mystique irrationnel, celui de la nation ou du caractère allemand, règne sur les destinées et les tâches de l’individu. Stein considère la nation comme une communauté spirituelle de culture soutenue par une parenté de filiation et de langue qui a besoin d’une forme étatique stable afin d’être une véritable puissance éthique de vie. Mais cette totalité requiert de l’individu qu’il en prenne lui-même la responsabilité personnelle et qu’il se donne à elle. C’est en ce sens que Stein cherchait à transformer la constitution et l’administration au moyen de la plus grande extension possible de l’autonomie administrative, et c’est encore en ce sens qu’il appela le peuple à lutter pour sa libération et en particulier qu’il donna son accord au plan de réforme militaire de Scharnhorst. Ici, le tout avait historiquement et factuellement une préséance constante sur l’individu; c’était grâce à ses chefs idéalistes que la population s’éduquait à la liberté et à l’auto-administration. Cette dernière, en particulier, présupposait la structure historique des rangs sociaux et des communes, et tout était construit sur les notions d’inégalité, de responsabilité des chefs envers ceux qu’ils dirigent. Toute cette conception tire son sens et sa force de l’exigence éthique de se vouer au tout spirituel de l’État et des actions responsables qu’entreprend l’individu en faveur de ce tout. [599] La communauté elle-même, avec ses structures, est quelque chose d’historique et d’irrationnel, et l’appel lancé à l’individu est purement éthique et donc, ici encore, irrationnel. Il n’est pas étonnant que Stein se soit senti proche de Fichte, lui qui avait renoncé à l’État rationnel abstrait et s’était fait le prophète de l’irrationnel, de l’historique et de l’individuel. Cette idée de la nationalité associa donc aussi la religion à l’administration de l’État et considérait les deux confessions [59] comme des soutiens du sens commun éthico-national; l’État devait les organiser et non plus simplement, comme l’État de l’Aufklärung, les surveiller et en tolérer la présence à ses côtés. Agacés, des hobereaux nostalgiques de la vieille Prusse ont certes pu qualifier Stein de jacobin et, plus tard, les libéraux ont pu se sentir héritiers de son époque, mais la pensée même de Stein accordait une part importante à l’idée de pouvoir et d’organisation, à la hiérarchie historique et à l’inégalité, à l’irrationalité mystique d’une idée de communauté insaisissable par l’entendement. Aussi ces réformes, même abstraction faite des obstacles et d’abrogations ultérieures, ont-elles produit un renforcement du pouvoir étatique ainsi qu’une concentration et une uniformisation de l’ensemble de la province, encore très morcelée à l’époque.
Or c’est partout cette dialectique interne que connut l’idée de nationalité, même lorsque ceux qui l’affirmèrent n’eurent pas au départ aussi clairement conscience que Stein de son caractère historique irrationnel. Même formulée de façon plus démocratique, elle devint une apothéose de l’esprit commun et de la propriété de tous, une réalité mystique qu’il fallait transformer en un pouvoir efficace en lui donnant forme d’organisations et de concentrations correspondantes. Déjà, l’idée napoléonienne d’État mua cette idée de nationalité en un impérialisme abrogeant la liberté et l’égalité, et ce destin s’est partout répété à travers cette production de la démocratie. La nationalité doit affirmer et protéger la propriété de tous, la garantir pour tous les membres de la race, la rendre accessible aux affligés et aux opprimés – en d’autres termes, elle doit devenir un pouvoir organisé et, dans cette mesure, elle répond à la logique de l’idée de pouvoir. Or il suffit que les buts de cette logique soient clairement reconnus pour que se mette à chanceler toute l’idéologie démocratique. C’est pourquoi elle est remplacée aujourd’hui par des doctrines darwinistes à propos de la lutte pour l’existence, de l’adaptation et de la transmission héréditaire, ou encore par des exigences purement éthiques [600] et religieuses qui réclament de l’individu don de soi et soumission, comme si ces choses avaient valeur pour elles-mêmes. Aujourd’hui, l’idée de pouvoir fleurit plus que jamais au sein de nos démocraties partielles ou totales et, qui plus est, elle s’est étroitement associée à la politique économique. Cette logique de son développement, on peut l’observer au sein de l’État et de la nation, mais aussi à petite échelle, au sein de partis, d’associations, d’organisations de classes. Chaque organisation monte en épingle l’esprit commun et se soumet aux conditions nécessaires à la constitution du pouvoir, elle engendre donc quelque chose qui paraît irrationnel du point de vue du pur intérêt rationnel de l’individu et que seul un point de vue tout autre permet de considérer comme émanant de la « raison », c’est-à-dire comme une « raison » supra-individuelle, cosmique, voire même divine.
[60]
Une quatrième série de causes [à la Restauration] tient à la religion et aux Églises, à leur développement interne qui, assez souvent, a été asservi à des intérêts politiques, à un fanatisme rétrograde ou à un besoin clérical de pouvoir, mais qui, d’abord et avant tout, tient à leur essence même. Certes, l’Aufklärung avait atténué les oppositions des confessions protestante et catholique sur les articles de foi, elle avait diminué la contrainte dogmatique et cultuelle et, en particulier, la philosophie et la théologie avaient entrepris une réforme en profondeur des conceptions religieuses. Mais les Églises, pendant ce temps, étaient demeurées sous le contrôle complet des gouvernements des États et n’étaient pas représentées au sein du peuple par des partis ou des mouvements. Sur le continent, le nouveau concept collégial d’Église n’avait d’aucune manière amené les Églises à se détacher de l’État. Partout dans le protestantisme, ce nouveau concept avait pris une tournure telle qu’il revenait à l’État de maintenir l’ordre et la stabilité, soit en vertu du droit de regard de l’État, soit parce que le gouvernement des Églises s’en était tacitement remis à l’État pour cela; quant aux communautés particulières, leurs représentants, les pasteurs, avaient la liberté en matière de religion, de théologie et de culte, sans être dérangés par l’État. Tout radicalisme trop affirmé était réprimé et il n’y avait pas encore d’ingérence et d’agitation de la part des communautés et des partis ecclésiaux. Dans le catholicisme, pareillement, l’Aufklärung penchait pour le concept épiscopalien et gallican d’Église et ce concept trouvait un soutien dans l’association de l’État [601] et de l’Église, dans la propriété foncière de l’Église et dans le cléricalisme de l’institution princière. Mais à présent, lorsque, sous l’effet de la révolution, des sécularisations, des fondations napoléoniennes d’États et du Congrès de Vienne, toutes ces choses furent supplantées par une technique administrative modernisée, les Églises se virent placées devant la tâche de se réformer elles-mêmes et de repenser leur rapport à l’État.
Dans la théologie et l’Église catholiques, les idées nationalistes épiscopaliennes et gallicanes agirent encore longtemps et la théologie s’allia de multiples manières à la pensée philosophique moderne. Toutefois, les évêques, privés du soutien que leur procuraient les seigneuries et les princes et n’étant plus issus de la haute noblesse, n’avaient plus le pouvoir dont ils avaient joui jusque-là de résister à Rome. Par ailleurs, les États policiers bureaucratiques redoutaient les Églises nationales, y voyaient un élément perturbateur dans la structure purement politique de l’État. Aussi laissèrent-ils Rome agir à sa guise avec les évêques isolés et, puisqu’une réforme était vraiment inévitable, celle-ci fut confiée à la seule curie. Ainsi, la porte était toute grande ouverte aux théories centralisatrices et jésuites, aux réclamations d’un épiscopat universel du pape et de son infaillibilité, ainsi [61] qu’à la diplomatie de la curie, avec sa réorientation des diocèses et de l’administration ecclésiale. Abandonnés par l’État, privés de ce qui jusqu’alors leur avait donné un poids social considérable, les épiscopats tombèrent peu à peu aux mains de la papauté nouvellement centralisée. Le besoin d’ordre et de centralisation dans l’Église fit voir dans l’épiscopat universel un aboutissement et l’on comprend ainsi que le concile du Vatican ait finalement atteint ce but, après que Grégoire XVI et Consalvi eussent préparé le terrain, précisément à l’époque de la Restauration. Cela se produisit en désaccord avec la majorité des évêques du Nord et en opposition aux tendances de la théologie scientifique, en opposition aussi avec les gouvernements d’alors, dont les intérêts étaient tout à fait ceux d’États policiers. C’était là la simple conséquence de la nécessité de réorganiser l’Église, d’accentuer son point d’unité et de définir de façon plus claire et uniforme les relations de l’épiscopat et de la curie. Mais la conséquence de cette concentration menée depuis l’intérieur fut la suppression des modernismes en théologie, l’extirpation [602] de toutes les influences venues des Lumières, de la philosophie classique et du romantisme, et ce romantisme finalement ne fut plus considéré que comme un pont tendu poétiquement vers un idéal sociologique d’unité rationnellement conçu. C’est seulement à partir de là que l’on peut comprendre la gigantesque restauration du catholicisme, sa clôture toute militaire et sa solidarité de parti, sa théologie néo-scolastique et son éveil de cultes nouveaux et attrayants pour le peuple, avec leurs miracles, leurs sanctuaires et leurs dévotions. La solution qu’avait trouvée l’Aufklärung au problème ecclésial n’était en vérité rien de neuf, simplement une atténuation et une réfraction des tendances logiques du catholicisme centralisé depuis le concile de Trente, et cette atténuation n’avait été possible qu’avec le maintien des privilèges à demi étatiques des évêques au sein de l’État éclairé. Ces conditions ayant disparu, la logique centralisatrice eut carte blanche et parvint à son but naturel, en dépit de toutes les contradictions et oppositions de la part de l’épiscopat, de la théologie et du sentiment populaire.
En pays protestant, les choses se déroulèrent semblablement et pour des raisons similaires, comme le montre la création de l’Église protestante provinciale sous Frédéric-Guillaume III et Frédéric-Guillaume IV. Après la disparition de l’État de l’Aufklärung, qui mélangeait la domination étatique sur l’Église, caractéristique de l’ancien protestantisme, et la liberté de croyance et de conscience dans les communautés, caractéristique du protestantisme nouveau, après qu’eussent été formés les États confessionnellement mixtes du Congrès de Vienne et que l’administration étatique centralisatrice [62] eût été contrainte de réordonner et de délimiter le domaine politique et le domaine ecclésial, il subsistait encore un urgent besoin de réformer de façon autonome et en vase clos le régime ecclésial protestant. En Prusse, on demanda à cette occasion, en 1815, de nombreux avis qui montrent combien la situation était intenable et chaotique; on avait besoin, comme le disait un avis, d’une « autorité sociale de la part de l’Église ». Mais à cette fin il n’y avait que deux voies possibles. Ou bien, à la manière du presbytérianisme, on créait une Église synodale libre à l’égard de l’État – or déjà, même les propositions en ce sens montraient que cela aurait pour effet secondaire un nivellement dogmatique et cultuel et une concentration cléricale; [603] étant donné les habitudes luthériennes de la majorité et les besoins de l’État policier, il ne fallait donc pas y songer. Seule demeurait donc l’autre voie : séparer l’organisation étatique et l’organisation ecclésiale, puis lier cette dernière à la personne du seigneur du territoire qui, en tant qu’« évêque provincial », gouvernerait grâce à une administration ecclésiale propre; étant en même temps le chef de l’État, il réaliserait ainsi l’union dans sa propre personne des deux institutions et assurerait donc leur accord. C’est ainsi que furent mis sur pied la nouvelle Église unie et son gouvernement ecclésial provincial, au milieu des hésitations et surtout des résistances de la population. Sur ce point encore, l’Aufklärung n’avait en vérité rien créé de neuf : elle s’était contentée d’assujettir les conditions antérieures à une interprétation théorique nouvelle et à une pratique dictée par le seul intérêt de l’État, préservant ainsi la stabilité de l’ancienne organisation tout en autorisant la liberté de dogme et de culte réclamée par l’esprit moderne. Or cela ne pouvait plus durer. Dans l’État confessionnel mixte et au sein de l’ordre étatique nouveau, l’Église devait elle aussi être réorganisée, ce qui voulait dire ici entièrement recréée en tant qu’Église protestante autonome. Elle reçut son propre appareil administratif, habilement apparié à la monarchie. Ce que cette administration ecclésiale a réalisé en propre, c’est naturellement, outre l’organisation de l’autorité et des finances, l’instauration immédiate de l’uniformité cultuelle et dogmatique à travers la liturgie et la confession de foi; ce faisant, les anciens dogmes – certes au prix d’un certain affaiblissement – ont évidemment servi de critère, en tant que seul bien commun disponible. Mais par là déjà, les nouvelles libertés et les progrès religieux et théologiques se trouvaient à nouveau éliminés en principe, le régime ecclésial était organisé, restauré et astreint à une unité sociologique manifestée dans le dogme et la liturgie. Il ne faut donc voir qu’une suppression des vestiges de l’époque antérieure dans le fait que la théologie de la cour de Frédéric-Guillaume IV élimina complètement de l’Église l’esprit du grand siècle, ainsi que l’avait fait en sol catholique la curie jésuite. [63] Or ce qui s’est produit en Prusse s’est répété partout ailleurs sur le continent, ce qui montre bien que ces développements ne furent nullement l’œuvre du hasard ou de l’arbitraire. Dans les pays catholiques, les Églises protestantes adoptèrent une structure analogue et donc, même les monarques catholiques durent [604] assurer la direction d’une administration ecclésiale « provinciale ». On ne pouvait faire autrement.
Dans ce contexte, il ne faut toutefois pas oublier qu’outre les formes nouvelles d’organisation, qui menèrent à des restaurations relatives par la simple logique des choses, il y eut aussi une réaction religieuse intérieure contre l’Aufklärung, un de ces renversements du sentiment religieux comme il s’en présente si souvent, apparemment à l’improviste, et où l’on délaisse l’étroitesse et la passion dogmatiques au profit d’une attitude d’indifférence et de liberté d’action dans le monde, puis, partant de là, où l’on retourne à des états de forte excitation religieuse. Mais les deux mouvements [, c’est-à-dire la réorganisation institutionnelle et la réaction religieuse intérieure,] doivent être strictement distingués; ce n’est que peu à peu qu’ils se sont rejoints et mutuellement renforcés, non sans de nombreuses frictions qui ont lieu encore aujourd’hui.
Les Lumières avaient réagi salutairement à la malédiction du confessionnalisme, mais leur esprit, jusque dans le classicisme et le néo-humanisme, avait été davantage séculier et humain; elles avaient abordé la religion de façon superficielle et lui avaient ôté toute force. Déjà dans l’Angleterre du xviiie siècle, pays qui fut à l’avant-garde de tous les mouvements européens, le méthodisme s’était élevé contre cela, et ses grandes campagnes d’éveil, qui atteignaient même l’Amérique, avaient restauré l’ancienne foi en présentant d’elle une synthèse fortement marquée d’affectivité. C’est le méthodisme qui a mis fin à l’époque des Lumières en Angleterre, non seulement par son action ecclésiale proprement dite, mais aussi par son effet sur les dissenters et sur l’Église d’État. De là, il a continué à transformer secrètement le régime ecclésial anglais. Dans les années trente, sous l’influence du romantisme continental, apparut le mouvement ritualiste d’Oxford; sous l’influence du méthodisme, il y eut également une activité piétiste considérable de mission et d’éveil, qui provoqua aussi sur le continent des réveils similaires. Ces interventions, ainsi que les vieux cercles piétistes toujours vivants, ont suscité plusieurs réveils et de nombreuses conversions en France, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Scandinavie, renforcés en cela par la religiosité romantique et par les grandes luttes de libération qui ébranlèrent la religiosité et l’historicisèrent; ces réveils affectèrent d’abord la fonction de pasteur et, de là, gagnèrent les communautés mais parfois, certes, davantage encore les cercles dirigeants. Ces mouvements oscillaient [605] entre un biblicisme archaïque et l’insistance sur l’intériorité de la conversion personnelle, [64] d’où leur caractère double: d’une part une subjectivité très moderne, d’autre part une autorité très rivée à l’histoire. Tout cela est passé ensuite dans les nouvelles formations ecclésiales, naturellement conservatrices. Sur le plan théologique, l’art romantique, avec sa synthèse toujours tenace de subjectivisme et de substance historique, a donné à ce mouvement religieux une expression chatoyante qui, finalement, s’est muée spontanément en une confessionnalité plus stable et, sur plusieurs points, s’est achevée par une restauration presque inconditionnelle de la dogmatique du xviie siècle. En sol catholique, de pareils mouvements ne se firent pas non plus attendre. Au xixe siècle se remirent à pulluler visions, miracles, stigmatisations, et de là surgirent partout de nouveaux cultes mis à profit par l’Église. Ce sont là des parallèles catholiques aux mouvements de réveil protestants. Une littérature ascétique qui fouettait sans scrupule les sentiments et qui, à l’occasion, éveillait aussi les superstitions, travaillait le peuple. De nouveaux cultes de saints, de nouvelles dévotions, des missions et des pèlerinages, un nouveau dogme marial accrurent et excitèrent la religiosité populaire, pendant qu’une théologie teintée de romantisme, dans l’esprit de Chateaubriand et de l’école de Tübingen, préparait lentement le retour à la restauration du thomisme scolastique, tout en le mettant au goût du jour. La Theologie der Vorzeit [7] l’emporta sur l’école de Möhler et de Döllinger qui, en vérité, l’avait préparée. Le résultat final fut un renouveau de la théologie et de la philosophie médiévales, ainsi que la création d’une tradition de recherche historique catholique portant sur tout le champ du catholicisme, pendant que le besoin populaire, lui, se trouvait excité et satisfait par des dévotions nouvelles plus nombreuses que jamais. Cette réaction religieuse atteignit jusqu’au monde russe; là, elle prit la forme d’un esprit du peuple aux traits russes orthodoxes, interprété en un sens romantique et opposé aux idées incohérentes de l’Occident corrompu.
Chacun des faits particuliers exposés jusqu’ici est un signe du grand bouleversement qui eut lieu vers la [fin du] xviiie siècle; quant à la signification globale et générale de ces changements, les prises de position des grands penseurs et publicistes en donnent pour finir un éclairage privilégié. [606] L’initiateur ici fut le vieux libéral anglais Edmund Burke. Animé d’un sens historique aigu des hiérarchies et des autorités sociales en place, pénétré d’une conception toute éthique des devoirs et des droits de l’individu en regard du tout, Burke devint le grand adversaire de la Révolution française et de sa construction rationaliste abstraite de la société, après avoir mis l’accent dans la première moitié de sa vie sur le côté libéral de cette pensée. [65] Il s’enracinait dans la conception puritaine de la liberté en tant que devoir et de l’inégalité sociale en tant qu’ordre instauré par Dieu, conception dans laquelle une foule de vertus éthiques ont leur origine. Surtout, il insistait sur le caractère organique lent et graduel de toute croissance historique, dont l’individu est une composante. Il se rapprochait en cela des théories tardives du romantisme continental qui, d’ailleurs, ont reçu de lui des impulsions durables. Déjà les dogmes de la condition originelle et du contrat social lui paraissaient douteux et, dans la mesure où il maintenait ce dernier, il l’interprétait au sens puritain ancien du devoir éthique des dirigeants, et de la collaboration hiérarchisée des classes historiques au bien de la totalité. Les pensées de Burke ont joué un rôle considérable sur la scène de l’histoire universelle; elles ont été reprises aussi bien par un Novalis que par un Maistre et par Friedrich Gentz, qui les ont prolongées chacun à sa manière.
En Allemagne, le kantien Fichte se fit le prophète et le philosophe d’une pensée sociologique nouvelle. Fichte qualifiait à présent le siècle du rationalisme abstrait d’ère de la culpabilité et de l’égoïsme parfaits. Il découvrait dans les nationalités les grandes formations historiques de la raison: en tant que trait d’union métaphysique entre la raison universelle divine et la raison de l’individu singulier, chaque grande nation pouvait révéler et mettre en oeuvre, d’une manière qui lui est propre, le contenu rationnel concrétisé en elle. Cette idée éthique de la nationalité lui paraissait liée à des formes politiques stables: il rendit à celles-ci leur position centrale et proclama un État idéal rappelant l’État platonicien par son exigence d’une éducation étatique, et le socialisme par son exigence d’une stricte fermeture économique. Il s’agit là, certes, d’un socialisme au sens platonicien du terme, [607] qui ne recherche pas la satisfaction des égoïsmes particuliers à partir d’un tout conçu à cette fin, mais qui veut plutôt montrer l’inscription de l’idée spirituelle dans le tout et donc aussi la participation de l’individu à cette idée. Les deux autres grands chefs du renouveau prussien, Wilhelm von Humboldt et Schleiermacher, ne furent pas aussi radicaux dans leur développement du monde idéel nouveau. Humboldt, qui est toujours demeuré personnellement un disciple du grand siècle humaniste, s’est trouvé cependant conduit par ses études historiques et psychologiques aux problèmes de l’esprit du peuple et du caractère national. Il enseigna à considérer l’État, qu’au début il voulait restreindre à un minimum, comme la forme et le support de l’esprit. Ainsi se rapproche-t-il lui aussi à sa manière de la conception antique de l'État en tant que totalité subsumant les individus, une totalité empreinte de substance éthique et spirituelle. Schleiermacher, qui, en sa jeunesse, avait trouvé l’individualisme kantien [66] encore trop général et abstrait et lui avait préféré l’individualisme romantique en matière de morale et de religion, enseigna à considérer le système de la culture, ou raison, comme la force qui propulse l’histoire et le développement humains, et il distinguait à présent soigneusement entre le côté individuel et personnel de toutes les valeurs culturelles et leur côté universel, créateur de la communauté; il fit ainsi voir dans l’État l’organisation communautaire essentielle, indispensable à la raison, dans laquelle le tout et l’histoire subsument l’individuel et le moment. Il aspirait même, maintenant, à ce que la religion elle-même s’organisât en une Église populaire la plus vaste possible, une Église dans laquelle l’esprit du tout animerait les individus et qui trouverait son lieu stable dans l’éducation élevant les peuples à la moralité et à la culture. Toutefois, c’est à Schelling que la pensée sociologique nouvelle doit ses formules les plus importantes. Il est le créateur de l’idée « organique » de la société, non pas au sens biologique et naturaliste du terme, mais au sens idéaliste, téléologique et métaphysique. Son monisme cosmique, qui perçoit dans le sensible et le fini l’expression et la manifestation de l’esprit et qui conçoit le développement universel comme une croissante révélation de ce rapport d’identité, enseigne à voir dans l’État et la société la révélation sensible finie de l’esprit en ses [608] divers stades de développement. L’organisme social, tout comme l’organisme biologique, prend forme à partir d’un devenir historique préconscient : la substance spirituelle prend corps, se sensibilise et s’organise dans un stade déterminé; l’individu surgit de l’esprit du tout; cet individu est éduqué pour prendre part consciemment et contribuer à ce tout; le tout n’existe que dans les individus, et ceux-ci n’existent que par le tout. Le sens de cette construction est non pas le bien matériel ou la liberté politique de l’individu, mais plutôt la présentation de l’idée d’une unité culturelle déterminée, telle qu’elle œuvre au sein du matériau individuel et grâce à la contribution consciente de l’individu. C’est seulement lorsqu’il se voue concrètement à l’idée régissant l’organisme que l’individu acquiert une valeur, et les termes « liberté et égalité » ne décrivent en aucun cas cette valeur. Dans sa doctrine ultérieure, Schelling a distingué entre le développement naturel et la rédemption surnaturelle, laquelle se réalise dans et au-dessus de la nature; il a ainsi assorti la notion de société du concept d’Église, ce qui a occasionné de nombreux infléchissements de son évolutionnisme fondamental. C’est à cette dernière version qu’a eu recours le plus grand historien allemand, Leopold Ranke, tandis que la Restauration s’appuyait sur la première doctrine schellingienne pour formuler sa philosophie de l’État. Mais il n’est pas jusqu’au socialisme d’État d’un Rodbertus qui ne prenne appui sur un fondement schellingien. [67] Quant à celui qui clôt la grande spéculation allemande, Hegel, sa doctrine de l’État et de la société est d’un antisubjectivisme encore plus radical. Alors que Schelling garde quelque chose de Heinz Widerporst à travers toutes ses mutations, Hegel, lui, est d’une fermeté très substantielle. Comme Fichte, il voit dans le mauvais subjectivisme de la réflexion le grand péché du xviiie siècle, mais il en retire quelque chose de positif, la préparation d’une notion nouvelle de société. Cette notion présuppose la désintégration du Moyen Âge par le subjectivisme mais, de ce matériau, elle tire une idée nouvelle de l’État, conçu comme la réalisation de la raison objective et comme incarnation de la moralité en général. On n’a plus là l’« homme en grand » de Platon ou l’organisme comme expression de l’idée, mais bien l’entéléchie aristotélicienne, le but du développement rationnel [609] en général. C’est l’idée antique de l’État, mais transposée aux dimensions des nationalités modernes. Cette idée est empreinte d’une estime toute chrétienne pour l’individu, mais elle réalise la fin et le sens suprêmes de la raison exclusivement dans les formes étatiques stables développées au cours de l’histoire. L’État est l’incarnation de l’idée, de la raison supra-individuelle, afin qu’au sein de ce tout l’individu s’élève à l’idée en suivant les degrés historiquement conçus de l’étagement social. L’État, s’il se soucie de l’individu et si celui-ci en retour se dévoue à son idée, met fin à tout utilitarisme et à tout mauvais subjectivisme, à tout ce qui n’est que société et association en vue de buts, mais aussi à toute religion et toute Église; en lui s’accomplit la personnalité libre, en lien organique avec la raison universelle qu’il incorpore. C’est là-dessus que prend fin pour longtemps en Allemagne la nouvelle pensée sociologique.
La philosophie française a alors pris le relais. Très tôt déjà, Saint-Simon avait reconnu l’effet anarchiste dissolvant du xviiie siècle et, un peu comme Novalis, il avait renvoyé au Moyen Âge comme au temps idéal de l’organisation et de l’unité sociales. Lui aussi était conscient que l’unité d’alors ne s’était réalisée que par le sentiment religieux et la communauté religieuse, qui cimentaient l’organisation sociale. Il envisagea donc un troisième règne, celui d’un socialisme religieusement fondé et consolidé qui sauverait du cauchemar de l’anarchie et de l’individiualisme sans retomber dans le dogmatisme théologique du Moyen Âge. Comte reprit ces idées dans son grand système, le positivisme, un système d’orientation essentiellement naturaliste et antimétaphysique. Le xviiie siècle lui apparaissait à lui aussi, comme à Novalis, Fichte, Hegel et [68] Saint-Simon comme l’âge métaphysique, celui d’une construction intellectuelle des choses et de la société à partir de l’arbitraire des intérêts individuels; il voyait là l’époque la plus funeste de l’histoire humaine, commencée avec le protestantisme et menée à son achèvement par la Révolution française. Lui aussi tenait l’Église médiévale, la plus grandiose création de l’ère mythico-théologique, pour le modèle d’un façonnement sain et solide de la communauté humaine. Toutefois, [610] le mythe et la théologie n’étaient à son avis qu’un écho de l’ignorance primitive quant à la nature. Ce qui avait cimenté l’organisation sociale à l’origine des grandes réalisations du Moyen Âge perdait donc sa valeur et était encore à peine disponible. Il fallait remplacer ce ciment mythique par un ciment nouveau, purement scientifique. La spéculation aérienne et infiniment confuse de l’ère métaphysique individualiste ne pouvait réaliser cela: il fallait plutôt une philosophie exacte, positive, valide universellement, d’une rigueur semblable à celle des sciences de la nature. Comte se fit ainsi le créateur de la sociologie en tant que science qui, présupposant la biologie et la psychologie, décrit les lois naturelles et évolutives de la société. C’est ainsi que prit forme cette théorie organique naturaliste qui est si radicalement opposée à la théorie organique idéaliste et métaphysique de l’école schellingienne, bien qu’elle en partage le nom. Comme pour l’organisme cellulaire animal, on devait pouvoir établir les lois de formation, de reproduction, d’adaptation et d’hérédité de l’organisme social et, par là, créer l’organisation idéale de la société, c’est-à-dire le plus grand bien possible pour le plus grand nombre, grâce à une espèce de science naturelle de la société et à son application à la thérapie sociale. Mais Comte, ce faisant, se heurta de nouveau à la religion, dont il voyait l’importance en tant que ciment social le plus stable qui soit; désireux d’en conserver le bénéfice, il constitua une nouvelle religion scientifique de vénération de l’humanité, une religion aussi éloignée de la religion romantique que sa sociologie l’était de la théorie sociale organique du romantisme. Mais du moins, les points de départ, les observations et les besoins des deux théories ont d’indéniables affinités et la sociologie française, dans ses récents développements, s’est tellement rapprochée des idées romantiques, par le lien étroit qu’elle établit entre l’ordre social primitif et la religion, qu’une conciliation de ces deux forces pour le présent et l’avenir n’aurait rien d’étonnant. Mais surtout, en remplaçant le rationalisme sociologique atomiste par une idée du tout, quelque redevable que sa formulation soit aux sciences de la nature, on introduit un moment d’irrationalité dont on comprend qu’il ait pris conscience de son affinité élective avec des idées religieuses. [69] L’« altruisme » qui s’était joint à l’égoïsme du xviiie siècle [611] en tant que principe social et éthique nécessaire au système renferme finalement tous les problèmes dont la métaphysique allemande s’était elle aussi occupée.
C’est seulement si on la situe dans l’horizon de ces faits et idéologies qu’on peut vraiment comprendre la Restauration. Elle n’aurait pu exister et s’imposer si l’esprit du xviiie siècle n’avait pas lui-même reflué et laissé place à de nouvelles intuitions fondamentales et à de nouveaux sentiments. À cela s’ajoutent les développements dans les Églises, provoqués en définitive par les conditions nécessaires à une organisation ecclésiale autonome, et les résultats politiques des grandes guerres napoléoniennes, qui transformèrent en puissances dominantes de l’Europe les puissances qui avaient le plus intérêt au maintien de l’ordre ancien, c’est-à-dire la Russie, l’Autriche, et l’empire des Bourbons que ces dernières contribuèrent à renouveler. Dans ces conditions, le développement politique et spirituel de l’Allemagne et de l’Italie demeurait faible; en même temps commençait le système des « grandes puissances », qui s’appuyait fortement sur l’armée et dont le militarisme favorisait les structures sociales et politiques conservatrices. Certes, la réaction spirituelle générale contre le xviiie siècle s’est partout empressée d’accorder un droit relatif à l’individualisme et à la liberté personnelle parmi les idées sociologiques nouvelles, bien qu’avec une inégale insistance. En revanche, la réaction de Metternich et la Restauration proprement dite se caractérisent par l’ajournement ou par une nouvelle suppression de la liberté politique, de la représentation populaire, de la liberté de presse et du nivellement des privilèges. Mais ce n’était là qu’une exagération et une exploitation de la situation spirituelle et politique par des intérêts politiques et sociaux déterminés; cette attitude correspondait aux rapports de pouvoir des grandes guerres, mais elle ne put se maintenir lorsque ces dernières s’achevèrent peu à peu. Le système a pris fin avec la Révolution de 1830 et de 1848, avec l’unification de l’Allemagne et de l’Italie sur la base de dispositifs politiques libéraux, et avec la reprise du libéralisme en Angleterre, à partir de la réforme électorale de 1829. La restauration ecclésiale est la seule à ne pas avoir été affectée par tous ces événements, parce que les constitutions nouvelles des Églises [612] avaient été conçues en lien très étroit avec la Restauration, parce que les États préféraient toujours avoir une Église bien disciplinée comme partenaire et, d’autre part, parce que de manière générale la grande masse se désintéressait des Églises. Le catholicisme romain a même porté à sa perfection le développement restaurateur avec le concile du Vatican, et il achève aujourd’hui de se purger du monde moderne, n’acceptant plus que des adaptations politiques et sociales temporum ratione habita. [70] Quant aux Églises protestantes du continent, elles aussi ont conservé leurs traits juridiques et officiels strictement archaïques et n'ont toléré une reformulation moderne de leur univers idéel que provisoirement, en des temps de politique libérale généralisée; en revanche, à toutes les fois que les circonstances de la politique des partis ont été favorables, ces Églises ont aussitôt réaffirmé le point de vue juridique concernant le dogme, la confession de foi et la liturgie. C’est le seul héritage durable et entier de la Restauration, auquel s’allient volontiers aujourd’hui encore toutes les tentatives politiques et sociales conservatrices de restauration. Mais lorsque cela arrive, les institutions modernes et l’esprit moderne ont coutume de réagir avec une passion d’autant plus grande. En France, cette réaction moderne a conduit à laïciser complètement l’État et à limiter fortement les possibilités de développement de l’Église – une issue que tôt ou tard on va partout essayer d’emprunter car elle apporte une solution à ce difficile problème légué par la Restauration. Mais certes, pareille solution ne concerne que la relation externe entre les organisations ecclésiales et les institutions officielles. Il est beaucoup plus difficile d’envisager une solution aux problèmes internes de la pensée et de la vie chrétiennes. Cette pensée et cette vie semblent comme coupées, aujourd’hui, des progrès apportés par les Lumières et il se pourrait bien ici que l’effet fatal de la Restauration ne puisse plus jamais être surmonté, que les Églises demeurent orthodoxes, qu’elles s’isolent et s’excluent toujours plus de l’ensemble de la vie, pendant que le plus grand nombre devra chercher des voies nouvelles pour sa vie religieuse. Mais on peut aussi envisager d’autres développements, si les élites spirituelles retrouvent intérêt à l’organisation religieuse. Or sur ce point, l’époque de la Restauration nous a légué le problème culturel le plus difficile et le plus périlleux qui soit et sa possible solution demeure encore tout à fait obscure. [613] Le christianisme ecclésial restauré est trop fort pour être écarté et trop faible pour déterminer l’ensemble de la vie. Dans ces circonstances, le problème se présente sous des traits tout à fait contradictoires et l’on pourrait s’attendre à de très surprenantes combinaisons.
Sur tous les autres points, l’esprit de la Sainte-Alliance et de la sujétion étroite est pour l’essentiel surmonté. Mais on ne doit pas oublier ici que la réaction sociologique plus générale contre le xviiie siècle se poursuit et qu’aujourd’hui encore elle est sans cesse occupée à harmoniser les conquêtes de l’individualisme aux besoins de la totalité et d’un ordre stable. Ici, l’issue du combat est indécise et l’on ne saurait exclure de soudaines surprises dans un sens ou dans l’autre. [71] Ce combat a même connu d’un côté une aggravation que l’image de la Restauration laissait à peine deviner. La Restauration, en effet, luttait contre l’individualisme politique, social et idéologique, mais elle avait plutôt soutenu l’individualisme économique dans son besoin de développement. Sur ce point, on prenait modèle sur l’Angleterre et l’on encourageait le commerce et l’industrie. Le continent n’a connu sa révolution économique individualiste qu’au cours du xixe siècle, par le biais d’une longue chaîne de transformations particulières. La Restauration, dans le domaine économique, n’a commencé que lorsque cette révolution devint perceptible, et elle a pris alors tantôt les traits du socialisme démocratique, tantôt ceux du socialisme d’État. Elle redonne vie au protectionnisme mercantiliste, à la constitution de monopoles et de cartels, aux zones d’écoulement assurées et au contingentement de la production, à la création de syndicats et d’associations patronales; tout cela va dans une direction telle que, sur bien des points, il semblera un jour qu’on ait abouti ici aussi à une restauration.
Nous n’avons rappelé ces choses qu’afin de situer l’époque de la Restauration sous un juste éclairage. Elle ne fut pas une simple régression, un pur anachronisme au service de puissances égoïstes. Elle mit à profit et exacerba une situation générale qu’il faut considérer comme une réaction contre l’individualisme du xviiie siècle. Cette forme et cette direction momentanée est maintenant éliminée – à l’exception de ses [614] répercussions dans la sphère ecclésiale – mais le problème auquel s’était confrontée l’ère de la Restauration est demeuré: apporter à l’individualisme moderne les limitations que rendent nécessaires aussi bien l’intérêt général et l’esprit du tout que le besoin d’organisations stables et durables.
[1] « La Chrétienté, ou l’Europe », in Novalis, Petits écrits / Kleine Schriften, trad. par Geneviève Bianquis, Paris, Aubier, 1947, p. 159 (ndt).
[2] Troeltsch écrit Allseitigkeit (« universalité ») au lieu de Allfähigkeit (ndt).
[3] Troeltsch omet ici une phrase sans le signaler (ndt).
[4] Souligné par Troeltsch (ndt).
[5] Trad. par Geneviève Bianquis, ibid., p. 163 (ndt).
[6] [Ajout ultérieur de l’auteur en marge:] Ainsi, Saint-Simon considérait dans son Nouveau christianisme l’époque du Moyen Âge comme le temps de l’idée spéculative générale, d’une généralité qui avait permis que les intérêts individuels fussent soumis à la direction spirituelle de la vie et de l’esprit chrétiens.
[7] Ouvrage de Joseph Kleutgen (ndt).
|

