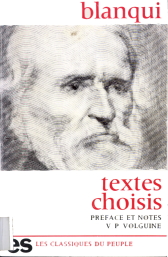 Note biographique Note biographique
- Le devoir d'un révolutionnaire, c'est la lutte toujours, la lutte quand même, la lutte jusqu'à extinction.
Louis-Auguste Blanqui naquit le 1er février 1805 dans la petite ville de Puget-Théniers (Alpes-Maritimes), à une cinquantaine de kilomètres de Nice. Son père, Dominique Blanqui, avait été membre de la Convention et Girondin. Il approuva le coup d'État de Bonaparte et en 1800 fut nommé sous-préfet à Puget-Théniers. La mère de Louis-Auguste, Sophie Brionville, originaire de Picardie, se distinguait par sa grande beauté et par ses hautes qualités morales. Blanqui tint d'elle son caractère résolu et intransigeant. Jusqu'à sa mort, la mère de Blanqui témoigna d'un grand amour pour son fils. À soixante ans, elle contribua activement à préparer l'évasion de Blanqui et de ses camarades de la prison du mont Saint-Michel ; à soixante-quinze ans encore, elle l'aidait une nouvelle fois à organiser sa fuite et celle de son ami Cazavan du pénitencier de Belle-Île. Le frère aîné d'Auguste, l'économiste bien connu, Adolphe Blanqui, fut très lié avec lui pendant sa jeunesse ; il partageait alors ses idées politiques. Mais il ne tarda pas à se détacher de lui.
Blanqui resta au contraire en excellents termes avec ses sœurs, Mmes Antoine et Barrellier, qui jouèrent un rôle important dans sa vie. Toutes les deux voyaient avec sympathie son activité révolutionnaire, se montraient pleines d'attention pour lui au long de ses tribulations, prenaient soin de lui quand il était en prison, l'aidaient moralement et matériellement, le cachaient, lorsqu'il vivait à Paris.
À l'âge de treize ans, Blanqui partit pour Paris où il devait rejoindre son frère aîné Adolphe qui était à cette époque professeur à l'institution Massin [1]. Pendant six ans – de 1818 à 1824 – le jeune Blanqui fit ses études, d'abord à l'institution Massin, puis au lycée Charlemagne. Il s'adonnait au travail avec passion et avec une assiduité extraordinaire et surprenait son entourage par ses aptitudes. Son frère Adolphe écrit dans une lettre à son père : « Cet enfant étonnera le monde ! ».
Blanqui termina brillamment ses études au lycée à dix-neuf ans. Il devint alors répétiteur, d'abord dans la famille du général Compans, puis au bout de deux ans à l'institution Massin. En 1824, il entra dans la société secrète des Carbonari. En 1827, il prit part à toutes les manifestations d'étudiants et fut blessé trois fois, deux fois par des coups de sabre, puis le 19 novembre par une balle sur la barricade de la rue aux Ours.
Il passa l'année 1828 et une partie de l'année 1829 à voyager dans le Midi. Il visita l'Italie, l'Espagne, et en août 1829, regagna Paris. Il y travailla quelques mois comme sténographe au journal Le Globe. Au cours de cette période, il se familiarisa avec les doctrines de Saint-Simon et de Fourier.
En juillet 1830, quand s'élevèrent les premières protestations contre les ordonnances de Charles X, Blanqui quitta la rédaction du Globe et se hâta, selon ses propres termes, de « prendre le fusil et d'arborer la cocarde tricolore ». Au cours des journées révolutionnaires, il se rangea aux côtés du peuple parisien contre les troupes de Charles X. Enivré par la lutte, il était persuadé que le peuple serait victorieux et que c'en était fini à tout jamais de la monarchie et du joug qu'elle faisait peser. Il fut déçu par l'issue de la révolution : la monarchie ressuscita sous une nouvelle forme Charles X fut remplacé sur le trône par le « roi-bourgeois » Louis-Philippe.
Aussitôt après la Révolution, Blanqui donna son adhésion à la Société des Amis du peuple, dirigée par Godefroy Cavaignac. Cette société propageait activement les idées républicaines. Blanqui prit souvent la parole à ses réunions. Par hasard, Henri Heine entendit son discours du 2 février 1832 qu'il qualifie de « discours plein de sève, de droiture et de colère » à l'égard de la bourgeoisie. Ce discours fut prononcé en présence de mille cinq cents personnes, dans une atmosphère qui rappelait celle de 1793.
Au début de 1831, Blanqui, qui prenait une part active aux manifestations d'étudiants, fut arrêté par la police et enfermé à la Force, d'où il sortit au bout de trois semaines. La Force fut la première des nombreuses prisons dans lesquelles Blanqui passa la moitié de sa vie.
En 1832, Casimir Périer, ministre de l'Intérieur du gouvernement de Louis-Philippe, qui voulait dissoudre la Société des Amis du peuple et arrêter ses dirigeants, obtint la mise en jugement de la société sous l'inculpation de violation des lois sur la presse et de complot contre la sûreté de l'État. En janvier 1832, Blanqui, Raspail, Thouret, Huber et d'autres furent arrêtés. Ce fut le fameux Procès des Quinze qui eut lieu du 10 au 12 janvier devant la Cour d'assises de la Seine. La cour d'assises acquitta les accusés, mais la défense que prononça Blanqui lui valut d'être inculpé par le procureur d'atteinte à la tranquillité publique. Blanqui fut condamné à un an de prison et 200 francs d'amende. Il subit sa peine d'abord à la prison de Versailles, puis à celle de Sainte-Pélagie à Paris.
Cependant les épreuves subies ne firent que fortifier Blanqui. À sa sortie de prison, il se mit avec une énergie accrue à répandre les idées révolutionnaires. Parallèlement, il élargissait et approfondissait ses connaissances en matière sociale et politique. Au cours de cette période, Blanqui subit l'influence de Buonarroti, l'ami de Babeuf, qui transmettait et diffusait la tradition glorieuse des « Égaux ». Blanqui fut également influencé dans une certaine mesure par Raspail, savant et révolutionnaire. Les premières années de la monarchie de Juillet étaient pleines de mouvements importants. Les troubles parisiens en septembre 1831, le soulèvement des ouvriers lyonnais en novembre 1831, l'insurrection républicaine de Paris en juin 1832, la deuxième insurrection des ouvriers lyonnais en avril 1834 et ses répercussions sur les autres villes françaises (les journées du 13 et du 14 avril à Paris et leur fin tragique, les massacres de la rue Transnonain), cette suite d'événements historiques ne put que renforcer Blanqui dans ses convictions révolutionnaires.
En 1832, Blanqui s'était marié avec Suzanne-Amélie Serre. Mais une vie familiale heureuse ne le détourna pas de l'activité sociale. En 1835 fut fondée avec son concours la clandestine Société des Familles, dont le programme définissait non seulement des objectifs politiques, mais aussi des objectifs sociaux.
Les membres de la Société se préparaient à l'insurrection et faisaient fabriquer de la poudre au no 113 de la rue de Lourcine. En mars 1836, à la suite d'une dénonciation, la police découvrit l'existence de la Société des Familles et arrêta 24 de ses membres, dont Blanqui. Pour sa part de conspiration dans ce qu'on appelle l'affaire des poudres, il fut condamné à deux ans de réclusion et à 2 000 francs d'amende. Il fut conduit à la prison de Fontevrault (Maine-et-Loire).
Le 8 mai 1837, une amnistie fut décrétée à l'occasion du mariage du duc d'Orléans. Blanqui fut libéré, mais sa réclusion fit place à la résidence surveillée dans la région de Pontoise. Avec sa famille, il s'établit dans le village de Jancy, sur les rives pittoresques de l'Oise. La période de Jancy fut la plus calme de la vie personnelle de Blanqui. Cependant il réfléchissait sans cesse aux événements contemporains et aux moyens d'instaurer le pouvoir populaire. Il était persuadé que le facteur essentiel du succès était l'organisation d'un noyau de conspirateurs solidement unis et disciplinés. Pour remplacer la Société des Familles, il fonda en 1837 une nouvelle organisation, la Société des Saisons, dont les dirigeants étaient Blanqui, Barbès et Martin-Bernard.
En 1839, Blanqui jugea la conjoncture favorable à l'insurrection. La crise économique parvenait à sa phase aiguë ; elle provoquait la misère croissante des classes populaires et le chômage. Elle se doublait d'une crise politique : la Chambre des députés était dissoute ; le président du Conseil des ministres, Molé, avait donné sa démission. Louis-Philippe ne réussissait pas à former un nouveau cabinet. Le peuple de Paris s'agitait.
Au début de l'année, Blanqui regagna Paris. Les conspirateurs estimaient que l'heure de l'insurrection armée, de la chute de la monarchie et de la constitution d'un gouvernement révolutionnaire était arrivée. Les armes manquaient, mais on pensait se les procurer dans les arsenaux pendant l'insurrection. Le jour fixé, le 12 mai, les courses hippiques devaient retenir l'attention de la police urbaine et d'une partie de la bourgeoisie, et l'Hôtel de Ville serait mal défendu. À l'heure dite, plus de 500 révolutionnaires en armes, concentrés dans les rues Saint-Denis et Saint-Martin, à un signal de Blanqui, marchèrent sur l'Hôtel de Ville et l'occupèrent. Mais ils furent cernés par les troupes royales. Une lutte inégale, livrée pendant plus de deux jours, se solda par l'écrasement de l'insurrection. Barbès, blessé, fut pris ; Blanqui réussit à s'échapper. Mais le 14 octobre, comme il s'apprêtait à prendre la diligence qui devait le mener en Suisse, il fut arrêté. Au procès qui se déroula au mois de janvier 1840, Blanqui se refusa à toute déclaration. Il fut condamné à la peine de mort, commuée, comme celle de Barbès, en réclusion à vie. Il fut envoyé au mont Saint-Michel, une des plus sombres prisons de France, immense construction de pierre qui fait corps avec le roc sur lequel elle s'élève, Cet ancien monastère servait alors de prison depuis la fin du XVIIe siècle.
Sept mois plus tôt, Barbès, Martin-Bernard, Delsade et autres avaient été conduits au mont Saint-Michel. Le régime pénitentiaire du mont Saint-Michel était affreux : chaînes, coups, supplices, railleries des gardiens, saleté, vermine ; toutes ces causes de souffrance accumulées conduisaient les uns au suicide, d'autres à la folie. Blanqui ne tarda pas à songer à l'évasion.
Dès avant son départ pour le mont Saint-Michel, il était entendu que sa femme viendrait s'établir non loin de la prison, mais une longue maladie avait empêché celle-ci de réaliser ce projet. Pendant toute une année, Blanqui attendit sa guérison. Mais, le 31 janvier 1841, Suzanne-Amélie mourait à l'âge de vingt-six ans. Blanqui supporta très mal le choc. Selon ses propres aveux, l'image de sa femme le hanta pendant des années. Le fils de Blanqui reçut une éducation religieuse dans sa famille maternelle, qui le dressait contre son père.
Après une longue préparation à laquelle prit part la mère de Blanqui, celui-ci et Barbès, Martin-Bernard et Huber tentèrent de s'évader. Cette tentative échoua et le régime de la prison se durcit encore.
Les détestables conditions de la vie de prison menacèrent la santé de Blanqui qui n'était pas solide. En 1844, au bout de quatre années de réclusion au mont Saint-Michel, Blanqui fut transporté à la prison de Tours, puis placé sous surveillance à l'hôpital, tandis que ses complices de l'insurrection étaient transférés dans d'autres prisons. Quand une maladie incurable fut diagnostiquée, Louis-Philippe le gracia par arrêt du 6 décembre 1844. Mais Blanqui refusa catégoriquement d'accepter sa grâce des mains du roi. Il le déclara ouvertement le 26 décembre, dans une lettre violente adressée au maire de Tours. Il resta à l'hôpital et dut garder le lit pendant vingt mois. Il ne put se lever et reprendre peu à peu son activité qu'en octobre 1845. À l'hôpital de Tours, il recevait des visites d'ouvriers et d'hommes politiques. Il reprit des contacts avec les milieux révolutionnaires. Lorsque, en 1846, éclatèrent à Tours des troubles provoqués par la crise économique, on accusa la société communiste locale de les avoir fomentés à l'instigation de Blanqui. Il, fut reconduit en prison. Au procès, qui eut lieu du 26 au 29 avril à Blois, Blanqui fut acquitté, faute de preuves, et regagna l'hôpital de Tours.
La révolution de février 1848 le libéra.
Le 25 février il arrivait à Paris. Des membres des sociétés secrètes, des partisans, anciens et nouveaux, les jeunes révolutionnaires, pour qui le nom de Blanqui était le symbole de la lutte révolutionnaire, se pressèrent en nombre autour de lui.
Le jour même, Blanqui apprenait que le gouvernement provisoire avait refusé de planter le drapeau rouge à l'Hôtel de Ville, malgré les réclamations des masses populaires. À cette nouvelle, les membres des sociétés secrètes, indignés, se réunirent à la salle Prado pour décider des moyens de faire pression sur le gouvernement. Ils étaient là, quelques milliers d'hommes armés, prêts à marcher sur le gouvernement provisoire. Mais Blanqui, par un discours plein de rigueur et de sang-froid, persuada les assistants de n'en rien faire. Il préférait attendre les actes ultérieurs du gouvernement provisoire et éviter le risque d'une contre-révolution.
Le même soir fut fondé un club qui prit le nom de Société républicaine centrale. La Société avait pour dirigeants Blanqui et Dézamy. C'est en son sein que, dès lors, Blanqui exerça son activité. Chaque jour il prenait la parole dans la salle du Conservatoire, rue Bergère, où elle se réunissait. Il expliquait aux membres de la société l'évolution de la situation politique, montrait les nouvelles perspectives, appelait à l'action.
Pendant les premiers jours de la révolution, l'activité de Blanqui ne se relâcha pas. Partout, dans les faubourgs ouvriers et au sein du club, il recrutait des partisans, il rassemblait des hommes fidèles à la révolution. Il ne tarda pas à être déçu par la politique du gouvernement provisoire : dès le 2 mars, il réclamait de lui des actes décisifs.
Blanqui voyait que le peuple n'était pas suffisamment préparé politiquement pour élire une Assemblée constituante et que, si les élections avaient lieu, le pouvoir passerait inévitablement aux mains des réactionnaires. Les 7 et 14 mars, il prenait la parole à la Société républicaine centrale pour demander l'ajournement des élections fixées au 9 avril ; le 17 mars, il organisait une manifestation pacifique, mais impressionnante, dans le même sens.
La lutte des classes en France s'aggravait de jour en jour. Blanqui était l'un des ennemis les plus dangereux de la bourgeoisie, qui s'en rendait parfaitement compte. La contre-révolution ne recula devant rien pour détacher les masses ouvrières de lui. Elle déclencha une campagne, dont la manifestation la plus odieuse fut le document Taschereau, pamphlet diffamatoire fabriqué par la police. Voici en bref ce dont il s'agissait. Taschereau, journaliste dénué de principes, qui avait servi les régimes les plus divers avec un dévouement égal, publia, sous l'inspiration du gouvernement, dans le numéro du 31 mars 1848 de La Revue rétrospective, un document intitulé « Déclarations faites par xxx devant le ministre de l'Intérieur sur l'affaire du 12 mai 1839 ». D'après ce document, ces dépositions avaient été faites les 22, 23 et 24 octobre 1839 au moment où Blanqui avait été arrêté à la suite de l'affaire du 12 mai. Le contenu et l'aspect de ces dépositions laissaient supposer que Blanqui avait trahi le secret de la Société des Familles et de la Société des Saisons, et qu'il en avait livré les principaux chefs. Enfin, il était fait mention des événements qui avaient précédé la manifestation du 12 mai. Le document n'était pas signé et portait toutes les marques du faux fabriqué d'après les dépositions de policiers qui avaient pénétré dans les sociétés secrètes. La publication de ce document avait pour but manifeste de ruiner, à coups de calomnies, l'autorité et l'influence de Blanqui. Le 14 avril, Blanqui fit paraître la « Réponse du citoyen Auguste Blanqui » contresignée par 50 de ses amis. Dans cette réponse, Blanqui flétrissait la turpitude des auteurs du document et démontrait que ces calomnies étaient absurdes.
Et c'est moi, triste débris, qui traîne par les rues un corps meurtri sous des habits râpés, c'est moi qu'on foudroie du nom de vendu ! tandis que les valets de Louis-Philippe, métamorphosés en brillants papillons républicains, voltigent sur les tapis de l'Hôtel de Ville... Réacteurs de l'Hôtel de Ville, vous êtes des lâches !
Plus de 400 anciens prisonniers politiques signèrent une protestation contre l'accusation dont Blanqui était victime. Cette protestation fut publiée dans La Gazette des tribunaux du 14 avril et dans Le National du 15 avril. Parmi ceux qui avaient pris position pour Blanqui, il y avait Dézamy. Mais un de ses anciens camarades de combat, Armand Barbès, s'était rangé aux côtés des calomniateurs.
Le coup fut douloureux, et cependant Blanqui ne suspendit pas un seul jour son activité révolutionnaire.
Le 16 avril, il se rendit au Champ-de-Mars où des ouvriers s'étaient rassemblés pour élire les officiers d'état-major de la Garde nationale. De là, ils se dirigèrent vers l'Hôtel de Ville pour remettre au gouvernement une pétition demandant l'« organisation du travail et l'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme ». Mais ils se heurtèrent à la résistance des gardes nationaux, mobilisés sous le prétexte de faire échec à la « conspiration communiste ».
Les résultats des élections à l'Assemblée constituante firent honneur à la perspicacité et à la clairvoyance de Blanqui qui avait réclamé leur ajournement. Dans plusieurs villes, des barricades s'élevèrent le jour des élections. Le choc entre la bourgeoisie et les ouvriers fut particulièrement rude à Rouen, les 27 et 28 avril, où les ouvriers furent véritablement massacrés ; ce fut une nouvelle « Saint-Barthélemy ». Dans une proclamation consacrée à cet événement, Blanqui dénonçait la responsabilité du gouvernement : « Est-ce trahison ou lâcheté ? » demandait-il. « Le sang du peuple répandu ne doit, ne peut rester sans vengeance. »
L'Assemblée constituante se réunit pour la première fois le 4 mai. Elle légitima la république bourgeoise en France. Il n'y eut pas de place au sein du nouveau gouvernement pour les représentants ouvriers. Les masses populaires parisiennes étaient profondément déçues. Leur mécontentement à l'égard des premières mesures gouvernementales se manifesta par la démonstration du 15 mai. Les ouvriers, voulant faire pression sur le gouvernement provisoire, envahirent la salle où se trouvait l'Assemblée constituante. Ils demandaient que l'on porte secours immédiatement aux Polonais insurgés. Blanqui prit la parole à l'Assemblée ; mais il n'avait pas été l'instigateur de la manifestation ; bien au contraire, pensant qu'elle échouerait, il avait essayé d'en détourner les membres de son club. À l'Assemblée, Blanqui réclame une assistance prompte aux Polonais, une enquête sur les événements de Rouen et le jugement des coupables, du travail pour tous les chômeurs et l'amélioration de la condition des classes populaires.
L'Assemblée constituante déclarée dissoute, les manifestants marchèrent sur l'Hôtel de Ville où un nouveau gouvernement fut constitué, composé de Barbès, Raspail, Albert, Ledru-Rollin, Louis Blanc etc. Blanqui n'en fit pas partie. Mais, très vite, l'Hôtel de Ville fut occupé par l'armée. Elle dispersa le peuple, arrêta Barbès et Albert. Blanqui réussit à se cacher pendant onze jours, mais il fut arrêté le 26 mai et enfermé au château de Vincennes.
Les nouvelles des journées de juin, baignées dans le sang du peuple parisien, parvenaient à Blanqui qui souffrait de son impuissance et de son inaction. Ce ne fut que le 7 mars 1849, neuf mois après l'arrestation de Blanqui, que la Haute Cour délibéra sur l'affaire du 15 mai.
Le procès eut lieu à Bourges. À cette époque, Blanqui avait quarante-quatre ans. Pâle, épuisé, les cheveux tout blancs, il avait l'air d'un vieillard. Mais ni les prisons ni les privations n'avaient ébranlé sa force d'esprit. Comme en 1832, au procès des Quinze, Blanqui fut son propre défenseur. Il disait :
- Debout sur la brèche pour défendre la cause du peuple, les coups que j'ai reçus ne m'ont jamais atteint en face... Le temps a trop prouvé que les traits lancés contre moi, de n'importe quelle main, sont tous allés au travers de mon corps frapper la Révolution. C'est ma justification et mon honneur.
À la dernière séance de la Cour eut lieu une scène pénible : la confrontation de Blanqui et de Barbès qui parla de nouveau du document Taschereau. Dans sa réponse, Blanqui dit :
- L'antiquité avait attribué à Hercule tous les faits des temps héroïques : la réaction personnifie en moi tous les crimes et toutes les atrocités [2].
On accusa Blanqui d'avoir voulu dissoudre de force l'Assemblée constituante. Blanqui répondit malicieusement qu'avec son expérience de conspirateur et d'organisateur d'insurrections il aurait agi tout autrement que les manifestants du 15 mai. Et il développa avec feu le plan possible d'une dissolution de l'Assemblée.
Le 2 avril 1849, Blanqui fut condamné à dix ans de prison. Il fut conduit à la prison de Doullens (Somme).
Blanqui resta dix-neuf mois à Doullens. À son habitude, il y lut et écrivit beaucoup. Le 20 octobre 1850, il fut emmené avec d'autres prisonniers politiques à Belle-Île-en-Mer.
Il y avait alors près de 250 prisonniers politiques à Belle-Île. Le régime pénitentiaire n'était pas très rigoureux. Les prisonniers pouvaient se rencontrer à certaines heures de la journée, converser, prendre leur repas ensemble, etc. Les discussions politiques et philosophiques devenaient facilement passionnées. Presque aussitôt deux partis se formèrent, opposant les partisans de Blanqui à ceux de Barbès. Au début, les blanquistes étaient rares. Barbès, par contre, était entouré de gens qui étaient hostiles à Blanqui et le persécutaient. Il y eut même un moment où Blanqui craignit pour sa vie. Il proposa à Barbès un arbitrage, mais en vain. Peu à peu, Blanqui s'attacha une grande partie des prisonniers, surtout les ouvriers. Plusieurs d'entre eux venaient écouter ses cours d'économie politique.
En février 1851, à l'occasion du troisième anniversaire de la révolution de Février, Blanqui écrivit le célèbre toast, adressé aux émigrés de Londres sous le titre d' « Avis au peuple ». Blanqui dénonçait la trahison de Louis Blanc, de Ledru-Rollin et des autres « socialistes » de 48. Marx, qui à cette époque vivait à Londres, envoya la traduction de ce texte aux communistes allemands. Pour lui, l' « Avis au peuple », faisait le bilan de la lutte de classes qui venait de se livrer.
À Belle-Île, Blanqui lisait beaucoup, approfondissait ses connaissances en philosophie, en économie politique, en sciences naturelles et particulièrement en géographie, pour laquelle il avait une prédilection. Sa mère et ses sœurs lui faisaient parvenir des livres et des atlas. Blanqui écrivait des articles et des comptes rendus de livres nouveaux, correspondait avec ses amis. Il était au courant de ce qui se passait au-delà des murs de la prison. Au mois de novembre 1851, dans une lettre à Rouget, un ancien prisonnier de Belle-Île, il prédisait un prochain coup d'État en France et celui-ci se produisit, en effet, le 2 décembre 1851. Dès 1853 la guerre de Crimée était, selon lui, inévitable.
Blanqui, qui passa la moitié de sa vie en prison, avait une capacité de résistance extraordinaire. On s'étonne que cet homme, chétif et de santé chancelante, ait pu supporter tant d'épreuves. Grâce à une force d'âme extraordinaire, il savait se détacher des détails de la vie quotidienne et se retrancher dans son propre monde intérieur. Il avait mis au point un mode de vie et une hygiène qu'il observait scrupuleusement. Il faisait de la culture physique, suivait un régime spécial qui excluait le vin, comportait peu de viande et beaucoup de laitages, de légumes et de fruits. À Belle-Île, il passait beaucoup de temps à cultiver un jardin potager qui se trouvait sous sa fenêtre et où il faisait pousser des fraises et des légumes.
À la fin de 1852, Blanqui pensa à s'évader. C'est alors que la mère et le fils de Blanqui, qui avait quinze ans, arrivèrent à Belle-Île. La mère se procura tout ce qui était nécessaire à l'évasion. Mais le ministère en eut connaissance par l'interception d'une lettre qui se trouvait dans un panier de pêcheur à fond double. Blanqui fut mis au cachot et sa garde fut renforcée.
Et cependant en 1853 Blanqui et Cazavant, son voisin de cellule, recommencèrent à préparer leur évasion. Ils avaient l'intention de fuir en Angleterre. Ils imaginèrent un plan audacieux dont l'exécution demandait beaucoup de temps. Blanqui et Cazavant laisseraient dans leur cellule des poupées, habillées de leurs vêtements de prison et assises comme ils avaient coutume de le faire. Mais pour que la fuite ne soit pas découverte immédiatement, pendant un certain temps, Blanqui et Cazavant ne répondirent plus aux questions que leur posaient les gardiens ni à l'appel de leur nom. Et les surveillants cessèrent bientôt d'y prêter attention. Le 5 avril, Blanqui et Cazavant s'évadèrent sous une pluie torrentielle. Parvenus à un puits, ils descendirent avec des cordes jusqu'au niveau de l'eau, ne bougèrent pas jusqu'à la fin de la ronde, après quoi ils sortirent et franchirent la clôture ; ils errèrent toute la nuit à travers l'île et enfin, épuisés, atteignirent la case d'un pêcheur, point désigné à l'avance où ils se dissimulèrent au grenier jusqu'au matin. Mais le pêcheur, qui avait reçu de Blanqui et de Cazavant une forte somme pour les transporter sur le continent, les trahit : il dénonça leur fuite aux autorités de la prison. Blanqui fut jeté au cachot du château Fouquet à Belle-Île, d'où il fut bientôt transféré de nouveau au département des prisonniers politiques, mais sous une surveillance plus sévère.
En automne 1854, Barbès fut libéré et les rapports entre les partis rivaux à l'intérieur de la prison s'améliorèrent. En 1857, Blanqui, avec 31 camarades, fut transféré en Corse, à Corte, où la population rassemblée les accueillit chaleureusement.
Blanqui resta dans sa prison corse, humide et mal aérée, jusqu'au 2 avril 1859. Ensuite, en raison de la loi dite de sécurité publique de 1858, il fut transféré en Afrique, à Mascara. Le 16 août 1859, après l'amnistie générale, Blanqui reçut le droit de rentrer à Paris. Mais à Toulon, sur le chemin du retour, il fut de nouveau arrêté ; on menaçait de l'exiler à Cayenne. Enfin Mme Antoine, la sœur de Blanqui, réussit à obtenir pour lui la permission de gagner Paris. Il y rencontra son fils, qui avait alors vingt-quatre ans. Au cours de ses séjours en prison, Blanqui n'avait pu voir son fils que cinq ou six fois. C'était un homme borné et superficiel, n'ayant rien de commun avec son père. Il le connaissait si peu et si mal qu'il lui proposa de renoncer à la vie politique et de partager sa vie bourgeoise. À Paris, Blanqui eut une autre déconvenue ; il apprit que ses manuscrits, fruits d'un long travail, avaient été brûlés en exécution des dernières volontés de sa mère, morte en 1858. Cette nouvelle plongea Blanqui dans le désespoir.
Peu après son retour à Paris, Blanqui se rendit à Londres. De nombreux émigrés politiques y vivaient, parmi lesquels ses amis : Lacambre et Barthélemy. À son retour à Paris, Blanqui s'adonna de nouveau à l'activité révolutionnaire. Il se cachait habilement de la police, mais celle-ci était constamment à ses trousses et réussit à la longue à l'arrêter. Au mois de juin 1861, il fut accusé d'avoir pris part à l'organisation d'une société secrète et condamné à quatre ans de prison. Cette condamnation suscita l'indignation des milieux révolutionnaires. Marx et Engels, qui avaient beaucoup d'estime pour Blanqui en qui ils voyaient le représentant du « parti révolutionnaire de la France », aidèrent son ami Denonville à publier un pamphlet contre l'ignoble procès de Blanqui.
De nouveau, Blanqui fut conduit à la prison de Sainte-Pélagie qu'il avait déjà connue en 1832 après son discours au procès des Quinze et en 1835 après le procès de la Société des Familles. La prison de Sainte-Pélagie avait enfermé entre ses murs de nombreuses personnalités politiques françaises. En 1793 : M-O Rolland et certains Girondins ; et par la suite Béranger, Paul-Louis Courier, Marrast, Godefroy Cavaignac, Daumier, Lamennais, Félix Pyat, les révolutionnaires de 1848.
Silencieux et peu sociable, méfiant à l'égard des inconnus, Blanqui était cependant un pôle d'attraction pour les détenus dont certains devinrent ses amis ou ses disciples fidèles. Ses connaissances, sa forte personnalité, son sort d' « enfermé »perpétuel, son dévouement exceptionnel à la cause de la révolution, son attitude évidemment critique à l'égard du parti républicain parlementaire lui conféraient une autorité grandissante.
Blanqui se lia surtout avec Gustave Tridon et les étudiants en médecine Villeneuve, Clemenceau, etc. Il connut intimement Arthur Ranc qui lui dédia son Complot romantique. Ranc devint pour quelque temps un blanquiste acharné. C'est à la prison de Sainte-Pélagie que prit naissance le parti blanquiste.
En 1864, Blanqui tomba malade. On le transporta à l'hôpital Necker où on le mit dans une salle particulière, sous la surveillance d'un policier. Des amis venaient le voir. C'est là qu'il fit la connaissance de Charles Longuet.
Au début de 1865, Blanqui participa à la publication du journal Candide, dont le rédacteur en chef était Gustave Tridon, élève préféré de Blanqui. Sous le pseudonyme de Suzamel (Suzanne-Amélie, le prénom de sa femme), Blanqui publia dans ce journal quelques articles sur des sujets philosophiques et scientifiques. Mais, après la parution du no 8, le journal fut suspendu et ses rédacteurs arrêtés.
Blanqui chercha à s'évader de l'hôpital. De nouveau, il habitua les surveillants à son absence au repas du soir et à l'appel. En compagnie de ses amis, Cazavant, Lamblin et les frères Levraud tous étudiants, Blanqui, coiffé d'une perruque claire et d'un chapeau à larges bords, passa devant le policier de garde et prit le train pour Bruxelles.
Le lendemain de son départ Blanqui envoya aux journaux parisiens une lettre ouverte ; il y disait que, condamné à quatre ans de prison, il avait été détenu pendant quatre ans et six mois et que le devoir l'obligeait à refuser le cadeau de cent jours supplémentaires de son existence. Il s'était évadé de crainte d'être transporté à Cayenne au terme de sa réclusion.
À Bruxelles, il vécut chez son ami le Dr Watteau. Il y fit de nouvelles connaissances, revit son ami Charles Longuet qui éditait à Bruxelles le journal La Rive gauche. Au congrès de Liège [3], en 1865, Blanqui rencontra Tridon, Paul Lafargue et Granger qui devint par la suite son meilleur ami. Au cours de ces années, Blanqui écrivit beaucoup. Quelques essais de cette époque, consacrés aux questions d'économie politique, de philosophie et de socialisme, furent publiés après sa mort en deux volumes, sous le titre : La Critique sociale.
En même temps, Blanqui continuait à correspondre avec ses amis parisiens. C'est alors que se constitua en France le groupe de combat blanquiste dont les membres étaient recrutés après une sélection sévère. En 1870, ils atteignirent l'effectif de 2 500. Blanqui venait souvent à Paris, en secret et pour un temps très court. Puis, quand l'activité de l'organisation prit de larges proportions, Blanqui resta à Paris plusieurs mois d'affilée.
En 1867-1868, Blanqui écrivit une « Instruction pour une prise d'armes » où il exposait en détail les mesures à prendre après la révolution pour établir une dictature parisienne. Il développait son plan de combat, indiquait les rues où l'on devait élever des barricades, donnait des modèles d'appels au peuple, à l'armée, etc. Les amis de Blanqui le pressaient de passer à la lutte ouverte contre l'Empire ; ils pensaient que le climat général du pays et le mécontentement à l'égard du régime étaient favorables à l'insurrection. Mais la crainte de nouveaux échecs rendait Blanqui prudent. Il y eut tout de même une tentative d'insurrection, le jour des funérailles de Victor Noir, jeune journaliste tué par un membre de la famille Bonaparte. Mais cette tentative ne réussit pas ; il n'y eut pas de collision entre la foule et les troupes, malgré une très large agitation à la Chambre et parmi le peuple.
Pendant la guerre de 1870, l'armée française connut, dès le début, une série de défaites. Les masses populaires furent indignées. Le peuple, qui se rassemblait sur la place de la Concorde, proclamait hautement sa colère et son indignation. Les blanquistes jugèrent que le moment était venu de renverser sans difficulté l'Empire et lancèrent un appel pressant à Blanqui qui se trouvait à Bruxelles. Il arriva à Paris le 12 août. L'insurrection devait avoir lieu le 14, au centre des quartiers ouvriers, boulevard de La Villette. On pensait occuper la caserne des pompiers du boulevard de La Villette pour s'approvisionner en armes, puis proclamer la république. Mais une fois encore la tentative échoua. La plupart de ses auteurs furent arrêtés, quelques-uns condamnés à mort, mais le verdict ne fut pas mis à exécution. Après la capitulation de Napoléon, survenue le 2 septembre à Sedan, l'Empire touchait à sa fin. Le 4 septembre, la République française fut proclamée, et le gouvernement de la défense nationale, dont faisaient partie Arago, Crémieux, Favre, Gambetta, Garnier-Pagès, Rochefort, Jules Simon et le général Trochu, fut constitué à Paris.
Aussitôt après la révolution du 4 septembre, Blanqui fonda le club et le journal La Patrie en danger. Dans son premier numéro daté du 7 septembre, Blanqui appelait les masses à accorder leur appui au gouvernement ; toutes les divisions devaient disparaître devant l'ennemi commun. Il ne comprenait pas qu'un gouvernement bourgeois, contre-révolutionnaire dans son essence, ne pouvait assurer la défense du pays, car il était guidé non pas par des intérêts nationaux, mais par des intérêts de classe.
Les collaborateurs du journal les plus proches de Blanqui : Tridon, les frères Levraud, Regnard, Granger et Verlet, faisaient également appel à l'union pour la défense de la patrie. Du 7 septembre au 9 décembre parurent 89 numéros, et dans chaque numéro Blanqui publiait des articles, des appels, des proclamations, dans lesquels il indiquait comment il fallait mener la défense de Paris, quelles mesures il fallait prendre pour le préserver. Dans ces conseils, il faisait preuve d'une profonde intelligence, de perspicacité et d'une grande connaissance de la tactique militaire.
Le soir, dans les clubs, Blanqui exposait les fautes et les crimes du gouvernement et indiquait les mesures à prendre pour constituer une armée nationale.
Au mois de septembre, à une réunion de gardes nationaux, Blanqui, après avoir prononcé un discours, fut élu commandant du 169e bataillon. Poste qu'il n'occupa pas longtemps, car, le 19 octobre, le général Trochu fit dissoudre le bataillon. Dans un des numéros de La Patrie en danger, Blanqui écrivait : « Le premier acte de la défense doit être la révocation de ceux qui rendent la défense impossible. » Le gouvernement de la défense nationale et le général Trochu, qui était à la tête des forces armées parisiennes, montrèrent au peuple français leur vrai visage, le visage de la trahison nationale. À la nouvelle de la capitulation de Metz, connue à Paris le 31 octobre, les masses populaires manifestèrent leur émotion. La capitulation menaçait Paris ; il fallait à tout prix sauver la capitale. Le 31 octobre, les masses populaires et les bataillons de la garde nationale, après avoir occupé l'Hôtel de Ville et mis en état d'arrestation les membres du gouvernement, créèrent un comité provisoire, chargé d'assurer la sécurité générale et de fixer les élections municipales. Blanqui et ses partisans prirent la tête du mouvement du 31 octobre et la candidature de Blanqui fut posée au nouveau gouvernement. Mais le mouvement du 31 octobre échoua comme les précédents ; le gouvernement de la défense nationale conserva le pouvoir, en promettant de ne pas poursuivre ceux qui avaient participé à l'insurrection. Blanqui resta à Paris. Dans le journal qu'il continuait d'éditer, il lançait des appels en faveur de l'armement de tous les citoyens pour défendre la capitale et s'indignait de l'inaction du gouvernement :
- Les pouvoirs légitimes sont aux mains de qui résiste. Le bulletin de vote, aujourd'hui, c'est la cartouche.
Blanqui et son groupe jouèrent un rôle actif dans la manifestation du 22 janvier 1871, qui avait pour but de renverser le gouvernement de la défense nationale. Mais cette manifestation populaire, aussi peu préparée que les autres, échoua.
Même après la capitulation de Paris et l'amnistie du 28 janvier, Blanqui espérait encore que la France serait sauvée. Le 8 février 1871 devaient avoir lieu les élections à l'Assemblée nationale. Le nom de Blanqui ne se trouvait pas sur la liste des 43 candidats présentés par les clubs, les comités et les rédactions des journaux. Après les élections, où il recueillit néanmoins 52 839 voix, Blanqui se décida à partir pour Bordeaux. En quittant Paris le 12 février, il fit apposer une affiche, intitulée Un dernier mot, dans laquelle il résumait tout ce qu'il avait écrit dans La Patrie en danger. Il y était question de la conduite du gouvernement pendant le siège de Paris, des mesures qu'on aurait dû prendre pour sa défense, de la nécessité d'évacuer en province un million de femmes et d'enfants et de les remplacer par autant de jeunes provinciaux en état de porter les armes, du ravitaillement de Paris, de son armement à prélever sur les arsenaux de province, etc. Un dernier mot se terminait par une mise en accusation du gouvernement traître.
De Bordeaux, Blanqui se rendit à Loulié (Lot), chez sa nièce, pour se reposer des événements parisiens. Mais ce repos fut de courte durée, car il tomba malade. C'est alors que, le 9 mars, il fut mis en jugement pour sa participation à la journée du 31 octobre. Le gouvernement violait son engagement de ne pas poursuivre les auteurs de ce soulèvement. Par décision du ministère de la justice, Blanqui fut arrêté à Loulié le 17 mars et conduit, tout malade qu'il était, à l'hôpital de Figeac le 18 mars, le jour même où la classe ouvrière prenait le pouvoir et proclamait la Commune à Paris. Lorsqu'on l'avisa de l'arrestation de Blanqui, Thiers, le bourreau de la Commune, s'écria : « Nous le tenons enfin, ce scélérat ! »
Le 20 mars, Blanqui fut transféré à la prison de Cahors, où il fut incarcéré avec des prisonniers de droit commun, jusqu'à ce qu'on le mette au secret.
Le 26 mars, il fut élu membre de la Commune de Paris [4] avec d'autres blanquistes : Tridon, Eudes, Flourens, Édouard Vaillant, Rigault, etc., qui avaient joué un rôle actif dans la révolution du 18 mars.
Aux premières séances de la Commune, Blanqui fut élu président d'honneur. Ses amis eurent l'idée de proposer au gouvernement de Thiers de l'échanger contre certains otages de la Commune, parmi lesquels l'archevêque Darboy. Les pourparlers engagés entre un homme de confiance de l'archevêque et Thiers durèrent plus d'un mois, mais ne menèrent à rien. Thiers ne voulait pas libérer Blanqui, même contre 74 otages, et déclarait que « rendre Blanqui à l'insurrection équivalait à lui envoyer un régiment ».
Après cet échec, la Commune vota un crédit de 50 000 francs pour préparer l'évasion de Blanqui de la prison de Cahors. Mais Granger, ami intime de Blanqui, à qui on avait confié cette mission, ne parvint pas à l'accomplir.
Le 22 mai, Blanqui fut conduit au fort du Taureau, dans la baie de Morlaix, où il arriva deux jours plus tard. Il avait alors soixante-six ans et sa santé était compromise. Cependant le régime du fort du Taureau était très rigoureux. La cellule de Blanqui, située au sous-sol, était froide, sombre et humide. La surveillance était extrêmement sévère. Le commandant avait reçu l'ordre de tirer à la moindre tentative de fuite ; pendant la promenade, Blanqui était toujours accompagné de gardiens armés ; on interdisait aux bateaux d'accoster, etc. En outre le bruit incessant de la prison empêchait Blanqui de travailler et de se reposer, et la nourriture était très mauvaise. Livré à lui-même, il s'adonnait à la méditation. Pendant la promenade, il étudiait le ciel et la mer, suivait le mouvement des planètes. Les conclusions de ses observations se retrouvent dans L'Éternité par les astres et dans l'exposé sur les causes de la lumière zodiacale qui, plus tard, le 8 janvier 1872, fut lu à l'Académie des Sciences et publié le 27 janvier dans La République française. La même année, L'Éternité par les astres fut éditée en volume à Paris.
Le 12 novembre 1871, Blanqui fut subitement transféré à la prison de Versailles. Pendant deux jours (le 15 et le 16 février 1872), après presque un an de détention préventive, le IVe Conseil de guerre de Versailles eut à se prononcer sur sa participation aux événements du 31 octobre et à d'autres manifestations ainsi que sur sa responsabilité « morale » dans l'existence de la Commune. Blanqui, alors âgé de soixante-sept ans, était un vieillard pâle et grêle d'aspect. Mais aucune prison n'avait pu le briser moralement. Il réfuta tous les arguments de l'accusation et termina par cette fière déclaration.
Je ne suis pas ici pour le 31 octobre. C'est le moindre de mes forfaits. Je représente ici la République traînée à la barre de votre tribunal par la monarchie. M. le commissaire du gouvernement a condamné tour à tour la révolution de 1789, celle de 1830, celle de 1848, celle du 4 septembre. C'est au nom des idées monarchiques, c'est au nom du droit ancien en opposition au droit nouveau, comme il dit, que je suis jugé et que, sous la République, je vais être condamné.
Blanqui fut reconnu coupable et condamné à la déportation et à la privation des droits civiques. La cour de cassation annula le jugement. Mais le 29 avril, le VIe Conseil de guerre le condamna à nouveau. On se proposait de l'exiler en Nouvelle-Calédonie, lieu de déportation des membres de la Commune, mais la commission médicale reconnut qu'il n'était pas en état de supporter un aussi long voyage. Le condamné à vie fut conduit à la prison centrale de Clairvaux (Aube).
Clairvaux, vieille abbaye, avait été convertie en prison en 1789. À son arrivée, Blanqui y trouva 140 détenus politiques, condamnés comme anciens Communards. Il fut mis dans une cellule isolée, longue de 2m et large de 1m50, avec une fente étroite qui tenait lieu de fenêtre ; il était séparé des autres détenus et on ne lui donnait que rarement la permission de recevoir des visites familiales. Dans la prison humide de Clairvaux, la santé de Blanqui fut définitivement compromise ; pendant de longs mois, il ne quitta pas le lit. Plus tard, on lui donna une cellule plus large, mais toujours isolée, où il se sentait « enterré vivant », comme il l'écrivait à sa sœur.
En janvier 1878, le journal socialiste L'Égalité fit campagne pour sa libération. On présenta sa candidature aux élections. En avril 1879, il fut élu député de Bordeaux au second tour de scrutin par 6 801 voix contre 5 330 au républicain bourgeois Lavertujon, ami de Gambetta. Mais la Chambre invalida l'élection de Blanqui. L'active campagne en faveur de la candidature et de la libération de l'« Enfermé » contraignit enfin le gouvernement à gracier Blanqui le 10 juin 1879.
Il était resté à Clairvaux huit ans et trois mois. Ce fut sa dernière prison. Au total, il avait été détenu pendant trente sept ans. Le lendemain du jour où il fut libéré, Blanqui, âgé de soixante-quatorze ans, revint à Paris avec sa sœur. Le 25 juin, il partit pour Bordeaux pour remercier ses électeurs et pour se présenter devant eux à nouveau. Les habitants de Bordeaux accueillirent Blanqui avec enthousiasme. Cependant, au cours de la campagne électorale, ses ennemis exhumèrent le document Taschereau, et, bien qu'il n'y eût aucune preuve de sa culpabilité, il recueillit 158 voix de moins que son adversaire.
Mais ce revers ne diminua pas son énergie, il entreprit un voyage à travers la France et prit la parole dans de nombreuses réunions ouvrières. Les milieux populaires l'accueillaient avec enthousiasme, et à Bordeaux, Marseille, Toulon, Lyon, Nice, etc., on fit des banquets en son honneur.
Dans l'été 1880, la candidature de Blanqui fut posée à Lyon, mais il n'obtint pas la majorité. En juin, les droits civiques lui furent rendus. Au début du mois de novembre suivant, il fit partie des délégués des comités républicains envoyés en Italie pour assister aux fêtes organisées en l'honneur de Garibaldi.
À la fin du mois de novembre, Blanqui et ses amis, Granger, Eudes, Vaillant et d'autres fondèrent le quotidien Ni Dieu, ni maître, dont Blanqui fut le rédacteur en chef. Le manque de ressources le força à transformer ce journal, à partir du 25e numéro, en hebdomadaire. Dans le même temps, il écrivait une brochure, L'armée esclave et opprimée, et, le 21 novembre, accompagné de Granger, il avait fait une conférence à Lille devant 6 000 personnes qui l'avaient acclamé avec enthousiasme.
Jusqu'à sa mort, Blanqui, comme s'il voulait rattraper le temps perdu en prison, multiplia ses discours dans les réunions ouvrières de Paris. Le 27 décembre 1880 il assista à la réunion de la salle Ragache, rue Lecourbe, où il prononça en faveur du drapeau rouge son dernier discours. À son retour à une heure tardive, il fut subitement terrassé par une attaque d'apoplexie. Le 1er janvier 1881, après avoir lutté cinq jours, il mourait à l'âge de soixante-seize ans.
Ses funérailles eurent lieu le 5 janvier. La nouvelle de sa mort bouleversa tous les révolutionnaires français. Près de 200 000 hommes accompagnèrent sa dépouille. Des délégués et des couronnes, envoyés par les organisations d'avant-garde de la France entière, affluèrent à Paris.
Il fut enterré au Père-Lachaise. Le 9 août 1885, les ouvriers parisiens firent édifier un monument sur sa tombe, avec sa statue en bronze, chef-d'œuvre du sculpteur Jules Dalou.
[1] L'institution Massin envoyait ses plus grands élèves suivre les cours du lycée Charlemagne, conformément au statut de l'enseignement secondaire établi par Napoléon 1er.
[2] Procès des accusés du 15 mai 1848, Haute Cour Nationale de justice séant à Bourges, Imprimerie des ouvriers associés, Bordeaux 1849.
[3] Congrès international d'étudiants (29 octobre-Ier novembre 1865) tenu à Liège. Les délégués parisiens, à leur retour, sont traduits devant le Conseil académique, frappés de diverses sanctions disciplinaires. Il en résulte une grande agitation dans les milieux universitaires en fin décembre 1865. Les cours sont provisoirement suspendus dans les facultés.
[4] Dans le XVIIIe et dans le XXe arrondissements.
|

