|
Avant-propos
La raison et la foi
Leurs rapports et leur conflit au Moyen âge.
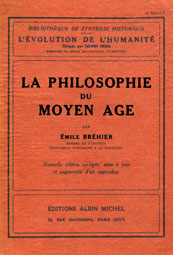
Henri Berr
Nous avons, dans des volumes antérieurs, ou naître, croître, s’affermir le psychisme. Par l’action des individus, dans les sociétés, — où la coopération sert le développement de l’esprit, mais où l’institution souvent l’entrave [1], — la pensée impersonnelle et suprasociale, la raison humaine se constitue. Léon Robin et Abel Reg ont marqué le rôle décisif de la Grèce travaillant avec son génie propre sur le « patrimoine commun » que lui ont légué les Empires orientaux, « A considérer l’évolution de la pensée humaine, la pensée grecque, aux VIe et Ve siècles, en est à la fois la résonance totale et la pointe avancée. » Chez un peuple et en un temps privilégié, ce ressort profond de logique, qui, d’après notre hypothèse, anime toute activité, — et, par conséquent, fournit le principe essentiel de l’explication historique, — apparaît à la conscience réfléchie dans le besoin désintéressé de comprendre, exerce largement son pouvoir, se traduit en méthode rationnelle : et c’est là un des aspects, ce n’est pas — nous l’avons dit — l’aspect le moins important, du miracle grec [2].
La pensée avait cherché à dégager ses éléments purs du complexe où l’impatience d’explication les avait mêlés aux pii imaginations les plus diverses et parfois les plus extravagantes, au produit contingent des milieux physiques, des caractères ethniques et individuels. Rappelons, toutefois, que, comme l’a noté Abel Rey, c’est la poussée téméraire de l’esprit, la hardiesse imaginative, qui a mû la raison, tout en l’égarant : c’est l’esprit mythique qui a développé « le besoin qu’a l’homme d’être satisfait par une réponse à ses étonnements » [3] ; et le positif a été enfanté dans la mystique.
Mais après l’éclair du miracle grec, dans la période hellénistique, une lassitude intellectuelle, une crise morale provoquent le débordement du mysticisme oriental. « La vague de foi montante balaye, pour bien des siècles, le travail de la raison grecque [4]. » Rome, on l’a vu, était plus douée pour l’action que pour la spéculation : dans la décomposition de l’Empire, ce qu’elle avait recueilli de philosophie et de science a été submergé « par le torrent de religiosité venu de l’Orient » [5].
Nous avons, ailleurs, défini ce qu’on appelle le Moyen Age, — expression contestable, mais qui répond à quelque chose d’historiquement réel. Nous avons cru pouvoir affirmer que, — si les limites du Moyen Age sont difficiles à fixer, varient selon le point de vue où l’on se place, — il y a un « homme du Moyen Age », un homme dont la mentalité « plonge ses racines dans le lointain Orient », chez qui la révélation annule l’effort de connaître et dont tout l’être est tendu vers l’au-delà, l’homme sentimental [6].
Ce que montre le livre d’Émile Bréhier, c’est, d’abord, cette raison, si lentement mûrie et par le génie de la Grèce rendue si vigoureuse, sombrant dans la ruine du monde antique ; c’est, ensuite, la pensée grecque, effacée mais non piii abolie, qui reparaît, qui, par des voies diverses, s’infiltre en Occident, qui s’impose à la réflexion chrétienne. Et, de nouveau, la mystique tout à la fois excite et gêne la spéculation. Là est l’intérêt profond du présent volume : pour une longue période, le Moyen Age intellectuel, — c’est-à-dire, selon la définition de Bréhier, « l’époque où l’enseignement philosophique est donné par le clergé, régulier ou séculier » [7], — il suit l’effort pour unifier deux données irréductibles : le christianisme et ce qui subsiste de la civilisation gréco-romaine ; il met en vive lumière les rapports, les essais de conciliation, les conflits de la raison et de la foi.
* * *
Il ne faut pas exagérer la solution de continuité entre l’antiquité et le Moyen Age et prendre à la lettre l’expression de « nuit intellectuelle ». Si la culture s’effrite, si l’Orient ne s’intéresse qu’aux choses divines, en Occident, « un mince filet coule de connaissances positives », qui se rattache à l’érudition romaine ; et la pensée philosophique est transmise, non sans rétrécissements, par des ouvrages comme ceux de Boèce ou de Martin de Braga, qui veulent joindre la logique et la théologie, la sagesse antique et la morale chrétienne. Le rôle capital, ici, a été joué par saint Augustin [8]. Combattu par des influences orientales, l’esprit augustinien triomphe à la fin du VIe siècle.
Le VIIe siècle voit se constituer — en Espagne, par exemple, avec Isidore de Séville, en Angleterre avec Bède le Vénérable — des encyclopédies, où sont plutôt juxtaposées que fondues des connaissances hétérogènes. Prêtres et moines font effort pour maintenir l’« armature intellectuelle ». piv Cependant, l’époque mérovingienne est celle où l’« atonie », pour employer une expression de Pirenne, a été le plus profonde. Un « regroupement des forces intellectuelles » (p. 41) s’opère aux VIIIe et IXe siècles dans les trois empires : byzantin [9], arabe, carolingien. Charlemagne recueille les moines chassés d’Irlande et d’Angleterre par l’invasion des Vikings ; et les grandes abbayes — Saint-Gall, Fulda, Reichenau, Corbie — deviennent les centres d’une culture qui est « une pièce intégrante de la notion d’empire, tel que l’a conçu Charlemagne » (p. 42) [10].
Mais cet empire est une théocratie, en sorte que le savoir n’a d’autre fin que de servir la foi : « les sept arts libéraux comme moyen [11], la théologie comme fin » (p. 46). Il n’y a rien à inventer : il ne s’agit que de conserver et de transmettre ce que les hommes sages ont trouvé dans les choses et fixé dans les livres (pp. 43-45). Nisi credideritis non intelligetis, dira Scot Érigène : on vient à la raison par la foi, et la raison confirme la foi. « Philosophie pieuse », qui ne veut pas être confondue avec la « philosophie du monde », — où les idées divines informent la matière, et qui « voit revivre... tout l’essentiel des conceptions platoniciennes, fortement altérées par l’idée chrétienne et gnostique de la fin des temps » [12].
Dans cet esprit, sous l’influence d’Alcuin, de ses disciples, — notamment Raban Maur et Loup Servat, — et des disciples de ceux-ci, les études se développent dans les monastères, et entre les monastères se forment des liens intellectuels. Mais le rapport qu’avaient eu les arts libéraux, pv chez les Gentils, avec le culte des idoles et les arts magiques exposait aux soupçons ceux qui s’y adonnaient. « C’est un fardeau maintenant que de vouloir apprendre, » déclare Loup Servat (p. 71).
D’ailleurs, au Xe siècle, la dissolution de l’empire carolingien, les invasions normandes et hongroises, la ruine des monastères enrayeront ce mouvement, jusqu’au rétablissement de l’unité impériale par Otton le Grand. Alors, Cluny et Saint-Gall, mais aussi les écoles épiscopales de Reims, de Chartres seront les foyers d’un humanisme — subordonné toujours à des fins religieuses [13].
Parallèlement à la Renaissance carolingienne, l’Orient, aux IXe et Xe siècles, présente un éveil de la pensée arabe qui a pour point de départ le kalifat d’Haroun-al-Raschid. Émile Bréhier montre la complexité de ce travail intellectuel où une spéculation d’origine grecque, qui cherche à concilier Platon et Aristote, et des éléments purement orientaux — cultes solaires, mysticisme — se mêlent au Coran. Un collège de traducteurs fondé en 832 par le calife de Bagdad Al Mamoûn met en langue arabe, parmi de nombreux textes grecs, l’œuvre complète d’Aristote. Événement considérable par ses conséquences ultérieures. Mais le monde matériel, objet principal d’Aristote, est subordonné, dans l’« arabisme », à l’être transcendant, de qui il emprunte la nécessité. La métaphysique d’Al Farâbi, le plus célèbre des philosophes arabes de ce temps, s’accommode même d’un mysticisme et d’un prophétisme qui ne s’y relient pas directement.
A celle époque également, une école philosophique juive étudie Aristote et se sert de la raison « comme machine de pvi guerre en faveur de la religion ». « Le monothéisme et l’hellénisme créèrent certainement, au cours du Xe siècle, à Bagdad, un terrain commun de discussion entre mahométans, chrétiens et juifs, et l’on y voyait des sortes de conférences philosophiques, où participaient même des athées » (p. 102).
Dans les régions où se répand l’Islam, la philosophie atteindra son apogée aux XIe et XIIe siècles, avec Avicenne, Al Gazali et Averroès, qui représentent des courants divers de la pensée musulmane. Le premier, qui se rattache à Al Farâbi, amalgame à sa façon Aristote, le néo-platonisme et des idées coraniques. Le deuxième, qui enseigne à Bagdad, Damas, Jérusalem, Alexandrie, puis retourne en Perse, son pays natal, propage « une mystique proprement orientale et persane qui ne pouvait s’accommoder d’un péripatétisme d’origine grecque ». Averroès, lui, s’oppose et au néoplatonisme et au mysticisme. Il enseigne en Espagne, où se trouvent, au XIIe siècle, les centres intellectuels de l’Islam, Grenade, Cordoue. « Son dessein est de revenir... au sens authentique d’Aristote », cet « exemplaire que la nature a créé pour montrer la suprême perfection où arrive l’homme revêtu d’un corps [14]. »
Mêmes influences dans la philosophie juive, en Espagne : elle est de tendance platonicienne avec Avicébron, au XIe siècle, de tendance péripatéticienne avec Maïmonide, au XIIe. Pour celui-ci, qui retient dans sa doctrine le prophétisme, « la Science de la Loi est une chose à part, et la philosophie est une chose à part ». Il demande à la philosophie de confirmer les vérités de la Loi, mais non sans voir leur antagonisme. Ses adversaires orthodoxes provoquent son exil et font brûler ses écrits [15].
* * *
Cependant, aux XIe et XIIe siècles, la chrétienté s’était pvii dressée contre l’Islam, opposant impérialisme à impérialisme. L’expansion, au nom de la foi chrétienne, résultait naturellement de l’intensité de celle foi.
Et si ardent, si profond est le sentiment religieux qu’il s’agit toujours de philosopher, non pour philosopher, mais uniquement pour penser la foi. On la pense pour la formuler mieux, et ainsi la propager plus efficacement chez les infidèles, la défendre plus sûrement contre les hérétiques. Le clerc, qui seul est philosophe, n’a pas à chercher des vérités nouvelles, puisqu’il détient la Vérité absolue [16]. Mais comment empêcher qu’« à l’universalité de la foi chrétienne, qui naît et se développe en des conditions définies, s’oppose l’universalité rationnelle de la philosophie, indépendante de toute foi » ? Opposition latente, mais réelle, en sorte que peu à peu, invinciblement, les éléments intellectuels, que la foi prétendait absorber, manifesteront des exigences propres.
Dès la seconde moitié du XIe siècle et au XIIe, enseignement et contrôle s’organisent : de la spéculation, qui va se développant, on se demande si elle n’est pas, « plutôt qu’un soutien, l’invention d’un orgueil diabolique » [17].
A mesure que s’affermira la raison, la défiance s’aggravera. Et rien n’est plus attachant que de voir, dans le clair, pénétrant et solide exposé d’Émile Bréhier, s’intensifier ces audaces et ces scrupules de la pensée médiévale. Effort émouvant, et rendu parfois tragique par des débats de conscience ou par des conflits publics, pour affranchir l’esprit de l’explication imaginative et fidéiste des choses.
Dans les villes, dont l’importance croît, le rôle des écoles épiscopales grandit, en attendant que naissent les Universités. Les études du trivium et du quadrivium tendent, en général, à se libérer. La dialectique, en rapports de plus en plus étroits avec la théologie, mais appuyée sur les œuvres d’Aristote, de pviii Porphyre, va jusqu’à prétendre « déterminer les natures des choses » ; elle se heurte à certains dogmes qui lui apparaissent obscurs ou absurdes ; et le danger, qui menace, du « primat de la raison » entraîne l’avertissement des condamnations [18]. Par ailleurs, au nom d’un savoir plus profond, sous l’influence de l’Orient, des doctrines ascétiques s’opposeront à la « philosophie mondaine » (p. 120).
De questions soulevées par des moines, des discussions d’un monastère, sont sorties les œuvres d’Anselme, dont É. Bréhier montre bien les préoccupations et la portée. Anselme précise et limite le rôle de la ratio. Elle n’a d’autre office que la méditation de la foi. C’est ce que traduit sa formule célèbre, Fides quaerens intellectum, — transposition de la non moins célèbre phrase d’Isaïe, reprise par Scot Érigène : Nisi credideritis, non intelligetis [19].
On voit, au XIIe siècle, des écoles diverses — les Chartrains, les Sententiaires — s’appliquer, inlassablement, au problème insoluble. Et ici se place l’épisode — dont É. Bréhier souligne l’importance et le dramatique intérêt — du grand duel entre Abélard et Saint Bernard.
La raison humaine, même en se soumettant, ne pouvait, dès lors qu’elle était éveillée, ne pas rencontrer de l’inintelligible : la trinité, la transsubstantiation, l’accord de la prescience divine et de la liberté humaine. Le nominalisme, — la doctrine qui considère les termes par lesquels on désigne les genres et les espèces, les universaux, comme des flatus vocis, de simples mots — conduisait, en rendant la trinité impensable, à l’erreur du trithéisme [20]. Le réalisme, en allant du supérieur à l’inférieur, en substantialisant les espèces par les genres, les individus par les espèces, permettait, dans la théologie, pix de concilier Dieu et la Trinité. Comme on l’a fait observer [21], le terme « réalisme », quand il attribue une réalité aux abstractions les plus générales, a un sens très différent de celui qu’il a pris en art, où il marque la préoccupation du détail précis dans l’étude du réel. En logique, le nominalisme est plus près de la réalité que le réalisme.
Abélard n’était pas un pur nominaliste ; et ce n’était pas non plus le rationaliste que certains modernes ont voulu voir en lui (p. 151). Son originalité et son mérite sont d’avoir été, dans une large mesure, psychologue. Il croit que les universaux, sans être des réalités, répondent à des manières d’être des choses, sont de légitimes abstractions, le fait de l’esprit. Il ne résolvait pas le problème de la Trinité, qui, pour lui, échappait — ainsi que beaucoup d’autres — au « petit raisonnement humain » (p. 153).
Abélard pratique et défend la dialectique, mais en limite l’emploi. Il est de ceux qui ont préparé une dialectique purement formelle, et non « solidaire de la réalité des universaux », « moyen de discuter, et non moyen de connaître ». Il rapproche la philosophie de la théologie, mais ne se dissimule pas que c’est en « détournant » parfois les textes des anciens vers la foi, en y cherchant un christianisme virtuel. En morale, c’est dans la conscience qu’il trouve la loi, et sa conviction que le péché, comme le mérite, est personnel, tend, sinon à infirmer, à diminuer tout au moins le rôle médiateur du Christ. Philosophe et croyant, somme toute, Abélard veut l’accord de la raison et de la foi ; et là où commence la difficulté, il s’arrête, pour faire triompher la foi [22].
Dans la présentation, tout abstraite, qu’en fait Émile Bréhier, telle que le comporte le déroulement de la pensée médiévale, la pensée propre d’Abélard est singulièrement attirante. Elle l’est plus encore, et éclaire la mentalité collective de son px temps, si on la relie à la vie romanesque de cette curieuse personnalité. On voit alors toutes les forces de vie, toutes les impulsions de nature rejoindre les besoins de pensée, pour préparer les affranchissements ultérieurs. Quand un traitement barbare l’a, comme il le dit lui-même, « rendu d’autant plus propre au service des saints autels que les souillures des voluptés de la chair ne pouvaient plus réveiller en lui les passions » [23], Héloïse, elle, dans son ardeur passionnée, ne se plie à ce service des saints autels que « par obéissance à celui qu’elle aime ». Elle emploie toute sa raison à adoucir la règle monastique [24]. Comme Abélard lui-même, d’ailleurs, elle rabaisse les œuvres [25]. Le travail de l’esprit religieux se situe alors, il ne faut pas l’oublier, dans un milieu où l’économie se développe, où vont bientôt fleurir les lettres et les arts, et subit l’action d’une sorte de poussée vitale. Nous y reviendrons.
Mais il y a des résistances et des hostilités. Pour un Saint Bernard, chercher l’accord de la philosophie et du dogme, c’est introduire la confusion entre le dogme et la philosophie : l’« intelligence » nuit à la foi ; l’orgueil fait sortir l’homme de la mesure [26]. En 1121, au concile de Soissons, en 1141, au concile de Sens, il obtient la condamnation de deux ouvrages d’Abélard. En 1140, le silence est imposé à celui-ci, par rescrit du pape, et ses partisans sont excommuniés [27].
Chez Saint Bernard et chez ceux qu’il inspire, le scepticisme sur les recherches des philosophes mène au mysticisme.
pxi Toute spéculation est vaine : il faut tout accepter et du dogme et des institutions de l’Église, qui échappent à l’intelligence humaine, et chercher la connaissance pleine dans l’amour divin. Saint Bernard n’est philosophe que contre la philosophie.
Le monastère de Saint-Victor, à Paris, s’accordait, sur ces questions, avec l’abbaye de Cîteaux, réformée par Saint Bernard. Opposé également aux « philosophes mondains », Hugues de Saint-Victor leur objecta que, parlant d’une « nature gâtée par le péché originel », ils ont prétendu atteindre Dieu par la seule lumière d’une raison « incomplète et déficiente » (p. 189). Pour tous ces mystiques, la raison ne saurait fournir qu’un passage de la foi banale à l’illumination, soit de l’amour, soit de la contemplation [28].
On ne bannit donc pas la raison, même dans ces milieux monastiques ; mais on ne lui accorde qu’un caractère « préparatoire et préliminaire ». Cependant, les écoles théologiques de Paris et, à côté d’elles, des écoles nouvelles, — qui devaient bientôt devenir la Faculté des Arts, — développaient, avec la dialectique, un goût de discussion inquiétant pour la piété intérieure. Le duel d’Abélard et de Saint Bernard est aussi le duel entre les écoles épiscopales et les monastères, entre la théologie spéculative et la vie chrétienne. Ennemis comme amis de la raison, tous sont préoccupés de préciser son rôle. Et, pour Bréhier, un caractère « foncier et presque inexprimable » de la pensée médiévale consiste en un effort, « puissant et douloureux », pour donner à nos facultés naturelles leur sens dans la vie surnaturelle [29].
* * *
Avec le XIIIe siècle, nous atteignons ce que notre collaborateur pxii appelle le tournant. « Nous trouvons ici ... un jaillissement de forces nouvelles et indépendantes qui sont foncièrement différentes de l’Église, et, d’autre part, une interprétation mystique de ces forces qui les asservit à l’Église et à la papauté » (p. 257). Et c’est le lieu d’insister sur les traits généraux de ces temps, pour mieux comprendre les luttes spirituelles et leur fatale aggravation.
Le Moyen Age, d’après Gustave Cohen [30], est l’âge de toutes les genèses. Une civilisation originale y est née, en France, qui a rayonné largement, — le fait s’est reproduit aux XVIIe et XVIIIe siècles, nous le verrons [31], — et dont le caractère était complexe : civilisation chrétienne, ou l’élan des croisades el la montée des cathédrales ont exprimé la foi ardente, mais où la chevalerie, puis la commune, ont préservé ou émancipé l’individu. Henri Pirenne, dans son ouvrage posthume, Histoire de l’Europe, a fait de cette « civilisation française » un magnifique tableau [32]. Il souligne l’influence de l’Université de Paris, — dont l’attraction, dit-il, « était irrésistible et est restée sans exemple ». C’est que, à Paris, l’Association générale des maîtres et des étudiants, Universitas magistrorum et scolarium, dépendante du pape, — qui la reconnut en 1231, — protégée par le roi, s’était affranchie de l’autorité épiscopale. Il y avait là un fait « analogue à celui des communes : comme les communes sont à côté de la hiérarchie féodale, l’Université est en dehors de la hiérarchie ecclésiastique ; comme la commune est aspiration à un développement économique plus libre et plus étendu, l’Université, pxiii faisant suite aux écoles du XIIe siècle, recherche, au milieu de toutes les difficultés d’une orthodoxie pointilleuse, un développement de la pensée qui corresponde à ses exigences internes [33] ».
Aristote fait, à ce moment, sa « grande entrée », et c’est lui qui est le principal agent des progrès de la pensée, — avant d’en devenir l’obstacle [34]. Par l’intermédiaire des Arabes, l’Occident recueille cette philosophie et cette science helléniques, dont il n’avait encore que des lambeaux. Les traductions se multiplient, — de l’arabe, ou même directement du grec. Comme Aristote, Platon, dont l’influence s’était prolongée avec les Augustiniens, va être mieux connu. Mais Aristote favorisait une spéculation purement rationnelle, relative au monde physique.
Une philosophie naît, distincte de la théologie, soutenue par les uns, combattue par les autres, et d’autant plus suspecte à ceux-ci que, jaillie d’une curiosité de l’esprit qui ignore la foi chrétienne, elle ne laissait plus à la raison « cette fonction intermédiaire que la culture chrétienne lui assignait » (p. 296). Un Saint Bonaventure, par exemple, déclare que s’arrêter aux choses de l’expérience, qui ne sont que des signes, s’abaisser à leur connaissance, c’est tomber de la contemplation véritable et « goûter de l’arbre défendu de la science du bien et du mal » [35].
Albert le Grand et Saint Thomas, son élève, dominicains tous deux, interprètes d’Aristote, détachent complètement la pxiv philosophie de la théologie : pour eux, la raison, qui, chez les Augustiniens, était un intermédiaire et « comme une illumination d’ordre inférieur » (p. 305), n’est pas orientée vers les choses spirituelles : elle n’a, en principe, que la nature — nature physique, nature morale, nature sociale — pour domaine. Sans doute, Saint Thomas croit que l’homme, par sa raison, peut remonter jusqu’à Dieu ; et il énumère cinq « voies » qui mènent à lui ; mais il y a un amour naturel et un amour surnaturel de Dieu. Il y a une surnature, — celle que la foi exprime et que l’Église représente ; et la philosophie reste « servante de la théologie », en ce sens que, si une vérité de la raison était contraire à une vérité de la foi, c’est celle-ci qui serait la vérité vraie.
Albert le Grand et Saint Thomas se sont opposés à la fois aux théologiens qui niaient la philosophie d’Aristote en faveur de la théologie et aux averroïstes qui niaient la théologie en faveur de la philosophie (p. 339). Ces derniers sont condamnés en 1270. Mais, en 1277, les efforts des maîtres séculiers de l’Université de Paris font condamner 219 propositions « qui portaient indistinctement sur la doctrine péripatéticienne, en général, et la doctrine averroïste, en particulier » (p. 342) [36].
Ce vivant XIIIe siècle voit, tout ensemble, un essor de la pensée qui comporte toutes les hardiesses, et un réveil de christianisme intérieur auquel répondent les ordres mendiants et les sectes. La fin en est remplie par des luttes entre Franciscains et séculiers augustiniens, d’une part, Dominicains et séculiers thomistes, d’autre part, — ces derniers plus ou moins soutenus par la papauté. Des conceptions de toutes sortes se confrontent ou s’affrontent. L’œuvre de Roger Bacon est un curieux mélange d’empirisme et de mysticisme ; celle de Raymond Lulle est un approfondissement pxv de la dialectique. L’un et l’autre sont préoccupés surtout d’expansion de la foi, d’organisation de la terre par l’Occident chrétien. L’un compte sur la science expérimentale pour consolider la théocratie : malgré des réminiscences des sciences occultes, il est un précurseur de son homonyme François, et aussi, comme le remarque Bréhier, d’un Jules Verne [37]. L’autre, en dehors du courant des sciences de la nature, conçoit un art d’invention et de découverte qui contienne les principes de toutes les sciences particulières (p. 373).
En ces temps de fermentation intense, dans ces années où « les maîtres ès arts de Paris furent à la fois le plus dangereusement hardis en innovations de toutes sortes : athéismes, immoralités, astrologie, déterminisme, scientisme, panthéismes, etc., et le plus durement traqués par les autorités de l’Église », dans celle même rue Saint-Jacques où Saint Thomas écrivait sa Somme contre les Gentils, un clerc, libre d’esprit, Jean de Meung, donnait une suite au Roman de la Rose : véritable Somme, à la fois croyante et frondeuse, scolastique et poétique, où une philosophie de la Nature et de la Raison s’enveloppait d’un christianisme, — sans doute sincère, quoique illogique :
Rien n’a pouvoir contre raison [38].
* * *
Le XIVe siècle est le siècle de l’argumentation dialectique cultivée pour elle-même, le siècle du pour et du contre, le siècle des thèses subversives que l’on introduit « en vue de la discussion », « que l’on approuve secrètement, mais que l’on est d’ailleurs prêt à révoquer » (p. 376). La raison, qui pxvi y règne, n’est pas seulement raisonnante, comme on l’a cru longtemps, elle est aussi critique, et par là même constructive.
Chez Duns Scot, chez Guillaume d’Occam, « la foi et la raison tendent à s’isoler chacune en sa sphère » ; « la science de Dieu et la science de la nature pourraient suivre des voies si différentes qu’elles n’arriveraient jamais à rencontrer la même vérité ; il n’y a entre elles ni pénétration comme le rêvait Saint Anselme, ni hiérarchie comme le pensait Saint Thomas » [39].
L’aristotélisme thomiste avait introduit l’idée d’une nature à laquelle une métaphysique donne sa fixité : le nominalisme occamiste abattait toute superstructure métaphysique, pour limiter la connaissance humaine à l’intuition et à la contingence. Dans l’universel, il voit non une réalité, mais une production spontanée de l’esprit ; l’ordre de l’univers n’existe pas dans les choses, mais dans l’esprit. Une physique nouvelle s’oppose à celle d’Aristote, qui ruine la preuve cosmologique de l’existence de Dieu. « Le chrétien est certain, par la Bible, que Dieu a créé le ciel et la terre ; mais la création n’est aucunement démontrable. » Le « rasoir » d’Occam fait des ravages dans la scolastique, et toute une pléiade d’occamistes — moines et maîtres de la Faculté des Arts — séparent radicalement, à sa suite, la philosophie et la théologie. Plus de théologie philosophique ; foi, d’une part, empirisme, de l’autre, ou scepticisme : on collectionne les cas d’intuitions sans réalité, rêves, hallucinations, — collection qui, des anciens sceptiques, passera à Montaigne et à Descartes [40].
pxvii Cette conception nouvelle de la nature mène à la physique ; cette conception nouvelle de la foi peut mener jusqu’au mysticisme panthéiste. Eckart a poussé à la rigueur une tendance commune à tous les néoplatoniciens ; l’Être est identique à Dieu, et il n’y a de connaissance qu’en Dieu [41].
* * *
La longue période qu’embrasse ce volume a vu se produire l’effort le plus considérable pour réaliser l’unité à la fois religieuse et politique de la chrétienté [42]. On parlera ailleurs des conflits entre la papauté et l’Empire [43]. Le pouvoir temporel a lutté pour n’être pas absorbé par la théocratie, comme la raison pour n’être pas étouffée par la tradition religieuse.
Cette tradition soulevait, la ratiocination multipliait, des problèmes, — dont les uns étaient vains, et les autres prématurés : nature de Dieu et des anges, rapports de l’existence et de l’essence, de la matière et de la forme, de l’âme et du corps, de Dieu et des êtres, portée de la connaissance. A côté des chantiers gothiques, il y eut des chantiers dialectiques où s’érigèrent des cathédrales de raisonnements. Et les bâtisseurs intellectuels, dans tout l’Occident, circulaient d’un monastère, d’une école à l’autre, — tantôt admirés, applaudis, tantôt persécutés, condamnés. De cette prodigieuse activité, qui voulait consolider la tradition, et dont l’œuvre était vouée à l’écroulement, quelque chose d’efficace devait résulter : le progrès de l’instrument intellectuel et surtout de la réflexion sur la nature de cet instrument.
Ce que j’ai essayé, ici, de rendre, c’est le mouvement, si pxviii passionnant à suivre, et à la longue libérateur, de la pensée médiévale. De cette pensée on trouvera le riche détail lumineusement exposé dans le présent volume.
« L’histoire de la philosophie médiévale, disait Henri Delacroix en 1902, est en somme toute récente et ne s’est franchement développée que dans les trente dernières années [44]. » Dans les trente-cinq années qui se sont écoulées depuis cette date, beaucoup de textes ont été publiés : rien d’essentiel ne fait défaut. D’importants travaux ont paru, notamment ceux de Gilson, du P. Mandonnel, de Grabmann, de Michalski. Émile Bréhier avait tous les éléments nécessaires pour établir sa vigoureuse synthèse ; et, historien averti de la philosophie générale, il a pu situer la pensée médiévale dans l’évolution de l’esprit humain.
Henri Berr.
[1] En marge de l’Histoire universelle, p. 292.
[2] Ibid., pp. 228, 230, 282, 287.
[5] Lot, La fin du Monde antique et le début du Moyen Age, pp. ix, xiii, 26, 211.
[6] Voir Robin, t. XIII ; Boulanger, t. XI ; Jouguet, t. XV ; Guignebert, t. XXVIII bis.
[8] Voir les tomes XXX et XXXI.
[9] Voir pp. 38, 105, 252.
[10] Pour la renaissance carolingienne, nous renvoyons au tome XXXIII.
[11] Trivium : grammaire, rhétorique, dialectique ; quadrivium : arithmétique, musique, géométrie, astronomie.
[12] P. 64. Cf. p. 76. De Scot Érigène, néoplatonicien à tendance panthéiste, un courant panthéiste est sorti. Voir H. Delacroix, La Philosophie médiévale latine, dans la Rev. de Synth, hist., t. V, pp. 105-106.
[13] Gerbert, le futur Silvestre II, Abbon, abbé de Fleury, travailleront même à la restauration des sciences. Voir A. Van de Vyver, L’évolution scientifique du haut Moyen Age, dans Archeion, mars 1937, et ultérieurement, Abel Rey, t. XLVI.
[14] Pp. 216, 237 ; 220, 222 ; 225, 226, 235.
[16] Voir pp. 145, 146, 186-187.
[19] Pp. 122, 124. — Sur la preuve ontologique de l’existence de Dieu, reprise par Descartes, voir pp. 126-129.
[20] P. 129. Sur Roscelin, nominaliste, condamné par le concile de Soissons en 1092, voir pp. 129-131.
[21] Wells, Esquisse de l’Hist. univ., p. 372.
[22] Voir pp. 156, 161, 177-178.
[23] Lettres d’Abélard et d’Héloïse, trad. Gréard, p. 98.
[24] Ibid., p. 117 (certains ménagements seraient conformes « au vœu de la nature »).
[25] Ibid., voir pp. 123, 125, 127, 128. — On peut se demander si les lettres d’Héloïse n’ont pas été « fabriquées » par Abélard : quoi qu’il en soit, il y a, dans ces lettres, des sentiments, des traits passionnés, qui viennent certainement d’Héloïse. Voir Me Charrier, Héloïse dans l’histoire et dans la légende, et Émile Henriot, La vraie Héloïse, Temps du 25 sept. 1934.
[27] Sur Gilbert de la Porrée, condamné en 1148, voir p. 174.
[28] Sur le mysticisme et, en particulier, le culte de la Vierge, voir Réau, t. XL, p. 42.
[31] Voir Réau, ibid., pp. 114 et suiv. Cf. t. LXX, L’Europe française, qui paraîtra prochainement.
[32] P. 268. — On connaît les thèses — conciliables — de Nordström, qui situe la vraie Renaissance dans la France des XIIe, XIIIe siècles et y rattache la Renaissance italienne, et de Toffanin, qui oppose au rationalisme français l’humanisme chrétien du Quattrocento. Voir Renaudet, L’humanisme italien, dans Science, avril 1937, et Italo Siciliano, Medio evo e Rinascimento, notamment pp. 33, 108, 117, 131.
[33] Sur l’Université de Paris, voir Lot, t. XLI, pp. 221, 292 ; Delacroix, art. cité, p. 119 ; Ch. V. Langlois, Les Universités du Moyen Age, dans Questions d’Histoire et d’Enseignement, pp. 34 (« le Studium generale de Paris fut, à partir du XIIIe siècle, une grande démocratie cléricale », hardie et turbulente), 38.
[34] Sur Aristote, voir Lot, ibid., p. 193 ; Delacroix, ibid., pp. 110-112 ; Langlois, ibid, p. 76 : « L’impression produite dans les écoles de Paris, qui étaient alors, pour ainsi dire, le cerveau de la chrétienté, par l’apparition d’Aristote, fut immense. Impression mélangée d’enthousiasme, de méfiance, d’horreur. »
[35] Pp. 280, 281, 284, 293.
[36] Sur Siger de Brabant, voir pp. 336 et suiv. ; Delacroix, art. cité, p. 117 ; Langlois, dans l’ouvrage cité, pp. 51-103, notamment pp. 62, 86, 91.
[37] P. 370. Voir le t. XLVI.
[38] Voir M. Gorce, Le Roman de la Rose, notamment pp. 44, 52, 67, 209.
[40] Pp. 397, 401, 411, 414, 417. — Avec H. Delacroix, pp. 101-102, nous croyons qu’il faut distinguer philosophie seolastique et philosophie médiévale, la première étant celle « où le dogme chrétien s’assimile la philosophie antique, où l’esprit chrétien opère la synthèse de ces deux données », la seconde, celle où l’esprit philosophique cherche son indépendance.
[41] P. 430 ; Delacroix, art. cité, p. 122, et Le Mysticisme spéculatif en Allemagne au XIVe siècle.
[42] Voir pp. 1, 107-108, 121, 204-205, 255, 359-360.
|

