|
Écrits philosophiques.
Tome 3 : Science - religion.
Introduction
Le dur labeur de la vérité [a]
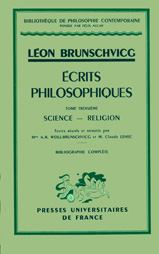
En 1868, Pasteur se tournait vers les Pouvoirs publics du Second Empire ; il les suppliait de consentir à réserver dans le budget de la nation une part plus large pour la recherche scientifique. « Prenez intérêt, je vous en conjure, à ces demeures sacrées que l'on désigne du nom expressif de laboratoires. Demandez qu'on les multiplie et qu'on les orne : ce sont les temples de l'avenir, de la richesse et du bien-être. C'est là que l'humanité grandit, se fortifie et devient meilleure. »
Depuis 1868 tous les pays, quel que soit le caractère de leur civilisation et de leur régime, ont entendu cet appel. À travers le monde, de grandes armées de biologistes, de physiciens, de mathématiciens, collaborent à une oeuvre dont à aucune époque les résultats n'ont connu un rythme aussi rapide, n'ont renouvelé d'une façon aussi heureuse et déconcertante, non seulement notre perspective sur l'étendue de l'univers ou sur les facteurs élémentaires de sa constitution, mais encore sur la façon dont l'esprit de l'homme entre en contact avec la réalité des choses, sur l'engagement réciproque de la raison et de l'expérience dans leur effort commun vers la vérité. S'il nous était permis de limiter au domaine spéculatif la curiosité de notre regard et son inquiétude, notre génération est de celles qui auraient le mieux mérité de l'esprit humain.
D'autre part, le langage même dont se sert Pasteur, catholique convaincu et pratiquant, invite à ne pas perdre de vue les temples du passé : pagodes ou synagogues, églises ou mosquées. Prêtres, moines ou fidèles y vivent leur vie de mission, de contemplation, de prière, attentifs à quelque chose qui semble ne relever ni de la démonstration purement mathématique, ni de la méthode proprement expérimentale, et que, cependant, ils appellent vérité, comme s'il pouvait y avoir un double sens de ce mot vérité, un sens pour la science et un sens pour la religion ? Et cependant ce qui caractérise l'idée de vérité, n'est-ce pas qu'elle se dépouille de sa signification intrinsèque et de sa dignité si elle se résigne à demeurer séparée d'avec soi, si on est autorisé à parler, tantôt d'une vérité qui respecte humblement et scrupuleusement les normes de la vérification, tantôt, au contraire, d'une vérité qui n'y porterait intérêt que pour s'attribuer le droit de les outrepasser ?
Problème fondamental que, pratiquement, chacun tranche à tout instant de son existence. Nous voudrions seulement, pour en déterminer les conditions, rappeler brièvement les bases de référence que le développement du savoir scientifique nous oblige à considérer. Il est, en effet, trop aisé de mettre en contraste, d'une part, l'unité et l'impersonnalité de la raison, d'autre part la diversité et la subjectivité des professions de foi religieuse ; d'ailleurs, il ne serait pas moins arbitraire de choisir, pour la réconcilier avec la religion, l'une quelconque des conceptions de l'intelligence qui se sont succédé à travers les siècles de notre civilisation occidentale. L'étude du monde spirituel, comme celles du monde matériel et du monde organique, n'atteint son but que dans la mesure où elle fait effort pour retracer le processus de son évolution aussi impartialement, aussi intégralement que possible.
En fait, et d'un point de vue strictement positif, l'histoire de la recherche de la vérité présente une série de phases doctrinales, qui ne peuvent manquer d'avoir leur répercussion sur la vie morale et religieuse.
Allons tout de suite au coeur d'un malentendu séculaire. Le rationalisme grec, vu de loin et en gros, apparaît homogène ; or, il est dominé par une alternative, que nous trouvons formulée avec une entière conscience de sa destination ultérieure dans un texte de la Métaphysique. Si Aristote s'est dressé contre son maître, s'il a institué une école rivale de l'Académie, c'est parce que les Platoniciens avaient eu le tort de suivre à la fois deux pistes : la piste des relations mathématiques et la piste des discours universels. Il faut choisir ; et Aristote choisit, comme choisira le Moyen Age, les discours universels. Depuis, jusqu'au moment où, avec Galilée et Pascal, la physique s'est constituée, l'humanité ira répétant que, tout au moins en ce qui concerne le monde sublunaire, il n'y a de science que du général.
Le postulat sur lequel s'appuie, sans y avoir réfléchi, la tradition de l'École péripatéticienne, était celui-ci : avant que notre intelligence entre en action, les données immédiates des sens constituent déjà un monde d'objets en soi, que le rôle de la raison se borne à répartir en espèces et en genres. De ce travail de classification procédera la nécessité apparente du raisonnement syllogistique. En effet, la déduction logique, pour être correcte, doit aller du plus au moins. Socrate est mortel parce qu'il appartient à l'espèce des hommes et que les hommes appartiennent au genre des mortels. Là-dessus va se greffer cette affirmation fondamentale que le moyen terme d'humanité, qui sert de lien entre la majeure du syllogisme et la conclusion, correspond au principe interne qui confère à l'individu ses déterminations caractéristiques, par quoi Callias ou Socrate se définit en tant qu'homme.
Autrement dit, la forme spécifique est constitutive de l'être. La logique s'appuie à une métaphysique qui exprime en termes abstraits le spectacle du développement organique, mais qui de la biologie déborde sur la physique. Elle va permettre une explication des phénomènes de la nature dans le domaine où l'observation immédiate se présentait comme la plus déconcertante, dans le domaine de la pesanteur. La pierre tombe tandis que la fumée s'élève vers le ciel. Comment ? Aucune cause visible ou tangible ; l'expérience, dans l'acception purement empiriste où Aristote l'entend, demeure muette. Le champ sera donc libre pour la raison, telle du moins qu'Aristote l'imagine. Ignorant le comment, elle n'éprouvera aucune hésitation à inventer le pourquoi. Le mouvement de la pierre ou de la fumée, comme la croissance de l'être vivant, traduit l'exigence d'une âme orientée vers sa fin. L'homme en puissance qu'est l'enfant veut devenir l'homme en acte qu'est l'adulte. De même, la pierre tombe parce qu'elle est séparée de son « lieu naturel », qui est le centre de la terre et du monde. Elle aspire à le rejoindre, comme la fumée se dirige vers son « lieu naturel »qui est l'orbite de la lune.
Le vocabulaire d'allure scientifique a pu faire illusion. Il est évident que nous retrouvons là un simple reflet de l'animisme primitif, et c'est par là qu'il devait fournir les cadres les plus propres à satisfaire l'instinct religieux. Saint Augustin parle le langage de la physique aristotélienne lorsqu'il écrit au début des Confessions : « Notre âme est agitée, et elle demeurera dans un état d'inquiétude tant qu'elle n'aura pas trouvé le repos en Dieu. » À cet égard, les astres d'Aristote, par la perfection du mouvement circulaire que commandent leurs âmes bienheureuses, remplissent entre Dieu et l'homme le même rôle d'intermédiaire que la tradition judéo-chrétienne réservait aux créatures angéliques.
Le système se suffit ainsi parfaitement ; et il avait toute chance pour s'imposer, en l'absence de relation mathématique et de contrôle expérimental, c'est-à-dire à défaut des normes authentiquement rationnelles qui, nous le savons aujourd'hui, sont requises pour qu'il soit donné à l'homme d'avancer dans la voie de la vérité. Le crédit en demeure provisoire, quelque longue qu'ait été la période entre l'avènement de l'aristotélisme et l'aurore, au XVIIe siècle, de la science moderne.
Encore avons-nous quelque motif de nous étonner ; car cet appel au syllogisme pour le renouveau de l'imagination animiste s'est cependant produit après qu'avait eu lieu la démarche pourtant décisive de la civilisation occidentale, après que les Écoles de Pythagore et de Platon avaient proclamé la nécessité de chercher dans les combinaisons de la mathématique, claires et distinctes pour l'intelligence, le fondement de l'harmonie entre l'esprit de l'homme et les phénomènes de l'univers. Ne devons-nous donc pas enregistrer une régression manifeste et singulière dans l'idée que la raison s'était déjà faite de la vérité ?
C'est ici précisément que le rationalisme, considéré dans le principe de sa méthode la plus profonde et la plus féconde, s'est fait obstacle à lui-même par ce besoin d'explication totale que l'instinct réaliste porte avec lui. Songeons à Auguste Comte, aux fantaisies aberrantes de la « synthèse subjective » qui ruinent la positivité de l'« analyse objective » ; nous ne pourrons nous refuser à regarder avec quelque indulgence, soit la cosmologie anthropomorphique du Timée dont l'auteur est le premier à souligner le caractère mythique, soit les propriétés quasi mystiques dont les néo-pythagoriciens et les néo-platoniciens revêtent les nombres avec cette même crédulité puérile que les ethnographes relèvent dans les traditions des sociétés inférieures. Du même coup, nous apercevrons par quelles vicissitudes le rationalisme mathématique avait à passer avant que soit dégagé en pleine lumière de conscience le bienfait d'une méthodologie rigoureuse, seule capable de conférer à la vie de l'esprit son double caractère de progrès indéfini et de communion universelle. Le manteau d'Arlequin ne s'est pas changé de lui-même en tunique sans coutures. L'établissement de la physique de Galilée et de la mathématique de Descartes était nécessaire pour comprendre ce qui avait empêché Platon d'achever sa doctrine suivant le plan qu'il s'était tracé, ce qui par suite, avait laissé l'Académie désarmée devant l'offensive du Lycée.
La Géométrie de 1637, à laquelle le Discours de la méthode sert de préface, est une algèbre ; les relations constitutives de la mathématique y apparaissent dans la pureté de leur évidence sans requérir l'appui douteux d'une dialectique imaginaire. D'autre part, avec la constitution d'une physique mathématique, les combinaisons analytiques se confrontent à la réalité des phénomènes, écartant le fantôme d'une mythologie suspecte. C'est un moment solennel dans l'histoire de l'humanité que celui où Descartes, en possession certaine d'un critère de vérité, peut écrire : « Enfin, pour les mauvaises doctrines je pensais déjà connaître assez ce qu'elles valaient pour n'être plus sujet à être trompé ni par les promesses d'un alchimiste, ni par les prédictions d'un astrologue, ni par les impostures d'un magicien, ni par les artifices ou la vanterie d'aucun de ceux qui font profession de savoir plus qu'ils ne savent. » Rappelons la date de cette condamnation ; elle touche presque à l'époque où Shakespeare, faisant allusion à la scolastique qui régnait alors dans les Universités d'Europe, prononçait la parole célèbre : « Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que dans toute votre philosophie. » Le rationalisme du XVIIe siècle, non moins sévère pour le dogmatisme mesquin d'Aristote, va déployer devant l'intelligence la perspective d'un progrès proprement illimité.
Le Moyen Age, dont la Renaissance et la Réforme avaient dénoncé la confusion sans pourtant oser s'y soustraire, ne pouvait s'achever que par la conclusion d'un nouveau pacte d'alliance entre la raison et l'expérience ; et l'on ne saurait trop en méditer les clauses paradoxales. Il ne s'agit plus, en effet, de l'expérience qui a pour fonction d'appréhender les objets à répartir en un tableau de genres et d'espèces. Par delà cette expérience et en opposition avec ce que nous avons cru saisir de ses données immédiates, il faudra faire droit à une expérience savante et profonde qui, elle, ne précède pas la raison, qui résulte, au contraire, de l'initiative que prend l'homme, lorsqu'il invente les questions qu'il convient de poser à la nature afin de la contraindre à dénoncer les pièges qu'elle nous tend par ses apparences sensibles. La vérité se dévoile dans ce qui lui est essentiel au prix d'un redressement pénible de l'image qu'elle avait d'abord offerte d'elle-même.
- « Qui osera, demandait Virgile, accuser de fausseté le Soleil ? » Et cependant le soleil nous trompe, non seulement lorsque nous lui demandons de se ternir brusquement à la mort d'un héros ou d'un Dieu, mais lorsque nous nous fions à l'intuition de son lever et de son coucher et que nous nous disons assurés de la réalité de sa marche à travers le ciel. Pour obéir à l'exigence de la vérité, il a fallu que les yeux de l'esprit aient eu l'audace de contredire les yeux du corps.
- Cette révolution totale dans le rapport de l'esprit et de la nature est si proche de nous que bien peu, même parmi les savants ou les philosophes de profession, en ont aperçu jusqu'au bout les conséquences. Descartes, l'initiateur de la civilisation moderne, tient encore le langage du réalisme primitif lorsqu'il dresse en face l'une de l'autre deux idées du soleil : « L'une tire son origine des sens par laquelle il me paraît extrêmement petit ; l'autre est prise des raisons de l'entendement, par laquelle il me paraît plusieurs fois plus grand que toute la terre. Certes, ces deux idées que je conçois du soleil ne peuvent pas être toutes deux semblables au même soleil. »
Suivant la lettre de ce texte le soleil astronomique serait donc un objet, comme le soleil sensible dont il prendrait en quelque sorte la place, et qui se représenterait de la même façon à l'imagination. Corrélativement, c'est sous la catégorie de substance, pour la conserver à titre de suppôt d'immortalité, que le même Descartes cristallise, au risque de le matérialiser, le moi dont il avait plus clairement et plus profondément que tout autre, lié la spiritualité à l'expansion infinie, au dynamisme constitutif de la raison.
Ainsi est-il exact de dire que Descartes se présente à nous comme tout à la fois « plus jeune et plus vieux que lui-même ». Et la formule platonicienne s'applique à ses grands successeurs, à Newton dont le système comporte tout ensemble la détermination positive de la gravitation et le mystère de la causalité par attraction, à Kant qui fait reposer sur l'activité du sujet l' « objectivation » de l'univers scientifique et qui cependant n'a pas le courage de renoncer au fantôme dialectique du monde nouménal.
On pressent par là les divergences, au premier abord décourageantes, des historiens et des commentateurs qui traitent d'une oeuvre publiée sous la même signature, sinon conçue par le même cerveau. Suivant qu'ils seront ou réalistes ou spiritualistes, on les verra opérer différemment la répartition des lumières et des ombres. Et cette remarque n'a pas un intérêt seulement rétrospectif. Toute la manière dont nous comprenons le progrès de l'esprit humain vers la vérité s'y trouve impliquée. Pour le dogmatisme, qui prolonge dans la métaphysique l'ingénuité de l'enfant, connaître, c'est entrer directement en possession de la nature des choses ; dès lors, chaque progrès de réflexion qui vient ruiner la confiance dans les données immédiates des sens est une occasion de trouble. S'il n'est plus permis de dire, en toute conviction de conscience, que le soleil se lève tous les matins et se couche tous les soirs, que l'air et l'eau sont des éléments simples, le sceptique n'aura-t-il pas gain de cause ? Newton qui détrôna Descartes, Einstein qui détrône Newton, nous avertissent à quel point la raison de l'homme est fragile et contradictoire avec elle-même, à moins que nous ne renversions la perspective, que nous acceptions de sacrifier une idée présupposée et tout illusoire du vrai à ce que nous enseigne le développement du savoir scientifique, qui est, à proprement parler, le lieu sacré de la vérité.
Nous découvrons alors que Newton sert, à titre posthume, la pensée cartésienne qu'il rapproche de son inspiration première. En effet, comme mathématicien, Descartes fait dépendre les propriétés géométriques des relations algébriques, tandis que dans sa physique le primat de l'analyse est abandonné au profit de l'imagination spatiale qui commande une vue réaliste et rigide du mécanisme. Un premier pas dans la voie de la libération se trouve accompli par Newton, dont la doctrine ne parvient cependant pas à se fermer sur elle-même, puisqu'on y cherche en vain le passage entre la formule de la loi, telle que l'expérience la confirme dans les limites atteintes par l'observation, et le schéma de représentation qui en fournirait l'explication. À leur tour, les difficultés qui résultaient de cet hiatus disparaissent grâce au génie d'Einstein, qui ne laisse plus rien subsister que la coordination des phénomènes par la vertu de l'analyse mathématique.
Ainsi, se trouve écarté définitivement du chemin de la vérité aussi bien l'absolu des principes a priori que l'absolu de l'intuition sensible. Les théories de la relativité font comprendre à merveille comment la nature des choses et l'esprit de l'homme se révèlent réciproquement l'une à l'autre dans une solidarité qu'il est impossible de rompre. Les mots ici ne doivent pas nous tromper. Tant que la géométrie d'Euclide passait pour la géométrie tout court, la dualité irréductible de l'axiome et du postulat, à l'origine du système où l'on se plaît à trouver l'application rigoureuse de la méthode déductive, demeurait un scandale, dont les siècles s'efforcèrent vainement de venir à bout. Les résistances auxquelles devait se heurter l'intelligence de la géométrie non euclidienne montrent avec quelle difficulté l'homme renonce à l'espérance, pourtant contradictoire, de « principes sans pétition ».
Il l'a fallu pourtant. Et, pour notre génération, quel spectacle plus éloquent que l'évolution de celui qui, plus que tout autre a contribué au renouvellement des études de logique formelle ? M. Bertrand Russell ne s'était-il pas flatté de restaurer l'ontologie, comme Husserl tenta aussi de le faire à ses débuts, par la considération d'essences situées dans un monde parfaitement intelligible, hors de toute dépendance à l'égard de l'esprit humain, Idées platoniciennes, ou plutôt sans doute, caricature des Idées platoniciennes ? Or, avec la netteté radicale qui est une part de son génie, M. Russell s'est converti aux critiques qu'on lui avait opposées dès la première heure. Il a reconnu, ce sur quoi les logisticiens paraissent aujourd'hui d'accord, que la forme conceptuelle fournit simplement un langage qui excéderait et trahirait sa fonction s'il se retournait contre la pensée pour l'enfermer dans les limites d'un système unique et nécessaire. La logique considère seulement le possible ; et tout possible implique l'éventualité d'un possible différent, de telle sorte que nous assistons à une prolifération de combinaisons libres qui expriment la fécondité inhérente à l'activité intellectuelle, sans cependant contenir en soi la décision de jugement à laquelle il appartient d'affirmer la réalité.
Encore une fois le nominalisme apparaît comme l'aboutissement inévitable de la réflexion sur la pure logique. La raison nous renvoie, à l'expérience. Et si nous nous transportons à l'autre extrémité de la recherche spéculative, c'est à un spectacle analogue que nous assistons. Dans l'intervalle d'une génération, l'atome a perdu sa simplicité, de même que l'axiome a perdu son évidence.
Les célèbres travaux de M. Jean Perrin semblaient promettre la résurrection de l'atomisme, témérairement condamné par les partisans de la physique énergétique. L'espérance millénaire que l'homme entre en possession de l'élément en soi cessait de paraître illusoire. Et cependant, pour le préjugé dogmatique dont philosophes et savants ont tant de peine à s'affranchir, que de déceptions se sont succédé depuis, déceptions d'autant plus significatives qu'elles sont liées à une accumulation de découvertes que le savant le plus autorisé a pu qualifier d'invraisemblables ! Chacune marque un épisode nouveau dans cette bienheureuse course à l'abîme où la nature entraîne la raison. Tandis que la raison rêve du simple, la nature la contraint à réformer ses principes, à déformer ses cadres les mieux définis en apparence, tels que la conservation de la matière ou les trois dimensions de l'espace ; elle la renvoie du continu au discontinu ; elle dévoile un nouveau continu sous le discontinu ; elle finit par interdire au savant de se désintéresser de la manière dont il intervient pour fixer la position ou mesurer la vitesse des éléments qu'il considère.
Au degré inouï de délicatesse où la physique expérimentale est parvenue, le phénomène de l'observation est lui-même un phénomène qu'il n'est plus permis de négliger : interférant avec le déterminisme du phénomène observé, il en limite pour nous les conséquences, et l'instrument nous manque qui nous permettrait de donner un coup de hache afin de séparer effectivement l'un et l'autre. Pas plus qu'une raison pure se constituant dans la formule immuable de principes définis a priori, la science ne connaît une expérience pure entièrement détachée des procédés d'investigation grâce auxquels s'est substitué au chaos des apparences sensibles un réseau toujours plus subtil et plus serré de relations analytiques. Le réalisme logique et le réalisme physique sont également hors de jeu. Ils font place, pour parler le langage de M. Gaston Bachelard, à une raison fine, à une expérience fine, qui ne se laissent plus isoler l'une de l'autre, inextricablement associées dans l'oeuvre salutaire que l'intelligence humaine poursuit depuis les temps de Pythagore et de Démocrite.
Quelle sera donc, relativement au vrai, la portée de cette conception qui apparaît imposée par le statut actuel de la science ? Au premier abord elle semble signifier simplement que l'homme retombe sur l'homme. Était-ce donc la peine d'avoir dénoncé le mirage anthropomorphique, dont le sens commun est naturellement victime, si le dur labeur que nous venons d'évoquer, toujours inspiré par le désir et la recherche de l'objectivité, n'a d'autre résultat que de retrouver le sujet au coeur de la connaissance ? Mais, là encore, il est à craindre que l'indigence du langage philosophique ne nous expose à une confusion d'idées. L'homme, en se repliant sur soi pour se rendre attentif aux conditions selon lesquelles l'univers se dégage dans sa réalité, découvre qu'il est devenu désormais, en esprit et en vérité, tout différent de ce qu'il était dans le stade où il se figurait posséder par la seule prise des sens les choses telles qu'elles sont.
Alors il faisait ingénument abstraction de lui-même, semblable à l'enfant qui oublie de se compter en énumérant les camarades avec lesquels il joue. Maintenant il comprend qu'il s'était installé, sans s'en apercevoir, dans un poste où il n'y aurait aucun intermédiaire entre lui et les objets. Or, cela, c'est le privilège du Créateur. L'erreur systématique du réalisme est le châtiment d'un orgueil d'autant plus malaisé à déraciner qu'il est naturellement inconscient. La science enseigne l'humilité quand elle avertit l'astronome qu'il doit prendre garde à son « équation personnelle » pour améliorer le rendement de son observation, ou tenir compte de la vitesse de la lumière pour ne pas identifier, ainsi que le fait même de l'intuition y pousse de façon presque irrésistible, le moment où il voit une étoile et le moment où elle a brillé. Nous dirons donc, et sans métaphore cette fois, qu'il dépouille le vieil homme selon qui toute donnée immédiate est signe de réalité. Un homme nouveau naît en lui, défini par ce caractère essentiel qu'il n'est plus au principe des choses elles-mêmes, comme on imagine que le serait la puissance d'un Dieu, mais à l'origine d'une science des choses, constituée selon la mesure effective de la condition humaine.
L'exemple d'un tel dépouillement, par une méthode faite de patience, de scrupule, de désintéressement, nous ramène brusquement au coeur de notre problème. C'est à Blaise Pascal que nous allons demander d'en préciser les termes et de nous en offrir, je ne dis pas une solution unique, mais plusieurs qui, par leur divergence même, nous aideront du moins à faire le tour de la difficulté.
Nous commencerons par la page classique des Réflexions sur l'art de persuader : « Personne n'ignore qu'il y a deux entrées par où les opinions sont reçues dans l'âme, qui sont ses deux principales puissances, l'entendement et la volonté. La plus naturelle est celle de l'entendement, car on ne devrait jamais consentir qu'aux vérités démontrées ; mais la plus ordinaire, quoique contre la nature, est celle de la volonté ; car tout ce qu'il y a d'hommes sont presque toujours emportés à croire non pas par la preuve, mais par l'agrément. Cette voie est basse, indigne et étrangère : aussi tout le monde la désavoue. Chacun fait profession de ne croire et même de n'aimer que ce qu'il sait le mériter. Je ne parle pas ici des vérités divines, que je n'aurais garde de faire tomber sous l'art de persuader, car elles sont infiniment au-dessus de la nature : Dieu seul peut les mettre dans l'âme, et par la manière qu'il lui plaît. Je sais qu'il a voulu qu'elles entrent du coeur dans l'esprit, et non pas de l'esprit dans le coeur, pour humilier cette superbe puissance du raisonnement, qui prétend devoir être juge des choses que la volonté choisit, et pour guérir cette volonté infirme, qui s'est toute corrompue par ses sales attachements. »
Double transmutation de valeurs : l'ordre propre de l'esprit et de la vérité renverse l'ordre du sensible et du charnel ; il sera transcendé à son tour par l'ordre d'une charité qui est proprement surnaturelle, ayant en Dieu non pas son objet seulement, mais aussi sa source. « On se fait une idole de la vérité même ; car la vérité, hors de la charité, n'est pas Dieu. » Il nous faudra donc perdre le goût de la clarté rationnelle, aller quêter un asile dans l'ombre insondable du Dieu caché où « la crainte et le tremblement » préludent à l'influx de la grâce, où une sorte de delectatio morosa ira s'alimentant et se sanctifiant à la perspective du « petit nombre des élus » et de la « masse des réprouvés », les uns (Pascal y insiste), « ignorant leurs vertus, les autres, la grandeur de leurs crimes ».
Cette vision, d'un pathétique saisissant, n'est cependant pas la seule que nous rencontrons dans l'Église de France et dans la littérature du XVIIe siècle. De la même source catholique, et nommément augustinienne, procède l'oeuvre de Malebranche, axée tout entière sur l'invincible exigence d'unité que l'esprit porte avec lui. Sans doute, s'il fallait opter entre la « beauté de l'ordre » et « l'évidence de la vérité », Malebranche n'hésiterait pas : une « préférence infinie » est acquise à l'ordre et à la beauté. Mais précisément à ses yeux c'est le propre du christianisme qu'il n'y a pas lieu d'opter : l'ordre est unique comme Dieu lui-même.
Sans doute l'ordre divin a-t-il été troublé par le péché. Tandis que l'homme ne peut manquer de comprendre les « rapports de grandeurs », il s'est refusé de concevoir dans son intégrité la hiérarchie des « rapports de perfections ». Il a détourné vers des biens particuliers l'élan qui aurait dû le porter jusqu'au bien général. Toutefois, si le Médiateur est intervenu, c'est afin de rétablir l'équilibre, de restaurer l'harmonie de la spéculation et de la pratique. « La foi passera (déclare Malebranche, se référant à saint Augustin) ; mais l'intelligence subsistera éternellement. »Le Verbe incarné apparaît ainsi au service du Verbe incréé, qui ne laisse pas d'être présent chez ceux-là mêmes qui l'ignorent, ou le méconnaissent, ou le renient, qui cependant sans lui seraient également incapables de rien comprendre en eux-mêmes et de se comprendre entre eux. « Sache, (dit Jésus) que tous les esprits sont unis à moi, que les philosophes, que les impies, que les démons mêmes, ne peuvent être entièrement séparés de moi ; car s'ils voient quelque vérité nécessaire, c'est en moi qu'ils la découvrent, puisqu'il n'y a point hors de moi de vérité éternelle, immuable, nécessaire. »
L'éclatant contraste entre le langage des Méditations chrétiennes et le dialogue du Mystère de Jésus, c'est tout le drame de la conscience religieuse. Est-il permis à l'homme de s'avancer dans la lumière du vrai pour saisir Dieu à la pureté de sa source ? ou la divinité de Dieu est-elle d'une essence tellement mystérieuse qu'elle échappe à toute promesse d'éclaircissement ici-bas, qu'elle dément toute assurance de vérité ? Question aiguë et décisive, devant laquelle on ne conçoit guère que deux attitudes : ou la curiosité ironique de l' « amateur d'âmes » qui se contentera de ranger le fidéisme de Pascal et l'intellectualisme de Malebranche parmi les « variétés de l'expérience religieuse » ; ou l'effort sincère d'analyse qui s'attache aux principes de l'une et l'autre théologies, qui sera conduit ainsi à se rendre compte de leur liaison profonde avec le critère du vrai, tel que le fournit, sinon l'arbitrage, du moins le témoignage, des connaissances authentiquement exactes.
Malebranche est cartésien ; c'est en pensant aux Méditations et à la Géométrie de son maître qu'il voit dans les sciences universelles comme la métaphysique et les mathématiques pures, « l'application de l'esprit à Dieu la plus pure et la plus parfaite dont on soit naturellement capable ». Or, Pascal prend le contrepied de Descartes, non pas seulement sur le terrain de la philosophie et du christianisme, mais aussi sur le terrain de la mathématique. La découverte dont Descartes se fait gloire et sur laquelle il fonde la généralité de sa méthode, résolution des problèmes de géométrie par les équations de l'algèbre, laisse Pascal complètement indifférent. C'est à l'intuition spatiale, envisagée dans ce qu'elle présente de spécifique et d'irréductible, qu'il en appelle dans ses travaux de géométrie projective, entrepris dès l'âge de seize ans à la suite de Desargues. Et plus tard, lorsqu'il aborde, pour distraire ses douleurs, le domaine des considérations infinitésimales, il ne refuse pas seulement l'appui de l'analyse, il prétend que, par ce refus même, il est en état de vaincre les difficultés inhérentes aux « infiniment petits » dont le maniement est interdit à la clarté de l'analyse explicite. Alors que Descartes revendiquait pour sa science et pour sa méthode le double bienfait d'un accès et d'un rayonnement universels, Pascal tire de ses recherches l'occasion d'un défi qu'il lance à ses contemporains comme pour souligner le privilège d'un génie extraordinaire.
De là va peut-être résulter une certaine complexité, un certain trouble, dans l'attitude pascalienne à l'égard du savoir profane. Il appartient à la raison de se proposer à elle-même l'idéal d'une démonstration achevée : définir tous les termes, prouver toutes les propositions. Idéal d'infaillibilité, mais qui, à la réflexion, se révèle, sinon théoriquement contradictoire, du moins pratiquement impossible puisqu'il faudrait d'autres termes pour expliquer les premiers termes, d'autres principes pour justifier les premiers principes. La raison, lorsqu'elle formule ainsi le programme d'une connaissance absolue, ne réussit qu'à mettre en relief sa radicale impuissance. Par là elle est disposée à s'incliner devant l'autorité de la grâce qui viendra s'offrir d'en haut pour la guérir de son inévitable incomplétude.
Mais cette confrontation de la raison et de la foi n'est encore qu'un aspect de la pensée de Pascal, qui est bien autrement subtile. La mathématique ne se renferme pas dans le champ couvert par l'appareil dont Euclide emprunte le modèle au syllogisme d'Aristote. Le vrai géomètre se moque de la géométrie ainsi « formalisée » ; la force irrésistible d'un instinct lui ouvre les portes de cet infini qui déconcerte l'entendement logique : « Tout ce qui est incompréhensible ne laisse pas d'être. Le nombre infini. Un espace infini égal au fini. » Les paradoxes de la mathématique infinitésimale préludent aux paradoxes plus étonnants encore de la foi chrétienne. Selon cette nouvelle perspective, il ne suffirait plus de dire que la folie de la croix renverse la sagesse de ce monde. C'est dans le domaine du savoir profane que se manifeste la transcendance de l'intuition et du coeur par rapport à l'exigence formelle et à l'étroitesse orgueilleuse de la raison.
Seulement, une fois que nous avons pris acte de ce renversement du pour au contre, qui se produit maintenant, non plus de la science à la religion, mais à l'intérieur d'une même science, nous devons nous demander s'il annonce une position définitive par rapport au problème de la vérité, ou s'il correspond à un simple épisode dans une histoire dont nous ne sommes pas libres de suspendre le cours, ni de solliciter à notre gré le verdict. En fait, le XVIIe siècle ne s'est pas achevé sans que la victoire apparemment remportée sur la raison pure par le développement de la géométrie infinitésimale ne soit effacée au profit de la pure analyse. À l'endroit précis où Pascal s'était laissé « aveugler » par sa prévention contre la méthode cartésienne, Leibniz ouvre les yeux. Et le créateur de l'algorithme différentiel pourra écrire : « Ce que j'aime le plus dans ce calcul, c'est qu'il nous donne le même avantage sur les anciens dans la géométrie d'Archimède que Viète et Descartes nous ont donné dans la géométrie d'Euclide ou d'Apollonius, en nous dispensant de travailler à l'aide de l'imagination. » Autrement dit, la conquête de l'infini, qui paraissait se faire contre l'intelligence pour l'éblouir et l'écraser, se fait désormais par l'intelligence qu'elle éclaire et qu'elle fortifie, au bénéfice mutuel, pouvons-nous ajouter, et de la raison et de la religion.
Sur ce point capital nous n'avons encore qu'à puiser dans les richesses de l'oeuvre pascalienne. La distinction entre « l'esprit de finesse » et « l'esprit de géométrie » a été suggérée à Pascal par son expérience personnelle. Il a vu le calcul des probabilités, qu'il institue avec Fermat, mettre hors de jeu tout à la fois l'homme de métier, Roberval « qui n'est que géomètre » et l'homme du monde, le chevalier de Méré « qui n'est que fin ». Le propre du vrai mathématicien est précisément d'avoir l'un et l'autre esprits ; c'est par là que la fortune lui adviendra d'adapter les ressources d'une intelligence toujours plus souple et plus hardie à la complexité infinie du réel.
Et cela ne vaudrait pas qu'on y insiste si la distinction même que Pascal a mise en évidence n'avait servi de prétexte à confondre la raison avec sa caricature, comme si elle devait demeurer asservie à la déduction formelle qui marque les limites de l' « esprit géométrique », s'obstinant pour tout ce qui va au delà dans un étrange refus de comprendre. Reconnaissons que cette restriction du champ de la raison, qui aboutit à dissocier la pensée en facultés séparées et ennemies, est assurément une méthode ingénieuse et commode pour fabriquer de l'irrationnel. Mais il faudrait aussi qu'elle réussît à se défendre contre le soupçon d'arbitraire.
La question que nous retrouvons ici est analogue à celle qui s'était posée, il y a deux milliers d'années, lorsque les Pythagoriciens eurent démontré l'incommensurabilité de l'hypoténuse par rapport aux côtés du triangle rectangle isocèle. Dupes de leur dogmatisme arithmétique, ils ne virent que scandale et sacrilège dans la découverte même qui était le plus propre à consacrer la rigueur et la fécondité de leur méthode. Ce genre de malentendu, destiné à peser si lourdement sur la suite des spéculations antique et médiévale, s'est renouvelé, au XIXe siècle, avec la constitution de la thermodynamique et les travaux d'un si légitime retentissement auxquels elle a donné occasion de la part d'Émile Meyerson. La marche de la thermodynamique est parfaitement assurée à partir de deux principes. Le premier en date a été formulé dès 1832 par Sadi Carnot : l'énergie subit une dégradation continue, par une sorte de chute inévitable d'une qualité supérieure à un niveau inférieur ; ce qui n'empêche pas que de l'énergie demeure en quantité constante, d'où le principe de conservation établi en 1842 par Robert Meyer.
Entre les deux principes Émile Meyerson s'était plu à rompre la connexion. Il suppose que la raison reconnaît son image dans la forme de l'équation, tandis que l'inégalité mise en évidence par l'énoncé du principe de Carnot serait, aux yeux de cette même raison, une création diabolique, apparentée à l'incommensurable que les Pythagoriciens avaient dénoncé jadis et réprouvé comme irrationnel. Or, avec une pénétration et une loyauté incomparables, Émile Meyerson a fourni la preuve que la raison ainsi acharnée à s'enfermer dans les bornes de la pure et simple identité, s'avouait elle-même absurde puisqu'elle s'interdisait de rien saisir de la réalité, qui consiste essentiellement dans l'irréversibilité du flux temporel.
Il est trop aisé de faire culbuter une créature, ou une faculté, en la privant d'une des deux jambes dont elle a pourtant besoin pour avancer. Comme M. Louis Weber l'avait signalé dans une séance mémorable de la Société française de Philosophie (31 décembre 1908), Kant, en traitant de ce qu'il appelle les Analogies de l'expérience, a démontré que, pour se donner raison d'un changement, il convient sans doute de le circonscrire dans le cadre d'une relation de permanence : le changement est toujours le changement de quelque chose d'identique ; mais il faut également que le cadre soit rempli, ce qui implique de nouveau la considération de l'avant et de l'après. Deux exigences solidaires auxquelles la thermodynamique vient apporter une double satisfaction positive, le principe de conservation d'une part, et d'autre part le principe de dégradation. Et il est sûrement gratuit de dire que celui-ci soit moins rationnel que celui-là. On sait, en effet, que l'inégalité de Carnot se résout par un calcul de probabilités, c'est-à-dire en définitive, qu'elle atteste, comme l'analyse infinitésimale, l'intervention de la mathématique de la finesse triomphant des résistances et des préjugés de l'esprit géométrique. Et surtout, il n'est pas indifférent de rencontrer dans la réflexion proprement philosophique de Kant et la prévision des embarras dans laquelle s'est engagée la critique contemporaine des sciences et les termes péremptoires de leur solution positive.
Nous entendons souvent répéter autour de nous que le rationalisme est aujourd'hui en baisse ; et, soit qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, on en tire des conséquences à perte de vue sur l'avenir de la science, de la métaphysique et de la religion. Une telle manière de prendre les choses demeure à nos yeux bien inconsidérée et bien fragile, alors qu'on n'a pas eu le souci de se définir à soi-même, avec une sincérité implacable, la physionomie authentique de ce rationalisme, alors qu'on n'a pas décidé s'il est permis de s'arrêter à l'image sèche et rigide qu'à la suite de Taine certains hommes de lettres se sont plu à forger, et qui semble faite tout exprès afin de favoriser le demi-scepticisme que William James a mis à la mode. Émile Boutroux, toujours d'une indulgence exquise à son égard, remarque cependant qu'à « en juger par son langage, on pourrait croire parfois que James réduit la raison, même dans la totalité de ses manifestations et jusque dans son essence, à n'avoir d'autre objet que l'absolu, l'un et l'immobile ». Autant dire que James apparaît victime de Taine, de son contresens initial sur l'intelligence, et d'autant plus sans doute qu'il s'efforce davantage de réagir contre lui.
Nous n'aurons donc pas à trop nous excuser auprès du lecteur qui a bien voulu nous suivre si nous avons dû lui faire traverser bien des chemins sinueux. Force est d'avouer qu'il n'y a pas de voie royale qui raccourcisse le temps de la réflexion ; et l'enjeu en vaut la peine. A l'occasion de son jubilé, l'un des premiers géomètres de notre époque, Élie Cartan, disait de son maître Jules Tannery : « Par une sorte de transposition mystérieuse due à l'ensemble de toute sa personne, à son regard peut-être, le respect de la rigueur dont il nous montrait la nécessité en mathématiques devenait une vertu morale, la franchise, la loyauté, le respect de soi-même. » Vertu morale, et vertu religieuse, ou plutôt le tout de la religion ; car rien ne saurait être plus vrai que la vérité même, et la vérité trahirait sa mission si elle laissait sa lumière se corrompre et se diviser, si elle manquait à se maintenir dans l'absolu de pureté qui est son essence constitutive. Il n'est pas assurément question, suivant une interprétation ridicule dont on a prétendu, depuis Platon, accabler la philosophie rationnelle, de ramener le contenu de la religion au contenu de la science. Mais il s'agit de prendre conscience de la spiritualité véritable, libérée du passé en tant que passé, obstinément fidèle à cet infini d'intelligence et d'amour qui est la divinité même de Dieu, et d'apercevoir que la voie d'accès en est ouverte par l'exemple de la science véritable, qui ne se réduit pas au formalisme de la déduction logique, qui n'accepte pas non plus d'être jugée par ses applications techniques. Cette science véritable, nul n'en a mieux reconnu le caractère qu'Émile Boutroux, auteur d'une thèse au titre d'une précision prophétique : De la contingence des lois de la nature, initiateur avec Cournot d'un positivisme qu'Auguste Comte n'a pas reconnu : « La science véritable n'est pas un système construit une fois pour toutes, où doivent venir se ranger de gré ou de force tous les objets qui se rencontrent dans la nature. La science est l'esprit humain lui-même s'efforçant de comprendre les choses, et, pour y parvenir dans la mesure du possible, se travaillant, s'assouplissant, se diversifiant, de manière à dépasser dans sa vision les aspects superficiels et uniformes des êtres pour pénétrer en quelque mesure leur individualité. »
a Cet article devait paraître dans le numéro de juin 1940 de la Nouvelle Revue française. Il a été publié dans Les Études philosophiques, juill.-déc. 1949, nouv. sér., 4e année, nos 3 et 4, pp. [319]-335.
|

