|
EXTRAIT
L’ESPRIT DE PARTI
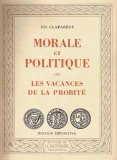 Un autre facteur, des plus importants, d’obscurcissement intellectuel, générateur de contradictions est, comme chacun sait, l’esprit de parti. Nous en avons déjà parlé. Bornons-nous ici à rappeler quelques-uns de ses caractères. Un autre facteur, des plus importants, d’obscurcissement intellectuel, générateur de contradictions est, comme chacun sait, l’esprit de parti. Nous en avons déjà parlé. Bornons-nous ici à rappeler quelques-uns de ses caractères.
1. Substitution du moyen à la fin. — Que, dans une démocratie, les citoyens nourrissant un même idéal social ou politique se groupent pour le faire triompher, rien n’est plus légitime. Ce but qu’ils se proposent d’atteindre, appelons-le « but légitime ». Bientôt cependant, par le fait même qu’ils sont groupés en vue d’une fin commune, une étroite solidarité va se créer entre les membres du groupe, du parti, et cela d’autant plus qu’ils doivent faire front contre les partis adverses. Le parti prend alors figure d’un organisme, qui a sa vie propre, et qui considère son existence comme un but en soi qu’il s’agit de défendre. De moyen qu’il était le voilà qui est devenu fin. Au but légitime s’est substitué un « but illégitime », qui trop souvent fait oublier celui pour le triomphe duquel on s’était associé : par exemple, un parti libéral recourra à des mesures antilibérales, opportunistes, afin de consolider sa position (voir l’histoire du « quorum » rapportée précédemment). Et la victoire du groupe finit par être désirée bien moins pour assurer celle du but légitime que pour des raisons d’amour-propre de parti. C’est cette déformation qui fait l’essence de l’esprit de parti.
2. Abdication du sens critique. — D’autre part, l’esprit de parti, exprimant l’esprit d’une collectivité, participe de tous les caractères qui sont le propre de la psychologie des masses. L’abaissement du sens critique en est la tare fondamentale, celle d’où découlent les autres. Il provient du fait que, dans la masse, chacun se sentant solidaire de l’ensemble, perd le sentiment de sa responsabilité personnelle, et ne fait donc plus jouer ses mécanismes de contrôle mental. Il accepte les mots d’ordre sans en examiner le bien-fondé ; c’est assurément moins fatigant que de penser par soi-même. Cette inhibition du contrôle, qui se produit avec l’inéluctabilité d’un réflexe, favorise l’émancipation des activités inférieures que le sens critique tenait en échec, à savoir la croyance, la passion, l’imitation, la suggestibilité. Au total, régression de l’être humain à un niveau mental inférieur. Conséquence : pris entre sa passion, qui engloutit sa raison, et l’abdication de son sens critique grâce à laquelle il ne s’en aperçoit pas, il manie à tort et à travers les outils de sa pensée. Et c’est à la faveur de cette défaillance de l’esprit que prennent naissance toutes ces entorses à la probité (aux principes d’impartialité, de fermeté, etc.) que nous avons exposées.
3. Incapacité d’abstraction. — Ce phénomène rapproche beaucoup la mentalité du partisan de celle de l’enfant : l’image particulière et concrète d’une chose empêche de la penser dans sa généralité. J’ai demandé une fois à un enfant quelle ressemblance il y avait entre une abeille et un oiseau. « Tous les deux sont jaunes », répondit-il. C’est que, au lieu de penser à l’oiseau en général, il avait songé à un canari. L’erreur de sa réponse provenait d’un défaut d’abstraction. — Transportons-nous dans le domaine de la politique. Les mêmes personnes qui protestent avec énergie contre un certain méfait lorsqu’il est commis pas un adversaire (par exemple les bombardements de villes ouvertes lors de la guerre d’Espagne) n’en sont nullement indignées lorsque c’est le camp ami qui s’en est rendu coupable. C’est que l’esprit du partisan est incapable de s’élever à l’idée abstraite et générale (par exemple l’idée de « bombardement de villes ouvertes ») pour la juger indépendamment des cas particuliers où on la rencontre. Nous avons là une des principales sources de l’entorse au principe d’impartialité (les deux poids et les deux mesures) : le jugement se fonde, non pas sur l’idée même qu’il conviendrait d’approuver ou de désapprouver, mais il s’arrête aux cas particuliers, aux images concomitantes, et s’inspire des sympathies ou des antipathies que le parti éprouve à leur égard.
Voici encore une observation qui se rapporte à cette incapacité d’abstraction. Etonné, depuis fort longtemps, que les défenseurs d’une politique de l’Esprit émissent des appréciations si opposées sur le fascisme (puis le nazisme) d’une part, et le bolchévisme d’autre part, qui avaient cependant ceci de commun d’être les adversaires absolus du libéralisme, j’ai de nombreuses fois fait remarquer à des personnes appartenant aux partis soi-disant libéraux et amis du droit, combien cette conduite me paraissait illogique. Vous devinez ce qu’on me répondait : que j’avais des sympathies bolchévistes ! Comme si défendre l’équité et la logique, c’était défendre le bolchévisme ! C’est que mes interlocuteurs n’arrivaient pas à abstraire l’idée d’équité des éléments entre lesquels elle devait jouer. Imaginez que des fidèles de l’anti-alcoolisme condamnent violemment la wodka, mais défendent le schnaps comme étant un rempart contre l’invasion de celle-ci. Quelqu’un fait remarquer que cette attitude est absurde et illogique, le schnaps étant aussi pernicieux que la wodka. A quoi on lui répond : « Eh ! eh ! vous êtes un ami de la wodka !»
4. Assimilation d’idées par généralisation simpliste. — L’affectivité, bien plus qu’un examen impartial des faits est l’agent de cette généralisation. Ainsi, on appartient à un parti de droite (ou de gauche), et l’on regarde comme dangereux tout ce qui vient de la gauche (ou de la droite), même s’il s’agit de mouvements se déroulant sur un tout autre plan. C’est en vertu de cette sorte de contamination d’idées que, chez nous et ailleurs, la politique intérieure a constamment faussé les appréciations sur la politique extérieure. (L’abdication du sens critique empêchait de s’en apercevoir.) Exemples : la façon enthousiaste dont a été accueilli, même dans le camp des bourgeois « libéraux » l’avènement du fascisme, même du nazisme, parce que, s’opposant au communisme, ils prenaient figure de mouvements de droite. Autre exemple : la façon tranchée dont étaient réparties les sympathies lors de la guerre d’Espagne entre « les rouges », et « la droite ». Le fait que « les rouges » comprenaient, outre les partis d’extrême-gauche, tous les libéraux espagnols, sans parler des Basques catholiques, était impuissant à atténuer ce jugement simpliste, —non plus que le fait que « la droite » se recrutait surtout parmi les antilibéraux, parmi les ennemis acharnés de toute liberté de pensée, qui mettaient dans un même sac marxistes, francs-maçons, juifs et protestants. Et les bourgeois protestants de Genève, qui, au printemps 1936 fêtaient solennellement le 400me anniversaire de la Réforme, acclamaient, peu après, un mouvement qui se proposait d’étouffer en Espagne les rares bienfaits que la Réforme avait pu encore y apporter, d’y supprimer, au détriment du protestantisme, la liberté des cultes.
D’après L’Echo de Paris du 3 août 1937, le général franquiste Davila, dans une allocution, déclarait que le propos inébranlable des patriotes espagnols était de « baigner la vie nationale dans les eaux très pures et très fécondes de la pensée catholique... La pensée catholique dans l’ordre social et dans l’Etat est la pensée sur la vie et la destinée des hommes et des peuples ; et cette pensée, qu’on ne connaît pas ou que l’on contredit, est la seule qui puisse faire les nations grandes. » Que les Espagnols catholiques veuillent refaire une Espagne catholique, rien de plus naturel (encore qu’on puisse s’étonner de voir ces mêmes personnages accorder leur admiration à des régimes racistes, fondés sur l’égoïsme sacré, et que le Pape a dûment condamnés). Mais que les bourgeois protestants de Genève n’aient pas vu le danger menaçant leurs coreligionnaires espagnols, cela montre à quel point, même chez des gens d’un haut niveau intellectuel et moral, l’esprit de parti bloque le sens critique.
Cette généralisation abusive a, en bref, conduit la plupart des gens de droite à cette opinion simpliste : tout ce qui s’oppose au communisme est bon, ipso facto, donc vive le nazi-fascisme ! Le monde se ramène ainsi à un dilemme, qui dispense de réfléchir.
Ayant un jour (c’était en novembre 1937) essayé de montrer à l’un des chefs du parti « national-démocratique » de Genève que cette opposition simpliste était absurde, que la coupure ne passait pas entre communisme et fascisme, mais entre dictature et régime libéral, entre Force et Esprit, il me fit cette réponse significative, que je cite textuellement : « Nous sommes en face de deux mouvements, le bolchévisme et le fascisme ; il faut être de l’un ou de l’autre côté de la barricade, il faut choisir. Moi, je choisis le fascisme. »
5. La puissance du mot. — Cette incapacité de généraliser correctement est exploitée par les meneurs du parti qui galvanisent leur troupeau en agitant devant lui tantôt comme un drapeau, tantôt comme un épouvantail, certains mots ayant une action d’autant plus efficace qu’on se donne moins de peine pour saisir exactement les choses qui y correspondent. Ainsi les mots « front populaire » et « les rouges » (spécialement en Espagne), « sans-Dieu » (on perd complètement de vue que beaucoup des membres du parti qui exploite ce terme n’ont peut-être pas la moindre parcelle de foi véritable), « discipline » (que de crimes ont été commis en son nom !), et, une jolie trouvaille, « belliciste », appliqué aux pacifistes qui repoussaient l’idée d’une paix fondée sur la lâcheté et l’injustice !
Et le mot « ordre » a aussi cette vertu magique d’évoquer dans l’esprit une image bien contraire à la réalité. J’entendais un vieux banquier genevois, d’ailleurs homme excellent et à la conscience droite (et c’est ce qui fait l’intérêt de cette observation), assurer, au moment de la première agression de la Chine par les Japonais en 1932, que ceux-ci allaient y « mettre de l’ordre ». Mais quand, au cinéma, on voyait défiler le lamentable exode des pauvres familles chinoises dont les habitations avaient été brûlées, on saisissait toute la distance qui sépare la réalité des mots qui sont censés la désigner.
Le mot « national » a aussi la vertu d’éblouir beaucoup de braves gens, au point qu’il en arrive à éclipser complètement le mot « socialisme », mot que pourtant ces braves gens n’aiment guère, lorsqu’on le place à côté de lui : c’est ainsi que dans le mot « national-socialisme », ils ne voient que « national », et n’aperçoivent plus du tout « socialisme ».
6. La fin justifie les moyens. — L’homme de parti est tellement convaincu que sa cause est juste qu’il estime qu’il serait coupable d’en risquer l’échec en étant trop regardant sur les moyens propres à la faire triompher. Un journaliste romand m’a déclaré, il y a deux ans, que « l’injustice est parfois un devoir, pour défendre une cause juste ». J’ai déjà dit précédemment combien graves étaient les conséquences d’une telle manière de voir et de faire. Demandons-nous donc comment des esprits distingués et épris d’honnêteté peuvent penser de la sorte.
Il semble que nous ayons affaire ici, non pas à quelque pitrerie du subconscient, mais à une opinion complètement consciente. Je n’en suis pas certain cependant. La passion qui sous-tend l’esprit de parti est parfaitement capable d’aveugler même un homme intelligent et honnête sur le danger moral et social de pareilles conduites. Il n’en aperçoit pas la portée ; sans quoi, il ne s’y abandonnerait pas.
« Le gentleman est chevaleresque aussi vis-à-vis de son ennemi — a écrit M. Coudenhove-Kalergi —. Qu’il s’agisse d’un ennemi personnel ou politique, il ne se sert que d’armes honnêtes. Sa loi suprême est le fair play. Il risquerait la défaite, plutôt que de s’assurer la victoire avec des armes déloyales. Pour lui, la fin ne justifie pas les moyens, bien au contraire, et le but le plus élevé peut être déshonoré par les moyens employés.,. (L’homme et l’Etat totalitaire, Paris, 1938.)
Je suis persuadé que les hommes de parti auxquels j’ai fait allusion seraient les premiers à applaudir une telle déclaration. S’ils ne s’y conforment pas, c’est donc sans le vouloir et sans s’en douter. Cet exemple montre bien jusqu’où peut aller l’oblitération mentale sous l’influence du sentiment. Sans doute la crainte d’être dupe, dont il a été question plus haut, joue-t-elle aussi son rôle.
|

