AVANT-PROPOS [2] [1]
de l'auteur
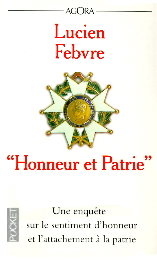 L'idée de ce livre, d'historien et, j'espère, de pure histoire, m'est venue brusquement un triste jour de 1942. Il sera né, comme bien d'autres, d'une méditation engagée par la mort. L'idée de ce livre, d'historien et, j'espère, de pure histoire, m'est venue brusquement un triste jour de 1942. Il sera né, comme bien d'autres, d'une méditation engagée par la mort.
1942 : nous connaissions en France, faut-il déjà le rappeler, nous connaissions d'affreux déchirements. De jeunes hommes, nos fils et nos frères, renouvelant chaque jour un même acte de foi dans ce qu'ils croyaient, dans ce qu'ils savaient être le salut de leur patrie, mouraient pour cette croyance sur des terres lointaines. Cependant, d'autres hommes, prisonniers d'eux-mêmes dans des ports de guerre qui n'étaient pour leurs chefs que des ports de diplomatie, de jeunes hommes, nos fils eux aussi et nos frères de sang, maintenus dans les voies d'une discipline qui risquait à chaque minute de déboucher sur la trahison, d'autres Français paraissaient accueillir sans révolte d'étonnantes prédications de déchéance ; et quand, incapable d'en réinventer les thèmes, je veux me représenter ce qu'elles durent être dans leur plus haute tenue, je relis cette déclaration qu'un vieil homme désintéressé, un universitaire, signe de son nom en cette même année : « Nous avons un chef ; il ne nous appartient ni de discuter, ni de juger, ni même d'approuver (car l'approbation implique une certaine liberté critique) les choix qu'il fait, les directives qu'il donne ; nous n'avons qu'à le suivre, les yeux fermés, dans un paroxysme d'obéissance, de discipline et de fidélité (a). »
Pourquoi ? Comment ? Les mots de l'historien, qui n'est pas un juge.
Car je ne le dirai jamais trop : ce livre est d'histoire, et non d'inquisition. Laissons saint Michel, svelte et droit sous son armure niellée, peser dans sa balance les âmes qui frémissent et qui tremblent. Faiblesses, calculs, impuretés s'il y en eût, la mort a tout purifié. Aux hommes qui se donnent, l'oblation finale restitue leur grandeur. Mais c'est l'oblation même qu'il convient d'expliquer. Et l'explication, n'est-ce point à l'historien de la fournir ? Voilà ce que je me demandais, ce triste matin de 1942 où j'appris d'une mère raidie dans sa douleur qu'un de ses fils venait de mourir pour défendre ce que son frère travaillait à détruire, au prix de son sang, lui aussi, s'il le fallait (b).
Point d'homme, à un certain niveau d'humanité, qui ne trouve en son coeur quelque moyen de se dépasser lui-même. Point d'homme(s), à de certaines heures, qui n'entende lui aussi ses voix. Les sacrifiés de 1942, quand, en 1940, en 1941, ils se trouvèrent à la croisée des chemins, quand, sans hésiter ou au terme de silencieux débats, ils choisirent, ou se laissèrent imposer l'une des deux routes : quelles voix écoutèrent-ils, hors d'eux-mêmes et en eux ?
On dit, un peu vite : les mots, les maîtres mots, ici et là, étaient les mêmes. Fidélité, discipline, honneur, courage, patrie : le compagnon de Leclerc dans son épopée saharienne écoutait ces voix résonner en lui, comme les entendit, à l'heure du sacrifice, l'enseigne de Darlan. Honneur, patrie : ces mots jumelés que le marin lisait, chaque jour, sur la passerelle de son navire et le soldat au coeur de son drapeau, pour les uns comme pour les autres n'étaient-ils pas lourds du même sens ? Mais précisément, c'est là tout le problème.
Honneur, Patrie, ces deux termes que le temps a soudés, comme il soude à la longue au fond des fosses humides dans les tombes de la préhistoire tant d'objets séparés dont la rouille ne fait plus qu'un seul bloc, ces deux mots devenus rituels, signifiaient-ils vraiment la même chose dans ce qu'il faut bien nommer les deux camps ? Évoquaient-ils les mêmes idées, remuaient-ils le même fond de sensibilité, provoquaient-ils chez les Français des deux obédiences les mêmes réactions ? Certes, qui les lit en temps de quiétude est bien excusable de les prononcer tout d'un trait, sans prêter l'oreille au son que rend chacun d'eux pris à part. Mais en temps de crise et d'inquiétude ? Ne retrouveraient-ils point alors, ces deux mots associés, ne retrouveraient-ils point une liberté d'action parfois antagonique, un dynamisme propre dont le mariage n'aurait pas eu raison ? Et d'instinct, ceux-ci, dans l'un des camps, n'auraient-ils pas mis l'accent plus fortement sur le premier, et ceux-là, dans l'autre camp, sur le second ?
Engagée dans cette voie, la réflexion ne pouvait que nous ramener au passé. Là où se sont nourries les racines du présent. Et voilà comment naquit un livre qui fut parlé au Collège de France publiquement, dès 1945, et que l'auteur a gardé dans l'ombre pendant dix ans, volontairement et par un sentiment qui se passe d'exégèse. Pour définir son espèce, je ne parlerai pas d'objectivité : mot pédant, mot barbare, qui n'est pas de chez nous. Encore moins parlerai-je de probité : les improbes seuls songent à se recommander de cette vertu que nos pères (dès lors qu'il ne s'agissait point d'argent) avaient quelque tendance à juger subalterne : « la vertu des pauvres » notait, au XVIIIe siècle, dans son fameux recueil de synonymes le bon abbé Girard (c). Je finis donc cet avant-propos comme je l'ai commencé : j'essaierai, dans tout le cours de ce livre, d'être et de rester un historien.
I
Questions préalables
Par quoi commencer ? Par de bonnes définitions, à la fois ingénieuses et bien étudiées ? C'est la vieille méthode française, que, pour mieux l'honorer, on baptise de cartésienne. « Qu'est-ce que l'Art ? », se demande Paul Valéry en tête d'un volume de L'Encyclopédie française consacré aux lettres (d). Et de la même façon, en tête du volume dédié à la Mathématique : « Qu'est-ce que le nombre ? » s'interroge Hadamard (e). Quand nous le saurons, tout deviendra facile : nous n'aurons plus qu'à déduire correctement.
Ici, tout le long de ce livre, nous allons parler d'États et de Nations. Demander au départ à de solides définitions de nous fixer, une fois pour toutes, sur le sens de ces mots, [c'est une] tentation, mais de celles à quoi ne peut céder un historien digne de ce beau nom. Car ce fleuve, le langage, qui ne cesse de ronger ses bords et de charrier au fond de son lit les alluvions les plus diverses, comment prétendre le fixer ? Plaisants propos, [que] ceux des juristes qui nous disent : « L'État, c'est ceci, et la Nation, cela. » Ils sont là, le centimètre à la main : « Tour de taille, tant... Largeur d'épaules, tant... ! » Le vêtement fini, cri de triomphe : « Comme il tombe juste ! » Mais qu'est-ce donc qui tombe ?
En termes bien pesés, ces hommes ont défini leur pensée du moment, leur pensée sur l'État, sur la Nation. Ils ont trouvé leur définition bonne parce qu'elle s'ajustait à la réalité qu'ils tenaient sous leurs yeux ! Vingt ans plus tard, s'ils se relisent, ils seront moins satisfaits de leur effort, comme le tailleur de son vêtement, non parce que la mode aura changé, mais c'est le client qui aura maigri ou grossi.
Pareillement, tout au long de ce livre, nous allons parler de sentiments. Nous allons voir des hommes suivre de préférence les conseils de l'honneur ou les appels de la patrie. Et donc, si nous étions des moralistes, notre premier souci devrait être de définir le sentiment de l'honneur, de définir le sentiment de la patrie. Si nous étions : mais nous sommes des historiens, autant dire les exégètes du changement ; à notre gré, rien de ce qui est matière d'histoire n'échappe aux exigences du temps qui déplace tout ; du milieu qui se modifie sans trêve ; de l'être humain qui ne demeure jamais identique à lui-même. Et donc : quand nous disons Nation, cette prise de conscience d'un passé traditionnel par des groupes assemblés, de gré ou de force, dans un même cadre et subissant le pétrissage quotidien de la vie en commun ; quand nous disons État, cette armature, cette mécanique étrangère à toute exigence morale, indifférente à toute prise de conscience sentimentale, à tout ce qui ne sert pas uniquement à son fonctionnement, à ses réussites techniques, à ses fins qui justifient les moyens ; quand nous jetons, peut-être, entre la Nation et l'État, le pont branlant de la Nationalité, de cette Nationalité qui fait de chacun de nous, Français nés en France de parents français, le porteur d'espérances communes à tous les Français, liés dans le bonheur et dans le malheur au sort commun de leur collectivité ; encore, quand nous prononçons le mot Patrie, et que ce mot évoque en nous l'objet d'une des multiples formes de l'amour, ou bien, quand nous nous référons au sentiment toujours vivant de l'Honneur, tel qu'il vit dans nos coeurs au milieu du XXe siècle, avons-nous, quand nous nous croyons au clair sur le sens précis de ces notions apparentées mais si fortement distinctes ; avons-nous appréhendé des réalités immuables depuis des siècles ? Tout au plus avons-nous analysé la façon dont, vers 1950, nous revêtons de caractères transitoires des notions qui n'ont cessé de changer au cours des temps, à l'intérieur des diverses civilisations et qui changeront encore, qui changent déjà sous nos yeux, si bien que, sous la pression d'expériences nouvelles, nous devrons modifier notre vue du monde, ou bien nous établir dans l'absurdité (f).
Non, la définition théorique n'est pas de grand secours pour nous, historiens. Elle n'existe à vrai dire qu'en dehors de nos études. Ce qui vaut pour nous, c'est l'histoire du mot, faite avec précaution. Savoir que tel mot est vieux dans la langue ou qu'au) contraire, il n'y a fait que récemment son apparition, que nos pères, nos grands-pères tout au plus l'ont engendré pour leur usage, voilà qui ne nous est pas, certes, indifférent, à plusieurs conditions, qu'il est bon de rappeler. La première, c'est que, pour l'historien, un mot ne date pas toujours, ne date pas nécessairement de sa première apparition dans un texte manuscrit ou, de préférence (63) imprimé. Toute langue compte des mots, en nombre et importants, qui ont mis des décades parfois, sinon des siècles, à se charger de sens. Tel , en français, le mot Nation, mot calqué sur le latin, « Natio », et qui lui emprunte à la fois sa forme et son fond. Il s'est prononcé, écrit, transmis longtemps avant l'âge où, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il a pris brusquement une valeur, une efficacité sur quoi nous aurons plus loin à revenir et qui lui a permis de dater une époque à qui de son Côté il devait sa portée, son essor et sa vogue. Voici un autre mot, Patrie, calqué pareillement sur le latin « Patria ». Mais ce n'est guère avant le XVIIIe siècle également que ce vocable savant a pris son extension et son sens véritable : je veux dire celui que nous lui donnons aujourd'hui encore, au terme d'une longue évolution. C'est alors qu'il est né à l'Histoire, s'il est né, deux siècles avant, à la philologie.
Autre remarque : Nation, Patrie, bel exemple de mots qui semblent se conférer mutuellement l'un à l'autre, sous l'empire de certaines circonstances d'ailleurs assez faciles à définir, une sorte de virulence particulière. Ils font couple. Et avec quelques autres, de même résonance, ils constituent une sorte d'association, une famille, si l'on veut. C'est une erreur, c'est une faiblesse que d'examiner les mots pris isolément, celui-ci d'abord, et puis cet autre, et cet autre encore. Un mot n'a pas de valeur pour l'historien s'il reste isolé des autres mots qu'il attire et qui l'attirent, ou qui le repoussent et qu'il repousse.
Abandonnons donc l'idée que les vieux mots sont nécessairement plus riches de sens et de résonances multiples que les mots plus récents. Tout au plus, aux heures de faiblesse, de défaillance et d'abandon, courent-ils la chance de parler plus fort, plus intimement à nos coeurs. Mais, encore une fois, ils ne parlent jamais seuls.
Dernière question préalable : chronologiquement parlant, où commencer notre enquête ? Je veux dire : jusqu'où remonter dans nos recherches ?
Aux temps sans histoire ? Certes, sur ce morceau d'Europe dont un travail tant de fois millénaire a fait la France que nous aimons, il est tentant de se le demander : depuis combien de temps y a-t-il des hommes, récolteurs de résine et de miel sauvage, chasseurs de bêtes rousses ou noires, piégeurs subtils ou meneurs de porcs à la glandée, pour vivre dans la forêt, chérir ses solitudes secrètement peuplées, goûter avec ravissement, au sortir des fourrés, la ronde clairière dont l'herbe ne semble qu'à eux seuls si verte, le soleil si clair et la source si pure ? Dans cette Gaule qui longtemps connut, semble-t-il, une civilisation du bois, depuis combien de temps y a-t-il des hommes qu'émeuvent le ramage des oiseaux au réveil, et les sourdes rumeurs qui, dans les coeurs, soudain, font passer le frisson de l'invisible ?
Et même, depuis combien de temps y a-t-il d'autres hommes pour se plaire, en dépit des fièvres, à l'étrange vie des marais tutélaires, à la stérile abondance de leurs herbes coupantes et, sous le soleil aux rayons alourdis de brume, à la fermentation bavarde des terres saturées d'eau ? Ne parlons pas des « champagnes » claires et nettes, chères aux mangeurs de pain : emblavures fécondes, emblavures ravagées, et il n'est pas certain que ce soient ces terroirs sans obstacles ni mystères qui aient toujours inspiré le plus d'attachement à leurs metteurs en oeuvre : les voisins qui les enviaient, au-delà de la ceinture des bois, ne facilitaient pas les longues implantations. Ainsi durent naître, en tout cas, dans le coeur des hommes, pâtres ou « boquillons », campagnards ou montagnards, « cil des plaines » et « cil des montagnes » pour parler comme Le Roman de Rou, ainsi naquirent à la longue des attachements profonds, fruits d'un genre de vie hérité et passé dans leur vie physiologique, dans leur organisme même, des attachements qui empruntaient à leurs objets quelque chose d'élémentaire et d'animal et qui nous sollicitent de prononcer le mot patrie : l'étymologie nous y autorise sans doute ; mais ce grand mot risque de nous égarer, de nous induire en anachronisme (g).
C'est que, partant de là, notre mécanique mentale se met en marche. Les petits terroirs dont il nous plairait de faire les premières patries, nous les imaginons volontiers qui s'assemblent, se lient, se fédèrent, donnent naissance à des peuplades : et chacune s'unissant à d'autres se bat pour tel ou tel chef prestigieux. Des sentiments s'affirment, se renforcent. Mais que sont-ils, au vrai ? Politiques ou religieux ? Personnels ou terriens ? La fidélité va-t-elle au sol, ou bien au chef de guerre ? Si peu qu'on les connaisse, ne voit-on pas les ligues se défaire, se délier aussi vite qu'elles ont pu se former ? Monde mouvant, monde inexplicable, mais générateur de romans historiques séduisants et plausibles si nous dotons nos ancêtres d'une mentalité semblable à la nôtre : avons-nous le droit de leur faire ce cadeau ?
Camille Jullian le pensait, qui aimait prodiguer ses dons à« nos ancêtres les Gaulois », comme on disait au temps de ma jeunesse (h). Mais restons de sang-froid : que se passait-il dans l'âme de ces Gaulois accourus à l'assemblée chez les Carnutes et qui, en 54, sur les enseignes reliées en faisceaux, juraient d'obéir au signal de la révolte contre les Romains ? Que se passait-il dans l'âme même du chef, Vercingétorix l'Arverne, à qui tous finalement engagèrent leur fidélité ? Nous faisons des hypothèses que nous prenons pour des constatations. Nous déployons toute une psychologie que nous pensons éternelle ; nous supposons, chez le fils de Celtill, l'âpre désir d'être à son tour ce qu'avait été son père, de restaurer le principat des Arvernes et par-delà, peut-être, de ressusciter Luern et Bituit, rois forts et splendides, rois sauvages et joyeux, maîtres des festins pantagruéliques et des beuveries sanglantes, magnifiques debout dans leurs chars de parade et que les peuples en liesse voyaient passer, dieux à leur mesure, couverts d'or et de pourpre, et jetant dans un grand geste de largesse des bourses garnies que les bardes, sans s'interrompre de chanter, attrapaient au vol avec un rire avide (i).
Soit. Mais des Gaulois nous ne savons rien par les Gaulois eux-mêmes, rien de leurs idées, de leurs sentiments, de leurs conceptions. Nous ne savons d'eux que ce que nous dit César, ce Romain, cet ennemi, et qui sans doute tenait de son Deuxième bureau des renseignements importants. Mais que valaient-ils comme documents psychologiques ? Quand on sait ce qu'en toute bonne foi un Français même cultivé peut penser d'erroné, aujourd'hui, sur la psychologie d'un Belge ou d'un Suisse francophones, ou inversement ce que ce Belge ce Suisse peuvent doter les Français de sentiments calqués sur les leurs, il faut quelque candeur dans l'intrépidité pour chercher dans César, ou dans Dion Cassius, une explication de Vercingétorix fondée en vérité. César compose un récit à sa louange ; il ne nous fournit pas d'exégèse. Il nous montre Vercingétorix s'agenouillant devant son tribunal ; il omet de nous confier qu'il l'injuria bassement, vilainement à notre gré de Français chevaleresques, de Français prompts à oublier qu'au temps du Grand Roi, il y a deux cent cinquante ans à peine, tout commandant de place qui s'avisait de sauver l'honneur en résistant avec une poignée d'hommes à toute une armée était, sitôt pris, pendu haut et court avec ignominie, sans le moindre respect pour son héroïsme, sans le moindre souci de chevalerie chez le plus fort.
Là-dessus, peignons « au vrai » le Vercingétorix d'Alésia, et définissons le sentiment de la Patrie chez les Gaulois, ou celui de l'Honneur chez leurs conquérants. Au terme de cet effort, nous saurons bien des choses, non pas sur les Gaulois, mais sur nous-mêmes.
Sachons nous limiter dans le temps. Reportons-nous aux siècles où, dans une Europe qui se cherchait, mais elle n'a cessé de se chercher, nos aïeux regroupés en grandes masses territoriales qu'ils dotaient de noms, France, Allemagne, refaisaient lentement, péniblement leur monde sur les ruines de mondes écroulés, et prenaient possession de sentiments nouveaux.
Annexe
[...] Je dis : les juristes. À plus forte raison les historiens. Car leurs définitions devraient valoir pour tous les âges, pour toutes les civilisations, pour toutes les contrées qui ont connu l'État et la Nation. Elles devraient tenir compte de toutes les exigences du temps, qui déplace tout ; du milieu, qui change sans cesse ; de l'homme, qui n'est jamais le même. Et donc : quand nous disons Nation, cette prise de conscience par des groupes assemblés dans un même cadre, et subissant l'action incessante, le pétrissage quotidien de la vie en commun, Nation, cette prise de conscience collective d'un passé traditionnel et d'un avenir, qui s'éclaire à la lueur du passé ; quand nous disons État, cette armature ; cette machine conçue, forgée, montée en vue de résultats qu'elle obtient en partie, qu'en tout cas elle impose par la force ; quand nous disons État, cette mécanique indifférente à toute prise de conscience, étrangère à toute exigence morale, à tout ce qui ne sert pas uniquement et directement à son bon fonctionnement, à ses réussites techniques, à ses fins qui justifient les moyens ; quand nous jetons, peut-être, entre la Nation et l'État le pont branlant de la Nationalité, de cette Nationalité qui fait de chacun de nous, automatiquement, s'il est né en France de parents français, le porteur d'un statut commun à tous les Français liés, dans le bonheur comme dans le malheur, au sort commun de la patrie ; quand nous pensons nous être entendus finalement sur toutes ces notions, qu'avons-nous fait ? Avons-nous appréhendé en elles-mêmes ces réalités la Nation, l'État, la Nationalité ? Non certes, mais analysé [...].
[1] Douze pages manuscrites autographes numérotées par Lucien Febvre dans le coin supérieur gauche ; ces pages sont rédigées sur papier quadrillé au stylo à bille bleu ; une partie des corrections est faite au stylo, à l'encre noire ; cet avant-propos est également conservé sous forme dactylographiée : huit pages dactylographiées ; le titre : « Avant-propos » est porté sur la première page du texte dans les deux versions, manuscrite et dactylographiée ; le texte édité ici apparaît comme la seconde rédaction de l'avant-propos au livre que L, Febvre projetait d'écrire ; pour la datation, voir ci-dessous, p. 360-362.
|

