|
Chapitre I. Introduction historique
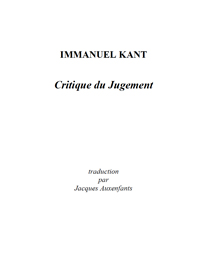
- I. De la division de la philosophie [171]
- II. Du domaine de la philosophie en général [174]
- III. De la critique de la faculté de juger comme moyen d'unir en un tout les deux parties de la philosophie [176]
- IV. De la faculté de juger comme faculté légiférant a priori [179]
- V. Le principe de la finalité formelle de la nature est un principe transcendantal de la faculté de juger [181]
- VI. De la liaison du sentiment de plaisir avec le concept de la finalité de la nature [186]
- VII. De la représentation esthétique de la finalité de la nature [188]
- VIII. De la représentation logique de la finalité de la nature [192]
- IX. De la liaison des législations de l'entendement et de la raison par la faculté de juger [195]
I. DE LA DIVISION DE LA PHILOSOPHIE
[171]

Lorsque l'on divise la philosophie, en tant qu'elle contient les principes de la connaissance rationnelle des choses par concepts (et non pas simplement, comme la logique, des principes de la forme de la pensée en général, abstraction faite des objets), comme on le fait ordinairement, en philosophie théorique et philosophie pratique, l'on procède tout à fait correctement. Mais dès lors les concepts, lesquels indiquent leurs objets aux principes de cette connaissance rationnelle, doivent également être spécifiquement différents, faute de quoi ils ne permettraient aucune division, division qui suppose toujours une opposition entre eux des principes de la connaissance rationnelle appartenant aux diverses parties d'une science.
Or, il n'y a que deux sortes de concepts, qui admettent autant de principes différents de la possibilité de leurs objets, à savoir les Concepts de la nature et le Concept de liberté. Comme les premiers rendent possible une connaissance théorique d'après des principes a priori, tandis que le second concept, eu égard aux premiers, n'introduit avec lui, déjà en lui-même, qu'un principe négatif (de la simple opposition), mais instaure en revanche des principes qui élargissent la détermination de la volonté et qui sont, pour cette raison, appelés pratiques, la philosophie est donc divisée à bon droit en deux parties tout à fait distinctes au regard de leurs principes, à savoir la philosophie théorique comme philosophie de la nature et la philosophie pratique comme philosophie morale (car ainsi est appelée la législation pratique de la raison d'après le concept de liberté). Or ces expressions ont été jusqu'à présent abusivement utilisées pour la division des différents principes et, avec eux, la division de la philosophie : on tenait en effet pour identiques le pratique selon des concepts de la nature et le pratique selon le concept de liberté et de ce fait, sous les mêmes dénominations de philosophie théorique et pratique, [172] l'on faisait une distinction par laquelle en fait (puisque les deux parties pouvaient avoir les mêmes principes) rien ne se trouvait distingué (distinction que l'on peut assimiler à celle du pragmatique et du pratique).
La volonté, en tant que faculté de désirer, est en effet une d'entre les multiples causes naturelles opérant dans le monde, à savoir celle des causes qui agit d'après des concepts (la vie étant l'agir selon des représentations d'objet) ; et tout ce qu'une volonté représente comme possible (ou nécessaire) est de ce fait appelé « pratiquement possible (ou nécessaire) », à la différence de la possibilité ou de la nécessité physique d'un effet, dont la cause n'est point déterminée à exercer sa causalité d'après des concepts (mais de manière mécanique, comme dans la matière inanimée, ou par instinct, comme chez les animaux). Dans un tel cadre pratique, la question de savoir si le concept qui donne sa règle à la causalité de la volonté est un concept de la nature ou le concept de liberté est donc laissée indéterminée.
Or, cette dernière différence est essentielle. En effet, si le concept déterminant la causalité est un concept de la nature, les principes sont pratiques techniquement ; mais si c'est le concept de liberté, ils sont pratiques moralement, et puisque dans la partition d'une science rationnelle tout dépend de cette différence des objets, dont la connaissance exige des principes différents, les premiers appartiendront à la philosophie théorique (comme doctrine de la nature), tandis que les autres, et eux seuls, constitueront la seconde partie, à savoir (comme doctrine des mœurs) la philosophie pratique.
Toutes les règles technico-pratiques (c'est-à-dire celles de l'art et de l'habileté en général, ou celles également de la prudence en tant qu'habileté à exercer une influence sur les hommes et leur volonté), dans la mesure où leurs principes reposent sur des concepts, doivent nécessairement n'être comptées que comme des corollaires de la philosophie théorique (ces principes relèvent de l'anthropologie pragmatique). Elles ne concernent en effet que la possibilité des choses d'après des concepts de la nature, dont relèvent non seulement les moyens que l'on rencontre pour cela dans la nature, mais encore la volonté elle-même (comme faculté de désirer, par conséquent comme faculté naturelle), dans la mesure où elle peut, conformément à ces règles, être déterminée par des ressorts (mobiles) naturels. Cependant les règles moralement pratiques ne s'appellent point des lois (au sens où l'on dit des lois physiques), mais simplement des préceptes (qui relèvent de la table des catégories de la liberté), et cela, plus précisément, parce que la volonté s'y subsume (Untsrstshsn : dépendance par rapport au concept amont pour certains traducteurs), non pas seulement sous le concept de la nature, mais aussi sous le concept de liberté, en rapport auquel les principes de la volonté se nomment des lois et constituent seuls, avec leurs conséquences, la seconde partie de la philosophie, c'est-à-dire la partie pratique.
Aussi peu donc que la solution des problèmes de la géométrie pure [173] appartient à une partie spécifique de celle-ci, ou que l'arpentage mérite d'être désigné sous l'appellation de géométrie pratique, distincte de la géométrie pure en tant que formant une seconde partie de la géométrie en général, aussi peu et moins encore l'art mécanique ou chimique des expériences ou des observations peut-il être compté pour une partie pratique de la doctrine de la nature, et finalement l'économie domestique, rurale et politique, l'art des relations sociales, les prescriptions de la diététique, même la doctrine générale du bonheur, même encore l'art de réfréner les penchants et de dompter les affects au profit dudit bonheur ne doivent être comptés comme relevant de la philosophie pratique ou être considérés, du moins ces dernières disciplines, comme constituant la seconde partie de la philosophie en général ; la raison en est que ces disciplines ne contiennent toutes que des règles de l'habileté, lesquelles ne sont par conséquent que technico-pratiques, aux fins de produire un effet possible d'après les concepts naturels des causes et des effets ; comme ces règles relèvent de la philosophie théorique, elles sont donc soumises à ces prescriptions en tant que simples corollaires de cette dernière (de la science de la nature) et ne peuvent par conséquent prétendre à obtenir aucune place dans la philosophie particulière, dite pratique. En revanche, les préceptes moralement pratiques, lesquels se fondent entièrement sur le concept de liberté, à l'exclusion totale de tout principe de détermination de la volonté procédant de la nature, constituent une espèce tout à fait particulière de prescriptions : ces dernières, tout comme les lois auxquelles la nature obéit, s'appellent purement et simplement des lois, mais elles ne reposent point, comme les lois de la nature, sur des conditions sensibles, mais sur un principe suprasensible, et elles exigent de ce fait, à côté de la partie théorique de la philosophie, et pour elles seules, une autre partie sous le nom de philosophie pratique.
On voit par là qu'un ensemble de préceptes pratiques que fournit la philosophie ne constitue pas, du seul fait qu'ils sont nommés pratiques, une partie spécifique de la philosophie qui serait instituée à côté de la philosophie théorique ; en effet, ces préceptes pourraient être ainsi nommés pratiques, quand bien même leurs principes seraient entièrement dérivés de la connaissance théorique de la nature (comme règles technico-pratiques) ; mais ces préceptes le sont au contraire parce que leur principe n'est pas du tout emprunté au concept de la nature, lequel est toujours conditionné de façon sensible, et parce qu'il repose en conséquence sur le suprasensible, suprasensible que seul le concept de liberté rend connaissable par des lois formelles, et qu'ils sont de ce fait moralement pratiques, c'est-à-dire non pas simplement des préceptes et des règles adoptés pour telle ou telle visée (médiatement), mais des lois qui ne présupposent ni fins, ni intentions.
II. DU DOMAINE DE LA PHILOSOPHIE EN GÉNÉRAL

[174]
L'usage de notre faculté de connaître d'après des principes, et par suite la philosophie, s'étend aussi loin que des concepts a priori trouvent à s'appliquer.
Mais l'ensemble de tous les objets auxquels ces concepts sont rapportés, afin d'en constituer, là où c'est possible, une connaissance, peut être divisé suivant le degré de suffisance ou d'insuffisance de nos facultés relativement à ce dessein.
Des concepts, dans la mesure où ils sont rapportés à des objets, sans que l'on tienne compte du fait qu'une connaissance de ces objets est possible ou non, possèdent leur champ, lequel n'est déterminé que d'après le rapport qu'entretient leur Objet avec notre faculté de connaître en général. La partie de ce champ en laquelle une connaissance est possible pour nous, est un territoire (territorium) pour ces concepts et pour la faculté de connaître requise à l'effet de cette connaissance possible. La partie du territoire ainsi défini sur laquelle ces concepts légifèrent est le domaine (dittio) de ces concepts et des facultés de connaître qui leur sont appropriées. Ainsi les concepts de l'expérience ont-ils, assurément, leur territoire dans la nature, en tant qu'elle est l'ensemble de tous les objets des sens, mais ils n'ont point de domaine (ils n'y ont au contraire que leur lieu de séjour, domicilium) ; ils sont bien, en vérité, produits d'une manière légale, mais ils ne légifèrent point et, bien au contraire, les règles fondées sur eux sont empiriques, par conséquent contingentes.
Considérée en tant qu'un tout, notre faculté de connaître a deux domaines, celui des concepts de la nature et celui du concept de liberté ; c'est en effet par ces deux types de concepts qu'elle légifère a priori. La philosophie se divise donc également, conformément à la partition de cette faculté, en philosophie théorique et en philosophie pratique. Mais le territoire sur lequel elle établit son domaine et sur lequel s' SXSTCS sa législation se limite toutefois toujours à l'ensemble des objets de toute expérience possible, dans la mesure où ces objets ne sont tenus pour rien de plus que de simples phénomènes ; en effet, s'il en était autrement, l'on ne pourrait concevoir aucune législation de l'entendement qui les concernât.
La législation d'après les concepts de la nature relève de l'entendement, et elle est théorique. La législation d'après le concept de liberté relève de la raison, et elle est simplement pratique. C'est uniquement dans ce qui est pratique que la raison peut légiférer ; en ce qui concerne la connaissance théorique (de la nature), la raison ne peut, partant de lois données (en tant qu'elle en est instruite grâce à l'entendement) [175] que tirer des conclusions à partir de raisonnements, conclusions qui cependant se cantonnent toujours au seul plan de la nature. Mais, inversement, là où les règles sont pratiques, la raison n'intervient pas pour autant en tant que législatrice, puisque les règles ainsi visées peuvent également être technico-pratiques.
L'entendement et la raison ont donc deux législations distinctes sur un seul et même territoire de l'expérience, sans que l'une doive porter préjudice à l'autre. En effet, le concept de la nature exerce aussi peu d'influence sur la législation fondée d'après le concept de liberté, que ce dernier trouble peu la législation de la nature. La Critique de la raison pure a démontré la possibilité de penser tout au moins sans contradiction la coexistence des deux législations et des deux facultés qui s'y rapportent dans le même sujet, par le fait qu'elle a anéanti les objections élevées contre cette possibilité en dévoilant l'apparence dialectique qui les habite.
Mais que ces deux domaines distincts, qui se limitent sans cesse au monde sensible, sinon certes dans leur législation, du moins cependant dans leurs effets, n'en constituent pas un Seul et Unique, cela vient de ce que le concept de la nature représente assurément ses objets dans l'intuition, non pas, il est vrai, comme choses en soi, mais comme simples phénomènes, tandis qu'au contraire le concept de liberté représente assurément dans son Objet une chose en soi, mais non pas dans l'intuition, en conséquence de quoi aucun des deux ne peut procurer une connaissance théorique de son objet (et même du sujet pensant) comme chose en soi, ce qui serait le suprasensible, dont on doit certes mettre l'Idée au fondement de la possibilité de tous ces objets de l'expérience, mais sans qu'il soit jamais possible d'élever et d'élargir cette Idée jusqu'à en faire une connaissance.
Ainsi, un champ illimité s'offre pour notre faculté de connaître dans son ensemble, mais aussi un champ inaccessible, à savoir le suprasensible, sur lequel nous ne trouvons pour nous aucun territoire, sur lequel par conséquent nous ne pouvons avoir de domaine propre à la connaissance théorique, ni pour les concepts de l'entendement ni pour ceux de la raison ; certes, c'est là un champ que nous devons occuper avec des Idées, tant au profit de l'usage théorique que de l'usage pratique de la raison, mais des Idées auxquelles, relativement aux lois procédant du concept de liberté, nous ne pouvons procurer qu'une réalité pratique, à partir de laquelle par conséquent notre connaissance théorique ne se trouve pas le moins du monde élargie au suprasensible.
Mais bien qu'un abîme incommensurable se trouve ainsi établi entre le domaine du concept de la nature, à savoir le sensible, et le domaine du concept de liberté [176], à savoir le suprasensible, de telle sorte que, du premier au second (donc au moyen de l'usage théorique de la raison), aucun passage n'est possible, tout comme s'il s'agissait de mondes différents, dont le premier ne peut avoir sur le second aucune influence ; celui-ci doit pourtant avoir une influence sur celui-là, autrement dit, le concept de liberté doit rendre effectivement réelle dans le monde sensible la fin qu'imposent ses lois ; et la nature doit en conséquence pouvoir être pensée de telle manière que la légalité de sa forme s'accorde pour le moins à rendre possibles les fins qui doivent agir en elle selon des lois de la liberté. Il faut donc bien qu'il existe un fondement de Y Unité au suprasensible, qui est à la base de la nature, avec ce que le concept de liberté contient dans le registre pratique, fondement dont le concept, bien qu'il ne réussisse ni théoriquement ni pratiquement à fournir une connaissance du passage recherché et que de ce fait il ne possède aucun domaine propre, rend cependant possible ledit passage reliant la manière de penser d'après les principes de l'un à la manière de penser d'après les principes de l'autre.
III. DE LA CRITIQUE DE LA FACULTÉ DE JUGER
COMME MOYEN D'UNIR EN UN TOUT
LES DEUX PARTIES DE LA PHILOSOPHIE

La critique des facultés de connaître, considérées dans ce qu'elles peuvent effectuer a priori, n'a à vrai dire aucun domaine pour ce qui est des objets, puisque cette critique n'est point une doctrine mais qu'elle doit seulement rechercher si, et comment, une doctrine est possible grâce à nos facultés, étant donné leur nature. Son champ s'étend à toutes les prétentions de ces facultés et son propos est de les replacer à l'intérieur de leurs limites légitimes. Mais ce qui ne peut rentrer dans la division de la philosophie peut toutefois rentrer, comme partie principale, dans la critique de la faculté de connaissance pure en général, si cette dernière contient des principes qui, considérés en eux-mêmes, ne conviennent ni à l'usage théorique ni à l'usage pratique.
Les concepts de la nature, lesquels contiennent le fondement pour toute connaissance théorique a priori, reposaient sur la législation de l'entendement. Le concept de liberté, lequel contenait le fondement pour toutes les prescriptions pratiques a priori non conditionnées par le sensible, reposait sur la législation de la raison. Ainsi ces deux facultés, outre le fait qu'elles peuvent être appliquées à des principes pour ce qui concerne la forme logique, quelle que puisse être l'origine desdits principes, possèdent chacune, en plus de cela, une législation propre quant à son contenu [177], législation au-dessus de laquelle il n'en existe aucune autre (a priori), ce qui justifie par conséquent la division de la philosophie en théorique et pratique.
Cependant, dans la famille des facultés supérieures de connaître, il existe toutefois encore un moyen terme entre l'entendement et la raison. Il s'agit de la faculté de juger, dont on peut supposer avec raison, par analogie, qu'elle pourrait tout autant contenir en soi, sinon une législation qui lui soit propre, toutefois un principe qui lui soit spécifique aux fins de rechercher des lois, un principe a priori en tout cas et simplement subjectif, lequel principe, alors même qu'aucun champ d'objets ne lui conviendrait comme son domaine propre, peut cependant avoir quelque territoire caractérisé de telle sorte que seul ce principe, précisément, pourrait bien y être valide.
Mais (à en juger par analogie) une raison nouvelle se présente à nous encore d'établir un lien entre la faculté de juger et un autre ordre de nos facultés représentatives, lien qui semble être d'une importance plus grande encore que celui apparentant la faculté de juger à la famille des facultés de connaître. Toutes les facultés ou toutes les capacités de l'âme en effet peuvent se ramener à ces trois que l'on ne peut plus déduire d'un fondement commun : la faculté de Connaître, le sentiment de plaisir et de déplaisir et la faculté de désirer *. Seul l'entendement légifère au regard de la faculté de connaître, pour autant que cette faculté (comme cela doit être lorsqu'on la considère en elle-même, indépendamment de la faculté de désirer) est, en tant que faculté de connaissance théorique, rapportée à la nature, à l'égard de laquelle seule (comme phénomène) il nous est possible de donner des lois fondées sur des concepts a priori, lesquels sont, à proprement parler, de purs concepts de l'entendement. Au regard de la faculté de désirer, en tant que faculté supérieure assise sur le concept de liberté, seule la raison (en laquelle uniquement se trouve ce concept) légifère a priori. Or, entre la faculté de connaître et la faculté de désirer se trouve inclus le sentiment de plaisir, tout comme entre l'entendement et la raison se trouve incluse la faculté de juger. Il faut donc présumer, au moins à titre provisoire, que la faculté de juger, considérée en elle-même, contient elle aussi un principe a priori et que, de même que le plaisir ou le déplaisir sont nécessairement liés à la faculté de désirer (soit qu'ils en précèdent le principe, comme c'est le cas pour la faculté inférieure de désirer, soit qu'ils résultent simplement de la détermination de celle-ci par la loi morale, comme [179] c'est le cas pour la faculté supérieure), de même la faculté de juger établira une passerelle au sein de la faculté pure de connaître, c'est-à-dire entre le domaine des concepts de la nature et le domaine du concept de liberté, aussi bien qu'elle rend possible, dans l'usage logique, le passage de l'entendement à la raison.
Si donc la philosophie ne peut être divisée qu'en deux parties principales, la partie théorique et la partie pratique, et bien que tout ce que nous pourrions avoir à dire des principes propres à la faculté de juger doive nécessairement y être porté dans la partie théorique, c'est-à-dire attribué à la connaissance rationnelle d'après des concepts de la nature, la critique de la raison pure (laquelle, avant d'entreprendre la constitution de ce système, doit établir tout cela en vue de le rendre possible) n'en reste pas moins constituée de trois parties : la critique de l'entendement pur, la critique de la faculté de juger pure, et la critique de la raison pure stricto sensu, facultés que l'on dit pures parce qu'elles légifèrent a priori.
IV. DE LA FACULTÉ DE JUGER
COMME FACULTÉ LÉGIFÉRANT A PRIORI

La faculté de juger en général est la faculté par laquelle le particulier est pensé comme compris sous l'universel. Si l'universel (la règle, le principe, la loi) est donné, alors la faculté de juger, qui subsume sous lui le particulier, est déterminante (y compris lorsque, en tant que faculté de juger transcendantale, elle indique a priori les conditions conformément auxquelles seules il peut y avoir subsomption sous cet universel). Mais dès lors que seul le particulier est donné, pour lequel la faculté de juger doit trouver l'universel sous lequel le subsumer, elle est alors simplement réfléchissante.
La faculté de juger déterminante, sous les lois transcendantales universelles que procure l'entendement, se limite à subsumer ; la loi lui est prescrite a priori et il ne lui est donc pas nécessaire de penser pour elle-même à une loi lui permettant de subordonner le particulier dans la nature à l'universel. Toutefois, il existe tant de formes diverses de la nature, et pour ainsi dire tant de modifications des concepts transcendantaux universels de la nature, modifications que laissent indéterminées les lois que l'entendement pur donne a priori, puisque ces lois ne portent que sur la possibilité d'une nature en général (comme objet des sens), il doit pour ces raisons également exister [180] des lois qui certes, en tant que lois empiriques, sont contingentes au regard de notre entendement, mais qui toutefois, pour mériter d'être appelées des lois (comme l'exige aussi le concept d'une nature), doivent pouvoir être considérées comme nécessaires aux fins de respecter un principe d'unité du divers, quand bien même ce principe serait inconnu de nous. La faculté de juger réfléchissante, qui est contrainte de remonter du particulier dans la nature jusqu'à l'universel, a donc besoin d'un principe, qu'elle ne peut emprunter à l'expérience précisément parce qu'il doit fonder l'unité de tous les principes empiriques sous des principes également empiriques, mais supérieurs, et par suite fonder la possibilité de la subordination systématique de ces principes les uns aux autres. La faculté déjuger réfléchissante n'a donc pour seule solution que de se donner à elle-même comme loi un tel principe transcendantal, sans pouvoir le tirer d'ailleurs (parce qu'elle serait alors faculté de juger déterminante), ni pouvoir le prescrire à la nature, puisque si la réflexion sur les lois de la nature se conforme à la nature, nous ne pouvons prétendre que celle-ci se conforme aux conditions suivant lesquelles nous cherchons à en acquérir un concept tout à fait contingent par rapport à elle.
Or, ce principe ne peut être autre que le suivant : attendu que les lois universelles de la nature ont leur fondement dans notre entendement, qui les prescrit à la nature (il est vrai uniquement d'après le concept universel de celle-ci en tant que nature), les lois empiriques particulières, compte tenu de ce qui, en elles, reste indéterminé par les lois universelles, doivent être embrassées selon une unité telle qu'un entendement (assurément pas le nôtre) aurait pu aussi la donner pour servir aux fins de notre faculté de connaître, afin de rendre possible un système de l'expérience d'après des lois particulières de la nature. Il ne s'agit pas pour autant de dire qu'il faille à cet effet admettre la réalité effective d'un tel entendement (car c'est à la seule faculté déjuger réfléchissante que cette Idée sert de principe, pour réfléchir, et non pas pour déterminer), mais au contraire de dire simplement que cette faculté se donne, ce faisant, une loi à elle-même seule, et non point à la nature.
Or, puisque l'on appelle fin le concept d'un objet, dans la mesure où ce concept contient en même temps le fondement de la réalité effective dudit objet, et puisque l'on nomme finalité de la forme d'une chose l'accord de cette forme avec celles des propriétés des choses que des fins seules rendent possibles, alors le principe recherché de la faculté de juger, pour ce qui concerne la forme des choses de la nature sous des lois empiriques en général, est la finalité de la nature en sa diversité. Ceci signifie que grâce à ce concept, on se représente la nature [181] comme si un entendement contenait le principe de l'unité de la diversité de ses lois empiriques.
La finalité de la nature est ainsi un concept particulier a priori, lequel a son origine uniquement dans la faculté de juger réfléchissante. On ne saurait, en effet, attribuer aux produits de la nature quelque chose comme une relation qu'en eux la nature entretiendrait avec des fins ; on ne peut faire usage de ce concept que pour réfléchir sur la nature au point de vue de la liaison qui s'y établit entre les phénomènes, liaison qui est donnée selon des lois empiriques. J'ajoute que ce concept est tout à fait distinct de la finalité pratique (de l'art humain, ou encore des mœurs), bien qu'il soit pensé en analogie avec celle-ci.
V. LE PRINCIPE DE LA FINALITÉ FORMELLE DE LA NATURE
EST UN PRINCIPE TRANSCENDANTAL DE LA FACULTÉ DE JUGER

Un principe transcendantal est un principe d'après lequel est représentée la condition universelle a priori sous laquelle seule des choses peuvent devenir des objets de notre connaissance en général. En revanche, l'on nomme métaphysique un principe dès lors qu'il représente la condition a priori sous laquelle seule des objets, dont le concept doit être par ailleurs donné empiriquement, peuvent être a priori déterminés plus complètement. Ainsi le principe de la connaissance des corps comme substances et comme substances susceptibles de modifications est-il transcendantal, si l'on entend par là que leurs modifications doivent avoir une cause ; mais il est métaphysique si l'on entend par là que leurs modifications doivent avoir une cause extérieure : dans le premier cas en effet, pour que l'on soit autorisé à parler de connaissance a priori de la proposition, le corps ne doit être pensé que par le biais de prédicats ontologiques (concepts purs de l'entendement), par exemple comme substance, tandis que dans le second cas, l'on doit mettre au fondement de cette proposition ainsi comprise le concept empirique d'un corps (comme objet mobile dans l'espace), de telle sorte que l'on puisse alors entendre entièrement a priori que ce dernier prédicat (celui du mouvement par le fait unique d'une cause extérieure) convient au corps. En ce sens, comme je le montrerai bientôt, le principe de la finalité de la nature (dans la diversité de ses lois empiriques) est un principe transcendantal. En effet, le concept des objets, dans la mesure où ils sont conçus comme soumis à ce principe, est uniquement le concept pur d'objets de la connaissance possible de l'expérience [182] en général, et il ne contient alors rien d'empirique. En revanche, le principe de la finalité pratique, finalité qui doit être pensée dans l'Idée de la détermination d'une Volonté libre, est un principe métaphysique parce que le concept d'une faculté de désirer, en tant qu'identique à celui de volonté, doit pourtant être donné empiriquement (il n'appartient pas aux prédicats transcendantaux). Toutefois, ces deux principes ne sont point empiriques, mais ce sont des principes a priori, parce qu'il n'est pas besoin d'une expérience plus large pour lier le prédicat avec le concept empirique du sujet de leurs jugements, ce lien pouvant être aperçu entièrement a priori.
Que le concept d'une finalité de la nature relève des principes transcendantaux, l'on peut s'en rendre compte de manière satisfaisante grâce aux maximes de la faculté de juger qui sont placées a priori au fondement de l'étude de la nature, mais qui toutefois concernent uniquement la possibilité de l'expérience, par conséquent la connaissance de la nature, non seulement comme nature en général, mais encore comme nature déterminée par diverses lois particulières. De même que des sentences de la sagesse métaphysique, ces maximes interviennent relativement souvent dans le cours de cette science, mais seulement de façon éparse, et ceci à l'occasion de maintes règles dont on ne peut montrer la nécessité à partir de concepts : « La nature emprunte le plus court chemin (lex parsimoniae) » ; « Elle ne fait toutefois pas de saut, ni dans la suite de ses transformations, ni dans l'assemblage de formes spécifiquement différentes (lex continui in natura) » ; « Sa grande diversité dans des lois empiriques constitue néanmoins une unité sous un petit nombre de principes (principia praeter necessitatem non sunt miltiplicanda) », etc.
Mais songer à indiquer l'origine de ces principes et tenter de le faire par la voie psychologique, c'est entièrement contraire au sens qui est le leur. En effet, ils ne disent pas ce qui arrive, c'est-à-dire selon quelle règle nos facultés de connaître mènent effectivement leur jeu et comment l'on juge, mais comment l'on doit juger ; et cette nécessité logique objective n'apparaîtrait pas dès lors que les principes seraient simplement empiriques. Ainsi la finalité de la nature est pour nos facultés de connaître et leur usage, usage où elle se manifeste en toute clarté, un principe transcendantal des jugements, et elle requiert de ce fait elle aussi une déduction transcendantale, par l'intermédiaire de laquelle le fondement de cette manière de juger doit être recherché dans les sources de connaissance a priori.
Nous trouvons en effet, en premier lieu, dans les fondements de la possibilité d'une expérience [183], quelque chose de nécessaire, à savoir les lois universelles, sans lesquelles une nature en général (en tant qu'objet des sens) ne peut pas être pensée ; ces lois reposent sur les catégories, appliquées aux conditions formelles de toute intuition pour nous possible, pour autant que cette intuition soit également donnée a priori. Sous ces lois maintenant, la faculté de juger est déterminante ; sa seule occupation en effet est de subsumer sous des lois données. Par exemple, l'entendement dit : tout changement a sa cause (loi universelle de la nature) ; la faculté de juger transcendantale n'a alors rien d'autre à faire que d'indiquer a priori la condition de la subsomption sous le concept de l'entendement proposé : et cette condition est la succession des déterminations d'une seule et même chose. Cette loi est dès lors reconnue comme absolument nécessaire pour la nature en général (comme objet d'expérience possible). Mais, outre cette condition formelle propre au temps, les objets de la connaissance empirique sont de plus déterminés ou, pour autant que l'on en puisse juger a priori, déterminables de manières très diverses, de telle sorte que des natures spécifiquement différentes, indépendamment de ce qu'elles ont de commun en tant qu'appartenant à la nature en général, peuvent de plus être des causes selon des modalités infiniment diverses ; et chacune de ces modalités (conformément au concept d'une cause en général) doit nécessairement avoir sa règle, qui est une loi emportant par conséquent avec elle la nécessité, bien qu'en raison de la constitution et des bornes de notre faculté de connaître nous ne puissions entendre cette nécessité. Nous devons ainsi penser dans la nature, au regard de ses lois simplement empiriques, la possibilité de lois infiniment diverses et néanmoins contingentes pour notre intelligence (elles ne peuvent être connues a priori) ; et au regard de ces lois, nous jugeons comme contingentes tant l'unité de la nature structurée d'après des lois empiriques que la possibilité de l'unité de l'expérience (en tant que système structuré d'après des lois empiriques). Mais comme une telle unité doit nécessairement être présupposée et admise, faute de quoi aucune liaison solidaire et intégrale de connaissances empiriques en un tout de l'expérience n'adviendrait, puisque si les lois universelles de la nature fournissent assurément une telle liaison dans le cadre de choses considérées selon leur genre en tant que choses de la nature en général, elles ne le font pas aux choses considérées selon leur espèce en tant qu'êtres particuliers de la nature ; c'est pourquoi la faculté de juger doit pour son propre usage admettre comme principe a priori que le caractère contingent des lois particulières (empiriques) de la nature pour l'intelligence humaine embrasse toutefois une unité relevant d'une loi opérant la liaison du divers qui s'y trouve en vue d'une expérience en soi possible, unité qui certes est insondable pour nous, mais qui toutefois [184] est susceptible d'être pensée. Par suite, puisque l'unité, relevant d'une loi opérant une liaison que nous reconnaissons assurément conforme à une intention nécessaire (à un besoin) de l'entendement, mais que nous reconnaissons en même temps cependant comme contingente en soi, puisque cette unité, dis-je, est représentée comme finalité des Objets (ici, de la nature), il s'ensuit que la faculté de juger, qui est simplement réfléchissante par rapport aux choses soumises à des lois empiriques possibles (lois qui restent à découvrir), doit, concernant ces dernières, penser la nature d'après un principe de finalité proposé à notre faculté de connaître, principe qui s'exprime dès lors dans les maximes de la faculté de juger indiquées plus haut. Or ce concept transcendantal d'une finalité de la nature n'est ni un concept de la nature, ni ne relève du concept de liberté, puisqu'il n'attribue absolument rien à l'Objet (la nature), mais représente seulement l'unique méthode que nous devons nécessairement suivre dans la réflexion sur les objets de la nature en vue d'une expérience qui soit complètement cohérente, et c'est de ce fait un principe subjectif (une maxime) de la faculté de juger ; de là vient aussi que, comme s'il s'agissait d'un heureux hasard favorable à notre dessein, nous nous réjouissons (proprement délivrés que nous sommes d'un besoin) lorsque nous rencontrons une telle unité systématique sous des lois simplement empiriques, bien que nous ayons dû nécessairement admettre qu'une telle unité existait sans que nous fussions à même pourtant de la pénétrer et de la prouver.
Pour se convaincre de la justesse de cette déduction du concept de finalité de la nature et de la nécessité de l'admettre comme principe transcendantal de la connaissance, que l'on songe simplement à la grandeur de la tâche, qui se trouve a priori dans notre entendement, de constituer une expérience cohérente à partir de perceptions données d'une nature contenant en tout état de cause une infinité de lois empiriques distinctes. Assurément, l'entendement est a priori en possession de lois universelles de la nature, faute desquelles celle-ci ne pourrait en rien être l'objet d'une expérience ; mais il a au surplus également besoin d'un certain ordre de la nature parmi les règles particulières de cette dernière, règles qui ne peuvent être connues de lui qu'empiriquement et qui sont de ce fait contingentes par rapport à lui. Ces règles particulières, sans lesquelles aucun progrès ne se produirait de l'analogie universelle d'une expérience possible en général à l'analogie particulière, il doit les penser comme étant des lois (c'est-à-dire comme nécessaires), faute de quoi elles ne constitueraient point un ordre de la nature, et cela bien qu'il ne puisse connaître leur nécessité ni la pénétrer jamais. Donc, bien que l'entendement ne puisse rien déterminer a priori concernant ces règles (ces objets) [185], il lui faut pourtant, afin d'attaquer la recherche de ces lois dites empiriques, mettre à la base de toute réflexion sur la nature un principe a priori selon lequel un ordre connaissable de la nature est possible d'après ces lois, principe qu'expriment les propositions suivantes : il existe dans la nature une subordination des genres et des espèces qui nous est compréhensible ; les genres à leur tour se rapprochent les uns des autres d'après un principe commun, de telle sorte qu'un passage est possible de l'un à l'autre et, par là, à un genre supérieur ; alors qu'il semble d'abord inévitable que notre entendement doive admettre autant d'espèces différentes de causalité qu'il y a d'effets spécifiquement différents dans la nature, elles peuvent bien cependant être rangées sous un petit nombre de principes qu'il nous faut rechercher, etc. Cet accord de la nature avec notre faculté de connaître est présupposé a priori par la faculté de juger en vue de sa réflexion sur la nature au regard de ses lois empiriques ; toutefois l'entendement considère en même temps cet accord objectivement comme contingent et c'est seulement la faculté de juger qui attribue cet accord à la nature comme finalité transcendantale (en rapport à la faculté de connaître du sujet) : faute de présupposer cette finalité, les lois empiriques n'envelopperaient aucun ordre de la nature, et par conséquent nous n'aurions aucun fil conducteur pour une expérience devant employer toutes ces lois dans leur diversité et pour en faire l'investigation.
On peut effectivement envisager qu'en dépit de toute l'uniformité des choses de la nature d'après les lois universelles, lois sans lesquelles ne saurait se concrétiser la forme d'une connaissance empirique en général, la diversité spécifique des lois empiriques de la nature, en ce compris tous leurs effets, pourrait cependant être si grande que notre entendement ne pourrait découvrir en elle un ordre intelligible, diviser ses produits en genres et en espèces, ce afin d'utiliser les principes de l'explication et de la compréhension qu'il exploite également pour l'explication et la saisie de la nature et de faire d'une matière aussi confuse pour nous (à proprement parler : seulement infiniment diverse et inadaptée à la capacité de notre intellect) une expérience cohérente.
La faculté de juger a donc elle aussi en elle-même un principe a priori rendant possible la nature, mais seulement d'un point de vue subjectif, principe grâce auquel elle prescrit une loi guidant la réflexion sur cette nature, loi que la faculté de juger prescrit non pas à la nature (en tant qu'autonomie de la nature), mais à elle-même (comme héautonomie) [186], loi que l'on pourrait nommer loi de la spécification de la nature au regard de ses lois empiriques, loi que la faculté de juger ne détecte pas a priori dans la nature, mais qu'elle adopte afin d'établir un ordre de la nature connaissable pour notre entendement, ordre obtenu dans la partition qu'elle opère des lois universelles de la nature, dès lors qu'elle veut leur subordonner une multiplicité de lois particulières. Lorsque par conséquent l'on dit que la nature spécifie ses lois universelles d'après le principe de finalité propre à notre faculté de connaître, c'est-à-dire en vue de les adapter à la façon nécessaire de procéder de l'entendement humain, à savoir trouver l'universel dans lequel s'inscrit le particulier que lui offre la perception et, pour ce qui est différent (qui correspond, certes, au général pour chaque espèce), trouver à nouveau une liaison qui le resitue dans l'unité du principe, lorsque l'on dit cela donc, ni l'on ne prescrit ce faisant une loi à la nature, ni l'on n'en tire une loi par observation (bien que ce principe puisse assurément être confirmé par l'observation). Ce n'est pas, en effet, un principe de la faculté de juger déterminante, mais simplement un principe de la faculté de juger réfléchissante ; l'on veut seulement, quel que l'ordre selon lequel est disposée la nature d'après ses lois universelles, qu'il faille rechercher ses lois empiriques d'après ce principe et selon les maximes reposant sur lui, parce que nous ne pouvons progresser dans l'expérience et acquérir de connaissance grâce à notre entendement que dans la mesure où ce principe est convoqué effectivement.
VI. DE LA LIAISON DU SENTIMENT DE PLAISIR
AVEC LE CONCEPT DE LA FINALITÉ DE LA NATURE

L'harmonie ainsi pensée de la nature dans la diversité de ses lois particulières avec notre besoin de découvrir pour elle des principes universels doit être considérée, autant que nous puissions la pénétrer, comme contingente, mais toutefois comme indispensable aux besoins de notre entendement, et par conséquent comme une finalité par laquelle la nature s'accorde avec notre dessein, mais seulement en tant que ce dernier est orienté vers une connaissance. Les lois universelles de l'entendement, qui sont en même temps des lois de la nature (bien que provenant de l'entendement de manière spontanée), sont tout autant nécessaires à celle-ci que les lois du mouvement de la matière ; et leur production ne présuppose aucun dessein de notre faculté de connaître, parce que c'est uniquement d'après ces lois en premier que nous obtenons un concept de ce qu'est la connaissance des choses (de la nature) [187] et parce qu'elles conviennent nécessairement à la nature, en tant qu'objet de notre connaissance en général. Mais que l'ordre de la nature issu de ses lois particulières, en toute leur diversité et toute leur hétérogénéité pour le moins possibles, bien au-delà de notre faculté de les appréhender, soit pourtant réellement approprié à notre connaissance, voilà qui est contingent, autant que nous puissions le pénétrer ; et la découverte de cet ordre est une opération de l'entendement, guidé par le dessein de réaliser une de ses fins nécessaires, à savoir introduire dans la nature l'unité des principes : cette fin, la faculté déjuger doit ensuite l'attribuer à la nature, puisque l'entendement ne peut à cet égard prescrire à la nature aucune loi.
À la réalisation de tout dessein s'associe le sentiment de plaisir ; et si la condition du dessein est une représentation a priori, tel ici un principe pour la faculté de juger réfléchissante en général, alors le sentiment de plaisir est lui aussi déterminé par un fondement a priori et valable pour tout homme : et cela simplement du seul fait du rapport de l'objet à la faculté de connaître, sans que le concept de finalité tienne ici le moins du monde compte de la faculté de désirer, se distinguant ainsi entièrement de toute finalité pratique de la nature.
En fait, tandis que, de l'accord des perceptions avec les lois afférentes aux concepts universels de la nature (les catégories), nous ne rencontrons en nous, ni ne pouvons rencontrer, le moindre effet sur le sentiment de plaisir, cela parce qu'en cette affaire l'entendement procède nécessairement selon sa nature et donc sans intention aucune, en revanche, d'un autre côté, la découverte de la possibilité d'unifier sous un seul principe deux ou plusieurs lois empiriques hétérogènes de la nature est la source d'un plaisir très remarquable, souvent même d'un étonnement admiratif, et plus encore d'un étonnement tel qu'il ne cesse pas quand bien même son objet est déjà suffisamment connu. Certes, nous n'éprouvons plus un plaisir remarquable en constatant que la nature nous est compréhensible, ainsi que son unité dans la division en genres et espèces, division grâce à laquelle seule sont possibles des concepts empiriques à l'aide desquels nous la connaissons d'après ses lois particulières ; mais un tel plaisir a certainement été éprouvé en son temps, et c'est uniquement parce que sans lui même l'expérience la plus commune n'aurait pas été possible qu'il s'est peu à peu confondu avec la simple connaissance et n'a dès lors plus été particulièrement remarqué. Il faut donc quelque chose qui, dans le jugement porté sur la nature, rende notre entendement attentif à la finalité de celle-ci, il faut que l'on cherche à ranger les lois hétérogènes de la nature sous des lois si possible plus intégrantes, quoique toujours empiriques, afin que nous ressentions du plaisir [188] en cas de succès devant cet accord de la nature avec notre faculté de connaître, accord que nous considérons comme simplement contingent. Au contraire, une représentation de la nature serait pour nous bien déplaisante, que la représentation d'après laquelle nous serait prédit qu'en la moindre recherche outrepassant l'expérience la plus commune, nous buterions sur une hétérogénéité des lois de la nature telle qu'elle rendrait impossible pour notre entendement le classement ordonné de ses lois particulières sous des lois universelles empiriques, la raison en étant que cela irait à l'encontre du principe de la spécification subjective et finale de la nature dans les genres et, à cet égard, à l'encontre de notre faculté de juger réfléchissante.
Cette présupposition de la faculté déjuger est néanmoins tellement indéterminée quant à la question de savoir jusqu'où doit s'exercer cette finalité idéale de la nature au profit de notre faculté de connaître, que si l'on nous dit qu'une connaissance plus profonde ou plus étendue de la nature acquise par l'observation doit finalement buter sur une diversité de lois telle qu'aucun entendement humain ne peut la ramener à un principe, nous en sommes également satisfaits, et ce bien que nous préférions entendre d'autres voix nous faisant espérer que plus nous connaîtrions la nature en son intimité, ou mieux nous pourrions la comparer à des membres extérieurs actuellement inconnus de nous, plus nous la trouverions simple en ses principes et, en dépit de l'apparente hétérogénéité de ses lois empiriques, accordée avec elle-même, cela aussi loin que puisse progresser notre expérience. C'est en effet un commandement de notre faculté de juger que nous procédions suivant le principe de la conformité de la nature à notre faculté de connaître, aussi loin qu'elle s'étende, sans définir (car ce n'est point une faculté de juger déterminante qui nous fournit cette règle) si ce principe a ou n'a pas quelque part ses limites ; nous pouvons en effet assurément déterminer des limites en ce qui concerne l'usage rationnel de nos facultés de connaître, mais nulle détermination de limites n'est possible dans le domaine empirique.
VII. DE LA REPRÉSENTATION ESTHÉTIQUE
DE LA FINALITÉ DE LA NATURE

Ce qui est simplement subjectif dans la représentation d'un Objet, c'est-à-dire ce qui relève du rapport de cette représentation au sujet et non à l'objet, c'est sa nature esthétique ; mais c'est sa valeur logique qui, en cette représentation, sert ou peut être utilisé à la détermination [189] de l'objet (pour la connaissance). Ces deux rapports sont mis en jeu à l'occasion de la connaissance d'un objet des sens. Dans la représentation sensible des choses extérieures à moi, le caractère qualitatif de l'espace dans lequel nous les intuitionnons est l'élément simplement subjectif de la représentation que je me fais d'elles (ce qu'elles peuvent être comme objets en soi reste pour cette raison indéterminé) et, en raison de ce rapport, l'objet n'est pensé que comme phénomène ; mais l'espace, nonobstant sa qualité simplement subjective, participe néanmoins de la connaissance des choses en tant que phénomènes. De même la Sensation (il s'agit ici de la sensation externe) exprime l'élément simplement subjectif de représentations que nous avons des choses en dehors de nous, tout comme l'espace exprime la simple forme a priori de la possibilité de leur intuition ; mais en vérité elle exprime également l'élément matériel (réel) de celles-ci (par lequel quelque chose d'existant est donné), et c'est pourquoi l'on utilise également la sensation pour la connaissance des objets en dehors de nous.
Mais l'élément strictement subjectif d'une représentation, CS qui ne peut en rien participer d'une connaissance, c'est le plaisir ou la peine qu'éprouve le sujet et qui lui sont liés ; en effet, par eux, je ne connais rien de l'objet de la représentation, bien qu'ils puissent assurément résulter de quelque connaissance. Maintenant, la finalité d'une chose, dans la mesure où elle est représentée dans la perception que nous en avons, n'est point une propriété de l'objet lui-même (une telle propriété ne peut en effet être perçue), bien qu'elle puisse de même provenir d'une connaissance des choses. Aussi bien, la finalité, qui précède la connaissance d'un objet, et même lorsque l'on ne désire pas utiliser la représentation de cette finalité en vue d'une connaissance, est néanmoins immédiatement associée à elle et en constitue l'élément subjectif, lequel ne peut absolument pas devenir une partie de la connaissance. L'objet n'est alors appelé final qu'en raison du fait que sa représentation est immédiatement associée au sentiment de plaisir, et cette représentation elle-même est une représentation esthétique de la finalité. Toute la question est simplement de savoir s'il existe en général une telle représentation de la finalité.
Lorsque du plaisir se trouve associé à la simple appréhension (apprehensio) de la forme d'un objet de l'intuition, sans que cette forme rapporte à un concept en vue d'une connaissance déterminée, alors, dans un tel cas, la représentation est rapportée, non à l'objet, mais purement et simplement au sujet, et le plaisir ne peut rien exprimer d'autre que la conformité de cet objet aux facultés de connaître mises en jeu dans la faculté de juger réfléchissante [190], et pour autant qu'elles y soient contenues, autrement dit le plaisir ne peut par conséquent exprimer qu'une simple finalité formelle subjective de l'objet. En effet, cette appréhension des formes dans l'imagination ne peut jamais se produire sans que la faculté déjuger réfléchissante, et cela même de façon non intentionnelle, ne la compare à tout le moins à son pouvoir de rapporter des intuitions à des concepts. Si donc, lors de cette comparaison, effectuée par le truchement d'une représentation donnée, l'imagination (en tant que faculté des intuitions a priori), sans l'avoir recherché, tombe en accord avec l'entendement (en tant que faculté des concepts) et que de cet accord naisse du plaisir, l'objet doit dès lors être considéré comme final pour la faculté de juger réfléchissante. Un tel jugement est un jugement esthétique portant sur la finalité de l'objet, jugement qui ne se fonde sur aucun concept existant de l'objet et n'en procure aucun. Si l'on juge que la forme ainsi considérée d'un objet (non pas l'élément matériel de sa représentation, en tant que sensation), à l'occasion de la simple réflexion sur cette forme (sans intention d'en acquérir un concept), est le principe d'un plaisir pris à la représentation d'un tel objet, dans ce cas l'on juge également ce plaisir comme nécessairement lié à cette représentation, par conséquent comme un plaisir non pas seulement pour le sujet qui appréhende cette forme, mais comme un plaisir qui serait partagé par toute personne qui juge en général. L'objet est alors dit beau et la faculté déjuger fondée sur un tel plaisir (par conséquent à valeur universelle) se nomme le goût. En effet, puisque le principe du plaisir est placé simplement dans la forme de l'objet intéressant la réflexion en général, par conséquent nullement dans une sensation de l'objet, et qu'il est également sans rapport avec un concept contenant une intention quelconque, c'est seulement avec les règles de l'usage empirique de la faculté de juger en général (unité de l'imagination et de l'entendement) dans le sujet que s'accorde la représentation de l'objet dans la réflexion, règles dont les conditions ont une valeur universelle a priori ; et comme cet accord de l'objet avec les facultés du sujet est contingent, il suscite chez le sujet la représentation d'une finalité de l'objet par rapport à ses propres facultés de connaître.
Voici donc un plaisir qui, comme tout plaisir ou peine non produits par le concept de liberté (c'est-à-dire par la détermination préalable, par la raison pure, de la faculté supérieure de désirer), ne peut jamais être saisi, à partir de concepts, comme nécessairement lié à la représentation d'un objet, mais doit, à chaque occurrence, être [191] reconnu seulement, par le truchement d'une perception réfléchie, comme étant lié à cette représentation ; par suite, comme c'est le cas pour tout jugement empirique, il ne peut indiquer aucune nécessité objective, ni prétendre valoir a priori. Mais, comme tout autre jugement empirique, le jugement de goût prétend également valoir pour chacun, ce qui est toujours possible, en dépit de sa contingence interne. Ce qui ici est étrange et singulier réside dans ce seul fait qu'il ne s'agit point d'un concept empirique, mais d'un sentiment de plaisir (donc nullement d'un concept), sentiment qui, d'après le jugement de goût, doit être attribué à chacun et lié à la représentation de l'objet, tout comme s'il s'agissait d'un prédicat lié à la connaissance de l'objet.
Un jugement d'expérience singulier, par exemple le jugement de celui qui perçoit une goutte d'eau mobile dans un cristal de roche, exige à juste titre que chacun l'admette de même, parce que ce jugement a été porté conformément aux conditions universelles de la faculté de juger déterminante assujettie aux lois d'une expérience possible en général. De même, celui qui, dans la simple réflexion sur la forme d'un objet et sans songer à un concept, éprouve du plaisir, prétend ajuste titre à l'assentiment de chacun, nonobstant le fait que ce jugement soit empirique et singulier ; c'est en effet que la cause de ce plaisir se trouve dans la condition universelle, quoique subjective, des jugements réfléchissants, à savoir dans l'accord final d'un objet (qu'il soit un produit de la nature ou de l'art) avec le rapport constructif, requis pour toute connaissance empirique, des facultés de connaître entre elles (l'imagination et l'entendement). Ainsi le plaisir que procure le jugement de goût dépend assurément d'une représentation empirique et ne peut être associé a priori à aucun concept (on ne peut déterminer a priori quel objet conviendra ou non au goût, il faut en faire l'expérience) ; mais le plaisir éprouvé est néanmoins le principe déterminant de ce jugement, par cela seul que l'on a conscience qu'il repose simplement sur la réflexion et les conditions universelles, quoiqu'uniquement subjectives, de l'accord de celle-ci avec la connaissance des objets en général, conditions pour lesquelles la forme de l'objet est finale.
C'est la raison pour laquelle les jugements de goût, concernant leur possibilité, dès lors qu'elle suppose un principe a priori, sont eux aussi soumis à une critique, bien que ce principe a priori qui leur est propre ne soit ni un principe de connaissance [192] pour l'entendement, ni un principe pratique pour la volonté, et ne soit donc pas du tout déterminant a priori.
La capacité de ressentir un plaisir provenant d'une réflexion sur les formes des choses (de la nature aussi bien que de l'art) n'indique pas seulement une finalité des objets en rapport à la faculté déjuger réfléchissante, finalité conforme au concept de la nature présent dans le sujet, mais aussi réciproquement, à la lumière du concept de liberté, une finalité du sujet par rapport aux objets au regard de leur forme ou même de leur défaut de forme ; et il en résulte que le jugement esthétique ne se rapporte pas seulement, en tant que jugement de goût, au beau, mais encore, comme issu d'un sentiment spirituel, au Sublime, de telle sorte que cette critique de la faculté de juger esthétique doit se diviser en deux parties principales qui correspondent à ces deux points de vue.
VIII. DE LA REPRÉSENTATION LOGIQUE
DE LA FINALITÉ DE LA NATURE

La finalité peut être représentée de deux façons distinctes dans un objet donné dans l'expérience : soit en partant d'un fondement simplement subjectif, comme concordance de la forme de l'objet, forme donnée dans l’appréhension (apprehensio) de cet objet antérieure à tout concept, avec les facultés de connaître, et ce afin de réunir l'intuition à des concepts aux fins d'une connaissance en général ; soit à partir d'un fondement objectif, comme concordance de sa forme avec la possibilité de la chose elle-même, possibilité déterminée d'après un concept de cette chose qui précède et contient le fondement de cette forme. Nous avons vu que la représentation de la finalité de la première espèce repose sur le plaisir immédiat pris à la forme de l'objet à l'occasion de la simple réflexion sur cette forme ; il s'ensuit que la représentation de la finalité de la seconde espèce, puisqu'elle ne rapporte pas la forme de l'objet, donnée dans l'appréhension de cette forme, aux facultés de connaître du sujet, mais qu'elle la rapporte à une connaissance prédéterminée de l'objet sous un concept donné, n'a rien de commun avec un sentiment de plaisir pris aux choses, mais relève de l'entendement dans le jugement qu'il porte sur elles. Le concept d'un objet étant donné, le rôle de la faculté de juger, dans l'usage qu'elle fait de ce concept pour la connaissance, consiste dans la présentation (exhibitio), c'est-à-dire consiste à adosser au concept une intuition correspondante, que cela s'effectue grâce à notre propre imagination, comme dans l'art [193], lorsque nous donnons corps au concept, préalablement formé, d'un objet qui est pour nous une fin, ou bien que cela s'effectue par la nature, dans le respect de sa technique (comme dans les corps organisés), lorsque nous lui attribuons notre concept de fin pour juger son produit ; auquel cas non seulement la finalité de la nature est représentée dans la forme de la chose produite, mais ce produit même est représenté comme fin naturelle. Bien que notre concept d'une finalité subjective de la nature dans ses formes, et respectant ses lois empiriques, ne soit nullement un concept de l'objet, mais seulement un principe de la faculté déjuger afin d'acquérir des concepts dans le contexte de cette excessive diversité (afin de pouvoir s'orienter en elle), ce faisant néanmoins, par l'analogie avec une fin, nous attribuons pour ainsi dire à la nature une considération pour notre faculté de connaître et nous pouvons ainsi considérer la beauté de la nature comme la présentation du concept de la finalité formelle (purement subjective), et les fins naturelles comme la présentation du concept d'une finalité réelle (objective) : de fait, nous les jugeons, la première par le goût (esthétiquement, grâce au sentiment du plaisir), la seconde par l'entendement et la raison (logiquement, suivant des concepts).
C'est sur cette distinction que repose la division de la critique de la faculté de juger en critique de la faculté de juger esthétique et critique de la faculté de juger téléologique : par la première, l'on entend la faculté que l'on tire du sentiment de plaisir ou de peine de porter un jugement sur la finalité formelle (que l'on nomme par ailleurs subjective) ; par la seconde, l'on entend la faculté qu'ont l'entendement et la raison de porter un jugement sur la finalité réelle (objective) de la nature.
La partie traitant de la faculté de juger esthétique est fondamentale dans une critique de la faculté de juger, parce que seule cette partie esthétique contient un principe que la faculté de juger met totalement a priori au fondement de sa réflexion sur la nature, à savoir, aux fins de notre faculté de connaître, le principe d'une finalité formelle de la nature d'après ses lois particulières (empiriques), finalité sans laquelle l'entendement ne pourrait s'y retrouver ; tandis que, du fait que l'on ne peut donner du concept de la nature, en tant qu'objet de l'expérience en général aussi bien qu'en particulier, absolument aucun fondement a priori, ni même indiquer la possibilité d'en dégager un, il s'ensuit clairement qu'il doit y avoir des fins objectives de la nature, c'est-à-dire des choses dont la possibilité n'est concevable qu'en tant que fins de la nature, et que seule la faculté déjuger, sans contenir en soi a priori un principe à cet effet, renferme en certains cas (à propos de certains produits) la règle permettant d'utiliser le concept de fin au profit de la raison, dès lors que ce principe transcendantal [194] a déjà préparé l'entendement à appliquer le concept d'une fin (du moins quant à la forme) à la nature.
Mais le principe transcendantal qui veut, cela dans le cadre d'une relation subjective avec notre faculté de connaître, que l'on se représente une finalité de la nature exprimée dans la forme d'une chose comme un principe permettant de porter un jugement sur cette forme, laisse tout à fait indéterminé le point de savoir où et dans quels cas je dois juger un produit de la nature d'après un tel principe de finalité et non pas plutôt simplement d'après les lois universelles de la nature ; et ce principe abandonne à la faculté de juger esthétique le soin de décider, en partant du goût, l'adéquation de ce produit (de sa forme) à nos facultés de connaître (dans la mesure où cette faculté prend sa décision non pas d'après un accord avec des concepts, mais d'après un sentiment). Dans son usage téléologique au contraire, la faculté déjuger détermine les conditions sous lesquelles l'on doit juger quelque chose (un corps organisé par exemple) d'après l'Idée d'une fin de la nature, mais elle ne peut alléguer à ce titre aucun principe tiré du concept de la nature, en tant qu'objet de l'expérience, lequel principe permettrait d'attribuer à celle-ci quelque rapport à des fins fixées a priori et de supposer de tels rapports, même de façon indéterminée, compte tenu de notre expérience effective de ces produits ; la raison en est que de nombreuses expériences particulières doivent être faites et envisagées sous l'unité de leur principe pour que l'on puisse, empiriquement seulement, reconnaître une finalité objective dans un certain objet. La faculté de juger esthétique est ainsi une faculté particulière permettant de juger des choses d'après une règle, mais non d'après des concepts. La faculté de juger téléologique au contraire n'est point une faculté particulière, mais n'est que la faculté de juger réfléchissante en général, puisqu'elle procède, comme partout dans la connaissance théorique, d'après des concepts, mais en observant toutefois, par rapport à certains objets de la nature, des principes particuliers, à savoir ceux d'une faculté de juger simplement réfléchissante, et de ce fait ne déterminant pas d'objets ; ainsi, par l'application qui en est faite, la faculté de juger téléologique relève de la partie théorique de la philosophie et, en raison des principes particuliers, non déterminants, qui sont les siens, et comme ce doit être le cas dans une doctrine, elle doit également constituer une partie spécifique de la critique ; au lieu que la faculté de juger esthétique ne contribue en rien à la connaissance de son objet et doit donc être mise au compte Seulement àe la critique du sujet qui juge et de ses facultés de connaissance, dans la mesure où elles sont capables de principes a priori, quel qu'en puisse être d'ailleurs l'usage (théorique ou pratique), et une telle critique constitue la propédeutique de toute philosophie.
[195]
IX. DE LA LIAISON DES LÉGISLATIONS DE L'ENTENDEMENT
ET DE LA RAISON PAR LA FACULTÉ DE JUGER

L'entendement légifère a priori pour la nature en tant qu'objet des sens, en vue d'une connaissance théorique de celle-ci dans une expérience possible. La raison légifère a priori pour la liberté en tant qu'elle s'identifie au suprasensible dans le sujet, et pour la causalité propre de celle-ci, en vue d'une connaissance pratique inconditionnée. Le domaine du concept de la nature soumis à la première de ces législations et celui du concept de liberté soumis à la seconde sont complètement isolés l'un de l'autre, coupés par conséquent de toute influence réciproque qu'ils pourraient avoir l'un sur l'autre (chacun respectant ses propres lois fondamentales) par le grand fossé séparant le suprasensible des phénomènes. Le concept de liberté ne détermine rien en ce qui concerne la connaissance théorique de la nature, de même que le concept de nature ne détermine rien en ce qui concerne les lois pratiques de la liberté ; et dans cette mesure, il est impossible de jeter un pont reliant un domaine à l'autre. Seulement, si l'on ne peut trouver dans la nature de quoi étayer les principes de détermination de la causalité selon le concept de liberté (et la règle pratique qu'il contient) et si le sensible ne peut pas déterminer le suprasensible dans le sujet, l'inverse est pourtant possible (non pas, certes, par rapport à la connaissance de la nature, mais toutefois quant aux conséquences qu'a le concept de liberté sur cette dernière) et se trouve déjà contenu dans le concept d'une causalité par liberté, dont l’effet doit advenir dans le monde conformément aux lois formelles qui sont les siennes, et cela bien que le mot Cause, appliqué au cas du suprasensible, signifie simplement la raison qui détermine la causalité des choses de la nature en vue d'un effet conforme à leurs propres lois naturelles, mais effet qui se trouve toutefois simultanément en accord également avec le principe formel des lois rationnelles ; de fait, l'on ne peut entendre la possibilité de ceci, mais on peut réfuter de façon satisfaisante l'objection qu'une prétendue contradiction s'y trouverait *. L'effet produit sous le concept de liberté est la [196] fin ultime qui doit exister (ou dont le phénomène doit exister dans le monde sensible), et pour cela la condition de possibilité en est présupposée dans la nature (du sujet comme être sensible, c'est-à-dire comme homme). Cette fin ultime, la faculté de juger la présuppose a priori sans avoir égard à la pratique, et ce faisant elle fournit le concept médiateur entre les concepts de la nature et celui de liberté, concept médiateur qui, par la notion d'une finalité de la nature, rend possible le passage de la raison pure théorique à la raison pure pratique, le passage de la légalité selon la première à la fin ultime selon la seconde ; et ce faisant, on reconnaît la possibilité de la fin ultime, qui ne peut se réaliser que dans la nature et en accord avec ses lois.
Grâce à la possibilité de ses lois a priori visant la nature, l'entendement apporte une preuve que la nature n'est connue de nous qu'en tant que phénomène et ce faisant nous donne simultanément des indications sur un substrat suprasensible de cette nature, mais il le laisse tout à fait indéterminé. Grâce à son principe a priori visant à juger la nature d'après les lois particulières possibles de celle-ci, la faculté de juger procure à son substrat suprasensible (en nous aussi bien qu'en dehors de nous) la déterminabilité grâce à la faculté intellectuelle. Quant à la raison, elle donne à ce même substrat la détermination, ce grâce à sa loi pratique a priori, et ainsi la faculté de juger rend possible le passage du domaine du concept de la nature à celui du concept de liberté.
Si l'on s'intéresse aux facultés de l'âme en général, et dans la mesure où on les considère comme supérieures, c'est-à-dire comme enveloppant une autonomie, celle des facultés qui contient les principes Constitutifs a priori est, pour la faculté de Connaître (la connaissance théorique de la nature), l'entendement ; pour le Sentiment de plaisir et de peine, c'est la faculté de juger, mais compte non tenu des concepts et des sensations se rapportant à la détermination de la faculté de désirer [197] et qui de ce fait pourraient être immédiatement pratiques ; pour la faculté de désirer, c'est la raison, qui est pratique sans la médiation d'aucun plaisir, quelle qu'en soit l'origine, et qui détermine pour cette faculté, en tant que faculté supérieure, la fin ultime, laquelle apporte en même temps avec soi la pure joie intellectuelle prise à l'objet. Le concept de finalité de la nature qu'élabore la faculté de juger relève encore des concepts de la nature, mais seulement en tant que principe régulateur de la faculté de connaître, cela bien que le jugement esthétique porté sur certains objets (de la nature ou de l'art), qui met en jeu ledit principe, soit un principe constitutif par rapport au sentiment de plaisir ou de peine. La spontanéité que présente le jeu des facultés de connaître, dont l'accord entre elles contient le fondement de ce plaisir, rend le concept ainsi pensé apte à assurer la liaison des domaines du concept de la nature avec le concept de liberté en ses conséquences, et cela dans la mesure où elle développe la disposition de l'esprit à être réceptif au sentiment moral.
Le tableau suivant peut permettre d'accéder plus facilement à une vue globale de toutes les facultés de connaître suivant leur unité systématique *.
|
Facultés de l'esprit dans leur ensemble
|
Faculté de connaître
|
Principes a priori
|
Application à
|
|
Faculté de connaître
|
Entendement
|
Légalité
|
La Nature
|
|
Sentiment de plaisir et de peine
|
Faculté de juger
|
Finalité
|
L'Art
|
|
Faculté de désirer
|
Raison
|
Fin ultime
|
La Liberté
|
* S'agissant de concepts que l'on utilise comme principes empiriques, il est utile, dès lors que l'on a quelque raison de supposer qu'ils sont apparentés à la pure faculté de connaître a priori et du fait précisément de cette relation, d'en rechercher une définition transcendantale, c'est-à-dire à l'aide de catégories pures, en tant que celles-ci seules indiquent de façon satisfaisante la différence entre le concept en question et les autres. On suit en ceci l'exemple du mathématicien, qui laisse indéterminées les données empiriques de son problème et ne classe sous les concepts de l'arithmétique pure que leur rapport dans leur synthèse pure, généralisant ainsi la solution du problème. On m'a reproché un procédé analogue (Critique de la. raison pratique, page 16, préface) et l'on a critiqué la définition de la faculté de désirer, à savoir la faculté d'être par ses représentations cause de la réalité des objets de ces représentations, en objectant que de simples souhaits seraient pourtant eux aussi des désirs, dont chacun se résout toutefois à ne pas pouvoir, par leur seul moyen, produire leur objet. Mais ceci prouve seulement qu'il y a en l'homme des désirs qui le mettent en contradiction avec lui-même, s'il vise par sa représentation seule à produire l'objet, attitude dont il ne peut pourtant attendre aucun succès, puisqu'il est conscient du fait que ses forces mécaniques (si je puis nommer ainsi ses forces non psychologiques), qui devraient être déterminées par cette représentation afin de produire l'objet [178] (par conséquent médiatement), sont ou bien insuffisantes, ou bien même tendent à quelque chose d'impossible, par exemple à pouvoir faire que ce qui est arrivé ne soit pas arrivé (O mihi praeteritos, etc. Oh, si Jupiter me rendait mes années passées - Enéide, VIII) ou à pouvoir, dans l'impatience de l'attente, annuler le temps qui le sépare de l'instant désiré. Bien qu'en de tels désirs imaginaires nous soyons conscients de l'insuffisance (ou même de l'inaptitude) de nos représentations à être cause de leur objet, cependant leur statut causal, par conséquent la représentation de leur causalité, est contenu dans chaque souhait et est surtout manifeste lorsque celui-ci est un affect, à savoir un désir intense. Ces affects en effet, parce qu'ils dilatent le cœur, le dessèchent et épuisent ainsi les forces, témoignent que celles-ci sont à diverses reprises tendues par des représentations, mais ne cessent de laisser l'esprit retomber dans la lassitude, dès lors qu'il prend acte de ce que son désir a d'impossible. Même les prières pour repousser de grands et autant qu'on le puisse voir inévitables maux, ainsi que maints moyens superstitieux pour atteindre des fins impossibles à réaliser de manière naturelle, prouvent le rapport causal des représentations à leurs objets, rapport tel que même la conscience de l'insuffisance de ces dernières à atteindre l'effet désiré ne peut réfréner l'effort fait pour y parvenir. C'est en revanche une question anthropologique et téléologique que de savoir pourquoi la propension à former de vains désirs, tout en étant conscient de leur vanité, a été inscrite dans notre nature. Or il semble que la plus grande partie de ces forces resterait inutilisée si nous n'étions pas enclins à user de nos forces avant même de nous être assurés que notre faculté suffit pour la production d'un objet. De fait, nous n'apprenons communément à connaître nos forces qu'à partir des essais que nous en faisons. Cette illusion inhérente aux vains souhaits n'est donc que la conséquence d'une disposition heureuse de notre nature.
* L'une des diverses prétendues contradictions que l'on reproche à cette séparation complète entre la causalité naturelle et la causalité par liberté est la suivante : lorsque je parle, dit-on, des obstacles que la nature oppose à la causalité d'après les lois de la liberté (lois morales), ou de la manière dont elle lui apporte son concours, j'admets en tout état de cause une influence de la première sur la seconde. Mais si l'on veut seulement comprendre ce qui a été dit, cette fausse interprétation est très facilement évitable. Ce n'est pas entre la nature et la liberté qu'il existe résistance ou concours, mais entre la première en tant que phénomène et les effets de la seconde en tant que phénomènes dans le monde sensible ; et même la causalité de la liberté (de la raison pure et pratique) est la causalité d'une cause naturelle subordonnée à la liberté (la causalité du sujet considéré en tant qu'homme, par conséquent comme phénomène) et dont le moment intelligible, qui est pensé sous la liberté, enveloppe le fondement de sa détermination d'une manière d'ailleurs inexplicable (tout comme il en est de cela même qui constitue le substrat suprasensible de la nature).
* On a trouvé contestable que mes divisions, en philosophie pure, soient presque toujours tripartites. Cela tient pourtant à la nature même de la chose. Dès lors que l'on doit procéder à une division a priori, cette division est soit analytique et respectant le principe de contradiction, et dans ce cas elle a toujours deux parties (quodlibet ens est aut A aut non A) ; soit elle est synthétique, et dans ce cas, dès lors qu'elle doit être effectuée à partir de concepts a priori (et non, comme en mathématiques, à partir de l'intuition correspondant a priori au concept), il faut que la division soit nécessairement une trichotomie, conformément à ce qu'exige en général l'unité synthétique, à savoir : 1°) une condition ; 2°) un conditionné ; 3°) le concept résultant de l'union du conditionné avec sa condition.
|

