|
[3]
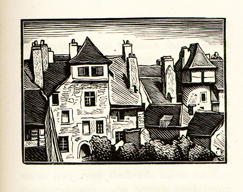
À M. Marcellin Berthelot
 Plus d'une fois, en retrouvant dans ces pages certaines idées dont nous avons mille fois causé ensemble, je me suis demandé si elles étaient de vous ou de moi, tant nos pensées se sont depuis trente ans entrelacées, tant il m'est impossible, dans notre intime association intellectuelle, de distinguer ce qui est mien de ce qui est vôtre. C'est comme si l'on voulait partager les membres de l'enfant entre le père et la mère. Tantôt l'embryon de [p. 4] l'idée est de vous et le développement m'appartient ; tantôt le germe est venu de moi, et c'est vous qui l'avez fécondé. Toul ce que j'ai pu dire de bon sur l'ensemble de l'univers, je veux qu'on le regarde comme vous appartenant. D'un autre côté, je réclame une part dans la formation de votre esprit philosophique ; je n'en aurai pas de meilleure. Plus d'une fois, en retrouvant dans ces pages certaines idées dont nous avons mille fois causé ensemble, je me suis demandé si elles étaient de vous ou de moi, tant nos pensées se sont depuis trente ans entrelacées, tant il m'est impossible, dans notre intime association intellectuelle, de distinguer ce qui est mien de ce qui est vôtre. C'est comme si l'on voulait partager les membres de l'enfant entre le père et la mère. Tantôt l'embryon de [p. 4] l'idée est de vous et le développement m'appartient ; tantôt le germe est venu de moi, et c'est vous qui l'avez fécondé. Toul ce que j'ai pu dire de bon sur l'ensemble de l'univers, je veux qu'on le regarde comme vous appartenant. D'un autre côté, je réclame une part dans la formation de votre esprit philosophique ; je n'en aurai pas de meilleure.
Vous aviez dix-huit ans, j'en avais vingt-deux quand nous commençâmes à penser ensemble. Nous étions alors ce que nous sommes aujourd'hui. Notre sérieuse jeunesse, traversée d'espérances vite déçues, fut suivie d'un âge mûr plein de tristesses. Punis de fautes que nous n'avions pas commises, nous vîmes la France s'abîmer dans la bassesse, la sottise, l'ignorance. Trahie vraiment par ses aînés, notre génération a droit de se plaindre. Chaque génération doit à la suivante ce qu'elle a reçu de ses devancières, un ordre social établi. Après avoir amené le fatal écroulement de février, ceux qui nous devaient une libre patrie [p. 5] préparèrent malgré nous la funeste solution de décembre. Puis, quand nous fûmes résignés à suivre la France dans la voie où elle s'était engagée, tout croula de nouveau, et il fallu attendre cinq ans encore qu'il plût aux présomptueux politiques qui nous avaient perdus de s'avouer impuissants.
Verrons-nous enfin de meilleurs jours, et notre vieillesse sera-t-elle comme l'arrière-saison du poète hébreu, qui récolta dans la joie la moisson qu'il avait semée dans les larmes ? Vous l'espérez, et puissiez-vous avoir raison ! Tant de fautes ont été commises qu'il en est beaucoup qu'on ne peut plus commettre. Si la France veut jouer une fois de plus sa belle partie de sympathie, de liberté, de dignité pour tous, le monde l'aimera encore. Sa défaite aura mieux valu que la plus éclatante victoire si elle donne l'exemple d'une nation sage sans guides et intelligente sans maîtres. Que volontiers j'effacerai alors toutes mes lugubres prophéties ! Comme je serai heureux de [6] me rétracter !... En attendant, notre tâche est bien simple : redoublons de travail. Je sens en moi quelque chose de jeune et d'ardent ; je veux imaginer quelque chose de nouveau. Il faut que M. Hugo et Mme Sand prouvent que le génie ne connaît pas la vieillesse. Il faut que Taine, About, Flaubert fassent dire que leurs meilleures œuvres jusqu'ici n'ont été que des essais. Il faut que Claude Bernard et Balbiani découvrent d'autres secrets de la vie. Il faut que vous étonniez la science par quelque nouvelle synthèse, que vous attaquiez l'atome, que vous recherchiez s'il est aussi incorruptible qu'on le croit. Il faut que chacun se surpasse, pour qu'on dise de nous : « Ces Français sont bien encore les fils de leurs pères : il y a quatre-vingts ans, Condorcet, en pleine Terreur, attendant la mort dans sa cachette de la rue Servandoni, écrivait son Esquisse des progrès de l'esprit humain. »
![MC900127369[1]](/classiques/renan_ernest/dialogues_philosophiques/decoration_fin_chapitre.jpg)
|

