|
[193]
André SIEGFRIED [1875-1959]
sociologue, historien et géographe français, pionnier de la sociologie électorale.
Membre de l'Institut
“Charles Seignobos.”
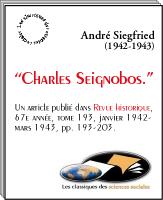 In Revue historique, 67e année, tome 193, janvier 1942-mars 1943, pp. 193-203. Paris : Les Presses universitaires de France. Édition réalisée à partir d’un facsimilé de la bibliothèque numérique GALLICA, France. In Revue historique, 67e année, tome 193, janvier 1942-mars 1943, pp. 193-203. Paris : Les Presses universitaires de France. Édition réalisée à partir d’un facsimilé de la bibliothèque numérique GALLICA, France.

C’est un grand historien français que nous avons perdu, le dernier, je crois, dont la compétence historique fût universelle : il pouvait, avec une égale autorité, enseigner l’antiquité, le moyen âge ou les temps modernes ; les partis politiques du Chili lui étaient aussi familiers que ceux de l’Angleterre ; il n’était pas, à vrai dire, d’époque ou de continent dont il se désintéressât : si, rentrant d’un voyage aux États-Unis ou au Canada, je l’entretenais de ce que j’y avais vu, il témoignait, par ses questions ou ses remarques, d’une parfaite connaissance de ces pays. Quand, à la fin d’une longue vie, il écrivit ce livre, si personnel, si riche de substance, l’Histoire sincère de la Nation française, il n’était pas un siècle de notre passé national dont il n’eût personnellement approfondi la connaissance. Les dangers de la spécialisation n’avaient pas de prise sur lui : à quatre-vingts ans, alerte, capable de parler intelligemment de tout, il restait ouvert comme un jeune homme à toutes les curiosités de l’esprit.
On disait quelquefois de lui que c’était le type du savant allemand, et par là on prétendait évoquer quelque magister, bardé de citations et de références. Sa documentation, en effet, était impressionnante : il semblait avoir tout lu, était au courant de tout ce qui se publiait, aussi bien à l’étranger qu’en France ; le dernier livre paru, la plus récente revue se voyaient sur sa table, et les pages étaient coupées. Cette conscience dans l’information, réclamant pour le moindre fait un témoignage ou une preuve, ne laissant rien à la fantaisie ou à la facilité, rejetant avec une sorte d’affectation le moindre soupçon de littérature, semblaient à certains, qui le connaissaient mal, relever de l’influence germanique, fort à la mode en ces temps-là dans les milieux universitaires. Mais l’impression était fausse, car c’était bien le contraire d’un savant de l’Europe centrale. Ses défauts, comme ses qualités, étaient entièrement de notre crû.
Je comprends mal qu’on ait pu se méprendre aussi complètement sur ce qui faisait l’essence de sa personnalité. Il y avait chez [194] lui quelque chose de direct, soit dans l’observation soit dans l’expression, qui relevait bien davantage de l’intuition que de l’enquête. Comment il faisait pour pénétrer, d’un œil implacable et à la façon d’un rayon X, la psychologie de pays qu’il n’avait jamais visités, c’est pour moi un mystère. La méthode, alors, n’était plus rien, c’est la personnalité qui faisait tout. Et l’exemple soulignait qu’aucune méthode ne dispense d’être intelligent. C’est par là notamment que ce maître était si authentiquement français, car, s’il y a partout des gens intelligents, c’est en France surtout qu’on croit à l’intelligence, mieux encore qu’on se réjouit de compter sur elle.
Charles Seignobos était du Midi, du moins de ce demi-Midi qu’est l’Ardèche, et d’origine protestante. Lamastre, son lieu de naissance, est juste en dehors, mais à promixité, de la zone méditerranéenne. Il pouvait donc, à juste titre, se défendre d’être méditerranéen, mais on sentait que ce n’était pas un homme du Nord. Dans cette partie de l’Ardèche les protestants sont nombreux, influents, de type moral et intellectuel marqué : encore que non-croyant, il était indéniablement l’un d’entre eux. C’est sans doute de cette double circonstance qu’il tenait le trait le plus significatif de son esprit, le non-conformisme. Individualiste forcené, il ne tenait aucun compte des opinions reçues, fussent-elles transmises par la tradition la plus vénérable ou les plus hautes autorités : sans aucun égard pour qui que ce fût, il les étalait sur la table de dissection, pour les analyser d’un œil intellectuel froid, qui, derrière son binocle toujours un peu de travers, semblait un acier tranchant. Rien n’y résistait. Il prenait même un malin plaisir à contredire les notions acquises les plus respectables : quand il pouvait montrer, avec preuves à l’appui, que Charlemagne ne portait pas la « barbe fleurie », mais avait au contraire la longue moustache à la gauloise, on voyait bien qu’il était enchanté.
Il y avait, dans de semblables traits, plus qu’une gaminerie. L’histoire est à ce point encombrée de légendes, dont beaucoup ne sont nullement désintéressées, que ce petit jeu de massacre, auquel il se complaisait, était, du point de vue pédagogique, extrêmement éducatif. La propagande est une chose, l’histoire en est une autre, et c’est un simple devoir intellectuel de les distinguer. Très peu de gens savent ou veulent le faire. Un cours, une conversation de ce maître hétérodoxe balayaient l’atmosphère à la façon [195] d’un coup de mistral. Le ciel de l’esprit était ensuite ravagé jusqu’à une pureté presque douloureuse. Après quoi l’on ne pouvait plus supporter sans une sorte de nausée l’académisme de la « Grande histoire », ni les considérations éloquentes auxquelles « s’élevaient » les faiseurs bien-pensants de généralisations moralisatrices. On avait respiré intellectuellement l’air d’un autre monde et l’on ne pouvait plus qu’étouffer dans l’atmosphère raréfiée du conformisme.
Il est bien certain que cette façon de procéder ne plaisait pas à tout le monde. Pour que cette critique fût efficace, il fallait qu’elle ne respectât rien, ni personne. On avait affaire à un iconoclaste, et ce n’était pas, après tout, chose sans conséquence que de s’abandonner à semblable influence : toute une conception de la connaissance et même de la vie s’y trouvait impliquée. De même, toute une conception des relations sociales, car ces fleurets n’étaient pas mouchetés : s’ils ne tuaient pas, ils blessaient assurément. Quand Seignobos répliquait à quelque thèse d’un important, qui sait, d’un membre de l’Institut ou de quelque pontife universitaire : « C’est absurde », l’interlocuteur n’était pas content et trouvait que c’étaient là de mauvaises manières intellectuelles. Ces remarques directes n’étaient pas du tout du genre « cher maître », « éminent confrère », qui malgré tout plaît à tant de gens. Mais je reste persuadé que cette franchise intellectuelle est nécessaire à l’esprit adulte qui, sans hypocrisie ni puérilité, essaie de regarder courageusement la vérité en face. L’expérience nous enseigne que, comme le soleil et la mort, il n’est pas facile de la regarder fixement.
Les égards mondains n’étaient donc pas son fait, mais il n’était pas mal élevé, bien au contraire : avec les femmes, avec les enfants, il avait des attentions charmantes ; il savait, au bon moment, offrir une fleur, et la fleur qu’il fallait ; c’est avec une véritable amitié qu’il s’enquérait de ce qui concernait les gens de son entourage. Par sa famille il appartenait à une sorte de gentry et, s’il y avait dans sa manière de vivre quelque teinte de bohème, il y avait en lui beaucoup de traits du gentleman. Je le lui dis un jour, un peu pour le taquiner, mais il prit la chose presque pour une insulte. Je crois qu’il redoutait surtout que les formules mondaines ne vinssent compromettre l’intégrité intellectuelle de ses jugements. Aussi les réduisait-il systématiquement au minimum : « Bonjour »… et déjà on parlait des lois agraires des Romains ou des partis politiques en Finlande. Ou bien, si l’on s’était entretenu longuement de quelque question, un bref « Adieu » mettait fin à la [196] conversation et tout à coup il n’était plus là. Avec lui l’exorde était toujours ex abrupto. On sentait bien qu’une seule chose comptait pour lui, la recherche de la vérité pure et simple, agréable ou désagréable. Il ne se gênait jamais pour dire en face aux gens les choses désagréables que nécessitait la vérité.
Voilà pourquoi Seignobos, qui avait des amis passionnés, avait aussi et surtout peut-être, des adversaires violents. Les traditionalistes, les conformistes, les académiques le détestaient, d’autant plus qu’appartenant à la gauche par doctrine et par tempérament il s’attachait, avec une sorte d’alacrité méphistophélique, à crever tous les ballons conservateurs qui passaient à sa portée. C’était sans que son objectivité y perdît rien, car il jugeait avec la même rigueur ses amis que ses adversaires. Le xixe siècle bien pensant nous avait légué tout un lot d’idées reçues, toute une collection de théories toutes faites, destinées le plus souvent à servir de soutien à l’ordre social, de fondement à l’autorité des classes dirigeantes. Impitoyablement il se faisait un programme de renverser cet édifice. Peut-être, dans son zèle, dépassait-il quelquefois la mesure, mais cette broussaille à élaguer était si touffue que c’était incontestablement œuvre utile. On pourra du reste bientôt procéder au même nettoyage pour les slogans, de gauche comme de droite, qu’a accumulés la dernière génération. Vers la fin du xixe siècle ou le début du xxe, les tenants de la « grande histoire » attachés à une autre tradition, ne le lui pardonnaient pas. Il ne fut jamais de l’Institut, sans doute pour cette raison, et il faut le regretter pour l’Institut, qui, vers la même époque, accueillait pourtant des historiens de troisième ou de quatrième ordre.
Ce serait une erreur cependant que de voir en lui un fanatique, emporté par sa passion (la vérité peut, elle-même, devenir une passion). Sa lucidité intellectuelle le préservait, malgré certaines apparences, de l’esprit partisan. « Hiver serein, hiver lucide… », a écrit quelque part Mallarmé. Le cerveau de Seignobos avait la netteté d’un ciel d’hiver par un temps froid. Je crois bien que l’observation et l’analyse constituaient sa véritable passion : il ne leur eût rien sacrifié, il vivait pour elles. Ce qu’il a transmis de meilleur à ses élèves, c’est ce besoin de voir clair, sans égard pour ce qui n’est pas la vérité. Wickham Steed, qui était de ses amis, a raconté, dans ses Souvenirs, comment, après de longs mois d’études en Europe centrale, il avait pris contact avec lui et avec son groupe. Plein de considération pour les méthodes allemandes [197] et autrichiennes, auxquelles il venait de s’initier, le voilà qui tombe sans autre préparation dans un milieu intellectuel où l’on discute tout, sans exception, où rien n’est accepté sur l’autorité de qui que ce soit, où tout est soumis à une critique joyeuse, irrespectueuse et implacable. Le jeune Anglais est d’abord éberlué et choqué : ces Français ne respectent donc rien ? À quoi sert donc l’autorité des maîtres ? Lui-même, on le raille de sa naïveté, on ne laisse debout rien de ce qu’il avait admis comme devant lui servir de fondement… Mais, après cette épreuve, dont il sort intellectuellement assoupli, comme les muscles s’assouplissent d’un pénible exercice de gymnastique, Steed déclare que cette formation dépasse en efficacité tout ce qu’il a vu ailleurs : c’est là, dit-il, et nulle part ailleurs, qu’il a appris à connaître la vraie civilisation de l’esprit, la culture véritable.
Je ne sais pas de plus bel éloge, car le fond de tout cela, c’est l’honnêteté intellectuelle. Seignobos, quand il jugeait les gens, finissait par les classer en deux groupes extrêmes. Des uns il disait : « C’est un homme profondément honnête », et il accentuait ces deux qualificatifs avec une conviction qui soulignait son respect de l’honnêteté. Des autres il disait : « C’est une fripouille », ou bien de compte une base morale. C’est beaucoup plus rarement qu’il disait de quelqu’un : « C’est un imbécile », ou bien : « C’est un homme intelligent ». Peut-être faut-il voir là l’effet de son hérédité protestante, car on sait que les protestants du Midi restent protestants de tempérament, même si, depuis longtemps, ils ont perdu la foi : la formation est si forte qu’on a l’impression d’être en présence d’une race à part, ayant accumulé en elle-même des siècles de résistance, d’individualisme, de libre examen. De ce point de vue Seignobos était protestant, et l’admettait. C’est sans doute aussi pourquoi il n’aimait pas les vrais gens du Midi, les gens du bas-pays, dont la vie est trop facile et qui n’ont plus le sens du rapport qui doit exister entre le résultat obtenu et le travail fourni. D’après lui, la France, la vraie France, s’est constituée dans le Nord. Il ne considérait pas non plus la Renaissance, avec son influence italienne, comme ayant représenté un progrès par rapport à notre moyen âge. Cet homme qui jamais ne parlait de morale admettait qu’en fin de compte les règles morales sont une condition nécessaire du bon fonctionnement de l’intelligence.
Le Midi, par sa proximité même, avait cependant laissé à cet [198] Ardéchois un virus politique. Pour les Méridionaux, les idées de richesse et de conservation sociale ne sont pas nécessairement associées ; ils ne croient pas non plus que l’ordre soit vraiment une condition essentielle de la vie des sociétés : on peut s’enrichir dans le désordre, prospérer dans la pagaïe ! Seignobos, quant à lui, semblait ne pas attacher de véritable importance à la notion de l’ordre ; sans le moindre effort, il s’accommodait d’une sorte de frange de désordre, estimant que ce n’était pas grave, qu’il ne fallait pas s’en formaliser. Il était cependant capable de beaucoup de finesse et de pénétration dans l’analyse des problèmes économiques, mais jamais on n’avait l’impression qu’en ce qui le concernait ces problèmes relevassent de la réalité. Causant un jour avec lui de je ne sais quelles prochaines élections, j’exprimais la crainte qu’une victoire de la gauche ne fût fatale à nos finances. « Évidemment », s’exclama-t-il, comme si la chose allait de soi, mais elle ne paraissait nullement l’inquiéter. Manifestement, l’essentiel, pour lui, était ailleurs. Comme les Méridionaux, il attachait plus d’importance à la politique des personnes qu’à celle des choses, et au politique qu’à l’économique. C’est une tradition que nous a léguée le xixe siècle, et, conformément à cette tradition, Seignobos était individualiste, politique et radical. Ni l’économique, ni le social ne pouvaient le détourner de cette triple préoccupation, qui répondait à son tempérament plus encore qu’à sa doctrine. « La France est radicale pour cent cinquante ans », aimait-il à dire. Jugement profond, si l’on observe que les partis qui remplacent de plus en plus le vieux radicalisme français tendent eux-mêmes à se radicaliser, revenant subrepticement, soit à la défense de l’individu, soit à l’affirmation de la petite propriété, soit à la revendication de la liberté de chacun à la manière de Paul-Louis Courier. À cet égard, Seignobos était lui-même le parfait radical, plaçant toujours l’aspect politique en vedette, accordant aux partis, à leur organisation, à leurs rivalités, une importance que notre siècle ne leur reconnaît plus guère. * C’est de ce point de vue peut-être que son œuvre historique, par ailleurs si solide, a partiellement vieilli. Nous considérons plutôt le parti comme un phénomène superficiel et nous sommes disposés à porter davantage notre effort de connaissance sur le soubassement social. Il était parfaitement capable d’en faire autant, comme il l’a prouvé par ses magnifiques études d’histoire de la civilisation, mais son intérêt spontané allait d’abord à la politique. À cet égard, sa [199] position fait un peu penser à celle de Clemenceau, qui jamais, dans sa longue vie publique, n’a accordé la première place ni même une place quelconque aux questions économiques et financières et qui, démocrate convaincu, n’était en rien un homme du peuple mais se serait plutôt classé parmi les aristocrates de l’esprit. L’un et l’autre étaient des hommes du xixe siècle.
Seignobos, qui est mort à quatre-vingt-sept ans, était entré très jeune dans l’enseignement supérieur. Après deux années d’études en Allemagne – le seul séjour de quelque importance qu’il ait, je crois, fait à l’étranger –, il avait enseigné, dès les temps lointains du boulangisme, d’abord à Dijon, puis très vite à la Sorbonne, où il a fait des cours pendant plus d’un demi-siècle. Il n’y a jamais eu pour lui de limite d’âge et c’est presque jusqu’à sa mort qu’il a continué d’enseigner (il s’agissait, à la fin, de cours libres, mais c’étaient toujours des cours, et cette magnifique activité ne se relâchait pas). La nature lui avait refusé l’éloquence : les mots se pressaient dans sa bouche, comme s’ils s’étaient bousculés dans leur hâte de sortir tous à la fois, et ils se précipitaient avec une nuance de bégaiement. « Je suis bafouilleur », disait-il avec simplicité. Son enseignement ne devait donc rien aux sortilèges de la parole, mais sa richesse en était accrue, car il n’avait d’autre souci que de dire ce qu’il avait à dire, sans la moindre préoccupation d’élégance ou de décorum. Dès l’instant que l’auditoire admettait cette atmosphère particulière, l’avantage était certain : le professeur prenait tout le temps qu’il fallait, revenait sur ce qu’il avait dit s’il sentait qu’on le comprenait mal, ne se gênait pas pour répéter ou insister. Le nouveau venu, sans doute, risquait d’être déconcerté, mais de temps à autre quelque éclair jaillissait qui illuminait la salle, et tout d’un coup l’on avait l’impression de voir clair, comme dans les voyages aériens lorsqu’un trou se dessine à travers les nuages. C’était admirable et on lui en avait une immense reconnaissance. René Benjamin, dans une de ces évocations fulgurantes dont il a le don, a décrit un cours de Seignobos, un peu à la façon dont Jules Lemaître, dans un article célèbre, nous avait conduits à un cours de Renan. D’après Lemaître, qui certainement n’inventait pas, l’auteur de la Vie de Jésus s’exprimait familièrement, avec une adorable absence de prétention : « Moi, j’sais pas… L’apparition du Pentateuque, ç’a pas été un événement du tout ». … Benjamin nous décrit Seignobos luttant contre les remous de langage comme un bateau peinant à travers les vagues [200] d’une forte mer : « Messieurs, pfïuitt pfïuitt, partis politiques, pasteurs protestants, pffuitt…, » A-t-il voulu le ridiculiser ? Je dois dire qu’il n’y a pas réussi et que cette pseudo-sténographie, quand je l’aie lue, m’a paru merveilleusement évocatrice de vie, de richesse intellectuelle, de formules éclatantes comme des jets de magnésium. J’exprimais un jour cette impression à l’auteur de la France de la Sorbonne, mais il m’a répondu : « Êtes-vous sûr que je n’aie pas voulu le faire admirer ? » Il y avait donc, dans cette parole embarrassée, encombrée et trépidante, une sorte de puissance oratoire particulière, infiniment supérieure au sirop mondain de certaines conférences d’il y a un demi-siècle.
Par contre, quand Seignobos prenait la plume, il apparaissait tout différent. Autant sa parole était heurtée, les phrases chevau chant les unes sur les autres, laissant une impression, du reste purement superficielle, de désordre, autant son style était net, précis, concis, définitif. Il écrivait avec un soin extrême, pesant chaque expression, ne laissant rien à la fantaisie de l’inspiration ; s’il introduisait un trait d’esprit, sous forme de quelque observation humoristique, c’était à dessein, pour éclairer d’un exemple frappant ses explications. Comme professeur, il était extrêmement sévère pour le style, pourchassant implacablement les néologismes inutiles, les adjectifs mal employés et même les expressions familières, qu’il jugeait déplacées dans une étude sérieuse. L’écriture artiste, l’abondance journalistique lui faisaient horreur. Je me demande s’il ne poussait pas ce purisme à l’excès : certaines de ses pages, nettoyées de toute impureté jusqu’aux limites mêmes de l’antisepsie intellectuelle, sont éventuellement difficiles à lire, parce qu’aucun mot n’étant inutile il n’en faut manquer aucun : on a l’impression de suivre la démonstration d’un théorème de géométrie. Un esprit bien formé, en pleine possession de sa maturité, ne manque pas de saisir la beauté de cette façon d’écrire, mais elle est fatigante et éprouvante pour la jeunesse. C’est le contraire de la facilité. Il y a là une vertu éducative dont j’ai éprouvé l’efficacité. Peu d’années avant sa mort, je l’avais prié, à titre d’amusement, de corriger, comme le ferait un professeur de rhétorique, quelques lignes d’un manuscrit que je destinais à la publication : pas un mot n’échappa à sa critique ; trois fois je repris mon texte et toujours il y trouvait à redire ; jamais il ne se déclara satisfait et l’épreuve se termina plutôt par lassitude que par la conclusion souhaitée de son approbation. Mais quelle magnifique leçon !
[201]
Ce n’est du reste pas dans sa chaire que son influence s’exerçait le plus efficacement, mais dans la conversation. Ses élèves allaient le voir chez lui : enveloppé dans une robe de chambre rouge, en forme de toge, il causait volontiers, sans effort, donnant l’impression de le faire avec plaisir. De ses propos, en apparence heurtés, jaillissaient des éclats qui révélaient dans les questions des aspects inédits ; de tous côtés, sans faire attention, sans compter, il jetait des semences… En ce qui me concerne, pendant près d’un demi-siècle, j’ai bénéficié de ces conversations. C’est d’abord comme étudiant que j’allais le voir pour lui demander des conseils de travail. Plus tard, je conservai l’habitude de lui rendre visite comme ami ; je laissais rarement passer un mois sans aller causer quelque soir avec lui. Deux ans avant sa mort, je passais quelques semaines à l’Arcouest, sa résidence d’été : tous les jours, dans son jardin, et tandis qu’il jardinait, nous échangions des propos pendant une heure ou deux… Je conserve un précieux souvenir de ces conversations, que j’ai du reste soigneusement notées, au cours desquelles il abordait tous les problèmes, à bâtons rompus, projetant de toutes parts des clartés. Dans ces entretiens intimes on ne souffrait plus ni de ce que sa parole en public avait d’un peu hésitant, ni de ce que son style avait de trop serré : c’était, dans sa forme parfaite, la conversation de l’homme le plus cultivé, le plus intelligent, le plus ouvert qui fût. Le véritable privilège de ses élèves est d’avoir pu en profiter. Je crois que ceux qui n’ont pas causé avec lui ne l’ont pas vraiment connu.
Il aimait du reste cette vie de relations, qui n’était qu’un simple prolongement de son activité professorale. Les snobs, en société, affectent de ne jamais parler de leur activité professionnelle : talk shop est, d’après eux, une chose qui ne se fait pas. Quand on aime son métier, quand on n’en est pas excédé, pourquoi ne pas parler, le soir, avec ses amis, du travail de sa journée ? L’homme intelligent n’est pas fatigué de ce qu’il fait. Jusqu’à la guerre de 1914, Seignobos recevait ses intimes, ainsi que ses meilleurs élèves, tous les mercredis soir : il avait à dîner quelques personnes, après quoi l’on venait passer la soirée sans avoir à être invité (ce fut ensuite, de façon plus réduite depuis 1918, le vendredi soir). Je n’ai jamais vu de réunions plus vivantes : les discussions étaient passionnées, les arguments s’entrecroisaient ; on parlait histoire naturellement, mais aussi politique, littérature, voyages ; les thèses soutenues ne trouvaient jamais grâce devant tous, les [202] opinions de chacun étaient passées au crible d’une critique impitoyable. Il allait, lui, de groupe en groupe, intervenant d’un mot, lançant quelque « C’est absurde » … après quoi il pirouettait sur lui-même, le pan de sa redingote (car on était encore presque au xixe siècle) balayant l’air et, sans qu’on sût comment, il reparaissait à l’autre bout du salon. Sa présence, à la façon de quelque sorcellerie, animait toute la réunion : il était toute la réunion ; sans lui elle n’eût plus été qu’une société brillante sans doute, mais comme il y en a d’autres. Grâce à lui l’atmosphère était unique.
On le voyait régulièrement chez un petit nombre d’amis, chez Pierre Mille notamment le samedi après-midi, mais autrement il sortait peu, soucieux de se ménager. Car c’était un sage, qui connaissait les limites des forces humaines et qui savait que, pour être durable et efficace, l’effort intellectuel ne doit pas se dépenser légèrement. Il prenait chaque année trois mois de vacances, l’Arcouest, en Bretagne, où il s’était construit une maison de campagne, dominant une magnifique étendue de mer et de côtes : il y menait l’existence du sage, cultivant son jardin, se promenant dans les chemins creux, prenant des bains de mer, naviguant sur son petit bateau à voile, bien connu de tous ses amis, L’Églanline : on l’avait surnommé « le capitaine », mais seuls avaient le droit de l’appeler ainsi ceux qui avaient navigué sous ses ordres (un honneur que je n’eus jamais). A Paris, tous les samedis matin, quelque temps qu’il fît, il faisait à pied le tour du bois de Vincennes : c’était son jour de repos, qu’il respectait scrupuleusement, car il connaissait les dangers du surmenage. La méthode lui a réussi, car il a pu travailler jusqu’à la fin, sans donner aucun signe de vieillissement ni de fatigue. Sa curiosité – c’est un signe certain de la jeunesse de l’esprit – était demeurée intacte ; il continuait à s’intéresser à tout, avec je ne sais quoi de spontané et de neuf qui émerveillait chez un homme proche de la quatre-vingt-dixième année. L’année d’avant sa mort, il avait repris ses études antérieures sur la méthode historique ; il se passionnait d’autre part pour l’analyse des termes employés par les économistes. On avait l’impression d’une étonnante lucidité. C’était la récompense d’une vie consacrée tout entière à l’étude, à elle seule, sans recherche d’ambition ni d’honneurs. On peut dire qu’il n’a vécu que pour sa mission de professeur et d’historien.
Dans une époque où la propagande déchaînée obscurcit systématiquement [203] les questions, où un pragmatisme obstiné qualifie de vérité pour le partisan tout ce qui le sert, le souvenir de cette probité intellectuelle est rafraîchissant. Seignobos a exprimé l’un des traits les plus authentiques de l’esprit français.
André Siegfried,
Membre de l’Institut.
* Nous soulignons. Michel Bergès pour Les Classiques des sciences sociales.
|

