|
Staline.
Aperçu historique du bolchévisme.
Arrière-propos
_______
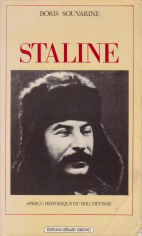 Ce livre se terminait en 1940 sur la réminiscence abrégée d’une sentence attribuée à Abraham Lincoln et qu’il faut restituer entièrement pour la contredire, à la lumière de l’expérience : « On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. » Ce livre se terminait en 1940 sur la réminiscence abrégée d’une sentence attribuée à Abraham Lincoln et qu’il faut restituer entièrement pour la contredire, à la lumière de l’expérience : « On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. »
L’histoire prouve que c’est une erreur. Staline a trompé tout le monde et tout le temps, sauf qu’il n’a pu tromper Hitler, son émule, en concluant avec lui le fameux pacte du 23 août 1939, suivi bientôt d’un « pacte d’amitié et de délimitation des frontières », publié le 28 septembre suivant et assorti de protocoles secrets. Le mot « amitié » y est en toutes lettres.
D’ailleurs le 25 décembre 1939, à la suite des victoires allemandes contre les « frères slaves » de Tchécoslovaquie et de Pologne, une amitié très explicite s’exprimait dans un télégramme de Staline à von Ribbentrop en ces termes : « L’amitié des peuples d’Allemagne et de l’Union soviétique, cimentée par le sang, a toutes raisons d’être durable et solide. » Le 22 juin 1941, le ciment de cette amitié volait en éclats et le sang des peuples allait couler à flots, car Hitler déchaînait sa Wehrmacht et sa Luftwaffe contre l’Empire dit soviétique.
Staline a trompé tout le monde, excepté Hitler pour un bref laps de temps. Il a trompé aisément Churchill, puis Roosevelt, puis de Gaulle ; et leurs gouvernements, et leurs conseillers, et leurs diplomates, et leurs moyens d’information, et la presse à leur dévotion. Il a trompé sans effort l’opinion publique dans les pays civilisés sans rencontrer d’obstacles avec lesquels il dût compter, les grands syndicats ouvriers américains étant la seule exception notable dans l’aberration universelle.
Quand von Schulenburg, ambassadeur d’Allemagne à Moscou, notifia la déclaration de guerre à Molotov, celui-ci ne put que balbutier : « Croyez-vous que nous ayons mérité cela ? En effet Staline avait fait de son mieux pour favoriser la sinistre entreprise dévastatrice d’Hitler, non seulement en paroles mais en actes. De longue date, plus précisément depuis 1933, il manœuvrait en vue d’un accord avec le « national-socialisme » allemand. Entre autres mobiles, son épuration sanglante des principaux cadres du Parti et de l’État, de l’Armée rouge et de la diplomatie soviétique, l’extermination de la « vieille garde » du bolchévisme, toutes ces mesures implacables tendaient à supprimer d’éventuels obstacles au progrès de cette politique.
Le 10 mars 1939, au dix-huitième Congrès du Parti, Staline prononçait un discours significatif dans le sens d’un rapprochement avec l’Allemagne. Peu après, au début de mai, la substitution de Molotov à Litvinov aux Affaires étrangères ne permettait qu’une interprétation possible. Lors de la conclusion du pacte d’août, Staline et Ribbentrop se congratulent à propos du récent discours de mars « bien interprété par Hitler », et Molotov porte un toast à Staline dont le discours avait amené « le retournement des relations politiques » entre les deux pays. À son tour, Staline lève son verre en disant : « Je sais combien le peuple allemand aime son Führer ; je peux donc boire à sa santé. »
Le 29 novembre 1939, Staline ose déclarer : « Ce n’est pas l’Allemagne qui a attaqué la France et l’Angleterre, mais la France et l’Angleterre qui ont attaqué l’Allemagne. » Le 25 septembre, il télégraphie à Ribbentrop sa formule cynique citée plus haut sur « l’amitié des peuples d’Allemagne et de l’Union soviétique, cimentée par le sang ». La Pravda du 26 janvier 1940 accuse : « Les impérialistes anglo-français veulent transformer cette guerre en guerre mondiale. Ils veulent plonger toute l’humanité dans un océan de souffrances et de privations. Etc. » Le 29 mars 1940, devant le Soviet suprême, Molotov justifie une fois de plus l’Allemagne nazie et dénonce la France et l’Angleterre.
Quand Hitler commet son agression contre la Norvège, Molotov dit à l’ambassadeur Schulenburg, le 9 avril 1940 : « Nous souhaitons à l’Allemagne succès complet dans ses mesures défensives (sic). » Les Isvestia du 11 avril suivant approuvent les nazis : « Il est hors de doute que les actions allemandes au Danemark et en Norvège ont été suscitées par les initiatives antérieures de l’Angleterre et de la France. »
Von Schulenburg, le 10 mai 1940 ; informe Ribbentrop de l’approbation de Molotov qui « comprenait que l’Allemagne devait se protéger d’une attaque anglo-française et ne doutait nullement de notre succès », lors de l’offensive allemande à l’Ouest. Après la défaite de la France, le 18 juin 1940 Molotov convoque l’ambassadeur allemand pour lui exprimer « les plus chaudes félicitations du gouvernement soviétique pour les succès splendides des forces armées allemandes » *.
Dans leur contribution à l’« effort de guerre » allemand, Staline et ses acolytes ne se bornent pas à des paroles. Il y a aussi les mesures pratiques. Les principales consistent en fournitures de matières premières qui font défaut à l’industrie du IIIe Reich pour une campagne militaire prolongée visant à asservir l’Europe entière. L’Union soviétique s’acquitte ainsi des livraisons convenues selon les pactes signés en août et septembre 1939. D’autre part, Staline ordonne aux sections de l’Internationale communiste d’agir à l’appui de la propagande et des manœuvres ou intrigues allemandes de toutes sortes qui contribuent à briser l’esprit de résistance dans les pays conquis ou à conquérir. En particulier, le parti communiste en France se distingue par son zèle odieux à coopérer avec l’envahisseur. Il ne fera volte-face qu’en juin 1941, sur l’ordre de Moscou, quand Hitler aura traîtreusement attaqué Staline, son complice.
On ne saurait prétendre écrire, même en résumé, l’histoire de la « grande guerre patriotique », comme l’ont qualifiée Staline et ses serviteurs pour les besoins de leur propagande chauvine, reniant toute l’idéologie socialiste, toute référence au communisme, abandonnant toute allusion à leur « marxisme-léninisme », invoquant les vieilles gloires de la Russie impériales et impérialiste, magnifiant l’exemple de Souvorov et de Koutouzov, manifestant enfin une touchante sollicitude envers l’Église orthodoxe hier cruellement persécutée, sans oublier d’exalter la solidarité des peuples slaves contre la race germanique. D’ailleurs personne ne pourrait écrire l’histoire véridique de cette guerre, tant que les épigones de Staline, les tenants du « marxisme-léninisme », en tiendront les secrets essentiels sous le boisseau. On ne peut faire état que de certaines certitudes, inséparables du portrait de Staline.
À la faveur des premières conquêtes de la Wehrmacht, irrésistibles dans les conditions données, l’Armée rouge avait occupé une large portion de la Pologne, presque sans coup férir. Ensuite elle put s’emparer des États baltes, puis de la Bessarabie et de la Bukovine, avant d’attaquer la Finlande dont elle ne put venir à bout et qui ne traita que sous la pression allemande. On en sut que longtemps après les crimes atroces commis par Staline dans les régions nouvellement occupées par ses troupes, les déportations en masse de Polonais et Baltes vers la Sibérie qui firent périr des millions d’innocents, hommes, femmes et enfants. Mais quand se déclencha l’agression perfide de Hitler contre son allié de la veille, on eut peine à croire les communiqués allemands de victoire, auxquels ne répondaient que des informations mensongères d’origine soviétique. Il fallut des années pour reconstituer la vérité, par fragments, voire par bribes.
Staline avait misé à fond sur Hitler. Il croyait leur alliance établie sur des intérêts communs durables. Son calcul à long terme était d’intervenir de toutes ses forces intactes après épuisement des pays belligérants et d’imposer ainsi sa prépondérance à bon compte. Cela se lit dans toute sa conduite et, d’ailleurs, il avait formulé ses vues dès 1925 en termes très explicites : « … Si la guerre commence, nous n’allons pas nous croiser les bras, nous aurons à intervenir, mais à intervenir les derniers. Et nous interviendrons pour jeter le poids décisif dans la balance, le poids qui pourra l’emporter » (discours au Comité central, 19 janvier 1925). C’est assez clair, sauf pour les politiciens occidentaux qui se complaisent dans l’ignorance et dans un optimisme irraisonné, pour aller ensuite de surprises en surprises coûteuses.
L’effondrement de la défense française en 1940 déjoua le calcul de Staline quant à l’usure réciproque des principaux antagonistes à cette date *. Mais l’Angleterre tenait bon et bien des signes promettaient l’implication future des États-Unis dans le conflit en passe de devenir mondial. Staline ayant procuré à Hitler l’avantage majeur de n’avoir pas à craindre un deuxième front n’imaginait pas que son partenaire prendrait un tel risque. Et malgré les renseignements et avertissements qu’il recevait de toutes parts et de toutes sources en 1940 et 1941, il ne voulut pas démordre de sa conviction quant à la fidélité de Hitler, à l’« amitié… cimentée par la sang ». Jusqu’au bout, il fit confiance au forcené qui, dans Mein Kampf, avait préconisé de « suivre les voies tracées par les anciens chevaliers teutoniques », afin d’aboutir à la fin de la Russie en tant qu’État » pour l’asservir et la transformer en colonie de l’Allemagne.
Hitler a pu masser quelque 180 divisions sur le pied de guerre à ses frontières de l’est, avec tout ce que cela comporte de blindés, d’aviation et de matériel, sans éveiller le soupçon dans l’esprit pourtant très méfiant de Staline. Les informations les plus sûres et précises affluaient chez le « chef génial » qui ne voulait rien savoir. À force de proclamer lui-même son propre génie, tout en massacrant sans merci des millions d’êtres humains qu’il supposait capables d’en douter, il avait fini par se croire omniscient et infaillible. Dans le jargon spécifique de son « marxisme-léninisme », c’est-à-dire du stalinisme à proprement parler, le mot « provocation » lui tenait lieu de réfutation à tout ce qui risquait de le contredire. Or les préparatifs du « plan Barbarossa », nom de code désignant l’agression prochaine, étaient la fable de l’Europe, sillonnée de trains chargés de militaires et de matériel de guerre en route vers l’est. Tous les services de renseignements, collectionnaient nombre de signes, échangeaient confidences et secrets de polichinelle. Les indiscrétions transmises des plus « hautes sphères » se multipliaient, répercutées vers le Kremlin par tous ceux qui avaient intérêt à contrecarrer les projets monstrueux du nazisme. Staline ne voulait rien savoir.
On dispose après coup d’une riche documentation irréfutable relative aux mises en garde adressées à Staline, tant de l’extérieur que de l’intérieur. Churchill fit de son mieux pour donner l’alarme. Il avait cru bien agir en nommant ambassadeur à Moscou un socialiste, un travailliste, Sir Stafford Cripps, le croyant bienvenu a priori comme tel auprès d’un gouvernement communiste. Erreur énorme qui dénote l’ignorance de Churchill en cette matière : Staline n’exécrait rien tant qu’un socialiste, auquel il prêtait gratis les plus noirs desseins. Si le Premier anglais avait eu quelque idée de la mentalité pathologique du Secrétaire général, il aurait envoyé à Moscou un conservateur d’extrême-droite, seule petite chance d’approcher Staline. Celui-ci refusa de prendre en considération le message personnel de Churchill qui, de bonnes sources, l’informait du rassemblement de 4 millions d’ennemis, en réalité davantage, à proximité de ses frontières. « Provocation », disait Staline, qui ne se reconnaissait d’affinités qu’avec les nazis. Réciproquement, Hitler sympathisait fort avec les staliniens ; il se flattait, entre autres, selon Hermann Rauschning, d’avoir « donné des ordres pour que les anciens communistes puissent immédiatement entrer au parti. Des petits-bourgeois sociaux-démocrates et des bonzes des syndicats, disait-il, on ne fera jamais des nationaux-socialistes, mais des communistes, toujours » (Gespräche mit Hitler, Zürich, 1940).
Roosevelt aussi, muni d’excellentes informations sur la prochaine offensive allemande, essaya d’en faire profiter Staline. Ni l’ambassadeur soviétique à Londres, ni les attachés militaires soviétiques à Berlin ne purent se faire entendre. L’un des meilleurs agents secrets de l’espionnage soviétique, Richard Sorge, exceptionnellement bien placé au Japon, transmit à Moscou des informations très exactes sur le « plan Barbarossa », mais en vain. Un réseau de renseignements installé en Suisse obtenait par l’intermédiaire d’un agent remarquable, Rudolf Roessler (alias Lucie), secondé par le géographe hongrois Alexandre Radò (alias Dora) et le communiste anglais Alexander Floote, des secrets militaires d’une précision stupéfiante, y compris sur l’imminence de l’agression nazie. « Provocation », commentait Staline *.
C’est seulement en 1974 qu’a paru à Londres le livre de F. W. Winterbotham, The Ultra Secret, qui révèle une des raisons capitales des défaites allemandes après les victoires initiales des Blitzkrieg, de la première phase. L’auteur, chef de la section aérienne de l’Intelligence Service, préfacé par le maréchal de la Royal Air Force Sir John Slessor, expose les conditions dans lesquelles une brillante équipe de mathématiciens et de cryptographes réussit à « briser » le secret réputé indéchiffrable des machines à chiffrer allemandes, dénommées Enigma, à partir d’avril 1940. Cette extraordinaire performance technique permettait d’intercepter et de décoder des milliers de messages, d’instructions et de communications ayant trait aux plans et intentions de l’ennemi, aux mouvements des troupes et du matériel, à la stratégie et à la tactique, aux ordres et contre-ordres dans tous les détails.
Sans ces informations constantes et inacceptables, transmises aussitôt à tous les dirigeants et chefs militaires responsables, il eût été impossible d’empêcher l’invasion de l’Angleterre et de vaincre Rommel en Afrique du Nord, avec toutes les conséquences qui en découlent. Elles ont permis à Churchill d’avertir à temps à temps Staline, qui ne voulait rien savoir. Mr Winterbotham ne dit pas que toutes ces données secrètes étaient passées également à Rudolf Roessler, lequel opérait aussi pour le compte de la Suisse, mais on ne trouve pas d’autre hypothèse plausible expliquant les capacités, uniques en leur genre, du réseau de « Lucie ». D’ailleurs Moscou ne cessa de demander toujours plus de renseignements à ce réseau quand celui-ci fut pleinement justifié par l’« opération Barbarossa ». L’Armée rouge en tira des avantages incalculables, dont Staline finira s’attribuer les mérites.
Il y a plus. Dans son ouvrage : Codeword Barbarossa (Cambridge, Mass., M. I. T. Press, 1973) ; Mr Barton Whaley étudie les conditions et les raisons qui ont fait de l’attaque allemande contre l’Union soviétique, sur une aussi vaste échelle, de la mer Baltique à la mer Noire, une « surprise ». Toukhatchevski avait prévu cette attaque brusquée, mais on sait comment Staline a su réfuter la prévision du maréchal. Les premières conséquences de la « surprise » furent, pour l’Armée rouge, la perte de plus de 1 800 avions, dont 1 400 au sol, dès le premier jour de l’agression, de 2 053 000 prisonniers jusqu’au 1er novembre, de 3 600 000 prisonniers jusqu’au 28 février 1942, soit après huit mois de campagne. « La monstrueuse fatuité d’un dictateur byzantin et son système autoritaire peuvent seuls expliquer un tel aveuglement », écrit Mr Whaley.
Cet auteur très qualifié dresse une longue liste des personnages que Staline n’a pas voulu écouter, lesquels puisaient à une douzaine de sources excellentes. Il recense, provenant de quatorze pays d’où partaient les messages interceptés et décodés, quatre-vingt-quatre révélations annonçant la mise en œuvre du plan Barbarossa (même si l’on en défalque trois ou quatre faisant double emploi, il en reste tout de même quatre-vingts). Il consacre des chapitres à décrire l’impréparation de la défense soviétique, dont Staline était responsable, corroborant les observations de John Erikson, l’écrivain militaire britannique dont nul ne conteste le savoir. Des pages et des pages seraient nécessaires pour seulement résumer les épisodes et les indices rassemblées par Mr Wahley afin de montrer l’incurie et l’incapacité de Staline, avant de commenter : « Je ne sais pas d’événement historique d’ampleur comparable jugé avec une telle unanimité par les autorités compétentes. » Cependant les trompettes de la renommée continuaient à proclamer le génie universel du chef suprême avec les moyens énormes d’une propagande sans précédent, dans son pays et dans le monde.
On est resté longtemps dans l’incertitude quant aux péripéties de la guerre à l’Est. Il était difficile d’ajouter foi aux bulletins triomphants de Berlin, annonciateurs de tels désastres soviétiques, comme de croire aux communiqués trop visiblement mensongers de Moscou. Il fallu se rendre à l’évidence devant certaines précisions géographiques et bientôt la certitude que les soldats de l’Armée rouge se rendaient à l’ennemi par millions (plus tard on apprendra que la Wehrmacht avait fait près de 6 millions de prisonniers au cours d’une année). « Il semblait que la Russie était près de partager le sort de la France. Mais ses grandes réserves et l’immensité des distances lui donnèrent le temps refusé à la France », a écrit F. A. Voigt dans le Nineteenth Century and after (n° DCCC). Le mot de Jaurès : « La Russie se défend par la profondeur », se vérifia une fois de plus ; et elle se défendait aussi par l’état primitif de son immensité et de ses routes campagnardes, les Panzerdivisionen s’enlisant dans la boue russe. Les talents démentiels de Hitler vinrent au secours de Staline et plusieurs divisions venues du froid sibérien tinrent les Allemands en échec devant Moscou à la veille de l’hiver. À quel prix en vies humaines, on ne le saura que beaucoup plus tard.
Des vérités sur la guerre germano-soviétique, stupéfiantes pour le public abusé par des politiciens indignes, par la presse ignorante et vulgaire, par les propagandes tendancieuses, ces vérités ont commencé à se révéler en Amérique avec la publication (dans Life du 19 décembre 1949) d’un article de Mr Wallace Carroll, chef de l’Office of War information américain en Europe. On y lit : « Il y a un chapitre non écrit dans l’histoire de la dernière guerre et dont il faut s’instruire sans délai. Nous savons comment les Russes ont arrêté les Allemands à Stalingrad. Mais comment les Allemands ont-ils pu arriver jusqu’à Stalingrad ? Comment ont-ils avancé de plus de 1 600 kilomètres malgré la puissance de la Russie et sa supériorité en nombre ? »
Car du fait de Staline, la Wehrmacht n’avait pas seulement pénétré en Russie sur plus de 1 600 kilomètres en profondeur, elle atteignait les approches du Caucase. Aux questions qu’il vient de poser, écrit Mr Carroll, « les archives militaires allemandes donnent la réponse : les Allemands avaient des millions de complices empressés en Russie ». Un petit nombre d’Américains avertis savaient « à quoi s’en tenir quant à la version officielle qui solidarisait faussement le régime soviétique et les peuples de l’U.R.S.S. Mais pendant la guerre il était impossible de contredire la légende forgée par le gouvernement de Moscou et accréditée inconsidérément dans le monde par les gouvernements de Londres, de Washington, d’Alger et de Paris. Depuis la guerre, par habitude et par inertie, par lassitude et par ignorance, par besoin aussi de justification rétrospective, les guides de l’opinion publique ont respecté ou entretenu la falsification historique dont les communistes tirent encore leur meilleur avantage ». Autrement dit, tout le monde a menti.
En résumé, explique Mr Carroll, les Allemands ont échoué « pour n’avoir pas répondu aux espérances des minorités nationales et des paysans soumis contre leur gré à la collectivisation ». « Des redditions en masse de plus de 2 millions d’hommes eurent lieu alors que les forces soviétiques combattaient sur leur propre sol » contre l’agresseur. « …Les Allemands furent stupéfaits de voir le peuple les accueillir en libérateurs et leur offrir sa collaboration. Dans les Pays baltes et en Ukraine, et même en Russie-Blanche, les paysans saluaient les colonnes gris-vert avec l’offre traditionnelle du pain et du sel. »
Les paysans, poursuit Mr Carroll, pensaient que les Allemands allaient abolir la collectivisation, « système sous lequel, disaient-ils, on ne peut ni vivre, ni mourir ». En Ukraine, le sentiment national s’ajoutait à la haine envers le régime. Il se forma « spontanément des unités de volontaires soviétiques ». En dépit d’une intense propagande anti-allemande d’une dizaine d’années, « les soldats russes, les paysans et les citadins, en particulier ceux des minorités nationales, accueillaient les Allemands en libérateurs. Cependant Hitler, trop sûr de soi et croyant vaincre par des moyens purement militaires, allait gâcher toutes ses chances ».
Cet énergumène en délire voulait faire de la Russie « les Indes germaniques ». Il refusa l’aide des allogènes. Les prisonniers soviétiques parqués en Pologne subissaient un traitement abominable. On le sut en Ukraine comme en Russie, il s’ensuivit un revirement dans l’opinion publique, hommes et femmes prirent le maquis en grand nombre et Hitler suscita contre lui une guerre de partisans. Plusieurs de ses généraux et conseillers tentèrent en vain de lui faire entendre raison. En 1942, il y avait pourtant quelque 200 000 volontaires soviétiques dans l’armée du Reich. « Bientôt certaines divisions comptaient autant de Russes que d’Allemands. Au milieu de l’été, l’armée allemande qui avançait sur Stalingrad avait un demi-million de Soviétiques dans ses rangs. »
Personne en Occident ne savait ces choses, tenues secrètes dans les articles du pays vaincu, et dont la révélation tardive parut inactuelle au public berné par les propagandes mensongères, rétif aux vérités qui troublent les consciences. Dans nombre de pays, comme la France, tout fut mis en œuvre pour maintenir le peuple dans l’ignorance, accréditer les pires tromperies. Notamment à propos du général André Vlassov, « héros de la défense de Moscou », comme on l’appelait dans son pays, décoré par Staline en personne, fait prisonnier en 1942, et qui, désespéré par l’impéritie du commandement soviétique ; par le sacrifice insensé de milliers d’hommes, tenta de créer en Allemagne une « Armée russe de libération » pour lutter non pas contre sa patrie, mais contre le régime de Staline, honni des populations soumises à une sorte d’esclavage.
« C’est à tort, d’ailleurs, que l’on confond cette formation distincte (l’armée de Vlassov) avec les détachements de prisonniers et corps d’allogènes auxiliaires de l’armée allemande », écrit Mr Carroll qui cite un mémorandum allemand selon lequel Vlassov « ne sera jamais un mercenaire achetable, ne voudra jamais commander à des mercenaires ». Vlassov voulait instaurer en Russie « un gouvernement démocratique et parlementaire. Il était prêt à s’entendre avec les Allemands pour atteindre ce but : Staline ne s’était-il pas entendu naguère avec Hitler ? … Il leur fit des concessions verbales … sachant que l’avenir n’est à personne ». Vlassov formula un programme démocratique dit Manifeste de Smolensk, en mars 1943, qui déplut à Hitler. Celui-ci fit mettre Vlassov aux arrêts domicile. À cette date, « le nombre de soldats russes dans l’armée allemande s’éleva à 800 000 ». En 1945, Vlassov ne disposait que d’une seule division armée, en Tchécoslovaquie. Elle se rallia aux Américains et les aida à libérer Prague. (Il n’y a jamais eu un soldat de Vlassov en France ; à ce sujet, tout n’est que calomnie et légende.) La nécessité de ne présenter ici que le résumé oblige de renvoyer le lecteur au texte principal *.
William Henry Chamberlain, un des observateurs les plus compétents de la scène soviétique, auteur d’ouvrages historiques qui font autorité, a de son côté publié dans le New Leader socialiste de New York, numéro du 28 janvier 1950, un témoignage qui corrobore le précédent, celui d’officiers allemands hostiles à Hitler : « Avec tous les handicaps créés par la brutale et insensée politique raciste nazie, nous avons levé plus d’un demi-million de soldats à notre profit parmi les prisonniers de guerre et les habitants des territoires occupés. Avec une politique intelligente, nous aurions gagné la guerre à l’Est simplement parce que les peuples de l’U.R.S.S. eux-mêmes auraient renversé le régime… Dans les premiers mois de la guerre, les redditions avaient lieu en masse, et elles étaient d’ordre politique, non militaire. J’aurais pu aller en patrouille comme officier de cavalerie et ramener des milliers de prisonniers volontaires… Une division de Turkmènes fut créée et a combattu sur le front italien. Nous avons levé 45 000 Cosaques… » Etc.
Ainsi, Hitler a sauvé Staline et son régime exécré des populations soumises à la pseudo-dictature du prolétariat. Par son obstination stupide à vouloir traiter les Russes en « sous-hommes », sa cruauté abjecte envers les prisonniers et les peuples sous le joug, sa prétention absurde à passer outre aux avis de ses généraux sérieux, il a constamment fait le jeu de son ex-partenaire pour lequel il nourrissait une considération comparable à celle dont faisaient preuve Roosevelt et Churchill. Il se croyait infaillible parce qu’il avait vu juste en spéculant sur la faiblesse de la France et en conquérant par surprise de petits États sans vrais moyens de défense. Mais dans l’espace russe infini, il a commis faute sur faute jusqu’à l’irréparable, permettant à l’instinct national de réagir et aux capacités populaires de s’affirmer avec une résolution efficace, puis de profiter du concours énorme venu d’Angleterre et d’Amérique.
Les écrivains militaires soviétiques, pour ne rien dire de la propagande communiste, passent sous silence l’aide britannique fournie à l’U.R.S.S. ou ne la signalent rarement, que d’une façon imperceptible. Un résumé de la London Gazette (18 octobre 1950) mentionne 5 000 tanks et 7 000 avions. La marine anglaise a perdu 2 669 officiers et marins dans ses périlleuses opérations d’escorte, plus 2 croiseurs, 6 destroyers, 3 sloops, 2 frégates, 3 dragueurs ; 62 bâtiments, 792 navires marchands coulés avec 300 000 tonnes de matériel. Sans parler des secours substantiels de la Croix-Rouge. En contre-partie, après la guerre, Staline et ses séides ont couvert l’Angleterre de calomnies et d’injures.
Le dossier de l’aide américaine est énorme. Quelques lignes de l’Observateur des Deux Mondes (1er octobre 1948) en donnant une idée insuffisante : « Au prix des plus grands risques et dangers (torpillages et bombardements), de durs sacrifices en vies humaines et sur des distances de plusieurs milliers de kilomètres, les U.S.A. ont livré à l’U.R.S.S. environ 2 000 locomotives, 375 000 camions, 52 000 jeeps, près de 4 millions de pneus, 35 000 motocycles, 415 000 appareils téléphoniques, 15 millions de paires de bottes, 4 millions de tonnes d’aliments, outre des machines-outils pour 500 millions de dollars et des matières premières pour 2 milliards et demi de dollars, sans compter les avions de chasse nocturne et l’essence à haute teneur d’octane que les Russes étaient incapables de produire… » Trop bref abrégé qui contraste avec les torrents d’accusations et d’outrages que Staline réservait à ses bienfaiteurs. Fait caractéristique : Staline fit effacer les marques d’origine sur le matériel américain, pour leur substituer des inscriptions en langue russe. (Cf. à l’appui de ce qui précède : « L’aide américaine à l’U.R.S.S. », dans Est et Ouest, nos 530 et 534, Paris, 1974).
Les limites de cet Arrière-propos ne permettent que d’évoquer en peu de mots certains aspects, certains traits de cette histoire contemporaine falsifiée par les versions mensongères répandues à grands frais pendant et après la guerre, alors qu’ils mériteraient chacun un chapitre. Le « cas Vlassov », notamment, n’a été qu’effleuré dans le récit de Mr Carroll. Il est pourtant de grande importance, par lui-même et par ses implications. La vérité à ce sujet est exprimée dans un remarquable exposé de Mr George Fischer qui fait justice de toutes les injustices, de toutes les assertions fausses, de tous les dénigrements, et qui offre toutes les références désirables. Rien n’excuse le geste des Américains responsables que le général Vlassov avait aidés à chasser les nazis de Prague et qui ont livré à Staline, c’est-à-dire au bourreau, le « héros de la défense de Moscou et de Léningrad », justiciable d’un tribunal impartial en Occident. Vingt ans après les travaux de Mr George Fischer, l’Archipel du Goulag d’Alexandre Soljénitsyne leur apportait une confirmation éloquente, démontrant que le général était une victime avant d’être un coupable *.
Dans ma présente esquisse adjointe à ce qui fut écrit à l’origine comme un « aperçu historique du bolchévisme », il ne saurait être question de suivre un ordre logique et chronologique, mais seulement d’éclairer quelques points principaux qui jalonnent la carrière du personnage, tout en suggérant quelques lectures complémentaires. On s’interroge naturellement sur l’attitude de Staline quand l’événement en juin 1941, lui a infligé un cinglant démenti et une humiliation ineffaçable. Le mensonge, pourtant, le pan-mensonge et l’omni-mensonge lui ont permis, avec les moyens de la technique moderne, de faire illusion et de sauver sa face. Il a pu mettre en œuvre à son avantage la formule que Hitler avait forgée pour l’attribuer à ses adversaires : « Plus le mensonge est gros, mieux il a chance de prendre » (elle est Mein Kampf). Mais il a fallu attendre quinze ans avant d’apprendre quelque vérité sur la réaction et le comportement de Staline lors du fiasco catastrophique de ses certitudes, le Blitzkrieg à l’Est, l’opération Barbarossa.
À l’occasion du vingtième Congrès du parti, en 1956, la coterie dirigeante, Præsidium ou Politbureau du Comité central, décida d’en finir avec le mythe néfaste de l’omniscience de Staline et avec les légendes ineptes qui lui faisaient cortège. Autrement dit de répudier le mensonge démesuré qui envoûtait le Parti et la société sous la terreur policière accablante instaurée à son profit par le tyran. Il s’agissait, dans cette entreprise risquée, de secouer la torpeur qui paralysait la vie intellectuelle, procéder par étapes révélatrices, ne pas administrer au Parti effaré des doses de vérités trop fortes, et surtout diminuer la stature de Staline tout en sauvegardant le dogme de l’infaillibilité du Parti, détenteur du sens de l’Histoire. La tâche fut confiée à Khrouchtchev, nouveau secrétaire du Parti, ex-complice actif de Staline dans ses hautes et basses œuvres terroristes, surtout en Ukraine, mais singulièrement oublieux de son propre passé récent, et capable de s’acquitter avec autant de verve que d’inconscience du devoir scabreux à lui imparti. Il ne s’attendait pas aux conséquences.
Plusieurs membres de la « direction collective » en avaient quelque pressentiment, ceux qui ont trempé le plus directement dans les agissements atroces de Staline, et qui craignaient d’avoir à en répondre, tout en redoutant non sans raison des troubles consécutifs à un relâchement de la discipline fondée sur l’omnipotence du maître d’hier et de sa police omniprésente. Ces coupables inquiets et prévoyants s’appelaient Molotov, Malenkov, Kaganovitch, Vorochilov, Boulganine, mais ils étaient en minorité et, selon la règle dans ce milieu, durent s’incliner pour se joindre, au congrès, à l’unanimité de rigueur.
Khrouchtchev prononça son rapport secret « sur le culte de la personnalité et ses conséquences » le 25 février 1956 devant une assemblée frappée de stupeur, provoquant une émotion, des exclamations, des remous, voire des syncopes et des crises nerfs. « Culte de la personnalité », expression péjorative emprunté à une lettre de Marx exhumée pour la circonstance, devint le nouveau mensonge passe-partout substitué aux mensonges précédents pour camoufler les crimes de Staline et de ses complices. Avant d’énoncer quelques vérités sur le pseudo-culte, Khrouchtchev devait rendre un hommage hypocrite et rituel aux vertus passées et dépassées du chef défunt, à son « marxisme », aux services rendus au Parti, tout cela visiblement pour la forme. Il en viendra enfin à parler de Staline pendant la guerre.
Il mentionne d’abord les avertissements prodigués par Churchill et ceux de « nos propres sources militaires et diplomatiques », dont Staline n’a tenu aucun compte, allant jusqu’à interdire des préparatifs de défense sous prétexte d’éviter toute provocation », refusant de se rendre à l’évidence quand l’ennemi ouvrit les hostilités. Il en résulta des pertes en vies humaines. Après les premiers désastres, « Staline pensa que c’était la fin… Il déclara : Tout ce que Lénine avait créé, nous l’avons perdu à jamais ». Pendant longtemps, « il cessa de faire quoi que ce soit ». Il ne sortit de son abattement que sous la pression instante du Politbureau. En effet son recueil de textes sur la guerre montre qu’il ne retrouva l’usage de la parole que le 3 juillet, après neuf jours de prostration. Le 16 octobre, il a quitté précipitamment Moscou, pris de panique.
Khrouchtchev se décide enfin à évoquer le massacre des maréchaux, Toukhatchevski en tête, des généraux, des cadres supérieurs de l’armée, de la marine et de l’aviation, comme l’une des causes principales des désastres. Il ne mentionne d’abord aucun nom. Pour le Politbureau, c’eût été prématuré, il fallait préparer le Parti à en entendre davantage. Mais il ressort déjà du verbiage de Khrouchtchev que les militaires assassinés par ordre de Staline, ainsi d’ailleurs que les leaders politiques, les intellectuels de toutes sortes mis à mort au cours des vingt années écoulées avaient été victimes cyniquement calomniées d’un maniaque sanguinaire disposant de tortionnaires capables d’extorquer des aveux insensés à n’importe qui. Les meilleurs chefs de l’armée, avoue Khrouchtchev, « ont été liquidés ». Ceux qui « ont survécu aux tortures » se sont comportés en héros. Il sera maintes et maintes fois question de tortures, de sévices, de « pressions physiques » dans ce singulier rapport secret qui ne restera pas longtemps secret, car trop de gens avaient intérêt à le divulguer.
Traitant du temps de guerre, Khrouchtchev dénonce « la nervosité et l’hystérie » de Staline, funestes aux opérations militaires et qui causèrent d’« immenses pertes d’effectifs ». Il cite notamment un cas précis où par la faute obstinée de Staline « nous perdîmes des centaines de milliers de soldats ». Et il commente : « Tel est le génie militaire de Staline », en ajoutant d’autres critiques pour discréditer la brute impudente qui se fit attribuer toutes les victoires finales, dues en réalité aux généraux formés pendant les combats et à l’héroïsme du peuple entier qui avait versé tant de sang et de larmes. Le rapport secret étant décousu et incohérent, on ne peut qu’y prélever quelques lignes sur quelques thèmes pour être bref et donner une idée de l’essentiel. Outre ce qui réfute les mensonges inouïs ayant dépeint Staline comme un grand stratège et tacticien, un grand capitaine, un leitmotiv ponctue constamment l’exposé celui des tortures infligées à d’innocentes victimes.
Khrouchtchev n’en désigne que quelques-unes, il « réhabilite » certains de ses collègues de l’oligarchie au pouvoir accablés de tourments avant le supplice final, mais il ne dit pas la millionième partie de la vérité puisque les victimes se compteront par millions. Des expressions comme « pressions physiques » et « annihilations physiques » reviennent sans cesse pour ne pas dire tortures et assassinats, mais les euphémismes font bientôt place à « tortures barbares », à « terreur de masse », à « tortures cruelles et inhumaines », à « terribles sévices », à « méthodes bestiales », etc., expliquant les moyens impitoyables employés pour arracher des aveux absurdes aux individus martyrisés. Ces horreurs sans nom alternent avec des platitudes trop connues sur le grand Lénine, le « marxisme », le Parti irréprochable, le cher peuple soviétique, et les blâmes sempiternels à l’adresse de Trotski, de Zinoviev, de Boukharine, l’heure n’étant pas venue de la vérité à leur propos. Certaines allusions indiquent pourtant que cette heure viendra, en particulier pour les militaires. Le rapport secret ne distille une justice frelatée que selon des critères connus des proches complices de Staline.
Le sort des militaires tués par le parti policier avant la guerre ne sera explicitement évoqué, du moins quant aux grands chefs, qu’à partir de 1957, les noms de Toukhatchevski, de Putna, de Blücher, de Iakir, d’Ouborévitch et autres étant mentionnés dans la presse, puis dans la Grande Encyclopédie soviétique ; comme si rien d’anormal ne leur était advenu. Selon l’hypocrisie du langage officiel, cela équivalait à des « réhabilitations ». Mais sans un mot pour dissiper les monstrueuses calomnies portées contre les suppliciés ni pour informer des circonstances de leur supplice. Bien que la vie de paysans et d’ouvriers injustement mis à mort ne soit pas moins précieuse que celle d’hommes en uniforme, l’intérêt public s’est inévitablement orienté vers l’armée, garante des destins du pays et dont la saignée eu des conséquences si catastrophiques sur la première phase de la guerre. Et il était naturel de s’interroger sur l’ampleur de l’« épuration » pratiquée par Staline.
Au moment où parlait Khrouchtchev, 7 679 personnes avaient été « réhabilitées » par un collège militaire spécial, et ce n’était qu’un début. Une telle précision suffit à balayer l’hypothèse idiote d’un complot dont le maréchal aurait été l’âme, avec l’appui de plusieurs milliers de complices. Mais W. Krivitski estimait à quelque 35 000 le nombre d’officiers exécutés sans rime ni raison avouables. D’autres évaluations sérieuses avoisinent ou dépassent ce chiffre. On sait que chaque arrestation d’un militaire entraînait celle de son entourage, de ses principaux subordonnés, de toute sa famille. Il n’a jamais existé de « groupe » Toukhatchevski, contrairement à ce qu’ont raconté tant de « spécialistes » ignares qui se prennent au sérieux. Il n’y a jamais eu la moindre « affaire » Toukhatchevski, n’en déplaise à tant de politiciens sans scrupules et de publicistes sans conscience. Pas davantage de « procès » et encore moins de prétendus « aveux ». Tout s’est passé au Politbureau, sous l’œil vigilant de Staline, Grand Inquisiteur sui generis, Khrouchtchev le dira à son heure.
Les supputations quant au nombre des victimes du carnage perpétré dans l’armée n’ont cessé de croître, et à bon escient. En 1961 eut lieu le vingt-deuxième Congrès du parti, et après cinq années de sourdes luttes intestines dans les hautes sphères de l’oligarchie, les maîtres de l’heure se décidèrent à disculper entièrement et sans restriction tous les militaires assassinés depuis 1937, les principaux étant nommément désignés. Plusieurs orateurs, I. V. Spiridonov, Catherine Fourtseva, A. N. Chelepine et Khrouchtchev s’évertuèrent à proclamer l’innocence totale des victimes, à répudier les diffamations éhontées, les calomnies monstrueuses de Staline et consorts. Toukhatchevski et Iakir furent particulièrement mis en honneur. On révéla qu’avant de mourir, Iakir avait crié : « Vive Staline ! » ce qui montre à quel point était partagée l’intoxication du Parti par le mensonge stalinien, commune aux victimes et aux bourreaux. Les Isvestia publièrent des apologies emphatiques à la gloire de Toukhatchevski et de Iakir. Les autres généraux sacrifiés furent diversement louangés dans la presse. Plus spécialement, un écrivain bien en cour, Lev Nicouline, reçut la tâche de rédiger une biographie élogieuse de Toukhatchevski ; pour s’en acquitter, il eut accès à de précieuses archives militaires, dans certaines limites. Son livre, très anodin et conformiste de façon à ne mettre en cause que le prétendu « culte de la personnalité », parut en 1963.
Or Nicouline, qui venait presque chaque année en France pour des soins médicaux, avait à Paris un vieil ami, le peintre Georges Annenkov. Leurs conversations évitaient soigneusement les questions politiques pour s’en tenir à la littérature et aux beaux-arts. Mais il se trouva des moments où, à propos d’amis communs disparus, comme Isaac Babel, des allusions discrètes au… « culte de la personnalité » devenaient inévitables. C’est ainsi que Nicouline, qui avait eu le privilège de compulser des archives secrètes, fit allusion à 60 000 militaires disparus dans la tourmente épuratoire. Chiffre stupéfiant qui dépassait de beaucoup les évaluations de W. Krivitski, de spécialistes occidentaux comme John Erickson et Raymond Garthoff, ou ceux des services de renseignements japonais très avertis. Chiffre effroyable qu’on a peine à croire et qui pourtant ne paraîtra plus tellement étonnant quand on en viendra au bilan démographique du régime de Staline.
Les données quantitatives privent de telles abominations d’une partie de leur influence affective. On a des détails horrifiants qui priment la froideur des statistiques. Un dernier chiffre sur l’année de la décapitation de l’Armée rouge : un communiste yougoslave, Moshe Pijade confident de Tito, n’a pas craint de dire qu’en 1936-1937, plus de 3 millions de personnes ont été tuées… Tous ceux qui refusaient de s’incliner devant Staline furent massacrés sous l’étiquette d’espions, ou de fascistes et d’agents d’Hitler. Et quand Staline se fut débarrassé d’eux, il signa un pacte avec Hitler » (Cf. Vladimir Dedijer : Tito parle…, Paris, 1953). C’est la vérité, sauf qu’en fait personne ne refusait de s’incliner devant Staline.
Plus émouvants et révoltants encore que les nombres croissants de morts sans sépulture, révélés d’année en année par des communistes excédés de tant de crimes, sont certains épisodes et certains détails qui font frémir. Khrouchtchev a raconté par quelles injures abjectes, imprécations crapuleuses, Staline et ses Molotov, Vorochilov, Kaganovitch, ont ponctué leurs décisions homicides, visant des hommes intègres dont nul ne pouvait suspecter le loyalisme et dont Fourtseva a pu dire au vingt-deuxième Congrès que « l’innocence était si évidente ». Innocence tellement évidente que dès le 12 juin 1937, au lendemain de l’assassinat pseudo-légal des généraux, le Figaro l’affirmait avec arguments catégoriques à l’appui, donc un quart de siècle avant C. Fourtseva et Khrouchtchev. Cet article dicté par l’indignation éprouvée à la lecture du funèbre communiqué de Moscou se terminait ainsi : « Staline veut rester l’unique survivant des compagnons d’armes de Lénine et n’avoir autour de lui que des médiocres incapables de regarder “le soleil” en face. Car Staline exige qu’on le compare au soleil. La parole est aux psychiatres *. »
Un écrivain russe conformiste en doctrine « marxiste-léniniste », mais dissident sur le plan moral, Roy Medvédiev, travaillant à Moscou révélera dans un livre publié à New York, puis à Paris, toute l’horreur de la vindicte stalinienne acharnée sur la femme, le frère, la fille quatre sœurs de Toukhatchevski (Au tribunal de l’histoire, N. Y., 1974, trad. fr., le Stalinisme, P., 1972). Cet auteur digne de foi confirme que la police secrète arrêtait « nombre de collègues, d’amis et même de relations fortuites des pseudo-ennemis du peuple… Chaque arrestation en entraînait une série d’autres… d’épouses, d’enfants adultes et souvent de frères, de sœurs et d’autres parents… Huit membres de la famille d’Enoukidzé périrent, et un destin semblable s’abattit sur des centaines de milliers d’innocents ».
Il n’a existé aucune « affaire Toukhatchevski », pas plus qu’une affaire Trotski ou une affaire Boukharine, etc. Sans doute Staline nourrissait-il de longue date un grief mortel contre l’auteur de « La marche au-delà de la Vistule », qui sous-entend par une allusion très discrète la responsabilité de Staline dans l’échec de l’offensive sur Varsovie en 1920, allusion qui sera explicitée par Trotski en 1927 et que le présent ouvrage expose succinctement. Ce texte de Toukhatchevski figure en français dans le livre de Pilsudski : l’Année 1920, Paris, 1929. Mais Staline méditait une « douce vengeance » meurtrière à l’égard d’innombrables camarades qu’il soupçonnait capables de faire obstacle, un jour ou l’autre, à son ambition démesurée et à ses projets monstrueux. De toute façon, il aurait tué le maréchal comme il a tué tous les cadres du Parti et de l’État créés par Lénine et qu’il jugeait incapables d’admettre son entente avec Hitler.
En Occident, tous les commentateurs, tous les spécialistes ayant étudié ce thème ont fait fausse route en prêtant à Staline des raisons particulières de supprimer des milliers de militaires, différentes de celles qui ont inspiré la « liquidation » de millions de civils. Dans The Twentieth Century, de Londres, juillet 1957, par exemple, John Erikson dont personne ne méconnaît la compétence en matière militaire traite de « The Soviet Military Purge » ; il cherche diverses explications à la « purge » dans les divergences de conceptions stratégiques ou tactiques passées ; il fait état d’écrits sans valeur, échos des mensonges staliniens, et discute de questions techniques sans rapport avec le sang versé. Pas un mot de cette argumentation, ni d’aucune autre de même inspiration, ne mérite créance. En quoi expliquerait-elle l’ampleur et la cruauté inouïes du massacre ? Elle n’explique pas non plus pourquoi sept sur neuf des officiers du plus haut rang, désignés comme juges du tribunal militaire fictif ayant condamné les huit premiers accusés, ont été exécutés à leur tour.
Au vingt-deuxième Congrès, dans une intervention où l’on ne saurait démêler la part de l’ignorance, celle de vérités fragmentaires et celle des mensonges rituels, Khrouchtchev a fait allusion à « une information curieuse parue dans la presse étrangère selon laquelle Hitler (…) aurait mis en circulation un document fabriqué de toutes pièces, selon lequel les camarades Iakir, Toukhatchevski et les autres auraient été des agents de l’état-major allemand. Ce document prétendument secret aurait été remis au président de la Tchécoslovaquie, Bénès, et celui-ci, sans doute dans une bonne intention, l’envoya à Staline ». Et d’ajouter : « Iakir, Toukhatchevski et les autres camarades furent arrêtés et ensuite supprimés. » D’après cette version, Staline le naïf aurait été dupe du méchant Hitler, ce qui expliquerait une si longue série d’hécatombes. On attend encore la publication du « document fabriqué de toutes pièces ».
Le 18 juin 1946, devant une commission d’enquête parlementaire, Léon Blum fit des confidences selon lesquelles en 1936 il avait reçu d’Edouard Bénès un avis « me conseillant instamment d’observer les plus grandes précautions dans mes rapports avec l’état-major soviétique. D’après son propre service de renseignements, — lequel jouissait en Europe d’une réputation méritée, — les dirigeants du grand état-major soviétique entretenaient avec l’Allemagne des relations suspectes ». En 1948, les mémoires d’Edouard Bénès confirmaient Léon Blum ; « un mot échappé » (sic) à un diplomate nazi fit comprendre à Bénès ce qui se passait à Berlin, avec « Toukhatchevski, Rykov et d’autres ». À remarquer l’adjonction inopinée de « Rykov et d’autres », c’est-à-dire de civils.
En 1948 commencèrent à paraître les Mémoires de Churchill sur la deuxième guerre mondiale, suscitant maintes objections, rectifications et protestations. L’illustre homme d’État dont il ne saurait être question de nier les mérites comme défenseur de son pays et de l’Europe, se réfère aussi à Bénès quant à « la conspiration de la soi-disant “vieille garde communiste” pour renverser Staline et instaurer un nouveau régime pro-allemand. … Il s’ensuivit une purge politique et militaire sans merci, mais peut-être justifiée, et une série de procès… » Etc. Mais une note sous le texte contredit étrangement ce qui précède, prouvant que Churchill n’a pas pris la peine de relire le travail de ses secrétaires : « Il y a cependant quelque preuve que l’information de Bénès avait été passée à la police tchèque par la Guépéou qui voulait atteindre Staline à travers une source étrangère amicale. » Autrement dit la Guépéou, donc Staline, a informé Bénès pour que celui-ci informe Staline. Pour comble d’absurdité, la note insiste : « Cela n’amoindrit pas le service rendu par Bénès à Staline et est par conséquent hors de propos » Si Churchill avait voulu se disqualifier comme historien et comme mémorialiste, il n’aurait pas pu accumuler de contradiction en si peu de lignes, après tant d’invraisemblance. À noter que, cette fois, toute la « vieille garde communiste » est mise en cause comme pro-allemande, alors que la réalité est exactement inverse : seul Staline a voulu, avec sa mafia, l’accord avec Hitler.
Cette histoire embrouillée est assez débrouillée, éclaircie, réfutée dans les deux textes précités : « “L’affaire Toukhatchevski” » et « La décapitation de l’Armée rouge ». Il s’agit d’une machination particulièrement retorse de Staline, accomplie en se servant d’un général d’ancien régime, Skobine, agent double et triple de la Guépéou, de la Gestapo et d’un groupe d’officiers tsaristes à Paris. Ce traître de haut vol, dont Staline tirait les ficelles, collabora avec les nazis qui fabriquèrent de faux documents pour compromettre Toukhatchevski et autres, puis les firent passer confidentiellement à Prague, d’où Bénès les envoya non moins confidentiellement à Staline, avant d’en aviser encore plus confidentiellement Léon Blum. Le livre de W. Krivitski auparavant cité, paru en 1940, dénonçait déjà les agissements de ce Skobine. Néanmoins, Bénès, Léon Blum, ensuite Churchill se sont laissé duper avec une complaisance déconcertante. Et de même, quantité de commentateurs, de politiciens, de diplomates, de publicistes de toute espèce. Il existe sur ce thème bon nombre de livres et d’articles de revues méprisables, bourrés de faux savoir.
Staline a donc mis en œuvre avec maîtrise la formule conçue par Hitler, à savoir que « plus le mensonge est gros, mieux il a chance de prendre ». L’ignorance des hommes d’État et de leurs conseillers à propos des procès mis en scène à Moscou, celle de Roosevelt et de ses successeurs égalant celle des Européens, va de pair avec l’insondable crédulité du public abêti par la presse écrite et parlée, de plus en plus basse et vulgaire. Une exception illumine, le temps d’un éclair, la sombre époque de Staline et de Hitler. Lors du « procès en sorcellerie » où Racovski confessa des crimes imaginaires, Anatole de Monzie, grand bourgeois libéral, intelligent et informé, qui fut plusieurs fois ministre et s’intéressait beaucoup à la Russie, lui fit écho dans le Matin du 7 mars 1938. Sous le titre : « La folie furieuse des procès de Moscou », ce journal publiait une déclaration d’Anatole de Monzie affirmant que « Racovski est innocent des crimes dont il s’est accusé lui-même », De Monzie repoussait des aveux « dépourvus de bon sens, voire de sens », après avoir affirmé : « Je tiens, quoi qu’on dise à Moscou et quoi qu’il dise lui-même, que mon ami est incapable de trahison. » Cri du cœur et parole de raison qui font justice d’une énorme masse de sottises accumulées par les dissertations pédantes de charlatans et de cuistres qui ont infecté l’opinion publique en France, l’intelligentsia française, l’Université, la presse et l’édition françaises, pendant plus d’un tiers de siècle, — et dont la contagion s’est propagée largement hors de France. Les quelques mots d’Anatole de Monzie dans un cas particulier font exception et font justice de tant de mensonges abominables. Car ce qu’il a écrit pour Racovski est vrai pour tous les autres.
Si d’aventure, après la première guerre mondiale, un gouvernement français d’imposteurs avait accusé Poincaré, Clemenceau, Joffre, Foch, Pétain, Cambon, etc., d’être des espions, des traîtres, des vendus, des terroristes, des assassins, personne en Angleterre ne l’aurait admis. Mais quand le pouvoir soviétique d’un détraqué mental, ivre de sang et d’orgueil, accuse Trotski, Boukharine, Zinoviev, Toukhatchevski, Iakir et tant d’autres d’avoir volé les tours de Notre-Dame et celles du Kremlin, il se trouve à Londres un Churchill pour l’admettre, en Europe et en Amérique des hommes d’État pour le croire et des « guides de l’opinion publique » pour le faire croire aux foules. Ceci ne concerne pas seulement la biographie politique d’un Staline.
La civilisation occidentale est ainsi mise en cause. Il y a plus d’un siècle qu’Alexandre Herzen a dit : « On écrit des livres, on prononce des discours, on fourbit les armes… et la seule chose que l’on omet, c’est l’étude sérieuse de la Russie. » Cet état des choses n’a cessé d’empirer jusqu’à nos jours, à mesure que se perfectionnaient les moyens d’information et de communication.
En 1975 se tint à Helsinki, sur l’initiative de Moscou, une conférence « sur la sécurité et la coopération » où participèrent les principales puissances occidentales avec l’Union soviétique et ses satellites. Les résolutions adoptées à l’unanimité impliquent l’acceptation, par les démocraties civilisées, des pires crimes de Staline et de ses auxiliaires et successeurs, des pires violations des droits de l’homme, du droit des gens et du droit des peuples *.
Dans son rapport secret, Khrouchtchev parlant au nom de la « direction collective » souscrit plus ou moins explicitement aux crimes de Staline commis antérieurement au dix-septième Congrès du Parti tenu en 1934. Car la nouvelle équipe leur doit son ascension au pouvoir. Ce « Congrès des vainqueurs », selon la phraséologie stalinienne, avait été une interminable cérémonie d’acclamations délirantes et d’apothéose en l’honneur du Secrétaire des secrétaires, décidément divinisé. Or, dit Khrouchtchev, sur 1 966 congressistes, 1 108 furent ensuite « liquidés ». Et sur 139 membres du Comité central élus (sic) à ce congrès, 98 subirent le même sort, de par la volonté homicide du maniaque. Khrouchtchev ne tente pas d’expliquer cette tuerie, et bien entendu personne ne questionne. À chacun s’il peut, de conclure.
À partir d’une telle révélation, les vérités partielles se succèdent, alternant avec les mensonges conventionnels à la gloire du régime. Il s’agit de désolidariser le Parti de certains excès horribles accomplis en son nom. Les auditeurs apprendront, entre autres, que des peuples entiers, au Caucase, ont été déportés en masse, « y compris les femmes, les enfants, les vieillards, les communistes et les komsomols ». Pour un motif inavoué, donc inavouable, les Tatars de Crimée et les Allemands de la Volga, eux aussi déportés, décimés, ne sont pas mentionnés. Pour eux, point de rémission, même morale.
Le rapport secret ne présente qu’une sélection des horreurs du régime, imputées au seul Staline et à ses proches instruments, Ejov et Béria. Pour un catalogue général même incomplet, il faudrait toute une bibliothèque. Khrouchtchev se garde d’évoquer l’assassinat, froidement perpétré, de quelque 12 000 prisonniers polonais à Katyn, dans la région de Smolensk. Seul un Staline, à défaut de Hitler, pouvait ordonner un forfait aussi lâche. Pas un mot non plus sur l’assassinat de Trotski et de toute sa famille, comme de la famille de Toukhatchevski ou celle d’Enoukidzé, dont on ne sera informé que beaucoup plus tard, et d’autres sources. Les héritiers de Staline acceptent l’héritage, sous bénéfice d’inventaire et selon des critères qui leur sont propres.
Pour expliquer les monstruosités qu’il évoque, Khrouchtchev effleure en passant le cas pathologique du monstre, sa « suspicion maladive », sa « méfiance généralisée », son « hystérie », sa « manie de la persécution », sa folie des grandeurs », sa mégalomanie », bref les traits caractéristiques du paranoïaque. La psychose du potentat se traduisait, entre autres, par les éloges outrés qu’il exigeait de ses thuriféraires, allant jusqu’à corriger lui-même leurs écrits serviles pour apparaître comme « un surhomme doté de qualités surnaturelles à l’égal d’un dieu ». Staline, améliorant sa biographie déjà exagérément flatteuse, « se couvrait lui-même de louanges relatives à son génie militaire, à son art de la stratégie ». Or le rapport secret l’a dûment discrédité à jamais comme chef de guerre, avec assez d’illustrations à l’appui, avant de le déshonorer comme meurtrier, comme tortionnaire et comme « marxiste », tout en rendant un dérisoire hommage à son « marxisme » primaire du temps jadis.
Mais plus de deux ans avant le rapport secret, la vérité sur « le cas pathologique de Staline » avait été dite, imprimée à Paris sous ce titre, et le sous-titre : « Un Caligula à Moscou », dans le bulletin déjà mentionné, devenu Est et Ouest, n° 98, en novembre 1953. L’auteur en était Nicolas Volski (alias Valentinov) en collaboration avec le présent historiographe, et l’information venait de source absolument sûre celle des frères Ivan et Valérian Mcjlaouk, l’un vice-président du Conseil des commissaires du peuple, l’autre gérant (oupravdiel) du Soviet suprême. En plus, Volski avait reçu les confidences d’un haut fonctionnaire de la Guépéou, nommé Fink, et celles d’un autre tchékiste important, I. N. Kogan. Ces personnages bien informés étaient venus à Paris en 1937 pour l’inauguration du pavillon soviétique à l’exposition. Ils eurent l’occasion de parler des docteurs Lévine et Pletniev, hommes irréprochables impliqués dans le procès Boukharine-Rykov de 1938 et futurs condamnés, mais sous quel prétexte ? Puisque tout était mensonge dans ce procès comme dans tous les précédents, il fallait une autre raison. Les interlocuteurs de Volski le savaient : les médecins avaient diagnostiqué la psychose paranoïaque de Staline et fait la confidence à des dirigeants le plus haut placés, et ce dans une ville où les murs ont beaucoup d’oreilles. Ils devaient payer cher leur diagnostic.
Ce « grand secret du Kremlin », autre sous-titre de l’exposé sur « le cas pathologique de Staline », est une précieuse contribution à l’histoire du régime soviétique, comme le sera différemment le rapport secret. Il suscita de vives controverses dans l’intelligentsia russe en exil où l’intelligence n’était pas « la chose du monde la mieux partagée ». Pourquoi Roosevelt, Churchill et autres visiteurs de Staline n’ont-ils rien remarqué, objectaient les contradicteurs incompétents, armés d’idées toutes faites, de formules stéréotypes opposant la « logique du système » et autres sophismes à la conclusion médicale, cependant qu’intervenaient des clichés pseudo-marxistes sur la « lutte des classes » et autres vieilleries. Les rédacteurs de « Caligula » s’appuyaient sur les travaux du docteur H. Baruk, psychiatre notoire, qui décrivent parmi les syndromes paranoïdes « le besoin impérieux de domination, la haine pathologique, la conscience morale anesthésiée, aboutissant à des réactions criminelles ». Une autre source sérieuse citée ajoute certaines caractéristiques connexes : « l’égoïsme exagéré, l’orgueil, la susceptibilité, la méfiance et des perversions de facultés logiques ». L’avachissement de l’esprit en Occident et la « trahison des clercs », comme disait Julien Benda avant de verser lui-même dans le stalinisme, firent obstacle à la vérité bien établie par des observateurs probes et qualifiés.
Un deuxième article : « Un Caligula au Kremlin », répondit point par point aux critiques (même bulletin, n° 102, janvier 1954). Sur ces entrefaites parut un papier du docteur Logre : « Caractère et personnalité », réponse fortuite à l’objection précédemment énoncée ; elle traite du « caractère méfiant et orgueilleux, enclin aux interprétations fausses, qui correspond à la constitution paranoïaque de Kraft-Ebing, prélude éventuel d’un délire de persécution ou de grandeur (…). Le délire hallucinatoire de persécution divise la personnalité en une partie lucide où le sujet se reconnaît lui-même et une partie automatique ou, par une intuition délirante, il croit reconnaître l’esprit hostile et injurieux d’autrui ».
En effet la partie lucide apparaît chez Staline conjointement avec les autres syndromes du mal et explique son comportement normal en présence en présence d’interlocuteurs dupes de son talent d’acteur. Les apparences épisodiques n’excluent pas les agissements morbides et spécifiquement staliniens qui ont ensanglanté le chronique du régime pendant plus d’un quart de siècle.
Quelque deux ans après les articles sur « Caligula », Khrouchtchev en confirma pleinement la teneur dans son rapport secret dont il nia effrontément l’existence, l’attribuant aux « services secrets américains », mensonge patent (un de plus) bientôt intenable, car le texte authentique s’en répandit, justifiant avec éclat la publication française. Ce qui permit au bulletin précurseur d’en faire état sous le titre originel : « Le cas pathologique de Staline », suivi de : « Khrouchtchev confirme le B.E.I.P.I. et persiste dans le stalinisme » *. Depuis, personne n’a pu contester le bien-fondé de ces témoignages recueillis par N. Volski et des arguments qui les accompagnent.
Plusieurs idées fixes, très caractéristiques chez un détraqué mental de cette sorte, sont discernables à première vue, en tant que partie lucide de la psychose. Dans le présent ouvrage, il a été écrit que Staline ne laisse et ne laissera pas vivre ceux qui savent la vérité : « Il se débarrasse aussi des gens qui en savent trop long sur son compte, sur son passé, son présent, ses tares et ses crimes… Il supprime les derniers témoins susceptibles de produire un jour à son endroit un témoignage véridique. » Du même auteur : « Il est douteux que Staline laisse vivre des gens susceptibles de parler plus tard… Il entend supprimer les témoins susceptibles d’écrire un jour des mémoires (Iagoda périra d’en savoir trop long). Bientôt, personne ne survivra pour témoigner devant l’histoire. » (« Cauchemar en U.R.S.S. », in Revue de Paris, juillet 1937.) Bien des confirmations vont suivre.
En effet, Svetlana Allilouieva, la propre fille de Staline, écrira beaucoup plus tard : « En 1937, mon père n’a pas hésité à exterminer les membres de sa propre famille : les trois Svanidzé, Redens, Enoukidzé (parrain de ma mère)… La même chose se produisit en 1948 avec mes tantes. Il les trouvait dangereuses parce qu’elles “en savaient trop” et étaient “trop bavardes”. Il n’hésita pas à faire arrêter les deux veuves, vieilles femmes ayant déjà tant souffert. Il ne pouvait sans doute oublier qu’elles étaient au courant de tout ce qui se passait dans notre famille, des détails du suicide de maman, de la lettre qu’elle avait laissée. » À la page suivante, elle remarque au sujet des tchékistes : « … Les plus importants, ceux qui “en savaient trop”, devaient s’attendre à être liquidés à leur tour ; c’est ce qui arriva à Iagoda, à Ejov, à Agranov, directement mêlé à l’assassinat de Kirov. »
Avant elle, un tchékiste de haut rang, transfuge, réfugié en Amérique, et qui signe Alexander Orlov, confirme ainsi tout ce qui précède, dans ce livre-ci comme dans celui de Svetlana : « En règle générale, Staline se débarrassait des gens qui en savaient trop sur son passé et qui, à la lumière des crimes monstrueux des dernières années, pourraient se rappeler et réviser certains épisodes douteux de son passé, auxquels ils n’avaient pas accordé assez d’attention sur le moment. » (Cf. The Secret History of Stalin’s Crimes. New York, 1953.) Sur ce point, aucune contestation sérieuse ne s’est fait valoir.
Une autre idée fixe du despote se dessine et s’accentue après le « Congrès des vainqueurs », quand il a exterminé la grande majorité de ses panégyristes, celle de s’entendre avec Hitler. Le massacre des principaux cadres de la diplomatie et de l’armée, après celui des hauts fonctionnaires du Parti confondu avec l’État, ne s’explique pas autrement : ces cadres sacrifiés ne se réclamaient d’aucune opposition. Staline partageait de longue date la judéophobie de Hitler. Il ne l’exprimait pas trop ouvertement du temps de Lénine, car celui-ci ne l’eût pas toléré, mais dès sa rupture avec Zinoviev et Kamenev, il ne se gêna plus pour mettre sournoisement en circulation les thèmes et les procédés favoris de ceux qu’on désignait comme les « Centuries noires » sous l’ancien régime. L’« antisémitisme », synonyme de judéophobie, prit un caractère de plus en plus vexatoire et persécuteur, à mesure que se poursuivaient les démarches occultes pour un rapprochement des deux tyrannies. Hitler, dans ses Propos de table, tient Staline pour « une des figures les plus extraordinaires de l’histoire mondiale… Staline aussi nous impose un respect inconditionnel. À sa façon, il est « ein genialer Kerl ». Staline pour sa part admirait la façon dont Hitler avait liquidé ses anciens compagnons d’armes, des gêneurs, lors de la « nuit des longs couteaux » en 1934, et réciproquement, Hitler lui rendra la politesse après la décapitation de l’armée rouge.
Hermann Rauschning a rapporté une intéressante remarque de Hitler : « Ce n’est pas l’Allemagne qui deviendra bolchéviste, mais le bolchévisme qui se transformera en une sorte de national-socialisme. En outre, il y a beaucoup plus de points qui nous rapprochent du bolchévisme que de divergences. » Cette prévision juste est compensée par un propos stupide qu’il tiendra en 1944, consigné par son ministre Albert Speer : « Aujourd’hui, il comprenait qu’en organisant un procès pour éliminer Toukhatchevski, Staline avait fait un pas décisif lui permettant de mettre sur pied un commandement efficace. En liquidant l’état-major général, il avait fait place nette pour des hommes nouveaux qui n’avaient pas été formés pendant l’époque tsariste. Jadis il avait toujours vu dans les accusations portées pendant les procès de Moscou de 1937, des falsifications ; mais maintenant, après l’expérience du 20 juillet, il se demandait s’il n’y avait pas eu une part de vérité dans ces accusations. Certes il n’avait aujourd’hui pas plus de preuves qu’hier, mais il ne pouvait plus exclure la possibilité d’une trahison des deux états-majors collaborant ensemble. »
Ces divagations d’aliéné mental vont de pair avec des observations étonnamment lucides comme celle-ci, dont il fit part au maréchal Antonesco, le Conducator roumain, le 26 mars 1944 : « Staline n’était pas homme à prendre des risques. L’exemple polonais est typique : il n’a ordonné à ses unités d’avancer, malgré l’invitation allemande, qu’au moment où l’immixtion dans l’affaire polonaise était devenue sans danger… Même s’il a un revolver et que l’adversaire ne soit armé que d’un couteau, il attendra jusqu’au moment où ce dernier se sera endormi : c’est un Goliath qui craint David. Il a la cruauté de la bête sauvage et la lâcheté de l’homme. » Remarque lucide qui alterne avec des propos d’ignorant sur Toukhatchevski et quelques miettes d’informations exactes mêlées à des sottises de maniaque.
Albert Speer dit encore que Hitler était « prisonnier de sa théorie selon laquelle les Slaves n’étaient que des sous-hommes ». Mais le Führer « parlait de Staline avec beaucoup de considération, tout en mettant en relief les analogies entre sa propre endurance et celle de Staline… Il disait parfois sur le ton de la boutade que la meilleure chose à faire si l’on parvenait à vaincre la Russie serait de confier à Staline l’administration du pays, évidemment sous la tutelle de l’Allemagne, car pour s’y prendre avec les russes, il était le meilleur chef qu’on puisse imaginer. Surtout il considérait Staline un peu comme un collègue ».
Staline aussi regardait Hitler comme un collègue. Il s’était persuadé que tous les deux étaient faits pour s’entendre. Il devint inconsolable, lui l’infaillible, de s’être trompé à tel point sur Hitler, et d’avoir été trompé à tel point par Hitler. On en a maints témoignages incontestables, notamment celui de sa fille qui en outre cite beaucoup d’exemples de ses obsessions judéophobes, pendant et après la guerre. Elles s’assouvissent avec la pire cruauté, même dans sa propre famille. Lui aussi méditait une « solution finale » à l’instar de Hitler, mais par d’autres moyens. Dans ce cas comme en bien d’autres, il prenait son temps. La guerre requérait toute son attention, posait de multiples problèmes à son pouvoir unipersonnel. Le persécuteur par excellence se croyait persécuté, par qui sinon par les juifs (considérés comme une nationalité, sous le régime soviétique). On sait comme il savourait longtemps d’avance sa « douce vengeance » *.
Selon le cliché si répandu, Stalingrad fut un « tournant » de la guerre, mais dans le sens donné à entendre par la propagande communiste et la crédulité populaire, aussi par le cynisme de Staline et la complaisance des dirigeants anglo-américains. Aucune personne sensée ne devrait croire que la pénétration allemande jusqu’à la Volga, sur 1 600 kilomètres en profondeur, fut une manœuvre stratégique habile de l’Armée rouge et que la conduite insensée de Hitler soit imputable au génie de Staline. Le fait est que l’hécatombe effroyable due aux deux sinistres « collègues » ne fait pas précisément honneur à la civilisation du xxe siècle. Aussi l’histoire vraie de cet épisode n’a-t-elle pas été écrite : sous Staline, c’était interdit, et à partir de la « destalinisation » relative inaugurée sous Khrouchtchev, les mémoires militaires, même ceux des maréchaux, feront partie de la littérature officielle, c’est-à-dire tendancieuse ou mensongère. Les signataires n’en sont d’ailleurs pas les vrais auteurs, qui peinent laborieusement dans quelque officine du Comité central. Détail burlesque pour caractériser cette littérature : le mérite de la triste victoire de Stalingrad, retiré à Staline après le vingtième Congrès attribué à Khrouchtchev quand celui-ci incarna le pouvoir, lui fut retiré à son tour après sa chute.
L’impossibilité d’écrire une histoire sincère de la « grande guerre patriotique » issue du pacte Hitler-Staline est démontée par l’expérience de l’historiographe Alexander Lekritch. Celui-ci, très conformiste en « marxisme-léninisme », mais autorisé par le Parti à traiter d’un moment de la guerre dans les limites prescrites par les autorités sous Khrouchtchev ; écrivit son pensum en style de propagande patriotique, tissé de poncifs sonores, et patronné par l’Académie des sciences, mais avec deux chapitres véridiques sur le début des hostilités, donc sur les responsabilités désastreuses de Staline, puisque c’était alors permis. Mais quand un revirement se produisit au « sommet » du parti avec la disgrâce de Khrouchtchev, le livre fut mis au pilon (bien qu’accueilli avec faveur par la critique et le public), l’auteur vilipendé et exclu du Parti, privé ainsi de moyens d’existence. Encore eût-il le privilège de s’expatrier, dix ans plus tard. Avis à qui voudrait écrire honnêtement sur Stalingrad.
Churchill raconte dans ses mémoires une conversation avec Staline qui laisse comprendre, en termes imprécis, que la collectivisation agricole avait coûté quelque 10 millions de vies humaines dans les campagnes soviétiques, que ce fut nécessaire. Le nombre des victimes à Stalingrad n’était donc pas pour émouvoir un Staline (un demi-million, peut-être, mais la Grande Encyclopédie soviétique évite de donner de donner un chiffre et le Larousse ne mentionne que les pertes allemandes). Staline est trop prudent pour dénombrer ouvertement ses victimes, lesquelles figureront dans l’anonymat de statistiques ultérieures. Il pousse même la prudence jusqu’à s’abstenir de s’approcher du front, ce qu’attestent plusieurs sources soviétiques. En revanche il est imprudent dans le mensonge, sachant toutefois que cela ne tire pas sur-le-champ à conséquence, d’après son expérience personnelle. Un seul exemple : le 7 novembre 1942, il proclame que « les forces de l’ennemi déjà minées, touchent à leur fin. Au cours de la guerre, l’Armée rouge a mis hors de combat plus de 8 millions de soldats et d’officiers ennemis ». Il ose dire cela après seize mois de guerre. Or, en 1945, après soixante-huit mois de guerre pour l’Allemagne, elle n’aura perdu « que » 2 800 000 militaires. Peu importe à Staline que personne ne peut contredire.
Là où il excelle, c’est dans l’art de berner ses alliés occidentaux, qui s’y prêtent de bonne grâce. Sur ce point aussi, Hitler s’avère étonnement lucide quand il dit au maréchal Antonesco, entrecoupant ses diverses divagations : Staline « ne sollicite jamais, mais chaque fois exige ou proteste. Quand on lui donne quelque chose, c’est parce qu’on lui doit. Quand c’est lui qui restitue, il n’avoue pas que c’est par obligation, bien au contraire, il veut paraître généreux. Ainsi il a su convaincre les Anglais, et surtout les Américains, que ce ne sont pas eux qui aident les Soviets à se défendre, mais que Staline serait entré en guerre uniquement pour tirer les Occidentaux d’une situation difficile. Le Russe (sic) qui aurait été, sans l’aide américaine, obligé de capituler pendant l’été 1942, réussit à se faire considérer par ses alliés comme un sauveur… Pour obtenir un tel résultat, il a mis le prix : les millions de Russes qui meurent sur le front. Seulement il a su persuader ses soldats que ce n’est pas pour le régime communiste qu’ils se sacrifient, mais pour la patrie russe ».
En effet Staline, bien informé par les Américains eux-mêmes qui répandent leurs vues et étalent leurs « secrets » sur la place publique, bien informé aussi par ses services de renseignements dont il a pourtant méconnu la valeur quant à la volte-face de Hitler en 1941. Staline a su exploiter au maximum le concours que Churchill et Roosevelt étaient tout disposés à lui donner pour tenir en échec le monstrueux agresseur devenu l’ennemi commun. Aider le pays attaqué, devenu malgré lui allié des démocraties qu’il maudissait la veille, c’était dans l’ordre des choses. Ce ne l’était pas d’ignorer la nature et les intentions, les projets du régime et de ses dirigeants possesseurs de ce pays victime de ses maîtres.
« Necessity creates strange bedfellows », savent les anglais qui ont lu leur Shakespeare, et même ceux qui ne l’ont pas lu. Les américains également. Mais rien de justifiait les expériences de Staline durant toute la guerre comme s’il avait des droits à faire valoir, surtout quand il s’est mis à presser Churchill et Roosevelt d’entreprendre un débarquement en Europe alors que n’existaient pas les moyens pratiques d’une telle entreprise. Cette exigence de créer un « deuxième front », véritable chantage exercé par Staline sur ses bienfaiteurs incapables de la satisfaire, leur donnait à craindre l’éventualité d’une paix séparée, profitable au seul Hitler. Les deux chefs de la coalition occidentale ne connaissaient pas Staline. Même sa mauvaise foi criante à propos d’un « deuxième front » n’enseignait rien à Roosevelt qui, jusqu’à sa fin, voulut croire à la conversion de Staline en un démocrate épris de justice et de paix perpétuelle.
Staline n’a pas su berner seulement Churchill et Roosevelt, plus tard de Gaulle, comme il avait berné Bénès et tant d’autres. Il a floué en outre tous les visiteurs distingués, diplomates, journalistes importants, hommes d’affaires, etc., venus « se rendre compte » sur place, de visu, des qualités du personnage légendaire. À tous, il disait simplement ce qu’ils désiraient entendre, sachant que rien ne l’empêcherait, l’heure venue, d’agir à sa guise. Il n’attendait de l’Occident qu’une aide matérielle illimitée, bien résolu à ne jamais payer un centime. Roosevelt lui dépêcha son confident, Harry Hopkins, qui revint enchanté d’avoir causé avec un homme si simple, si raisonnable. Une seule fois, Staline a changé de ton, c’était en parlant de Hitler, son ex-partenaire félon : « Dire que nous avons eu confiance en cet homme… » Aveu dépourvu d’artifice. Staline ne demande à l’Américain que des tanks, des avions, des canons, des camions, de l’essence, etc., oubliant de préciser qu’il fera effacer les marques d’origine américaine pour leur substituer des signes fictifs en langue russe *.
Un mois avant l’agression allemande, Staline s’était fait nommer président du Conseil des commissaires, lequel ne tardera guère à devenir « Conseil des ministres » pour plus de respectabilité bourgeoise ; peu après il sera président du Comité de défense et, bientôt, il prendra de surcroît le titre de commissaire à la Défense, puis celui de commandant en chef des armées, et, finalement, il se nommera généralissime. Entre-temps, insatiable, il aura ajouté à ses décorations multiples celle de Héros du travail socialiste, ensuite celle de Héros de l’Union soviétique. Ainsi valorisé à ses propres yeux comme devant la masse humaine inculte et soumise, il a délibéré avec Roosevelt et Churchill aux conférences de Téhéran (1943) et de Ialta (1945), avec le président Truman à Potsdam (1645), sûr de lui, fort des sacrifices en hommes dont il ne se privait pas de se prévaloir et que, seul, son Empire pouvait endurer, fort surtout de l’ignorance de ses interlocuteurs qui l’appelaient gentiment « Uncle Joe », diminutif amical qu’il interpréta comme péjoratif et vite adopté par la presse américaine empressée à suivre la mode.
C’est ainsi qu’à Ialta, la Pologne fut trahie et livrée à la domination communiste, en échange de vaines promesses quant à son indépendance, formulées par l’assassin des quelques 12 000 Polonais prisonniers à Katyn. Il n’y eut à cette conférence aucun « partage du monde », comme de Gaulle a voulu le faire croire en France, où une littérature pseudo-historique, polémique et mensongère, a proliféré sur ce thème trompeur, où le faux « partage du monde » est devenu une notion courante, contre toute évidence. En revanche, les accords de Ialta incluaient une clause secrète, inavouable, qui ne sera avouée que trente ans plus tard, ce qui oblige à enfreindre ici l’ordre chronologique déjà transgressé, en cet Arrière-propos, par les références au rapport secret de Khrouchtchev, aux souvenirs de Svetlana Allilouieva, au témoignage de Soljénitsyne et d’autres. (Le caractère de la présente adjonction à un livre âgé d’une quarantaine d’années rend l’irrespect chronologique inévitable, là où les secrets d’État ont tenu tant de vérités sous le boisseau. On ne saurait prétendre qu’à tracer à grands traits la chronique et qu’à suggérer des lectures complémentaires.)
La clause secrète de Ialta comportait l’engagement de « rapatrier » de gré ou de force, les sujets dénommés arbitrairement soviétiques, de catégories très diverses, et installés hors de leur pays natal. Personne en Occident n’eut connaissance de l’action effroyable par laquelle Roosevelt et Churchill, ignares en cette matière et inconscients, croyant n’avoir rien à refuser à Staline livrèrent aux sbires et aux bourreaux de la Guépéou plus de 2 millions d’individus, hommes, femmes et enfants. Un grand nombre de ces malheureux préférèrent le suicide, beaucoup d’autres ne cédèrent qu’aux plus cruelles violences, la plupart périrent dans les affres du Goulag dont le nom n’était pas encore répandu à travers le monde, alors que des chefs d’État qui se respectent, ou leurs conseillers, n’avaient pas le droit d’ignorer la chose *.
À Potsdam, le président Truman était encore plus novice que son prédécesseur devant « Uncle Joe ». Rentré aux États-Unis, il déclara en public : « J’ai fait simple connaissance avec Joe Staline et j’aime ce vieux Joe — c’est un type convenable. Mais Joe est prisonnier du Politbureau. Il ne peut pas faire ce qu’il veut. Il prend des engagements et, s’il pouvait, il les tiendrait, mais les membres du gouvernement (?) disent très nettement qu’il ne peut pas les tenir. » (Cf. L’Observatoire des Deux Mondes, 15 juillet 1948.) Par mains agents à sa solde ou à sa dévotion, Staline avait aisément accrédité la fable de sa position précaire devant la redoutable opposition de Molotov et consorts, d’où le devoir des américains de satisfaire ses exigences pour éviter le pire. Le New York Times soutenait sérieusement cette thèse, par exemple avec un article de Dorothy Thomson qui mériterait place dans une anthologie. Truman avait été chapitré par Roosevelt, celui-ci chapitré par Bénès et par son ex-ambassadeur à Moscou, le richissime et stupidissime Joseph Davies, auteur d’une apologie effrénée des mensonges et des crimes de Staline. (Cf. Mission to Moscow, New York, 1941.)
Ayant affaire à de telles compétences, « Uncle Joe » n’avait aucune peine à se faire passer pour un démocrate débonnaire et philanthrope, par contraste avec l’intraitable et méchant Molotov. On lui devait aide et assistance de toutes les manières, sous toutes les formes. Aussi l’armée américaine au cœur de l’Europe reçut-elle l’ordre de laisser à l’Armée rouge l’avantage de prendre Berlin et Prague. On en sait les conséquences. William Bullit, ami personnel de Roosevelt et son ambassadeur Moscou, puis à Paris, a éclairé la conduite de Roosevelt dans son article de 1948 : « Comment nous avons gagné la guerre et perdu la paix ». Il y expose les conditions dans lesquelles fut accordé le « prêt et bail » américain à l’allié de Hitler sans contrepartie d’aucune sorte, Staline bénéficiant ainsi d’une aide s’élevant à 11 milliards de dollars.
Roosevelt parlant de Staline dit à Bullit : « Si je lui donne tout ce que je puis lui donner sans rien lui demander en retour, noblesse oblige, il ne pourra penser à annexer quoi que ce soi et acceptera de travailler avec moi à un monde de démocratie et de paix. » Bullit fit remarquer qu’en fait de noblesse oblige, « il n’était pas question en l’occurrence du duc de Norkolk, mais d’un bandit caucasien qui pense, obtenant quelque chose pour rien : mon partenaire n’est qu’un âne ». (Cf. Est et Ouest, B.E.I.P.I., supplément, 16 mai 1949.)
Bullitt ne croyait pas si bien dire en qualifiant Staline de bandit. Il ne savait pas que Jaurès, au début du siècle, avait écrit à Charles Péguy : « Une classe née de la démocratie, qui, au lieu de se ranger à la loi de la démocratie, prolongerait sa dictature au-delà des premiers jours de la révolution ne serait bientôt plus qu’une bande campée sur le territoire et abusant des ressources du pays. » Sous la plume de Jaurès, bande n’est pas une injure, mais une définition. Et comment désigner les membres d’une bande, surtout leur chef, alors que la bande campe, en 1977, depuis soixante ans ? Bullit cite l’ex-ambassadeur Joseph Davies pour qui « la parole d’honneur du gouvernement soviétique est aussi sûre que la Bible », et il commente : « Il (Davies) ne mentionne pas le fait que Staline avait violé autant d’accords internationaux que Hitler. »
Et comment définir le chef d’une bande qui a envoyé un assassin au Mexique pour tuer un adversaire politique en exil ? Le 20 août 1940, Léon Trotski eut la crâne fracassé d’un coup de piolet assené par un de ses partisans, en réalité agent de la Guépéou, aux ordres. Acte de banditisme caractérisé, lâche et cruel, signé Staline. La victime n’avait plus d’autre arme que sa plume dans sa lutte politique. Et ce crime n’est qu’un anneau dans une chaîne sans fin de crimes dont l’initiative stalinienne le laisse aucun doute : les attestations et les preuves abondent, qui n’ont pas ici leur place. Indénombrables sont les crimes individuels de Staline comme seront innombrables les victimes de ses crimes collectifs. Et c’est en préparant un autre crime comparable en monstruosité à sa collectivisation, à ses famines, à la guerre dont il est co-responsable, que son cerveau pervers défaillera une fois pour toutes.
Staline avait emprunté à Hitler la notion des « Juifs utiles », c’est-à-dire du petit nombre d’entre eux qui sont temporairement irremplaçables et qu’on aura loisir de supprimer dès que seront formés des remplaçants capables. Il en conservait donc quelques-uns bien en vue, très peu, pour donner le change, éliminant les autres de leurs positions ou fonctions responsables, tout en méditant sa version future de la « solution finale », selon l’expression hitlérienne. De même, les cyniques de Moscou étiquetaient « idiots utiles » leurs sympathisants à l’étranger, définis comme « libéraux » aux États-Unis, comme « intellectuels de gauche » en France (y compris la sous-catégorie des « existentialistes »), ces deux pays n’ayant pas l’exclusivité d’une telle perversion. L’une des plus étonnantes réussites de Staline a été la mise en œuvre et la mise en scène, à son profit, d’un déploiement de courtisanerie sans précédent, d’un concert inouï de louanges délirantes qu’on ne saurait qualifier en aucune langue.
La contagion s’en est propagée partout hors de son domaine, appuyée par des moyens de corruption multiples, et dont la pression n’a pas peu contribué à orienter les pouvoirs publics « bourgeois » dans un sens favorable à l’impérialisme soviétique. Il s’y mêlait, certes ce qu’Anatole France appelle « la générosité tumultueuse des idées générales », en la circonstance une séduction naturelle des principes abstraits du socialisme, encore que la pratique de Staline en ait toujours pris le contre-pied dans la pratique. Personne ne pouvait faire entendre la vérité à la multitude des ignorants et des naïfs, englobant les « milieux bien informés », les « cercles autorisés » et autres fictions couramment admises. Il en résulta la possibilité pour une puissance maléfique d’acquérir la complaisance quasi universelle en faveur de sa volonté dominatrice.
Pourtant on avait vu Staline à l’œuvre pendant la guerre civile espagnole, de 1936 à 1939, où ses interventions démentaient les professions de foi socialistes affichées, au seul avantage de la contre-révolution, au seul détriment du camp démocratique. On l’avait vu, en pleine guerre européenne, entreprendre sa persécution homicide conte le Bund polonais, et exercer sa judéophobie meurtrière sur les intellectuels inoffensifs, pour la seule raison de leur origine, et sous le prétexte perfide de « cosmopolitisme ». C’était à qui ne voulait pas comprendre. D’ailleurs bien des actions de Staline s’avéraient réellement incompréhensibles aux dirigeants occidentaux et aux « guides de l’opinion ».
Ainsi quand il supprime d’un trait de plume l’Internationale communiste, le 15 mai 1943, les « experts » imaginent qu’il a donné satisfaction à une exigence de Roosevelt. Supposition gratuite et entièrement fausse : Roosevelt n’y était pour rien, l’explication se trouvait déjà dans le présent ouvrage qui rapporte cette parole de Staline : « L’Internationale communiste ne représente rien et n’existe que par notre soutien. » On a de lui d’autres appréciations encore plus méprisantes sur cette « petite boutique ». Il n’attendait qu’un moment favorable pour s’en débarrasser et, faisant d’une pierre deux coups, faire jaser les bavards. Roosevelt avait trop peur de lui déplaire, il l’a dit à maintes reprises. Et Staline en ce cas n’avait renoncé qu’à une façade, gardant la haute main sur les partis communistes ravalés à la condition d’humbles domestiques.
Même incompréhension en Occident devant les mesures obscurantistes imposées dans les lettres et les arts, sous l’autorité nominale d’André Djanov, contre les écrivains et artistes de talent, Anna Akhmatova, Boris Pasternak, Chostakovitch et tant d’autres. Le terme de « jdanovisme » mis alors en circulation était impropre, Jdanov n’étant qu’un instrument de Staline. De même avait-on parlé à tort de ejovchtchina pour désigner la période où Ejov commandait à des répressions terrifiantes, bien qu’il ne fût lui aussi qu’un serviteur de Staline. Singuliers artifices du langage qui révèlent une tendance irraisonnée à exonérer Staline d’une partie de ses turpitudes.
Il fallait, à la longue, un aveuglement étrange et tenace pour ne pas savoir ce qu’était Staline, pour ne pas le comprendre, ne pas lire dans son jeu implacable, même après le massacre des infortunés Polonais, en majorité des officiers de réserve, sans défense, massacre froidement conçu et commandé afin de saigner à blanc l’Intelligentsia de la Pologne *. Pendant toute la guerre, Staline n’a cessé de poursuivre son génocide propre, à plusieurs fins, selon ses critères personnels au service de ce que ses complices masqueront sous la formule du « culte de la personnalité ». La nomenclature de ses obsessions, de ses phobies, de ses délires accompagnés ou suivis d’actes meurtriers exigerait tout un chapitre. On n’a jamais su exactement en quoi avait consisté une certaine « affaire de Léningrad » qui a décimé les cadres supérieurs du Parti dans cette ville. Ce qui paraît indiscutable, c’est que pour Staline, il n’y a que les morts qui ne parlent pas, qui ne reviendront jamais. Le nécrologe est interminable, de ce régime terroriste dont l’espèce de fascination exercée sur les représentants de l’Occident civilisé est peu intelligible.
Roosevelt se proposait d’« apaiser » Staline (c’est l’expression américaine) en allant au-devant de ses désirs, sans réciprocité aucune. Il fut assez inconscient pour se déplacer, lui malade et âgé, jusqu’à Téhéran et Ialta « pour rencontrer Staline face à face et le convaincre d’accepter des voies chrétiennes et des principes démocratiques », écrit W. Bullitt qui décrit l’invasion de l’administration à Washington par les communistes et leurs amis. « Le département d’État, celui du trésor ainsi que d’autres institutions furent farcis de partisans des Soviets. Le département de la Guerre commença à admettre les communistes connus et les bolchévisants dans les rangs des officiers ayant accès aux informations secrètes. » Etc. Il s’en fallut de peu pour que le vice-président Henry Wallace, pro-stalinien par ignorance et ingénuité, ne devînt président des États-Unis à la mort de Roosevelt en 1945. Truman hérita de cette politique. Churchill ne se sentit pas capable de s’y opposer. Staline n’entrevoyait aucun obstacle.
Finalement, le poids de l’industrie américaine combiné avec la ténacité britannique ont eu raison de la démesure nazie, Staline ayant dépensé sans compter la matière première humaine qui ne sera évaluée qu’après sa mort. Par les plus vulgaires procédés de la réclame commerciale, de part et d’autre, tout fut mis en œuvre pour que Staline, surtout par la grâce de ses alliés provisoires, apparût comme grand vainqueur de la guerre qu’il avait fomentée avec Hitler. Rien ne fut épargné pour l’exalter, le couronner, le combler des honneurs immérités de la victoire.
Roosevelt dans sa prescience, était sûr que Staline « n’essayera pas d’annexer quoi que ce soit et œuvrera avec moi pour un monde de démocratie et de paix ». En fait, Staline a annexé plus de 680 000 kilomètres carrés peuplés de près de 25 millions d’âmes. En outre, il a soumis six pays européens étendus sur près de 800 000 kilomètres carrés et peuplés de quelque 90 millions d’habitants. Roosevelt n’a pas vécu jusqu’à constater l’aboutissement de sa politique, dont les conséquences stabilisées après trente ans d’existence ont eu leur consécration à la conférence d’Helsinki en 1975. Mais il a eu des disciples car en France, devant l’Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères s’est félicité, rapporte le Figaro du 30 octobre 1975, de la conférence d’Helsinki, « la grande entreprise à laquelle le général de Gaulle avait ouvert la voie il y a dix ans ». En réalité, Roosevelt eut sur de Gaulle, dans le même esprit, vingt ans d’avance.
« Staline a changé », tel était le leitmotiv qu’entendait W. Bullitt à la Maison Blanche, au département d’État et autres institutions gouvernementales à Washington, répété par les fellow-travelers (compagnons de route des communistes) au cours de ces années funestes. Qu’en savaient-ils, et pourquoi Staline aurait-il changé ? La preuve qu’il restait toujours le même, il l’a donnée dès le 6 juin 1945 en affirmant mordicus à Harry Hopkins que Hitler n’était pas mort. Mensonge grossier, sciemment mis en circulation pour chercher querelle en cas de besoin. (Moscou n’admettra qu’en 1968 la mort de Hitler.) Le seul fait qu’au procès des « criminels de guerre » à Nuremberg, en novembre 1945, les représentants soviétiques aient siégé au tribunal en tant que juges au lieu d’être au banc des accusés ne pouvait que stimuler Staline dans son arrogance et ses prétentions sans limites.
Staline n’avait pas changé et ne pouvait changer dans son comportement pathologique et incurablement criminel. Tous ses actes, tous les faits le prouvent, dont on ne saurait mentionner que peu d’exemples dans cet Arrière-propos sommaire qui se limite à noter l’essentiel d’une carrière horrifiante et à suggérer l’essentiel de lectures complémentaires. Étant entendu que les crimes de Ejov, chef de la Guépéou, et ceux de Béria, son successeur, doivent être inscrits au compte de Staline, leur seigneur et maître.
Hérodote raconte que Xerxès, fils de Darius, avant l’invasion perse en Grèce, ordonna de fouetter les flots de la mer Égée qui avait brisé son pont de bateaux, pour apprendre aux vagues à se tenir tranquilles. De même Staline prétendit commander aux éléments indociles et décida de détourner les courants aériens pour entreprendre la « transformation stalinienne de la nature » en complantant des rideaux d’arbres sur des kilomètres de terrain afin de dissuader les vents de contribuer à dessécher d’immenses régions arides. Un énorme tintamarre apologétique accompagna cette coûteuse expérience sans précédent, condamnée d’avance par les arboriculteurs compétents, et qui prit fin en effet sur un piteux fiasco soigneusement passé sous silence.
Le « coryphée de la science », comme disaient ses flatteurs, ne s’en tenait pas à cette extravagance écologique. Il se mêla aussi de biologie et de génétique. Illettré en la matière, il accorda pleinement sa confiance à un charlatan agronome, Trofim Lyssenko, qui se targuait de créer une agrobiologie matérialiste et « prolétarienne » opposée aux loi de Mendel, aux travaux de Morgan taxés d’idéalisme bourgeois et retardataire. L’imposteur pseudo-marxiste couvert par le génie universel qui avait misé le sort de l’Europe sur Hitler parvint à ses fins en chassant de l’Académie des sciences agricoles Nicolas Vavilov, savant véritable, et ses collaborateurs irréprochables, tous taxés de sabotage, de « trotskisme » et autres mensonges infâmes, pour être livrés aux tourmenteurs de la Guépéou (Vavilov et beaucoup d’autres moururent en prison ou dans les camps du Goulag). Il imposa par la terreur sa théorie de l’« hérédité des caractères acquis », au mépris des connaissances de la génétique classique, condamnée comme « occidentale », et comme si le stalinisme inculqué aux fidèles serait transmissible à leur progéniture par les gènes et les chromosomes, dont l’existence même était niée par lui d’autre part. Quant à ses expériences agronomiques concluantes à rebours et à grandes pertes, rien n’en subsiste. Il s’agit là, encore et toujours, de stalinisme sous le pseudonyme fallacieux de « marxisme-léninisme ».
Dans ses rapports avec le communisme international, Staline a pu soumettre et avilir les anciennes sections de l’organisation créée par Lénine, mais après des épurations qui ont duré un quart de siècle, renouvelant presque entièrement leur composition et combinées avec une corruption sans précédent dans l’histoire du mouvement ouvrier. Mais il s’est lourdement trompé en croyant asservir les sections de Yougoslaves et de Chine (cette dernière ne s’affranchira qu’après sa mort, mais déjà de son vivant apparaissent les signes d’une volonté d’indépendance).
Khrouchtchev, dans son rapport secret, exposant la « folie des grandeurs » de Staline, cita le mot de celui-ci : « Il me suffira de remuer le petit doigt, et il n’y aura plus de Tito. Il s’écroulera. » Dénonçant cette « mégalomanie » Khrouchtchev a souligné la méconnaissance du mégalomane devant un chef communiste très averti, ayant « derrière lui un État et un peuple élevés à la rude école des combats pour la liberté et l’indépendance ». Staline ne se borna pas à « remuer le petit doigt », il a remué ciel et terre sans intimider Tito, homme sans illusion sur son adversaire. Hitler était plus clairvoyant quand il disait au maréchal Antonesco : « Quel homme ce Tito !…On ne pouvait pas faire un pas en Serbie sans danger. Voilà un véritable héros national… À côté de lui, le général de Gaulle était un héros de T.S.F. » À la vérité, Tito savait à qui et à quoi il avait à faire, contrairement à Roosevelt, à Churchill, à de Gaulle, et sa résolution de résister correspondait aux moyens de sa résistance. La leçon n’a pas été comprise à Washington, à Londres, ni à Paris dans les milieux dirigeants. Elle ne sera pas perdue pour Mao Tsé-tung ni pour les Albanais quand ils se heurteront aux successeurs de Staline. Ils sauront réagir sans faiblesse et tenir le seul langage que les staliniens comprennent.
Pendant la guerre et ensuite, la persécution des Juifs dont l’idée fixe hantait l’esprit de Staline stimulé par l’exemple de Hitler, cette persécution se poursuivait sans merci, et les mesures judéophobes les plus cruelles se succédaient contre les intellectuels et les artistes traités de « cosmopolites », livrés à l’arbitraire effréné du régime, de plus en plus proche du « national-socialisme » germanique, Staline ruminait son grand dessein exterminateur par d’autres procédés que ceux de Hitler, à des fins identiques.
Brusquement l’heure fatale sonna le 13 janvier 1953 quand fut annoncée la découverte d’un complot de « médecins terroristes » accusés de tuer sournoisement leurs malades (Jdanov et autres importantes personnalités politiques et militaires), en outre d’être à la solde de services secrets étrangers, notamment d’une institution philanthropique juive dénoncée comme criminelle. Ces « bourreaux du genre humain » (sic), comme il se doit, avaient tous passés des aveux. Il s’agissait de neuf sommités de la médecine, académiciens et professeurs, dont six d’origine juive, et peu après s’y ajoutèrent six autres. Ils étaient les médecins du Kremlin, devenus des « assassins en blouse blanche ». Cette invention fantastique, inimaginable, accueillie avec intérêt et déférence dans le mode extérieur intoxiqué de propagande communiste, ne put tromper personne dans le monde soviétique : c’était l’annonce du pogrome final, dont nul ne prévoyait encore les modalités. Les secrets techniques de la Guépéou sont lents à filtrer *.
Ils filtrent pourtant, avec le temps, car des initiés finissent par passer. La déportation en masse des Juifs dans l’extrême-nord glacial de la Sibérie était dès lors une prévision courante dans le Parti et autour de celui-ci. Vingt ans après la menace qui planait sur des millions d’innocents, Alexandre Soljénitsyne écrira dans l’Archipel du Goulag : « …Selon les rumeurs qui circulaient à Moscou, le plan de Staline était le suivant : au début de mars, on devait pendre les médecins assassins sur la place Rouge. Les patriotes, piqués au vif, devaient naturellement (sous la conduite d’instructeurs) se lancer dans un pogrome et, alors, le gouvernement (on reconnaît bien là le caractère de Staline, n’est-ce pas ?) aurait magnanimement sauvé les Juifs de la fureur populaire en leur faisait quitter Moscou dans la nuit même, en direction de l’Extrême-Orient et de la Sibérie, où l’on était déjà en train de leur préparer des baraques. » On sait le taux de mortalité dans les camps de la mort lente, où sont de surcroît innombrables les cas de mort violente.
Le sort en décida autrement : le 3 mars 1953, un communiqué officiel annonçait l’hémorragie cérébrale qui avait terrassé Staline précédant de trois jours l’information nécrologique : le malade était mort le 5 mars sans avoir repris connaissance. La coïncidence avec l’affaire des « médecins empoisonneurs » devait donner lieu à diverses hypothèses et maints commérages, dans un pays où tout est secret, même sans raison. Selon Lev Nicouline, Staline ayant donné l’ordre de n’être approché par personne sans son appel, il s’était enfermé et nul n’osa tenter de pénétrer chez lui avant une journée d’attente. Ses plus proches auxiliaires furent alors alertés, qui forcèrent la porte, mais trop tard pour porter secours au mourant. Version très plausible et d’ailleurs aucun correctif n’aurait d’importance. Un mois après, les médecins terroristes, assassins en blouse blanche, étaient libérés, « réhabilités » à la manière hypocrite du stalinisme, sans explication sincère et véridique sur la machination dont ils furent victimes. Deux d’entre eux étaient morts sous les tortures.
Tous les « experts » occidents prévoyaient l’ascension de Molotov ou de Malenkov au « sommet » du Secrétariat. Ce ne fut ni l’un, ni l’autre. Le choix de la direction collective se porta sur un des membres du Politbureau le moins en vue, Nikita Khrouchtchev, sans doute parce qu’il était le plus rassurant pour ses collègues apeurés, le plus capable de respecter le conseil de Lénine : « Ne pas verser le sang dans le Parti », alors que Molotov et Malenkov avaient trempé le plus directement dans les crimes de Staline visant leurs camarades du Comité central. Le sang coula, néanmoins, dans les hautes sphères du Parti, l’habitude prise étant une seconde nature ; le « système » établi par Staline ne pouvait fonctionner autrement. Nombre d’exécutions capitales eurent lieu, en réalité des assassinats, celui de Béria en particulier (dont Khrouchtchev a donné plusieurs versions) et celui de divers tchékistes notoires. « Mais ceci est une autre histoire. »
Aussitôt après la mise en scène pompeuse des cérémonies funèbres et les commentaires aussi grandiloquents qu’insincères en l’honneur du défunt, un profond soulagement se fit sentir dans la société soviétique. Le nom de Staline qui pullulait chaque jour à chaque page des journaux, sous la terreur, disparut presque entièrement, et bientôt tout à fait
À l’étranger, l’incertitude donnait lieu à toutes sortes d’hypothèses vaines, le prestige factice de Staline ayant perverti les milieux influents et désorienté l’opinion publique. Qu’il suffise de rappeler qu’en France, pays traité en ennemi par Staline, le Parlement avait rendu un solennel hommage à l’allié de Hitler, tous les députés debout pour entendre le laïus de leur président ; un seul socialiste, un seul, qui n’avait rien oublié, eut la dignité de rester assis, et son nom, Jean Le Bail, mérite d’être noté à ce titre. Les autres parlementaires, toutes opinions confondues, partagèrent le deuil des complices.
Pourtant à Téhéran, comme à Ialta et en toutes circonstances, Staline avait manifesté son hostilité ou son mépris envers la France qu’il tenait pour belliqueuse, agressive et impérialiste. Selon lui, pendant la guerre, « c’est Pétain qui représente la France, de Gaulle ne compte pas ». Dans ses tractations avec l’Angleterre, il propose à Anthony Eden une entente pour qu’elle occupe en permanence des bases militaires en France en temps de paix, atteste Churchill dans ses Mémoires. La liste de ses faits et gestes d’inimitié serait longue. Retenons au moins que 16 000 Alsaciens et Lorrains français, captifs du Goulag, ne sont pas rentrés en France, victimes du traitement barbare infligés aux prisonniers de toutes sortes sous Staline. (Cf. « Staline contre la France », in Est et Ouest, n° 34, Paris, novembre 1950. Et : « Jean Le Bail », in Contrat social, vol. X, n° 3, Paris, mai 1966.) La République française ne lui en tenait pas rigueur, au contraire.
Mais le triste « culte de la personnalité » de Staline, en France et ailleurs allait tourner à la confusion des fidèles en 1956, après que se tint à Moscou le vingtième Congrès du Parti où Khrouchtchev prononça le « rapport secret » qui ne tarda guère à être ébruité malgré les précautions prises. Il a bien fallu s’y référer ici sans respecter la chronologie puisqu’il évoque tant de choses à titre rétrospectif. Ce document, émondé du verbiage pseudo-marxiste et des mensonges conventionnels qui entretiennent le mythe du Parti et les légendes du régime, mériterait une reproduction entière. Car lu en connaissance de cause, il confirme et justifie toute ce qu’expose le présent ouvrage la révision de l’histoire officielle. Quelques passages, même, semblent inspirés par ce livre-ci, bien que ce ne soit pas le cas, mais doivent être remarqué cum grano salis. Il est à lire en entier. Après les emprunts déjà faits plus haut, on se limitera à mettre quelques traits en relief : ils prouvent que les pires ennemis du communisme soviétique ne l’ont jamais dénigré tel que Khrouchtchev le dévoile.
Parlant du « complot des médecins » il révèle que Staline en personne « ordonna l’arrestation d’éminents spécialistes et donna ses instructions quant à la conduite de l’enquête et aux méthodes d’interrogatoire (…). Il prescrivit que l’académicien Vinogradov soit chargé de chaînes, que tel autre soit roué de coups ». Il dit au ministre de la Police : « Si vous n’obtenez pas de confessions des docteurs, nous vous trancherons la tête. » Il donna ses ordres au juge d’instruction : « Des coups, des coups et encore des coups. » Etc. Cela confirme ce que l’on savait d’autre part sur la satisfaction sadique de Staline en matière de répression inquisitoriale ; cela s’applique aussi à des milliers d’autres innocents tourmentés à mort par des tortionnaires aux ordres.
Khrouchtchev s’en prend spécialement à Béria qu’il accuse, non sans raison, des pires forfaits et traite d’espion (?) au service de l’étranger. « Il est maintenant prouvé que ce scélérat a gravi les divers échelons du pouvoir en passant sur un nombre incalculable de cadavres », dit-il, ce qui est vrai, mais également vrai pour toute l’équipe alors au pouvoir, y compris Khrouchtchev qui semble frappé d’amnésie quant à son rôle en Ukraine. (Cf. Lazar Pistrak : The Grand Tactician. Khrushchev’s Rise to Power. New York, 1961.) Le rapport cite nommément des cas lamentables de cruautés commises par Béria « qui avait liquidé des dizaines de milliers de personnes » innocentes. Cela remet en cause Staline autant que Béria et tout le régime pseudo-socialiste.
Staline n’est pas moins mis en cause quand Khrouchtchev dénonce le prédécesseur de Béria, qui dressait des listes de gens condamnés d’avance : « Ejov envoyait ces listes à Staline… En 1937-38, 383 listes portant les noms de plusieurs milliers de bons serviteurs du Parti, des soviets, du Komsomol, de l’armée, etc, avaient été envoyées à Staline », qui ratifiait ces sentences de mort collectives. (Ultérieurement Khrouchtchev, dans ses mémoires, écrira que les victimes ainsi désignées étaient envoyées au « hachoir » à viande.) Il révèle que Staline suspectait Vorochilov d’être un espion anglais, s’apprêtait à liquider Molotov et Mikoïan, ainsi que tout le Politbureau, afin de « recouvrir d’un voile de silence ses actes honteux ». Lui-même, Khrouchtchev, ainsi que Boulganine craignaient à tout moment d’être expédiés au « hachoir ».
Le rapport désormais public et fameux, sauf dans l’Union soviétique où il n’a pas été imprimé à l’usage de la population, ne donne qu’une douzaine de noms bien connus dans les cadres du Parti, à titre d’exemples, alternant avec le leitmotiv obsédant des tortures infligées aux victimes d’« accusation folles et contraires au bon sens ». Ce n’était qu’un début, prudemment dosé, avec le souci de sauvegarder la raison d’être du parti, la fiction d’une terminologie simili-marxiste mêlée à une part de vérités, pas trop, de façon à maintenir le mensonge fondamental sur lequel repose tout l’édifice de l’État totalitaire. Tel qu’il est parvenu jusqu’à nous, après quelque censure opérée en haut lieu, il apporte une contribution essentielle à la biographie de Staline. Une lutte sourde se déroulait dans la coulisse entre le groupe prépondérant qui sera dénommé « antiparti », étiquette aussi arbitraire que les injures courantes dans l’oligarchie suprême. Elle apparaîtra au grand jour à l’occasion du vingt-deuxième Congrès, en 1961, plus révélateur encore que le rapport secret, pour l’histoire.
En effet, cette fois, ce n’est plus le seul Khrouchtchev qui cloue au pilori le seul Staline flanqué de ses deux larrons, Ejov et Béria traités ouvertement de « crapules » par leurs apologistes de naguère, c’est toute une kyrielle d’orateurs qui, de la tribune du congrès, vont mettre en accusation les principaux adjoints du tyran discrédité, nommément Molotov, Malenkov, Kaganovitch, Vorochilov, Boulganine. Parmi ces accusateurs publics figurent Brejnev, Podgorny, Souslov, Mikoïan, Fouetseva, Kuusinen, Chelepine, Pospelov, Ponomarev, pour ne signaler que les plus connus. On ne saurait résumer en quelques lignes un compte rendu de 1 800 pages *. Tous les discours répètent inlassablement les mêmes formules sur le « culte de la personnalité », sur le grand Lénine, sur le Parti infaillible, sur la glorieuse révolution d’Octobre. Mais ces litanies concertées au Politbureau servent à encadrer d’impitoyables réquisitoires contre le « groupe antiparti » qui n’aurait pas hésité à liquider la coterie dirigeante s’il avait réussi à la supplanter au Secrétariat (c’est dit et répété plusieurs fois en toutes lettres).
Retenons que Molotov, Malenkov, Kaganovitch et consorts sont déclarés « coupables des crimes les plus graves » et de « massacres d’honnêtes gens » à n’en plus finir. Ils ont tantôt décimé, tantôt exterminé, sans rime ni raison, de précieux cadres du Parti. Ils ont commis « crimes crapuleux » sur « répressions brutales » (répressions étant synomyme de tortures et d’assassinats). Celui-ci tuait de sa propre main des travailleurs sans reproche, celui-là « torturait ses subordonnés ». L’un est un « véritable sadique », l’autre est une « ordure », l’un et l’autre sont des « bêtes féroces », qui n’ont « plus rien de communiste ». Cela remplit des pages et des pages d’un compte rendu pourtant expurgé pour la publication. Dans la monotonie de ces redites, une seule parole humaine s’est fait entendre, que les censeurs ont oublié d’effacer : « On se demande parfois comment ces gens (Molotov et ses compères) peuvent marcher tranquillement et dormir tranquilles. Les cauchemars devraient les poursuivre, ils devraient entendre les pleurs et les malédictions des mères, des épouses et des enfants de nos camarades qui ont péri innocents. » Ce cri mémorable d’A. N. Chelepine appelle un amendement : en général, les mères, les épouses, les enfants périssaient de même, le sort de toute la famille Toukhatchevski le prouve.
« J’en ai la gorge serrée d’entendre décrire les souffrances physiques et morales qu’on qu’on dû endurer ces braves combattants du Parti », déclare l’un des accusateurs. Et cependant aucun des accusés n’est admis à se défendre et les criminels ne sont pas traduits en justice. Ce qui montre que la Constitution soviétique, les statuts du Parti, la législation et le reste sont des chiffons de papier, que le stalinisme survit à Staline, mais un stalinisme sans la démence de son créateur. Et quand un certain N. N. Rodionov taxe les Molotov, Malenkov et autres Kaganovitch « de banditisme, de brigandage », on ne saurait mieux justifier la sentence de Jaurès sur « une bande campée sur le territoire » et le mot de W. Bullitt sur le « bandit caucasien ». Il s’agit effectivement de banditisme politique, et non pas, comme le croit une multitude d’ignorants et de philistins à travers le monde, de « marxisme ».
Il importe aussi de souligner que c’est seulement à ce congrès cinq ans après le précédent, que les maîtres de l’heure se sont décidés à « réhabiliter » enfin en les nommant Toukhatchevski et les autres militaires de haut rang calomniés, insultés, salis, assassinés, eux et leurs proches, par décision du Politbureau (aucun simulacre de tribunal, invoqué mensongèrement en 1937, n’avait été nécessaire). Il en appert que le souci de la vérité et de la justice n’est pour rien dans cette pseudo-réhabilitation, issue de sordides calculs et de marchandages politiques entre profiteurs de tous ces crimes. Pour comble de dérision, le vingt-deuxième Congrès décida un monument expiatoire en l’honneur des innombrables victimes, décision restée lettre morte. La seule résolution mise en vigueur fut celle d’expulser du mausolée de Lénine le cadavre de Staline qui y était placé, en même temps que le nom de Volgograd remplaçait l’appellation maudite de Stalingrad.
Et quel monument aux morts aurait pu être dressé à proportion du nombre des victimes sacrifiées aux appétits insatiables de puissance et de gloriole du « plus grand des chefs de tous les temps et de tous les peuples », comme disait dévotieusement Serge Kirov ? En 1950, dans une étude sérieuse et aussi bien documentée que possible à cette date, Paul Berline s’est efforcé d’évaluer les pertes soviétiques pendant la guerre fomentée par Staline avec Hitler. (« Combien y a-t-il d’habitants en U.R.S.S. ?, » in Est et Ouest, n° 35, Paris, novembre 1950.) Par différentes méthodes de calcul, dont les résultats concordent, on constate que « 37,5 millions de vies humaines représentent le coût démographique de la guerre » pour l’Union soviétique, soit 30 millions de morts et 7,5 millions de manque à naître. Longtemps les menteurs de Moscou n’ont voulu avouer que 17,5 millions de morts, mais ils ont fini par admettre le chiffre de 25 millions, qui figure dans la dernière édition (1976) de l’Histoire de l’U.R.S.S., d’obédience stalinienne, publiée par les Presses universitaires de France parmi la quantité de livres de même tendance. L’Allemagne qui a mené une guerre plus longue, et sur trois fronts, n’a perdu que 2 800 000 militaires et 500 000 civils. Telle fut la supériorité du « génial » Staline.
Moins de trois ans plus tard, une autre étude du même Paul Berline : « Ce que Staline a coûté en vies humaines à l’U.R.S.S. » (in Est et Ouest, n° 82, Paris, février 1953) dénombre les pertes causées par les famines, la collectivisation, la mortalité dans les camps, l’agression contre la Finlande, la guerre mondiale, la dénatalité, le génocide perpétré contre les allogènes, etc., pour conclure aussi sur le chiffre terrifiant de 37,5 millions d’âmes. On ne connaît pas le précédent. Mais depuis cet exposé très détaillé, fortement motivé, d’autres données d’origine soviétique ont permis des recoupements, des rectifications, des inductions qui font pâlir les évaluations précédentes.
En 1964, le professeur I. Kourganov, économiste, statisticien et démographe, dans un exposé qui s’intitule : « Trois chiffres », compilant et confrontant exclusivement des données soviétiques concluait à une perte de 44 millions d’âmes pendant la guerre voulue par Staline conjointement avec Hitler (mortalité, plus dénatalité). Il calculait les pertes antérieures à la guerre, depuis la révolution d’Octobre, comme s’élevant à plus de 66 millions d’âmes. Et par conséquent, le coût de la révolution et du régime soviétique dépasserait 110 millions de vies humaines, tant par mort prématurée que par dénatalité consécutive à cette catastrophe démographique. Tous les chiffres, coefficients, taux de fluctuations sont mis en œuvre devant le lecteur, avec leurs références indiscutables. Seul l’immense pays soviétique a pu subir une hémorragie aussi effroyable, portée par Alexandre Soljénitsyne à la connaissance d’un vaste public occidental sans en troubler l’indifférence *.
De Gaulle n’avait sans doute pas la moindre idée de ce bilan démographique quand il a dit à un journaliste que Staline, pour « la Russie », a été « positif ». En effet, parlant du général Franco, « positif en dépit de toutes les répressions, de tous les crimes », il ajoute : « Staline aussi en a commis. Et même beaucoup plus. Il a pourtant été positif, ô combien, pour la Russie, qui le reconnaîtra un jour. » De Gaulle, tout comme Roosevelt, « ne savait rien de la Russie », ni du communisme, et ainsi que Roosevelt et selon George Kennan, « ne cherchait ni n’appréciait l’avis de ceux qui en savaient quelque chose ». (Au Quai d’Orsay, il fit mettre à l’écart le seul haut fonctionnaire compétent en ces matières.)
Dans ses Mémoires de guerre, racontant ses rapports avec Staline au Kremlin en 1944, de Gaulle attribue à la « passion » (?) de son interlocuteur « une sorte de charme ténébreux », outre « une volonté de puissance » qui n’a rien de commun avec ce que Nietzsche entend par cette expression. Il croit que Staline est « un Russe » et quand il parle de « la Russie », il n’emploie jamais le terme « soviétique », ou très rarement. Comme Roosevelt et comme Churchill aussi, il ne conçoit pas que le pouvoir bolchéviste soit d’une autre sorte, d’une autre nature, que celui des gouvernements classiques connus jusqu’alors. Comme Roosevelt encore, qui pensait édifier les « Nations unies » sur deux piliers, les États-Unis et l’Union soviétique, il espère réaliser une Europe étendue « de l’Atlantique à l’Oural », associant la France à « la Russie ». Dans ses Mémoires, où il faut faire la part du talent littéraire et des arrière-pensées politiques, il laisse entendre qu’il n’est pas dupe de la mise en scène agencée en son honneur à Moscou, culminant au dîner d’adieu : « La table étincelait d’un luxe inimaginable. On servit un repas stupéfiant. » Mais il finira quand même par s’incliner devant le personnage « positif ». En passant, il rapporte une apostrophe de Staline à son traducteur : « Tu en sais trop long, toi ! J’ai bien envie de t’envoyer en Sibérie. » On sait par le présent ouvrage et par le récit de Svetlana comme son père en usait envers ceux qui « en savaient trop long ». Le dernier mot n’est pas dit quant à ce qui prévaudra, du positif ou du négatif, dans la mémoire des hommes *.
Cet Arrière-propos ne prétendait pas compléter la biographie politique de Staline d’une manière exhaustive ; il y aurait fallu un autre volume traitant de la guerre, de l’après-guerre, et surtout de l’après-Staline puisque les vérités, les révélations sur le récent passé n’ont abondé, de source soviétique, qu’à partir du « rapport secret » de 1956. D’autres sources, elles, avaient filtré bien avant. On n’a pu ici qu’indiquer à grands traits l’essentiel d’un supplément à l’ouvrage interrompu en 1940 et l’on ne voudrait, finalement, que signaler les principales contributions à l’étude du sujet. Tous les témoignages authentiques, tous les exposés d’auteurs compétents et probes vont dans le même sens.
La première de ces contributions importantes, après la guerre fut celle d’Ivanov-Razoumnik dont la brochure : Destinées d’écrivains parut en 1951 aux États-Unis, précédant son livre : Prisons et déportations (New York, 1953). La brochure a été traduite et publiée en français dans le Contrat social, vol. VIII, nos 5 et 6, Paris, 1964 ; et vol. IX, n° 1, Paris, 1965. Elle évoque le sort tragique de plusieurs écrivains russes, alors qu’Ivanov-Razoumnik ignorait la mort d’Isaac Babel et de tant d’autres. La revue précitée a esquissé une liste, encore incomplète, d’écrivains et poètes assassinés ou acculés au suicide. Quant au livre, on peut en lire un extrait en français dans Est et Ouest, n° 15, du 1er décembre 1949, « tableau saisissant des prisons soviétiques et relation poignante de certains interrogatoires. Aucun éditeur français n’a eu le courage élémentaire de publier ce livre véridique indispensable ». Cet extrait est accompagné d’une introduction : « Les camps de concentration et les prisons soviétiques », anonyme (auteur Boris Souvarine qui, dans les deux publications, a écrit des notices biographiques sur Ivanov-Razoumnik).
Des témoignages de première importance sur Staline et sa camarilla sont dus aux chefs communistes yougoslaves, écrits après leur rupture avec Moscou. Communistes, ils l’étaient, et même staliniens, mais sans consentir à se soumettre à l’autoritarisme du « nouveau Tchigins-Khan », comme le dénommait Boukharine. Ils entendaient rester maîtres chez eux, et la logique de leur nationalisme naturel les a conduits à dévoiler des faits consignés dans leur mémoire. Il serait impossible de résumer en quelques lignes, voire en quelques pages, leurs livres qui montrent la grossièreté, la bassesse intellectuelle et morale des parvenus hissés au faîte de la pyramide bureaucratique-soviétique à force d’impostures cyniques et de meurtres. Vladimir Dedijer rapporte un conseil de Staline à Tito, celui-ci refusant de se prêter à un accord, même provisoire, avec le roi Pierre II de Yougoslavie : « Tu n’as pas besoin de le restaurer pour toujours. Reprends-le momentanément et, à la première bonne occasion, poignarde-le tranquillement dans le dos. » Staline est là tout entier, et vraiment « positif » : poignarder quelqu’un dans le dos, au bon moment, et surtout « tranquillement ». Dedijer a entendu Staline s’adressant par téléphone au maréchal Malinovski : « Tu dis que tu n’as pas de tanks ? Ma grand-mère n’aurait pas besoin de tanks pour se battre. Il est temps de te remuer. Tu as compris ? » La menace implicite dans les derniers mots était familière à tous les subordonnés, fussent-ils maréchaux. Un communiste yougoslave qui a vécu en Russie, témoin des « massacres qui noyèrent dans le sang la fleur des révolutionnaires yougoslaves réfugiés en U.R.S.S. » et qui lamente l’œuvre du stalinisme, « asphyxie des âmes, anéantissement des corps », est cité par Dedijer : « Staline a tué plus de communistes que toute la bourgeoisie du monde entier réunie *. »
Il existe un document saisissant, relatif à la « réhabilitation » partielle de Staline entreprise quand le Politbureau a jugé que le déboulonnage de l’idole était allé trop loin (les conséquences de cet électrochoc avaient dépassé les prévisions dans les pays asservis à l’impérialisme soviétique). C’est une longue lettre de l’historien L. Pétrovski au Comité central, datée du 5 mars 1959, et dénonçant la survivance du stalinisme, fût-ce sous des formes maquées ou quelque peu atténuées. Dans un style et avec une terminologie strictement « léninistes », elle rappelle les abominations innombrables commises sous Staline (déguisées sur le tard en culte de la personnalité) parmi lesquelles l’extermination de « brillantes cohortes du Comintern », les humiliations et les souffrances mortelles infligées des centaines de milliers de femmes innocentes, aux enfants mineurs des prétendus « ennemis du peuple » comme les fils d’Antonov-Ovséenko, de Piatiski, de Tomski, de Iakir et de tant d’autres (ces noms figurent dans le présent « aperçu historique du bolchévisme »). Elle plaide, cette lettre, pour la famille de Lénine odieusement persécutée, N. Kroupskaïa, M. Oulianova, Dmitri Oulianov (épouse, sœur et frère de Lénine). Et pour la femme de Kalinine, pour le frère et le neveu de Sverdlov, les trois frères d’Ordjonikidzé, les deux fils de G. Pétrovki, la fille de Bontch-Brouiévitch, etc., « les familles des meilleurs représentants de la vieille garde léniniste ». La lettre énumère encore les principaux militants de l’Internationale communiste envoyés ad patres, entre autres Bela Kun, Warski, Sulta Zadé, Hermann Remmelé, Vladimir Tchopitch, Ganetski, Laslo Rajk, Tanev… sans oublier Fritz Platten. (Cf. à ce sujet, de Baranko Lazitch : « Le martyrologe du Comintern », suivi de « Commentaires sur le martyrologe », par B. Souvarine, in le Contrat social, vol. IX, n° 6, Paris, novembre 1965. Sur le massacre des communistes étrangers, cf. de Roy Medvédiev : le Stalinisme, Paris, 1972.) Staline n’a pu précipiter au « hachoir » le fils et le neveu de Karl Liebknecht, qui se trouvaient hors de sa portée, mais il les a chassés du Parti. Enfin, dans la lettre de L. Pétrovski, suit un long nécrologue des compagnons de Lénine injustement tourmentés, mis à mort (leurs noms figurent presque tous dans ce livre-ci).
Le recueil des Vingt lettres à un ami, de Svetlana Allilouieva, et ses réflexions consécutives, Une seule année, parus en 1967 et 1971, déjà mentionnés plus haut en raison d’un télescopage chronologique inévitable, sont un apport documentaire inappréciable à la connaissance de Staline dans sa vie courante, son comportement dans le privé, ses relations familiales et amicales. On ne saurait faire grief à une fille de ne pas accabler son père, donc à Svetlana de décharger Staline de crimes qu’elle impute naïvement à la mauvaise influence de Béria. Mais elle n’insistera pas sur ce point, et d’un livre à l’autre, on voit qu’elle a beaucoup appris depuis son séjour en Occident. Elle ne peut plus nier que son père ait machiné l’assassinat de Kirov, « son meilleur ami ». Elle croit au suicide de sa mère, Nadiédja, mais elle répète ce qu’on a dit au Kremlin, où tout le monde ment, alors que la version du suicide, admissible en son temps, est abandonnée en privé autour du Kremlin et réfutée par des témoignages qui comptent. De même que l’hypothèse d’une mort naturelle de Gorki, acceptable avant la guerre faute d’informations précises n’est plus soutenable depuis diverses publications sérieuses d’après la guerre.
Dans l’ensemble, l’évocation du milieu où Svlétana a vécu, la description des lieux et des conditions de cette vie, l’écho de certains événements de l’époque et des propos que tient Staline, tout cela est narré avec une sincérité indéniable, un talent simple et naturel de la narratrice. Elle ne dit sans doute pas tout ce qu’elle sait et d’ailleurs en ne sait pas tout, mais elle intéresse au plus haut point l’historien assez averti pour s’orienter (ce n’est pas écrit pour la grand public désinformé). Qu’elle le veuille ou non, et malgré le sentiment filial coexistant avec l’honnêteté du témoignage, le portrait de Staline qui s’en dégage est hideux, autant que le tableau des parvenus dont le maître s’entoure, profiteurs, jouisseurs, vulgaires, parvenus tels que les ont déjà montrés Dedijer et Djilas qui les avaient vus sur place. Quiconque a connu Lénine et Trotski, ou Boukharine et Kamenev, par exemple, et quelque jugement qu’on puisse porter sur eux, ne trouve rien de commun entre cette espèce d’hommes et la « bande » que dépeint Svetlana.
La conduite infâme de Staline envers son malheureux fils aîné, Iacha (Jacob), dont il commente avec sarcasme le suicide manqué, puis qu’il laisse agoniser misérablement dans un camp allemand alors qu’il pouvait le sauver par un échange de prisonniers, son comportement criminel envers les membres de sa propre famille par alliance, les Svanidzé, les Allilouiev, spécialement contre ceux qui étaient d’origine juive, cette méchanceté révélée par Svetlana donne véritablement la nausée. On est constamment tenté de citer, mais ce serait à n’en plus finir. Pourtant il faut retenir quelque chose d’essentiel qui dépasse la biographie du personnage et le cadre de ses méfaits et forfaits, à savoir les attestations multiples de la judéophobie invétérée qui apparente étroitement Staline à Hitler, consubstantielle à sa politique d’alliance avec le national-socialisme germanique *.
Cette judéophobie virulente, inoculée à son parti inculte, déjà infecté de chauvinisme délirant, et épuré de son héritage du communisme classique, a transformé ce parti en une armée nationale-socialiste soviétique, agissant comme telle sur la scène internationale par ses innombrables ramifications publiques et secrètes Anatole France prévoyait, dans le Lys rouge : « L’antisémitisme, voyez-vous, c’est la mort de la civilisation européenne. » Il s’avère que l’hécatombe des années 40 de ce siècle n’est qu’une phase de cette perspective ; une autre se prépare au vu et au su de quiconque a des yeux pour voir que Staline et Hitler ont laissé une descendance, laquelle est à l’œuvre.
Il n’est pas vrai que l’Union soviétique soit « un rébus enveloppé de mystère, à l’intérieur d’une énigme », selon la formule célèbre de Churchill applicable seulement à la politique astucieuse du Politbureau. Celui-ci se considère en état de guerre permanent contre le monde qui lui résiste, et par conséquent ne livre pas le secret de ses intentions, de ses manœuvres, sur la place publique (contrairement aux Américains et à d’autres qui ne cessent de renseigner l’ennemi). Mais quant au régime soviétique, il n’a plus rien de mystérieux ni d’énigmatique. À preuve le livre très remarquable, essentiel, de Robert Conquest : la Grande Terreur, paru à Londres en 1968, à Paris en 1970, véritable somme des connaissances certaines, obtenues par diverses voies, sur les réalités de la vie et de la mort dans le domaine de Staline et de ses successeurs, sans rébus, ni mystère, ni énigme. Cet ouvrage corrobore tout ce que le nôtre a pu énoncer en son temps, mais le dépasse de beaucoup en tant que bilan de la terreur. (S’y ajoute : « The Great Purge », in Encounter, Londres, octobre 1968.) Il mérite de faire date et ne sera dépassé à son tour, sur certains chapitres que par un historien soviétique, Roy Medvédiev, déjà mis à contribution ici et dont on ne dira jamais assez l’importance.
Ce Medvédiev se déclare « marxiste-léniniste », étiquette inventée après la mort de Lénine pour définir la doctrine officielle patronnée par Staline. Mais il se sépare de ses congénères sur le plan moral, car il s’efforce de dire la vérité selon ses convictions (souvent criticables) et il réagit avec humanité contre les injustices et les « répressions » arbitraires (répressions qui n’ont rien à réprimer). Abstraction faite de l’idéologie, encombrée de stéréotypes, de lieux communs, de contradictions, de termes impropres, son livre sur le stalinisme est un véridique et terrifiant nécrologe qui récapitule les listes de victimes de toutes les catégories déjà connues et les enrichit de renseignements inédits dont certains font frémir. Sous ce rapport, cette œuvre capitale éclipse tout ce qui a précédé dans cet ordre de choses et enseigne beaucoup aux soviétologues les plus qualifiés. Personne encore n’avait révélé, par exemple, que l’épouse du président Kalinine dut passer sept ans au bagne, soumise à la torture comme « des centaines » de malheureuses (mais pourquoi ? pourquoi ?). La torture est appliquée aussi aux enfants. « À Leninsk-Kouznetsk, soixante enfants âgés de dix à douze ans furent arrêtés, accusés de former un groupe terroriste contre-révolutionnaire… Les responsables de l’enquête mirent à la question plus d’une centaine d’enfants. » Mais pourquoi ? pourquoi ? À cette interrogation angoissante, une seule réponse. Parce que Staline. Suprême dérision, les enfants ont été « réhabilités ». Ils n’en avaient pas moins subi la torture.
On apprend dans ce livre, entre autres choses, que des personnalités très en vue, sachant quelles souffrances les menacent, elles et leurs proches, prennent les devants. « Lioubtchenko, président du Conseil des commissaires d’Ukraine, craignant pour sa famille après sa mort, tua sa femme et son fils, puis se suicida. » Plus loin : « Vladimir tua sa femme, son fils et se donna la mort. » Plus loin : Nestor Lakoba, exécuté sous un prétexte insensé, sa veuve fut torturée plusieurs fois de suite ; « on la ramenait le matin, couverte de sang… Son fils âgé de quatorze ans, fut amené en pleurs devant sa mère à qui l’on dit qu’il mourrait si elle ne signait pas ». Les séides de Staline tuèrent l’enfant et, « après une nuit de tortures, elle mourut dans sa cellule ». La femme, le frère, la fille, les quatre sœurs de Toukhatchevki périrent de la sorte. Selon une expression courante en Russie, « cela glace le sang dans les veines ».
Au sentiment d’horreur qu’inspirent ces pratiques se mêle un sentiment de stupeur devant la soi-disant intelligentsia occidentale qui les regarde avec faveur comme des applications du « marxisme ». Au moins Medvédiev a-t-il la sagesse d’affirmer que « le marxisme n’est pas seulement un ensemble de concepts, c’est aussi un ensemble de convictions et de principes moraux ». Et il a la présence d’esprit de se référer à Marx et Engels qui, en leur temps, répudiaient déjà fermement une demi-douzaine de types du socialisme impliquant dans l’abstrait ce qui est exécrable dans celui de Staline. Aucun individu doué de raison, en France, ne saurait trouver, dans le marxisme de Jaurès, de Guesde et de Vaillant, la moindre trace de ce qui caractérise le « marxisme-léninisme ».
On savait déjà que Staline n’était pas l’auteur de certains écrits qu’il a signés pour se donner des airs de penseur et de théoricien. Medvédiev met les points sur les i. Jan Sten, qui s’est évertué à enseigner Hegel à Staline, d’ailleurs en vain, a été arrêté en 1937 et exécuté. Son article sur le « matérialisme dialectique » a paru dans une Encyclopédie soviétique, mais impudemment signé M. B. Mitine, porte-plume de Staline pour le chapitre philosophique du précis d’Histoire du Parti. La brochure de Staline sur les Bases du léninisme n’est que le plagiat d’un livre de Xenophontov dont il a fait arrêter l’auteur, tué lors de son interrogatoire. Les textes de Staline sur la linguistique, contre N. Marr, doivent leur sens à l’académicien V. Vinogradov, lui aussi emprisonné, puis de sort inconnu. Ces détails donnent quelque idée de la richesse d’infirmation du livre de Medvédiev qui mériterait, expurgé de son verbiage « marxiste-léniniste », d’être mis à la portée du plus large public. Vers la fin, un document extrait des archives du « vieux bolchévik » E. P. Frolov rassemble les principales manifestations de la judéophobie de Staline et signale une résolution votée par l’usine de tracteurs de Stalingrad (sic), préconisant la déportation générale des Juifs, c’est-à-dire la « solution finale » au sens hitlérien des termes. Ce que confirme pleinement Soljénitsyne.
Le nom de Soljénitsyne étant prononcé, on hésite à n’évoquer qu’en quelques lignes son œuvre grandiose, mais elle est inséparable de l’époque déshonorée par Staline et Hitler, avec tout ce qui leur fait cortège et prolonge leur malfaisance. Comment réprimer une réminiscence de Chateaubriand, si souvent citée, pas toujours à bon escient, mais qui s’impose beaucoup qu’après l’assassinat du duc d’Enghien : « … Lorsque, dans le silence de l’abjection, l’on n’entend plus retentir que la chaîne de l’esclave et la voix du délateur, lorsque tout tremble devant le tyran et qu’il est aussi dangereux d’encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l’historien paraît, chargé de la vengeance des peuples. C’est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dans l’empire… » Soljénitsyne n’est pas Tacite, mais il est Soljénitsyne, c’est-à-dire le Russe qui incarne la Russie civilisée et domine de toute sa grandeur morale, de toute sa richesse documentaire, ce qui a été écrit avant lui sur Staline et son régime.
Soljénitsyne est le Témoin par excellence, incarnation de mille témoignages, témoin et moraliste qui surpassent l’historien, et il a érigé à lui seul, à la mémoire des martyrs, le monument funéraire que le Parti oligarchique avait promis sans être capable de tenir sa promesse, comme cette oligarchie a menti à toutes ses promesses depuis plus d’un demi-siècle. De Soljénitsyne, le cri inoubliable : « Ne pas vivre dans le mensonge », mérite de retenir sans répit à tous les échos du monde. Sa profession de foi religieuse ne convaincra guère les incrédules, car il oublie les persécutions cruelles infligées par l’Église orthodoxe aux catholiques de Lituanie et de Pologne. Ses vues hâtives, improvisées, sommaires sur le « marxisme » et sur les origines de la révolution en Russie ne sont pas à la hauteur de son témoignage extraordinaire sur l’Archipel du Goulag ni de son talent littéraire qui l’égale aux écrivains les plus éminents. Mais cela n’amoindrit pas sa place exceptionnelle dans l’histoire de la civilisation contemporaine.
On attendait de Trotski la plus importante contribution à l’intelligence de la tragédie qui a imposé à son pays un malheur sans nom et au monde entier une guerre inexplicable. Il n’a pas répondu à cette attente avec son livre sur Staline (quelque inachevé) parce qu’il s’est interdit de porter une appréciation critique sur le parti devenu sien, donc sur le régime soviétique et ses « réalisations ». Il tenait à exprimer une solidarité indéfectible avec Lénine considéré comme infaillible, donc avec tout ce qui a déterminé l’ascension de Staline au pouvoir suprême et sans partage. Il fait preuve aussi d’un solide parti pris de justifier après coup sa propre conduite comme si, de toute façon, rien n’aurait pu modifier le cours fatal de l’histoire. En 1926, il regardait Staline comme « l’homme le plus éminent de notre parti » et sans lequel « on ne saurait constituer le Politbureau ». Avant longtemps, il le tiendra pour « la plus éminente médiocrité de notre parti ». Le droit de changer d’avis est indéniable, mais le devoir de s’expliquer là-dessus ne l’est pas moins.
On ne peut que déplorer l’imprudence très significative qui a permis au tueur stalinien de remplir sa tâche et d’empêcher Trotski d’accomplir la sienne, car vers la fin du livre sur Staline, de brèves allusions à Néron et à César Borgia semblent suggérer que l’auteur commençait à douter des explications sempiternelles et inopérantes mises en avant par lui jusqu’alors pour éclairer la prépotence de Staline. En effet, évoquer Néron et Borgia, c’était renoncer au « marxisme » primaire et caricatural consistant à invoquer la lutte des classes, l’influence des koulaks, le phénomène bureaucratique, le reflux de la vague révolutionnaire, et autres notions abstraites sans rapport avec la réalité prosaïque d’où a surgi peu à peu la monstruosité totalitaire dénommée Staline.
Quant Trotski se décide, sur le tard, à écrire « Néron », c’est l’équivalent de notre « Caligula », et le rapprochement s’impose puisque Medvédiev, de son côté, penser à « Tibère, Caligula et Néron », tandis que Boris Pasternak, dans Docteur Jivago, fait allusion à « la férocité sordide et sanguinaire des Caligula labourés de petite vérole » (allusion transparente à Staline). Les Douze Césars de Suétone offrent l’embarras du choix. Consciencieusement ou non, donc, Trotski laisse enfin son simili-marxisme au vestiaire. D’ailleurs il lui est arrivé, dix ans après sa défaite, de hasarder une réflexion selon laquelle « la lutte politique est dans son essence une lutte d’intérêts… et non d’arguments ». Or il a passé des années à opposer aux intérêts personnels de Staline des idées nourries de citations « marxistes » dont Staline n’avait cure. Ses interprétations livresques ont alimenté nombre de thèses universitaires et d’ouvrages politico-historiques dont l’influence a passablement contribué à une sorte de divagation universelle sur les rapports imaginaires entre Marx et le Goulag, et ce, des deux côtés de l’Atlantique.
Autre professeur de marxisme, Boukharine, auteur de l’A.B.C. du communisme en collaboration avec Préobrajenski, celui-ci jeté par-dessus bord et livré aux bêtes féroces. On sait que Boukharine traqué, aux abois, a reconnu en Staline un nouveau Tchingis-Khan. L’idée lui vint non de Marx, mais de Tolstoï, à qui elle venait d’Alexandre Herzen. C’est en 1910 que dans sa brochure : Tchingis-Khan avec télégraphe, Tolstoï écrivait que « le gouvernement russe se trouve précisément dans la situation dont parlait Herzen avec horreur. Il représente ce Tchingis-Khan avec télégraphe dont l’éventualité épouvantait Herzen ». Et Tolstoï énumère tout ce que la science et la technique modernes ajoutent au télégraphe. Ni lui, ni Herzen ne pouvaient concevoir ce qu’un demi-siècle de progrès matériel allait offrir de nouveaux moyens au Tchingis-Khan du Politbureau, de la Guépéou et du Goulag.
Staline a été encore comparé, non sans bonnes raisons, à Mithridate et à Hérode, illustres par la perfidie et la cruauté, grands massacreurs devant l’histoire et jusque dans leur propre famille, comme Staline. Ni l’origine, ni la race, ni la religion n’apparentent ces virtuoses du carnage, prototypes différents de despotisme oriental. Le marxisme n’a rien à y voir. À tous trois peut s’appliquer le mot de lord Acton, devenu banal à force d’être répandu : « Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. » Quant aux Borgia, d’origine espagnole, dont Trotski ranime le souvenir, Anatole France en dit : « Ils pouvaient tout : c’est ce qui les rendit effroyablement criminels. » Staline aussi pouvait tout, au nom du Parti omniscient, détenteur du sens de l’histoire.
Comme Tchingis-Khan moderne, des pédants pervers, des cuistres et des charlatans disposent aussi des merveilles de la science et de la technique, couvrant la faible voix des témoins authentiques, des historiens consciencieux, des penseurs solitaires. Ils peuvent impunément se réclamer qui de Marx, qui de Hegel, qui de Freud pour faire admirer l’« expérience » communiste camouflée sous l’idéologie trompeuse si justement dénoncée par Soljénitsyne. Ainsi les progrès de l’ignorance qui s’ignore devancent de beaucoup ceux de la mécanique et de l’électronique, favorisant la théâtromanie derrière laquelle s’élaborent les futures catastrophes. Roosevelt et de Gaulle, personnages de théâtre, se croyaient pleins de sagesse et dans la bonne voie en traitant avec Staline comme si le pouvoir de ce potentat était de même nature que tout autre pouvoir. Le général Franco, à son tour, a fait l’éloge de Staline en apprenant la réussite soviétique d’une expérience spatiale. Soixante ans après le coup de force mené par Lénine et Trotski à Pétrograd en octobre 1917, la légende de Staline et la pratique du stalinisme ont encore la vie dure.
Marx a eu l’intelligence de répudier explicitement à plusieurs reprises toute espèce de marxisme. Cela n’empêche pas la multitude des ignorants et des philistins, les uns de le revendiquer indûment, les autres de le rendre responsable du « socialisme de caserne » qu’il a condamné longtemps d’avance. Marx a révisé dans sa maturité, puis dans sa vieillesse relative, bien des idées conçues dans sa jeunesse romantique, et il est absurde d’en faire état sans tenir compte des dates. Mais il n’a pas eu tort d’écrire en 1842, dans la Kölnische Zeitung : « L’ignorance est une force démoniaque et il est à craindre qu’elle ne cause encore beaucoup de tragédies. » Réflexion pertinente plus actuelle que jamais quand on a vu la bourgeoisie occidentale entichée de Staline, puis du Staline chinois, Mao Tsé-tung, lequel n’a exterminé que 50 à 60 millions de ses compatriotes selon l’enquête minutieuse de Richard Walker, spécialiste très scrupuleux et qualifié *.
Et réflexion qu’on ne saurait contredire quand on observe les phénomènes de la mode et du snobisme inciter les milieux dirigeants de pays libres à fraterniser les pires oppresseurs de peuples désarmés. Et quand une prétendue intelligentsia européenne ne craint pas de justifier les pires brutalités des descendants de Staline et de Mao en se référant à Marx, à Hegel ou à Freud, qui n’en peuvent mais.
La deuxième édition de la Petite Encyclopédie soviétique en 1940 consacrait à Staline 72 colonnes de panégyrique. L’édition suivante, en 1960, les a réduites à 3 colonnes, d’ailleurs encore trompeuses dans l’esprit du « marxisme-léninisme ». Cet aveu implicite de l’imposture antérieure ne suffit pas à endiguer la prolifération des philistins « cosmopolites » ni à dégriser le chœur innombrable des suiveurs ignares, ivres d’illusions et de phraséologie, qui aspirent à renouveler chez eux l’« expérience » du communisme « scientifique ». Devant cette forme d’obscurantisme dépourvue de tout sens moral, il y a matière à philosopher sur le déclin de l’Occident autrement qu’à travers la métaphysique d’Oswald Spengler. Cela dépasserait les limites d’un livre sur Staline.
À la fin du siècle dernier, le « père du marxiste russe », Georges Plékhanov, rendit un mauvais service à ses disciples, entre autre à Lénine, en leur enseignant que la nature humaine n’existe pas, que seules comptent les conditions économiques et sociales. Avec le temps il s’ensuivit la version desséchée du « marxisme russe » où Marx n’est plus reconnaissable et qui, niant le fait de la nature humaine, aboutit avec Staline au socialisme à visage inhumain. L’expérience existe, ainsi que l’« humaine condition » dont parle Montaigne.
Passant outre au matérialisme historique et au déterminisme économique, quelque part de vérité qu’ils contiennent comme d’autres théories plus ou moins controversables, il faut croire avec Machiavel que « le monde fut toujours, invariablement, habité par des hommes qui ont eu les mêmes passions ». Croire avec Pascal que parmi ces passions figure la libido dominandi, indépendamment des doctrines. Croire avec La Fontaine que « l’homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges ». Il faut savoir enfin qu’on peut devenir « prince », ou premier secrétaire du Parti, « par scélératesse », autrement dit par des moyens dirigés contre le peuple, devenir prince « par quelque voie scélérate et abominable », comme Agathocle de Sicile : « On ne peut pas dire que ce soit mérite que de tuer ses concitoyens, trahir ses amis, être sans foi, sans pitié, sans religion ; de tels procédés peuvent conduire au pouvoir, non à la gloire… Sa bestiale cruauté et inhumanité, comme ses innombrables scélératesses, ne permettent pas qu’il soit célébré parmi les plus excellents personnages… » Ces propos ne sont pas non plus de Marx, ni de Hegel, ni de Freud, mais de Machiavel. Encore faut-il apprendre à le lire.
Bibliographie
- STALINE
I. V. Staline, Œuvres, 13 vol., Moscou, 1946-1952. Treize volumes ont paru sous ce titre, du vivant de Staline. Le quatorzième, annoncé en janvier 1956, n’est jamais sorti, non plus que les suivants. Les héritiers du despote ont eu honte de leur maître, après le rapport secret de Khrouchtchev, lu au vingtième Congrès du Parti le 25 février 1956. Les divers textes de Staline, tirés à millions d’exemplaires, sont pratiquement retirés de la circulation en Union soviétique.
I. V. Staline, Œuvres, 3 vol., The Hoover Institution, Stanford, Calif., 1967. Tomes XIV, XV et XVI. (Complément aux 13 vol. précédents, réalisé par Robert H. MacNeal.) — Stalin’s Works, An annoted bibliography compiled by R.H. MacNeal, The Hoover Institution Stanford, Calif., 1967. — Iossif Vissarionovitch Staline. Courte biographie (243 p.) composée par six apologistes dont M.B. Mitine et P.N. Ponomarev, Moscou, 1947 ; À propos du marxisme en linguistique, Paris, 1952 ; Derniers écrits, Paris, 1953. — The Anti-Stalin Campaign and International Communism, Colombia University, New York, 1956. — Correspondance de Staline avec les présidents des U.S.A. et les premiers ministres de Grande-Bretagne, 1941-1945 (en russe et en anglais), 2 vol., Moscou, 1957.
A. Avtorkhanov, Stalin ad the Soviet communist Party, New York, 1959. — A.V. Baikaloff, I. Knew Stalin, London, 1940. — L. Fischer, The Life an Death of Stalin, New York, 1952 ; Vie et mort de Staline, Paris, 1953. — H.M. Hyde, Stalin, London, 1971. — S. Labin Staline le Terrible, Paris, 1948. — L. Laurat, Staline, la linguistique et l’impérialisme russe, Paris, 1951. — K. Mehnert, Stalin versus Marx, London, 1951. — J. Monnerot, Sociologie du communisme, Paris, 1949. — A Ouralov, Staline au pouvoir, Paris, s. d. E.E. Smith, The Young Stalin, New York, 1967. — (B. Souvarine), Staline et Trotski, le Contrat social, revue, vol. IV, n° 3, Paris, mai 1960. — L. Trotsky, Stalin, New York, 141, 1941. Trad. fr., Paris, 1948. — R.C. R-Tucker, Stalin as Revolutionary, New York, 1973. — A. Ulam, Stalin, New York, 1973.
- LÉNINE
La 5e édition des Œuvres (dites complètes), en 55 vol., plus 3 vol. de tables et d’index, a été publiée à Moscou de 1958 à 1965. Elle est la seule dite complète, alors que les précédentes s’intitulaient simplement Œuvres. La 1re édition ne comptait que 20 vol., sous la direction de Kamenev. Elle a conservé un intérêt particulier en raison des notes explicatives qui l’enrichissent, bien que rédigées dans l’esprit tendancieux du Parti, ce qui n’empêche pas les historiens sérieux de s’y orienter. Les 2e et 3e éditions, en 32 vol., sont identiques, mais les trois premiers vol. seuls sous la direction compétente et relativement honnête de Kamenev, lequel fut alors envoyé au « hachoir », comme dit Khrouchtchev. Les notes et annexes sont précieuses à l’historien. À partir du quatrième volume, Kamenev est remplacé par une équipe où figure Boukharine jusqu’au vol. 12, conjointement avec Molotov et autres, après quoi Boukharine, à son tour, est précipité au « hachoir » et l’édition échoit et déchoit sous la coupe de Molotov et autres scribes de Staline. (La réalité fut un peu moins simple parce que les tomes n’ont pas tous paru dans l’ordre chronologique, mais peu importe.) La quatrième édition, en 38 vol., dite « stalinienne », ne mérite que d’être jetée au rebut. La 5e, enfin, la plus complète, n’est pas réellement complète, car une décision du Comité central, prise en 1967, a créé un fonds spécial de documents non communicables, aux archives du Parti, et notamment ceux (cotés n° 2) qui concernent Lénine et sa famille. Ce sont donc des textes inavouables, selon les héritiers du Père fondateur de l’État soviétique. Les écrits de Lénine contenus dans les 37 vol. du recueil Lénine (Moscou, 1924-1970) ont été incorporés aux Œuvres complètes.
L. Fisher, The Life of Lenin, New York, 1964. — J. Laloy, le socialisme de Lénine, Paris, 1967. — B. Lazitch and M. Drachkovitch, Lenin and the Comintern, vol. 1, Stanford, Cal., 1972. — V.I. Lénine et la Vé-Tché-Ka. Recueil de documents, Moscou, 1975. — R. Payne, The Life and Death of Lenin, New York, 1964. — D. Shub, Lenin, A Biography, New York, 1948. - L. Trotsky, Lénine, suivi d’un texte de A. Breton, Paris, 1970. — A.B. Ulam, Lenin and the Bolcheviks, London, 1965. — N. Valentinov, Rencontres avec Lénine, Paris, 1964 ; The Early Years of Lenin, Ann Arbor, 1969 ; Lénine peu connu, introduction de B. Souvarine, Paris, 1972. — B.D. Wolfe, La jeunesse de Lénine ; Lénine ; Lénine, Trotsky, Staline, 3 vol., Paris, 1951.
- TROTSKI
L. Trotsky, The First Years of the Communisme International (vol. 1. New York, 1945 : vol. 2, London, 1953) ; Journal d’exil, Paris, 1960 ; Sur la deuxième guerre mondiale, Paris, 1970 ; Bulletin de l’opposition, 87 numéros, de juillet 1929 à août 1941 ; The Trotsky Papers. 1917-1922, edited end annoted by J.M. Meijer, The Hague, 1964 ; 2e vol., 1971 ; Littérature et Révolution, Paris, 1964.
H. Habosch, Trotzki Cronik, München, 1973. — J. Baechler, Politique de Trotsky, Paris, 1968. — J. Gorkin, L’assassinat de Trotsky, Paris, 1970. — L.D. Levine, The Mind of an Assassin, London, 1959. — L’assassinat de Léon Trotsky, publ. du secrétariat de la quatrième Internationale, s.l.n.d.
W.D. Allen and P. Muratoff, The Russian Campaign, of 1941-1943 ; of 1944-1945 ; 2 vol., London, 1944 et 1946. — The Anatomy or Terror, Washington, D.C., 1956. — D. Anine, La révolution de 1917 vue par ses dirigeants, Roma., 1956. — H. Arendt, Du mensonge à la violence, Paris, 1972. — A. Avtorkhanov, technologie du pouvoir, Munich, 1959. — A. Balabanoff, My Life as a Rebel, London, 1938. — E. Beck an W. Godin, Russian Purge and the Extraction of Confession, New York, 1951. — A Besançon, Court traité de soviétologie à l’usage des autorités civiles, militaires et religieuses, Paris, 1976. — C.E. Black. editor, Rewriting Russian History, New York, 1956. — Z. Brzezinski, La purge permanente, Paris s.d. Suicide of the West, New York 1964. — R. Caillois, Description du marxisme, Paris 1951. — La campagne antistalinienne de l’Internationale communiste, Paris 1956. — A Cigila, Au pays du mensonge déconcertant, Sibérie, 2 vol., 1950. — Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution, London, 1974. — M. Collinet, du bolchévisme, Paris, 1957 — G.N. Crocker, Roosevelt’s, Road to Russia, Chicago, 1959. — D.J. Dallin, German Rule in Russia, London, 1957. — D.J. Dallin, Soviet Espionage, New Haven, 1955 ; From Purge to Coexistence, Chicago, 1964. — D. Dallin and B. Nicolaevsky, Forced Labor in Soviet Russie, New Haven, 1947. — Th. Dan, Origine du bolchévisme, New York, 1946. — R.V. Daniels, The Conscience of the Revolution, Cambridge, Mass., 1960. — (J. Degras), The Communist International, 1919-1943, documents, 2 vol., London, 1956, 1960. F.R. Dulles, Le chemin de Téhéran, New York, 1944.
M. Eastman, The End of Socialism in Russia, Boston, 1937 ; Stalin’s Russia an the Crisis in Socialism, New York, 1940, 1940 ; Reflections on the Failure of Socialism, New York, 1962 ; Love an Revolution, New York, 1964 — Général « El Campesino », La vie et la mort en U.R.S.S., Paris, 1950. — J. Erickson, The Soviet High Command, London, 1962 ; The Road to Stalingrad, London, 1975. — M. Fainsod, Comment l’U.R.S.S. est gouvernée, Paris, 1957 ; Smolensk under Soviet Rule, Cambridge, Mass., 1952 ; Russian Liberalisme, Cambridge, 1958. — M.T. Florinsky, Encyclopaedia of Russia and the Soviet Union, New York, 1961. — A. Floote, Les secrets d’un espion soviétique, Paris, 1951. A.L. Garthoff, La doctrine militaire soviétique, Paris, s.d. — I. Getzler, Martov, Cambridge Univ. Press, Univ. Press, Melbourne, 1967. – M. Gorki, Pensées intempestives, texte établi et annoté par H. Ermolaev, avant-propos de B. Souvarine, Lausanne, 1975. — H. Gruber, Soviet Russia master the Comintern, New York, 1974. — W. Gurian, Bolchevism, Notre Dame, Indiana, 1952 ; Soviet Impérialism, Notre Dame, 1953. — L.H. Haimson, The Mensheviks, Chicago, 1974. — M. Heller, Le monde concentrationnaire et la littérature soviétique, Lausanne, 1974. — G. Kennan, Memoirs, London, — A. Kerensky, Russia and History’s Turning Point, New York, 1965 — W. Kerr, The Russian and History’s Turning Point, New York, 1965. W. Kolarz, La Russie et ses colonies, Paris, 1954.
A.B. Lane, J’ai vu la Pologne trahie, Paris, s.d. — L. Laurat, Du Komintern au Kominform, Paris, 1951. — I. Lazarévitch, La médecine en U.R.S.S., Paris, s.d. — I. et N. Lazarevitch, L’école soviétique, préface, préface de P. Pascal, Paris, 1954. — B. Lazitch with M. Drachkovitch, Biographical Dictionary of the Commintern, Stanford, Calif., 1973. — N. Leites, A. Study of Bolshevism, Glencoe, III., 1953. — W. Leonhard, L’Union, apparences et réalités, Paris, s.d. — B. Levytsky, The Stalinist Terror in the Thirties, Stanford, Calif., 1974. — B.H. Liddell Hart, The Soviet Army (ouvrage collectif), London, 1956. — E. Lyons, Assignment in Utopia, New York, 1937 ; The Red Decade, the Stalinist Penetration in America, New York, 1941. — Machiavel, Le prince, et autres écrits politiques, traduction, introduction et analyse par Y. Lévy, Genève, 1972. — Colonel Makhine, L’armée rouge, Paris, 1938. — J. Malera et L. Rey, La Pologne, d’une occupation à l’autre, Paris, 1952. — Martov et ses proches, recueil, New York, 1959. — K. Marx, La Russie et l’Europe, Paris, 1954. — R. Medvedev, Qui a écrit « le Don paisible » ? Paris, 1975. — J.A. Medvedev, Dix ans après « Une journée d’Ivan Denissovitch », Londres 1973 A.G. Meyer, Leninism, Cambridge, Mass., 1957. — G.I. Miasnikov, Nouvelle tromperie, Paris, 1931. — J. Monnerot, La guerre en question, Paris, 1951 ; Sociologie de la révolution, P., 1969. — M. Moskalev, Le bureau russe du Comité central du parti bolchéviste, 1912-mars 1917, Moscou, 1947. — L. Navrazov, The Education of Lev Navrazov, New York, 1975. — B. Nicolaevki, Les dirigeants soviétiques et la lutte pour le pouvoir, Paris, 1965. — A. Nove, Was Stalin really Necessary ? London, 1964.
K. Papaioannou, Marx et les marxistes, Paris, 1972. — R. Pipes, The Formation of the Soviet Union, Cambridge, Mass., 1954 ; Russia under the Old Regime, New York, 1974. — Ch. Plisnier, faux passeports, Paris, 1937. — Polititchevski Devnik, 2 vol., Fond Herzen, Amsterdam, 1972 et 1975. — E.K. Poretski, Les nôtres, avant-propos de L. Trotsky, Paris, 1969. — W. Reswick, I. dreamt Revolution, Chicago ; 1962. — A. Rossi, Les communistes français pendant la drôle de guerre, Paris, 1951. — A. Sakharov, Mon pays et le monde, Paris, 1975. — L. Schapiro, Les bolchéviks et l’opposition, Paris, 1957 ; De Lénine à Staline, P., 1967. — L. Schapiro and P. Reddaway, Lenin, London, 1967. — J. Scholmer, Vorkuta, London, 1954. — G.K. Schueller, The Politburo, Stanford, 1951. — S.M. Schvartz, L’antisémitisme dans l’Union soviétique, New York, 1952. — M. Schachtman, The bureaucratic Revolution, New York, 1962. — R.E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 2 vol., New York, 1948. — D. Shub, Polititchevskié Dèiateli Rossii, new York, 1969. — A. Soljenitsyne, Une journée d’Ivan Denissovitch, Paris, 1963 ; La maison de Matriona, P., 1966 ; Le pavillon des cancéreux, P., 1968 ; Le premier cercle, P., 1968 ; Les droits de l’écrivain, P., 1969 ; Soljénitsyne accuse, P., 1971 ; Lettre aux dirigeants de l’Union soviétique, P., 1974 ; L’archipel du Goulag, 3 vol., P., 1974-1976 ; Le chêne et le veau, P., 1975 ; (Soljénitsyne, préface de) D***, Le cours du Don paisible, P., 1975. — F. Sternberg, The End of a revolution, New York, 1953. — Z. Stypulkowski, Invitation à Moscou, Paris, s.d. — I.G. Tseretellli, Souvenirs sur la révolution de Février, 2 vol., Paris – La Haye, 1963. — S.V. Valentinov (Volsky), The New Economic Policy and the Party Crisis after the Death of Lenin, Stanford, Calif., 1971. — Lord Vansittart, Leçons de ma vie, New York, 1945. — K.A Wittfogel, Oriental Despotism, London, 1957. — B.D. Wolfe, Communism totalitarism, Boston, 1956 ; Six Keys to the Soviet System, B., 1956 ; Khushchev and Stalin’s Ghost, New York, 1957 ; Marxism ; N.Y., 1965, tr. fr., Paris, 1965 ; An Ideology in Power, N.Y., 1969 ; Dress Rehearsals for the great terror, in Studies in Comparative Communisme, vol. 3 n° 2, april 1970 — W.S. Woytinsky, Stormy Passage, New York, 1961 ; So Much alive, N.Y., 1962. — K. Zawadny, Death in the forest, the Story of the Katyn Forest massacre, Indiana, 1962. K. Zemtsov, La corruption en union soviétique, Paris, 1976.
* Cf. Nazi-Soviet relations, 1939-1941. Department of State, Washington, 1948. (Documents tirés des archives de la Wilhelmstrasse.) L’édition française est un sabotage éhonté de ce précieux recueil, sous le titre : la Vérité (sic) sur les rapports grermano-soviétiques, Paris, 1948. Il y manque les deux tiers des principaux textes, notamment les protocoles secrets annexés aux deux pactes, et les propos les plus infamants de Molotov. Les autorités américaines n’ont pas été capables de publier une version française correcte. — Cf. les deux ouvrages irréfutables d’A. Rossi : Deux ans d’alliance germano-soviétique, Paris, Fayard, 1949 : et le Pacte germano-soviétique, Paris, « Preuves », 1954. — Cf. Général W. G. Krivitsky : Agent de Staline, Paris, 1940. Et Maurice Ceyrat : la Trahison permanente, Paris, Ed. Spartacus, 1947. (La préface, alors anonyme, est de Boris Souvarine.) — Cf. en outre : les relations germano-soviétiques, sous la direction de J.-B. Duroselle, Paris, 1954 ; M. Beaumont : la Faillite de la paix (1918-1939), Paris, 1945. Les deux ouvrages d’A. Rossi précités donnent toutes les références désirables et dispensent d’alourdir ici la bibliographie du sujet.
Sur les préliminaires de l’« amitié » stalino-nazie que personne ne voulait envisager en Occident avant le pacte Hitler-Staline, Cf. l’article de Boris Souvarine : « Une partie serrée se joue entre Hitler et Staline », dans le Figaro du 7 mai 1939, reproduit sous le titre « Staline et Hitler », dans Est et Ouest, n° 149, du 1er avril 1956.
* Staline n’était pas seul à faire ce calcul. Mussolini dit à l’un de ses hiérarques : « Ces imbéciles s’égorgeront sur la ligne Maginot et c’est nous qui dicterons la paix. » Documentation française, 6 février 1951 (citation du Corriere della Sera, du 14 décembre 1950).
* Il existe sur ces faits une littérature journaliste et policière considérable où les rares données historiques réelles ne se laissent pas dégager en quelques lignes. Il faut donc ici se borner à des vérités sommaires et à une mise en garde, en s’abstenant de toute bibliographie qui risquerait d’égarer le lecteur insuffisamment averti.
* Traduction française dans B.E.I.P.I. (Bulletin de l’Association d’études et d’informations internationales), n° 25, Paris, 1er mai 1950, sous le tire : « Comment Hitler a perdu la guerre en U.R.S.S. ». Ce bulletin est devenu Est et Ouest à partir de janvier 1956, et il sera désigné plus loin comme tel, pour simplifier la référence, et puisque sa numérotation est restée continue. C’est pour la France un recueil documentaire unique en ces matières et pour la période traitée dans le présent ouvrage. Dans le même numéro de ce bulletin, voir « Un autre témoignage » mentionné ci-après.
* Cf. George Fischer : Soviet Opposition to Stalin. Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1952. Et du même auteur : « Le cas Vlassov ». Bulletin Est et Ouest, n° 89, Paris, 16 mai 1953. La presse et l’édition françaises ont gardé le silence sur cette contribution majeure à l’histoire de la guerre.
* Article de Boris Souvarine reproduit textuellement, ainsi que divers documents essentiels, dans « La décapitation de l’Armée rouge », in le Contrat social, revue, vol. VI n° 4 Paris, août 1962. — Cf. également : « “L’affaire Toukhatchevski” », guillemets contestataires, ibid., vol. III, n° 4, juillet 1959. Mémoire rédigé par Boris Souvarine en juillet 1957 pour une Commission internationale de révision des « procès en sorcellerie » mis en scène à Moscou avant la guerre. Cependant aucun procès, même fictif, n’a eu lieu pour les chefs de l’armée rouge.
* J. Staline : Sur la grande guerre de l’union soviétique pour le salut de la patrie. 5e éd. Moscou, 1946. — Général W. C. Krivitski : Agent de Staline. Paris, 1940. — Rapport secret de N. S. Khrouchtchev, etc. la Documentation française. — Notes et études documentaires, n° 2.189. Paris, 1956. A. Rossi : Autopsie du stalinisme. Avec le texte intégral du rapport Khrouchtchev. Postface de Denis de Rougemont. Paris, 1957. — The Crimes of de Stalin Era. Spécial report to the 20th Congress of the Soviet Union, by Nikita S. Khrushchev, Annoted by Boris I. Nicolaievski. Introduction par Anatole Shub. New York, The new leader. — « Le rapport secret de N. Khrouchtchev », in Est et Ouest, n° 168. Paris, 16 février 1957. (Les annotations sont de B. Nicolaievski et de B. Souvarine). — « Les Mémoires de Churchill », et : « Encore les Mémoires de Churchill », in l’Observateur des Deux Mondes. Paris ; 1er et 15 juin 1948. Bertram D. Wolfe : Khrushchev and Stalin’s Ghost, New York, 1957. Charles E. Boj-hlen : Witness to History, 1929-1969. New York, 1973. Branko Lazitch : le rapport Khrouchtchev et son histoire. Paris, 1976. (Complément indispensable à l’Autopsie du stalinisme, d’A. Rossi, citée ci-dessus
* Cf. Est et Ouest, n° 149. Paris, avril 1956. L’article introductif et les notes complémentaires des articles sur « Caligula » sont de Boris Souvarine. De ce dernier, Cf. également : « Khrouchtchev signe son discours secret » ; in Est et Ouest, n° 219. Paris, 1er juillet 1959. Et : « Sur la folie de Staline », ibid., n° 220. Paris 16 juillet 1959.
* Albert Speer : Au cœur du Troisième Reich. Paris, 1971. – Svetlana Allilouieva : Vingt lettres à un ami. Paris, 1967 ; id. : Une seule année. Paris, 1971.
* A. M. Nekritch : 22 juin 1941. Moscou, 1965. Trad. française : L’armée rouge assassinée. Paris, 1965. — Harry Hopkins : « My meeting with Stalin », American Magazin, décembre 1941. — Eric A. Johnston : « My talk with Stalin », The reader’s Digest, octobre 1944. — Elliot Roosevelt : « A Personal Interview with Stalin », Look, 4 février 1974.
* Julius Epstein : Operation Keelhaul. The story of forced repatriation. Introduction by Bertram D. Wolfe. Old Greewich, Conn., 1973. — Nicholas Berthell : The Last Secret, London, 1974. Trad. fr. : le Dernier secret, Paris 1975.
* Avec la même arrière-pensée perfide, il a fait inciter par radio, le 29 juillet 1944, les forces patriotes de Varsovie à s’insurger contre les allemands dès que l’Armée rouge fut à proximité de la capitale polonaise, mais les Soviétiques restèrent passifs tandis que les Allemands puissamment équipés massacraient les insurgés polonais livrés à eux-mêmes. Sinistre provocation typiquement stalinienne, pour anémier la Pologne, et que relate Churchill dans ses Mémoires. Cf. Henri de Montfort : le Massacre de Katyn. Paris, 1966. — Joseph Czapski : Souvenirs de Starobielsk. Paris, 1945 ; id. : Terre Inhumaine. Paris, 1949. — Stanislas Mikolakjczyk : le Viol de la Pologne. Paris, 1949.
* Gédéon Haganov : « Le communisme et les Juifs ». Paris, supplément de Contacts, n° 9, mai 1951. — « Staline contre Israël ». Paris, supplément du B.E.I.P.I. (Est et Ouest, février, 1953). — « Sur la judéophobie communiste ». Paris, Est et Ouest, n° 319, avril 1964. — Lev Navrozov : The Education of Lev Navrozov. New York, 1975. (Ce livre témoigne dans le même sens que Soljénitsyne. Un passage, p. 46, dit que Staline préparait « un pogrome général, bien organisé, parfaitement centralisé, après lequel tous les survivants juifs seraient mis dans les camps de la mort-par-le-travail, excepté ceux que l’on classerait comme aryens à titre personnel ».)
* XXIIe Congrès, etc. Compte rendu sténographique. 3 vol. Moscou, 1962. — « Au XXIIe Congrès : aveux et révélations », in Est et Ouest, nos 270, 271, 272, 273. Paris, janvier et février, 1962. — Merle Fainsod : The 22nd Party Congress. United States Informations Service.
* I. Kourganov : « Trois chiffres », in Novoié Rousskoié Slovo, New York, 14 avril 1964 ; id. : « Catastrophe démographique », ibid., 5 décembre 1965. — A. Soljénitsyne : l’Archipel du Goulag, t. I. Paris, 1974.
* « De Gaulle : Franco a été aussi positif pour l’Espagne que Staline pour l’U.R.S.S. », le Figaro, 29 octobre 1975. — Charles de Gaulle : Mémoires de guerre, t. 3. Paris, 1959.
* Vladimir Dedijer : Tito parle… Paris, 1953. — Milovan Djilas : la Nouvelle classe dirigeante. Paris, 1957 ; id. : Conversations avec Staline. Paris, 1962. — Vladimir Dedijer : le Défi de Tito : Staline et la Yougoslavie. Paris, 1970.
* Cf. de Boris Souvarine : « La fille de Staline ». Et : « Le meurtre de Nadiédja Allilouiéva », in le Contrat social, revue, vol. XI, n° 3, Paris, mai 1967. Et : « Staline et les siens », ibid., vol. XI, n° 6, novembre 1967. — Elisabeth Lermolo : Face of a Victim. Préface d’Alexandra Tolstoï. New York, 1955. — B. Souvarine : « Deux nouvelles biographies de Staline », in Est et Ouest, n° 554, Paris, juin 1975. (En post-scriptum, l’auteur cite deux témoignages qui accusent Staline de meurtre direct, celui de la femme d’Otto Kuusinen, ex-secrétaire du Comintern, membre du Politbureau et du Secrétariat du P.C., et celui de la sœur de Iagoda, le célèbre tchékiste en chef. Ce sont des témoignages de communistes staliniens. Cf. Aimo Kuusinen : Der Gott stüezt seine Engel. Verlag fritz Molden, Wien, München, 1972. Et : Karlo Stajner : 7 000 dana u Sibiru. Zagreb, Globus, 1971.) — Raphael R. Abramoviytch : The Soviet Revolution. New York, 1962. — M. Vichniac : « Ruse et amour », Novoié Rousskoié Slovo, New York, 21 décembre 1949.
* Richard L. Walker : « Le prix en vies et en souffrances humaines du communisme en Chine ». Étude pour la sous-commission du Sénat américain. In Est et Ouest, nos 482 et 483, Paris, février 1972.
|

