|
Staline.
Aperçu historique du bolchévisme.
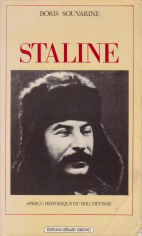 Post-scriptum Post-scriptum
La guerre
Un quart de siècle après l’août 1914 qui vit le début d’une guerre funeste dont les conséquences sont le bolchévisme, le fascisme et le national-socialisme, Staline arrivait à ses fins qui étaient, dans l’immédiat, de rendre la guerre inévitable tout en l’évitant, du moins le croyait-il, pour soi-même. Le 23 août 1939, au nom de leurs maîtres, Ribbentrop et Molotov signaient à Moscou le « pacte Hitler-Staline », annonciateur d’une nouvelle guerre européenne. Le 1er septembre, l’Allemagne envahit sans avertissement la Pologne. Le 3 septembre, la France et l’Angleterre, garantes de la Pologne, constataient l’état de guerre entre elles et l’Allemagne. Un nouveau chapitre de deuils, de ruines et de malheurs s’ouvrait dans l’histoire de l’Europe et du monde.
Staline, comme tous les bolchéviks, jugeaient en principe la guerre fatale, tôt ou tard, Lénine lui ayant appris qu’elle est la « continuation de la politique par d’autres moyens », suivant l’aphorisme de Clausewitz incorporé au marxisme vulgaire. Le pacifisme est pour lui une antithèse du bolchévisme et, dans son parti, l’épithète de pacifiste a le sens bien établi d’une injure. Toujours disposé à écraser des faibles ou à annexer de vive force un peuple sans défense, mais trop prudent pour se hasarder de plein gré dans une guerre d’issue incertaine, il ne craignait rien tant que d’y prendre part contre un proche et puissant adversaire. Dans son esprit, c’eût été sa perte avec celle du régime car l’U.R.S.S. eût alors subi une épreuve disproportionnée à ses moyens matériels et spirituels de résistance, car aussi un pouvoir autocratique imposé à la population essentiellement par la violence n’eût pas survécu longtemps aux premières défaites. Il s’agissait donc d’orienter les événements en sorte que l’inéluctable guerre se fasse entre les principales puissances européennes et les épuise, l’U.R.S.S. restant intacte et Staline indemne. Une tactique visant au maintien de la paix, mais d’une paix très précaire selon les vues bolchévistes, comportait le danger probable de laisser se former contre Moscou une coalition future : mieux valait par conséquent, pour Staline, manœuvrer pour créer l’irréparable au moment opportun.
Tant que Hitler se refusait à une entente avec Staline, en dépit de sondages et d’avances, ce dernier n’avait d’autre ressource qu’un rapprochement avec la France et l’Angleterre. Il essaya d’en tirer le maximum d’avantages, avec le minimum de risques, tout en renouvelant sous main ses invites à l’Allemagne et sans cesser d’entretenir pour les vieilles démocraties pusillanimes la menace révolutionnaire sous le couvert de son Internationale communiste. Dans la guerre civile espagnole, de 1936 à 1939, alimentée par les interventions étrangères, il ne vit que l’occasion possible d’amorcer loin de ses frontières une conflagration plus ample, espérant bien demeurer neutre pour devenir arbitre. Dans la guerre de Chine commencée par le Japon en 1937, il ne pensa qu’à user les forces japonaises absorbées dans les profondeurs chinoises pour les détourner de son domaine asiatique, tout en cherchant à traiter avec le Japon sur le dos de la Chine. Les combats de Tchan-Kou-Fong, auprès du lac Khassan (août 1938) ne furent pour l’U.R.S.S. et le Japon que manifestations respectives de faiblesse, chacun ne désirant qu’éviter une guerre sérieuse et sauver la face. Après l’annexion de la Bohême et de la Moravie en mars 1939 par l’Allemagne, qui ne cachait plus ses intentions et ses préparatifs quant à la Pologne, la volonté de la France et de l’Angleterre d’enrayer l’expression germanique apparut enfin à Staline comme la conjoncture la plus propice.
Le demandeur, récompensé de sa patience, était sollicité à son tour. Paris et Londres négociaient avec Moscou un accord protégeant la Roumanie et la Pologne, cependant que Berlin évoluait dans le même sens mais à des fins contraires. Staline pouvait vendre au plus offrant son concours, à condition de ne rien donner, ou peu de chose, et de beaucoup recevoir. La France et l’Angleterre avaient ipso facto garanti ses frontières polonaise et roumaine sans rien lui demander en échange. Elles lui proposaient maintenant l’honneur de se battre, le cas échéant, et contre l’Allemagne, c’est-à-dire de se faire battre, sans rien lui promettre en retour. Hitler n’avait besoin que d’aide passive, moyennant quoi il accordait à son complice le tiers de la Pologne, à occuper sans coup férir, et lui laissait les mains libres dans les États baltes et en Finlande, sans parler d’avantages balkaniques, — jusqu’à nouvel ordre. Staline avait trop peur de l’Allemagne pour hésiter, nonobstant ses dernières attitudes officielles et déclarations publiques, en maître cynique rompu aux palinodies doctrinales comme aux volte-face politiques.
Avec le monopole de l’information parlée ou écrite dans son pays privé de toute opinion par la terreur, et dans un régime où le tyran n’a de comptes à rendre à personne, il était facile à Staline de présenter chez lui les choses sous un jour favorable, surtout en apportant l’argument suprême de la paix sauvegardée pour le peuple russe. Quant aux sections domestiquées de l’Internationale communiste, corrompues, perverties et dressées de longue date à l’obéissance servile, il ne leur restait qu’à se renier une fois de plus à rétracter leurs gratuites affirmations démocratiques et pseudo-jacobines des dernières années, à répudier leur patriotisme de circonstance et la solidarité nationale, d’adoption toute récente, pour prôner à nouveau la lutte de classe et prêcher l’internationalisme révolutionnaire cette fois au profit éventuel des divers États totalitaires confondus dans la même cause.
Ayant redécouvert l’impérialisme français et britannique, dont il n’était plus question depuis cinq ans sur l’ordre intéressé de Staline, les prétendus communistes de tous les pays, zélateurs de l’« antifascisme », de la « sécurité collective », de la « politique de fermeté » contre les « fauteurs de guerre », se firent en un tournemain les champions de la paix à tout prix, les propagateurs clandestins du défaitisme, sauf en Allemagne, en Autriche, en Tchécoslovaquie et en Pologne. Ainsi s’accomplit, dans le fracas des divisions blindées allemandes passant sur le corps de la Pologne, sous le tonnerre des avions à croix gammée bombardant les villes ouvertes, les villages et les routes, l’union obscène et significative du bolchéviste et du nazisme. Il n’y eut pour s’étonner, se récrier ou s’indigner en Europe et en Amérique que de bons démocrates assez naïfs pour avoir cru à la conversion sincère des communistes et par trop ignorants du passé de Staline comme de l’histoire du bolchevisme.
À la faveur de l’agression brusquée commise par Hitler au moyen de forces irrésistibles, l’Armée rouge attaquait dans le dos des Polonais en déroute, le 17 septembre, et prenait sans péril la part de butin dévolue à Staline pour prix de sa nouvelle trahison. Les États baltes terrifiés par le sort de la nation voisine se soumettaient sans résister au pouvoir militaire de l’U.R.S.S. comme à un moindre mal. Staline semblait le grand profiteur de l’opération et s’apprêtait à imposer ses volontés à la Finlande. Le 28 septembre, à Moscou, Ribbentrop et Molotov signaient de nouveaux accords, rejetant sur la France et l’Angleterre la responsabilité de la guerre, fixant la « frontière des intérêts d’empire réciproques dans le territoire du ci-devant État polonais » et esquissant un programme vague de relations économiques entre les deux puissances totalitaires complices. L’un des accords menaçait les Alliés de mesures concertées, au cas où ils persévéraient à ne pas reconnaître le fait accompli et à continuer la guerre.
Mais après deux mois de pourparlers, la Finlande ne s’inclinait pas devant des exigences équivalant à la rendre vassale de Staline. Celui-ci, le 29 novembre, fit sa première déclaration publique depuis la guerre, pour innocenter Hitler : « Ce n’est pas l’Allemagne qui a attaqué la France et l’Angleterre, mais la France et l’Angleterre qui ont attaqué l’Allemagne… Après l’ouverture des hostilités, l’Allemagne a fait des propositions de paix à la France et à l’Angleterre, et l’Union soviétique a ouvertement soutenu les propositions de paix de l’Allemagne… Les cercles dirigeants de France et d’Angleterre ont brutalement repoussé, tant les propositions de paix de l’Allemagne que les tentatives de l’Union soviétique de mettre fin rapidement à la guerre. » Le lendemain, 30 septembre, l’Armée rouge se ruait sur la Finlande et donnait au monde stupéfait le spectacle de troupes inconscientes battues par une armée cinquante fois moins nombreuse et cent fois moins pourvue de moyens matériels. Le 21 décembre, Staline célébrait dans la défaite ignorée des populations de l’U.R.S.S. son soixantième anniversaire, sur des monceaux de cadavres. Le 25, en réponse aux félicitations de Ribbentrop, il télégraphie : « L’amitié des peuples d’Allemagne et de l’Union soviétique, cimentée par le sang a toutes raisons d’être durable et solide. »
Les faits parlent d’eux-mêmes. Ils dissipent le moindre doute quant à la transformation du bolchévisme théorique en son contraire pratique. Ils lèvent toute incertitude et tranchent tout désaccord quant aux résultats et conséquences de vingt années de dictature, quant à l’appréciation des réalités dites soviétiques. Ils éclairent aussi l’essentiel de ce que Staline, au cours des années précédents, avait eu soin de laisser dans les ténèbres. La contre-révolution conduisait à la guerre, et les massacres de l’intérieur préparaient les hécatombes aux frontières. Dès le 29 août, la Frankfürter Zeitung hitlérienne publiait un article où la vérité se fait jour : « Le rapprochement entre l’Allemagne et l’U.R.S.S. s’est réalisé dans une évolution qui a duré des mois. Du côté russe, il s’est accompli dans ces dernières années des changements de personnes et des modifications de structure d’une importance essentielle et que l’on peut sans doute considérer comme des conditions indispensables à cet événement historique. La mise à l’écart de la vie publique de la couche dirigeante, opérée sur une large base sous le mot d’ordre de l’antitrotskisme, a formé sans aucun doute un élément important contribuant à rendre l’U.R.S.S. conciliante… » Ainsi, Staline avait perpétré crime sur crime pour supprimer tout obstacle dans la voie conduisant au plus grand crime. Par peur de Hitler, il lui fallait pactiser coûte que coûte avec Hitler. Par peur de certaine guerre, il lui fallait précipiter l’Europe dans la guerre.
Mais en même temps, il a dû découvrir son jeu où chacun désormais peut lire, allié ou adversaire. Et pour les moins prévenus, ses mécomptes en Finlande ont dévoilé des tares profondes, révélé d’incurables faiblesses. Il n’a pu vaincre un petit État désarmé dont la population ne dépasse guère celle de Léningrad et qui n’a signé la paix, le 12 mars 1940, que sous la menace d’une descente militaire allemande dans la péninsule scandinave. Sera-t-il maître chez soi des événements qui ébranlent le vieux monde et balaieront les régimes vétustes ou impopulaires ? De toute évidence, il ne saurait tenir et durer qu’en redoublant désormais de prudence, en s’abstenant d’affronter au-dehors quelque épreuve sérieuse, et en se subordonnant de plus en plus aux autres pays totalitaires. Sans doute est-il fondé à spéculer sur la cécité des hommes d’État qui l’ont ménagé alors qu’ils tenaient pourtant à ne point compter exclusivement et indéfiniment sur les fautes d’autrui, car il n’est guère d’exemple montrant qu’il soit possible, sur le plan historique de tromper toujours et tout le monde.
Paris, mars 1940.
|

