[1]
Marc ANGENOT
McGill University Montréal, Canada
“Champ et contre-champ :
sur l’invention de l’art social.”
Montréal : Université McGill, 17 pp.
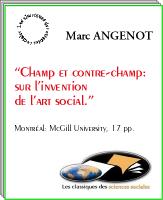 On pourrait remonter à la fin de la monarchie de Juillet, au milieu de l'agitation créée par les « sectes » saint-simonienne, fouriériste et icarienne, par ces idées nouvelles baptisées vers 1832 d'un néologisme, « socialistes », qui circulent dans la jeunesse des écoles et dans le peuple et qui exploseront au grand jour en 1848. À la critique des maux sociaux, au scandale d'injustices et de misères qui ne tiennent, affirme-t-on, qu'à une « mauvaise organisation sociale », à la vision d'une société injuste « condamnée » à un effondrement prochain, — condamnée au Tribunal de l'histoire et condamnée comme l'est un édifice qui va à la ruine, — se joint tout de suite une critique de l'art et de la littérature : traîtres à leur « mission », mis au service du mal social et conçus pour la seule jouissance d'une poignée de privilégiés qui profitent de ce mal, reflétant la décadence de la société entière et sa déchéance tant par le côté faux et malsain des contenus et des thèmes, coupés de la vraie « vie », que par le « dévergondage » de la forme... Une littérature qui, comme la société tout entière aurait pris une mauvaise voie, qui tournerait le dos à la « vérité » et au « réel » — mais où quelques heureuses exceptions apparaissent comme annonciatrices d'un avenir artistique régénéré. Une littérature condamnée à être remplacée, elle aussi comme la société dont elle émane, par une autre, toute contraire, car ayant renoué avec son essence, sa « mission », s'étant remise au service du Bien reflété et confirmé dans le Beau. On pourrait remonter à la fin de la monarchie de Juillet, au milieu de l'agitation créée par les « sectes » saint-simonienne, fouriériste et icarienne, par ces idées nouvelles baptisées vers 1832 d'un néologisme, « socialistes », qui circulent dans la jeunesse des écoles et dans le peuple et qui exploseront au grand jour en 1848. À la critique des maux sociaux, au scandale d'injustices et de misères qui ne tiennent, affirme-t-on, qu'à une « mauvaise organisation sociale », à la vision d'une société injuste « condamnée » à un effondrement prochain, — condamnée au Tribunal de l'histoire et condamnée comme l'est un édifice qui va à la ruine, — se joint tout de suite une critique de l'art et de la littérature : traîtres à leur « mission », mis au service du mal social et conçus pour la seule jouissance d'une poignée de privilégiés qui profitent de ce mal, reflétant la décadence de la société entière et sa déchéance tant par le côté faux et malsain des contenus et des thèmes, coupés de la vraie « vie », que par le « dévergondage » de la forme... Une littérature qui, comme la société tout entière aurait pris une mauvaise voie, qui tournerait le dos à la « vérité » et au « réel » — mais où quelques heureuses exceptions apparaissent comme annonciatrices d'un avenir artistique régénéré. Une littérature condamnée à être remplacée, elle aussi comme la société dont elle émane, par une autre, toute contraire, car ayant renoué avec son essence, sa « mission », s'étant remise au service du Bien reflété et confirmé dans le Beau.
Voyons un texte-clé et l'un des plus anciens, le plus ancien je crois : la brochure du fouriériste Désiré Laverdant, De la mission de l'art et du rôle des artistes (Paris : « La Phalange », 1845). Une logique discursive s'y exprime, logique qui va perdurer jusqu'aux années cinquante de notre siècle et trouver sa forme dogmatique accomplie dans Monde, dans Commune, dans la critique communiste stalinienne et dans la doctrine du réalisme socialiste. Voici ce que je lis dans la brochure de Laverdant : le contraste entre une erreur esthétique prédominante, reflet de la décadence morale de l'époque, et quelques rares œuvres au service du Vrai et du Bien - tout d'un tenant. Paul Nizan, dans les années mil neuf cent trente, ne dira rien d'autre que son prédécesseur sous Louis-Philippe : « La littérature du socialisme sera une littérature du bonheur », prédit-il, le contraire de cette littérature, bourgeoise, du malheur dont la figure typique est un Dostoïevsky - avec tout son talent, et « ses héros comporteront de moins en moins d'analogies avec les héros du monde où il n'y a pas d'issue ». [1] Puisque pour le fouriériste comme pour le stalinien (et pour tous les penseurs modernes de Morelly et Saint-Just à nos jours), le malheur a ses racines dans un système social injuste et que, d'autre part, la littérature « exprime » ou « reflète » son époque, et ne peut faire autrement, le critique va démontrer : 1. que le « dévergondage » esthétique général est un grand indice de la décomposition sociale ; 2. qu'au milieu de cette décadence, quelques œuvres méritoires et prémonitoires font voir cependant [2] les prodromes d'une littérature du bien, car rédigées par des gens de lettres voulant le bien des hommes et s'étant mis au service de leurs revendications.
Mais où, vers 1840, Désiré Laverdant découvre-t-il cette littérature belle et bonne, rare exemple de réussite civico-esthétique ? Ce qu'il donne comme modèle, — il fallait s'y attendre ! — ce sont « les triomphes de l'auteur des Mystères de Paris ». [2] Deux inconnus lisent alors avec exaspération, je suppose, la brochure de Laverdant et les élucubrations des jeunes-hégéliens qui lui font écho et ils rédigent un gros pamphlet (qu'ils renonceront à publier, le confiant à la « critique rongeuse des souris »). Karl Marx et Fr. Engels rédigent La Sainte famille et y démontrent l'absurdité des doctrines de progressisme esthétique de Szeliga, Bruno Bauer et consorts (Laverdant n'est pas cité) et la médiocrité esthétique du roman si fameux alors d'Eugène Sue, que tous ces gens exaltent, le réalisme truqué et la morale sociale fausse de ce feuilleton de bonne volonté, avec sa prostituée vertueuse (Fleur-de-Marie) et son forçat innocent (Le Chourineur). Admirateurs du légitimiste Balzac, Marx et Engels réfutent ainsi d'emblée, dans un de leurs premiers écrits, les doctrines volontaristes sur une « mission sociale » directe de l'art qui avaient commencé à apparaître vers 1830 dans Le Globe des saint-simoniens. Ils réfutent par avance non seulement tout stalino-jdanovisme, il va de soi, mais un siècle de mots d'ordre et conjectures sur un « art social » contrasté aux erreurs (thématiques et stylistiques) de ce qui se nommera un jour le modernisme.
Voilà qui fixe le cadre de ma réflexion, mais qui ne conclut pas avant l'analyse et la réflexion : je ne prétends pas dans cet essai que la littérature du monde soit le jugement ultime du monde ni que, des fouriéristes à Nizan, Barbusse et Aragon, les doctrines de l'art social aient été purement « à côté de la plaque », que la transposition à l'art qui se fait d'une « critique sociale » ait été simplement philistine et absurde. Après tout, c'est en lisant les Mystères de Paris que Victor Hugo concevra en « mieux » Les Misères, — retitré plus tard Les Misérables. Or, une littérature moderne qui va de Jean Valjean à Bardamu doit bien « refléter » quelque chose au bout du compte — et quoi d'autre qu'une sorte de décadence morale et civique ?
Tout ce que je voudrais montrer d'abord, c'est la permanence sur plus d'un siècle d'une réflexion aporétique sur l'« art social », partant d'un rejet argumenté de la littérature (et la peinture) acclamées et reconnues, que, dès 1848, la presse démoc.-soc. va qualifier de « bourgeoises ». Encore pourrait-on ajouter que l'impertinence de cette critique n'a cessé de s'aggraver. Car le lecteur « cultivé » de la fin du XXème siècle peut croire comprendre encore les feuilles d'extrême gauche qui, en 1848, opposent à la peinture du Salon, le génial « réalisme » d'un Courbet, diffamé par le jugement faux d'une « poignée de privilégiés » [3], mais il ne peut que s'avouer choqué de la raide condamnation « marxiste », un siècle plus tard, de Picasso, typique échantillon de l'art bourgeois décadent prisé par les snobs, condamnation dogmatiquement motivée par le critique d'art communiste Max Raphaël [4] (condamnation fulminée en 1933, mais qui sera opportunément oubliée le jour où le peintre donnera des gages au stalinisme).
On pourrait donc suivre entre 1830 et 1890 et puis du tournant du siècle aux années 1930, le [3] développement d'un débat sur la « mission sociale de l'art » et singulièrement de la littérature. On devrait analyser alors des revues comme Le Globe, Le Phalanstère, les écrits et passages sur l'art d'Enfantin, de Considérant, de Leroux et d'autres réformateurs romantiques, relire les essais d'esthétique de Proudhon, lequel oppose également à la « prostitution idéaliste » de l'art établi le sain réalisme d'un Courbet. [5]
On montrerait qu'une même sorte de réflexion émerge au même moment en Allemagne où la Sozialdemokratie trouvera le modèle de sa critique « révolutionnaire » chez... Richard Wagner, auteur en 1850 d'une brochure fameuse, Kunst und Revolution. [6]
On étendrait pertinemment l'enquête en montrant que tout ce qui relève de la sphère épistémique des Grands récits et de la « critique sociale » va aborder la littérature qui se fait de la façon que j'ai dite : comme le triste reflet d'une société mauvaise et injuste en voie de se décomposer. Auguste Comte se prononce, au nom de la vision positiviste du monde, et juge sévèrement la décadence littéraire de son temps, on s'observe « une sorte de dévergondage esthétique où le désordre même des compositions devient un mérite trop souvent destiné à dispenser de tout autre, et qui n'a finalement produit aucune œuvre vraiment durable ». Il démontre dans la foulée que cette production littéraire avortée n'est que le reflet d'une « décomposition sociale qui interdit à l'art tout large exercice spontané et toute profonde efficacité générale » [7] : c'est le même schéma.
Ce ne sera cependant qu'entre 1889 et 1914, dans le mouvement socialiste organisé de la Deuxième Internationale, que les théories sur l'art social et la critique « sociale » de l'art canonique vont se former en une doctrine construite et soutenue par toute une institution. Les partis ouvriers révolutionnaires vont en effet développer et défendre ce qu'ils jugent leur conception propre de l'art et de la littérature et ils vont lui donner la forme d'une contre-proposition totale, complément idoine de leur vision « révolutionnaire » du monde. Dans l'Europe francophone, il se met ainsi en place dans le mouvement socialiste une doctrine quasi-officielle accompagnée sinon d'une contre-littérature toute déployée, du moins d'un contre-barême des valeurs littéraires. Sans doute, cette doctrine n'aura ni les moyens pour s'imposer ni la brutalité dogmatique du stalinisme littéraire. Mais elle partage avec la future critique communiste sinon les certitudes en béton qui lui permettront de « dénoncer » l'art décadent des Proust et des Joyce, du moins tous les présupposés et les thèses fondamentales.
Voilà qui me paraît intéressant pour l'histoire des idées. Il ne s'agit ni de pratiquer l'amalgame ni non plus d'exonérer un socialisme « pur », celui des Jaurès et des Vandervelde, qui aurait été moins prompt au dogmatisme. Il n'en est rien. Il s'agit plutôt de dégager certaines façons de raisonner sur la société qui sont probablement constitutives de toute pensée « militante ». André Gide avait dit vers la fin du siècle, avec la perspicacité d'un jeune écrivain situé, lui, dans la logique du champ littéraire : « On ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments ». Je vais montrer comment les socialistes français et belges ont mis leurs « bons sentiments » au service d'un rejet indigné de l'art « bourgeois » [4] et du bricolage d'un contre champ, de l'invention d'une autre littérature qu'on pourrait opposer à cette littérature bourgeoise, inaccessible aux masses, coupée de la « vie », doublement condamnable par ses « contenus », si étrangers aux luttes sociales, et par sa « forme ». Les grands et petits doctrinaires socialistes ont raisonné d'une certaine manière ; ils l'ont fait spontanément — si on veut dire par là qu'ils l'ont fait sans effort ni contrainte portés par la logique du champ ouvrier-socialiste en passe de se muer en « institution totale » (au sens d'Irving Goffmann, — mais Vidée est déjà là en sociologie chez Roberto Michels).
Une date me sert de point de départ : le 14 octobre 1889, — l'année même où, à l'ombre de la Tour Eiffel, deux congrès ouvriers ont déclaré reconstituer l'Internationale, — quelques écrivains « mineurs » au cœur progressiste, Léon Cladel, J.-H. Rosny aîné et autres, se joignent à quelques activistes révolutionnaires dont Adolphe Tabarant, pour créer un Club de l'art social lequel s'éteindra un an plus tard pour renaître peu après. La presse socialiste applaudit avec emphase : « Il est permis de pronostiquer qu'un avenir prospère s'ouvre pour cette association. Nous le souhaitons de très grand cœur tant dans l'intérêt de l'art lui même qui ne peut que gagner en devenant plus vrai et plus émouvant, que dans celui du corps social, obligé, nécessairement, de ressentir l'influence bienfaisante de l'art dont la mission est d'élever, de charmer et d'ennoblir l'âme humaine. » [8]
Le Club part de l'idée que tout « art puissant véhicule des idées sociales » [9], que l'art actuel doit pour durer et intéresser la postérité se mettre au service de la révolution et à l'écoute des masses. Joignant la pratique à la théorie, ses membres se proposent de réaliser une œuvre littéraire collective, La Grande Enquête « qui sera peut-être l'œuvre littéraire capitale de notre période de transition. » [10] Tout est dit dans cette naïve annonce, - non suivie d'effet - d'une œuvre décisive, opposée à l'individualisme « stérile » et vouée à refléter la réalité historique. Le Club compte sur un « petit nombre d'artistes non stérilisés par les préjugés romantiques », d'« artistes conscients » avec qui l'art qui doit émerger apportera « sa sanction au socialisme ». [11] En 1891, le groupe se recompose autour de Fernand Pelloutier, et lance une revue, L'Art social qui réexpose la « mission » qui doit être celle des artistes « conscients » :
Mission
- Tant que durera l'exploitation de l'homme par l'homme (...) nous lutterons par la plume, par la parole, par le pinceau (...)
- Améliorer, rendre plus belle une société, c'est faire de l'art social (...).
- Le socialisme incarnera en lui toutes les manifestations de l'esprit humain, — y compris l'art.
[5]
- L'Art social sera. [12]
Je ne ferai pas l'historique détaillé de la progressive édification doctrinaire à laquelle contribuent des activistes obscurs, proches du « socialisme-révolutionnaire » (avec le tiret) des années 1890, comme Ad. Tabarant et E. Museux, puis de l'anarcho-syndicalisme, comme Bernard Lazare (L'Écrivain et l’art social, 1896) et Fernand Pelloutier, mais auxquelles se joignent les leaders « responsables » comme Jaurès, P. Lafargue ou Emile Vandervelde, et des littérateurs de second rang qui ont cherché à se légitimer par le socialisme comme Anatole Baju, le fondateur de la fameuse École décadente, brûlant soudain ce qu'il avait adoré pour adhérer, fin 1889, au guesdisme, dénoncer « l'art pour l'art », pasticher grotesquement Rimbaud transmué en « Mitrophane Crappoussin » [13] et exiger que « le livre » devienne l'« auxiliaire de la Révolution ». [14] Il renoue, dit-il, ce faisant, avec « l'école moderne », avec une autre manière d'être absolument moderne : « L'École moderne est une révolution : elle ne laisse rien subsister de ce vieux fond d'idées sur lesquelles on a vécu depuis Homère et Virgile jusqu'à nos jours (...), nous violentons les préjugés. » [15]
Un peu plus tard, Marius-Ary Leblond, Saint-Georges de Bouhélier, Bernard Lazare, et une poignée d'autres, brûlant aussi ce qu'ils avaient adoré, chercheront leur salut, tant civique que littéraire, dans la classe ouvrière et renieront « l'art bourgeois », l'art pour l'art.
La synthèse de ce discours répétitif qui oppose, entre 1889 et la Guerre, l'art social à « l'art pour l'art » est relativement aisée en peu de pages car il ne repose que sur quelques thèses récurrentes. Voici comment je reconstitue les grandes articulations du dispositif idéologique.
D'abord, il faut démontrer que l'art importe au socialisme : le socialisme devient un discours total qui doit avoir son mot à dire sur ce qui est un besoin « supérieur » des humains et une manifestation « supérieure » du travail.
- La vie supérieure de l'humanité ne peut leur être indifférente [aux socialistes]. Poursuivre des améliorations matérielles, c'est bien mais c'est insuffisant (...). Il faut que nos amis (...) se persuadent de la puissance et de l'utilité suprême de l'art, l'une des plus nobles forces sociales. [16]
Second axiome : l'art, tout art, « exprime » son époque ou il la « reflète ». C'est également en 1889 que paraît, posthume, l'ouvrage du philosophe Yves Guyau, L'Art au point de vue sociologique, première tentative d'une sociologie artistique et littéraire en effet ; ce que dit en conclusion le philosophe-sociologue plaît aux socialistes car il « confirme » leurs vues : « L'art étant par excellence un phénomène de sociabilité, - puisqu'il est fondé tout entier sur les lois de la sympathie et de la transmission des [6] émotions - il est certain qu'il a en lui-même une valeur sociale.... » [17] L'art acclamé par la classe dominante, issu d'elle, ne peut être, à ce titre, que pervers et mensonger comme elle. De façon converse, si on peut démontrer que cet art est en pleine « décadence », on peut faire de ce diagnostic l'intersigne d'un effondrement prochain de tout l'édifice social. Le capitalisme a « monopolisé » la production artistique comme il a fait l'économique, « au profit exclusif de quelques privilégiés ». [18] Ce faisant, il a « détourné l'art de sa destination logique » en imposant à cette « manifestation supérieure du travail (...) la discipline avilissante et stérilisante de ses bagnes intellectuels ». [19]
Cependant, puisque la conjecture est aussi prérévolutionnaire et en dépit de cette esthétique dominante détournée et corrompue, quelques artistes conscients anticipent l'aurore de la « démocratie sociale » ; l'observateur assure qu'il perçoit même les prodromes d'un « prodigieux élan » qui prélude à la Révolution. [20] On peut constater aussi, prétendent les socialistes, que les écrivains mêmes de la classe exploiteuse, en dépit de leurs orientations politiques, ne peuvent s'empêcher de montrer dans leurs œuvres la mort prochaine de leur classe et de leur société. Cela a été une sorte d'« Eureka-Erlebnis » de toute critique socialisante : en dépit d'eux-mêmes, par un aveu d'autant plus précieux qu'ils ne souhaitent pas le faire, par une logique inconsciente du texte (j'interpole l'expression), les bourgeois écrivains dépeignent l'à-vau-l'eau.
- Certes, la presque totalité des écrivains sont des bourgeois conservateurs, des bourgeois réfractaires à toute idée nouvelle. Mais malgré leur hostilité contre le progrès, ils ne peuvent s'empêcher de constater ... les convulsions dernières d'une société agonisante. [21]
Ainsi la vision crépusculaire et l'ironie inhérents au modernisme sont-ils transmués en aveux précieux de la fatalité d'une crise ultime débouchant sur le socialisme !
Commençons par la Pars destruens de cette idéologie : comment se caractérise l'art de la société bourgeoise agonisante et en quoi est-il, en quelque sorte, antiphysique, contre-nature ? C'est un art monopolisé, appauvri et restreint parce que détourné par une classe, on vient de le voir ; il est le contraire de l'art véritable car l'art authentique s'adresse à l'humanité, il n'est « pas réservé à une élite, celle-ci fut-elle composée en majeure partie de noceurs fatigués, de rastas et de grues ». [22] Bernard Lazare avait contrasté deux formes d'art, « l'art universel » (dont l'art socialiste serait la renaissance) et l'« art particulier » - accidentelle perversion. Depuis Homère jusqu'au futur art collectiviste, l'art vrai fut et sera universel, c'est-à-dire « social ».
[7]
- Ou l'œuvre d'art s'adresse à un peuple et à l'humanité, ou elle s'adresse à une classe restreinte et devient égoïste. Il n'y a jamais eu que ces deux arts : l'art universel et l'art particulier. [23]
L'art particulier n'est qu'un phénomène passager, un épisode mort né, condamné d'avance. Ergo, les « décadents et prétendus symbolistes » ne sont que « la pourriture de la bourgeoisie ». [24] Bernard Lazare qui vient de ces milieux, en une phraséologie qui n'aurait pas déparé Littérature internationale et autres feuilles staliniennes, dénonce maintenant avec fougue « leur littérature de dégénérés, d'incomplets, d'inadapté » [25], « leur horreur de la vie » [26]. « Pas une pensée nouvelle, pas une conception neuve » chez ces « déchets d'humanité », ces « petits fils épuisés de la bourgeoisie conquérante... » [27]. Le diagnostic sur la littérature bourgeoise tourne autour de quelques thèses : morbidité, goût du « malsain », manque de « virilité », horreur de la « vie », égocentrisme (« nombrilisme »), et, inséparablement, inflation de la forme. Car deux critiques alternent et s'additionnent : ou l'art bourgeois, reproche-t-on, est trop hermétique, ou il est trop « sensuel » (l'austère socialiste veut dire : sexuel) :
- Il semble que l'art n'ait pas d'autre mission que d'achever d'émouvoir le repu et de chatouiller savamment ses fibres sensuelles. [28]
Juge du style, le socialisme dénonce l'art bourgeois comme verbal, obscur, tarabiscoté, mais juge civique, il le dénonce toujours d'abord comme « malsain ». Le roman actuel « se complaît dans les peintures obscènes » et « passe trop rapidement sur le bien ». [29] Il devrait nous « instruire » et devrait pour cela rapporter « des scènes de la vie réelle ». [30] C'est mot pour mot que le syndicaliste Fernand Pelloutier semble pasticher avec quarante ans d'avance les tartines des staliniens dénonçant la littérature décadente, « contre quoi doivent réagir les penseurs et les artistes révolutionnaires » pour préserver de l'infection le prolétaire en lutte :
- Outrages au sens commun, charlatanisme, folie, érotisme ! Ce sont là les armes, plus sûres et plus pénétrantes que l'acier dont ils frappent (défenseurs méprisables d'une [8] société qu'ils méprisent) les victimes du Minotaure bourgeois. [31]
F. Pelloutier, l'une des grandes figures du syndicalisme, est particulièrement indigné par la « lubricité » littéraire qui, redoute-t-il, risque de détourner le prolétaire des luttes révolutionnaires : « C'est l'élixir qui ranime pour les prouesses de l'alcôve (...), c'est le déshabillé savant qui met le feu à la cervelle et au ventre (...) Nous redoutons seulement que, poussé toujours au rut, le peuple finisse par y sacrifier ses généreuses ardeurs d'affranchissement. » [32] Ceci, ce genre de choses va se redire avec véhémence et évidence vers 1930 : à quoi bon, pour l'ouvrier en lutte les « mots » d'Oriane, duchesse de Guermante et les vices de Palamède, baron de Charlus, — peignez-nous les luttes épiques de la C.G.T. ! Cet art, « coupé de la vie », écrit pour l'« amusement » des « épuisés », incapable de peindre le réel laborieux qu'il ignore, s'est naturellement replié sur le vain culte morbide de la forme. Inflation de la forme sans la « couverture-or » du contenu, sans une réserve de « vie » : cette réflexion ressemble à une critique de la monnaie fiduciaire.
Les bourgeois appellent cela de « l'art pour l'art. » Le socialiste dira les choses comme elles sont, dénonçant « les jongleurs de mots qui dissimulent le néant de leurs idées sous une phraséologie hermétiquement fermée » [33], les « nombrilistes » du style, ceux qui préfèrent la « prostitution » de la plume à l'« éducation des hommes » ! L'image du nombril est revenue cent fois. Et l'alternative qui était : peindre le réel ou se regarder le nombril ! La Revue socialiste dénonce civiquement ceux qui « riment des sonnets à leur nombril. » [34] Et Bernard Lazare fulmine ce propos (que Proust dans La Recherche attribuera à peine transposé à... Monsieur de Norpois, juge de Bergotte) :
- Ce n'est pas ainsi que nous devons concevoir l'art, nous qui travaillons pour demain. Pour nous le rôle de l'écrivain n'est pas de jouer de la flûte sur une tour en contemplant son nombril ; l'artiste n'est ni un solitaire, ni un amuseur et l'art doit être social. [35]
En effet, il y a un choix qui vous régénérerait, mais il faudrait changer de cap : cesser de contempler son nombril, retrouver l'Universel, renouer avec la Vie et se rendre, du même coup, intelligible au Peuple, et intéressant pour ses Luttes.
Autre chapelet d'évidences : le prolétaire est injustement éloigné de l'art, les exploiteurs lui refusent les plaisirs esthétiques ; il ne pourrait du reste qu'être rebuté par les « chinoiseries formelles » de cet art qui amuse les bourgeois, sinon, comme l'a suggéré F. Pelloutier, détourné des luttes par une sensualité qui plaît aux seuls repus. Exploité économiquement, volé par le surtravail qu'on tire de lui (« vol légal »), l'ouvrier n'en est pas moins aussi volé « de son intelligence et de ses efforts vers le beau, [9] vers l'idéal, vers l'art enfin ! » [36]
Ce propos accusateur peut se retourner : oui, l'ouvrier est dépossédé, privé de jouissance esthétique et de pain... mais l'artiste, de son côté, éloigné du peuple, en pâtit : il se perd en raffinements « stériles » et consomme son « divorce de la vie ». [37] Si l'ouvrier dédaigne l'art actuel, la faute en est imputable à ces artistes qui se complaisent dans un art faux (voir plus haut) et qui, prostitués à l'argent (au « commercialisme »), ne conçoivent plus leur rôle comme un noble « sacerdoce ». [38] Conclusion pratique de ces thèses : « Il faut combler le fossé, chaque jour plus profond, qui sépare le peuple de l'art ». [39]
C'est que le prolétariat, — s'il ne jouit pas d'une éducation raffinée, comme ils le rappellent, — possède un sens esthétique inné, issu d'une expérience saine et directe de la vie, laquelle manque au bourgeois. « Dès maintenant, malgré son état rudimentaire d'éducation morale, le prolétariat est seul capable de saisir toutes les nuances de la vie. » [40] On n'en est pas encore à l'idolâtrie communiste d'un prolétariat mythique doté d'esthétique et de science infuses, mais on en prend le chemin.
Or ce prolétariat, avide de « nobles » jouissances esthétiques, est nourri par la classe dominante de sous-produits, d'une prétendue « littérature populaire », qui n'est que destinée à 1' « abrutir », à fausser son goût et son jugement. On rencontre toujours ici un raisonnement conspiratoire : tout ceci est voulu ! La presse socialiste n'a cessé de dénoncer les proto-industries culturelles, le café-concert niais, patriotard, et le roman-feuilleton « où s'entrechoque toutes les sexualités faussées, les cerveaux et les sens égarés des vibrations décadentes et raffinées, les conflits de possession des hommes et des femmes nourris de l'esprit de propriété... » [41] « Ensuite [le fils du peuple] chante les refrains de la rue, chansons stupides se terminant presque toutes par la haine du Prussien, la revanche et l'amour de la patrie.... » [42] La dénégation sous-jacente à ces indignations et ces mises en garde était claire : les genres dits populaires ne reflètent aucunement le goût spontané des masses ! La sous-littérature est imposée aux masses par la classe dominante pour les maintenir dans un état d'aliénation (grande notion marxienne qui sera redécouverte par les intellectuels des années trente), profitable aux exploiteurs. Épuisé par un labeur excessif, le prolétaire sainement rebuté par un art bourgeois hermétique et « coupé de la vie », se voit gavé d'une sous-littérature destinée à perpétuer son asservissement politique.
À ce tableau de la situation, les doctrinaires socialistes ont répondu par un mot d'ordre : « L'art [10] pour tous ». L'art devenu le « pain quotidien des foules » et non le privilège d'une prétendue élite. [43] Que l'art devienne un objet de première nécessité ! L'art mis dans de telles conditions serait tout le contraire de l'art bourgeois.
Ce slogan appelait à une alliance entre le prolétaire et l'artiste. Il promettait à celui-ci qu'il pourrait s'il le voulait sortir de sa « tour d'ivoire », peindre et écrire pour les « larges masses » et en communion avec elles. Il a été entendu de bien des écrivains, — ceci, encore, avant l'image d'Épinal répandue par la presse soviétique du temps de Staline, du poète devant une foule en bleu de chauffe, émue, attentive, sur fond de haut-fourneau. « Artistes, si vous le voulez, faisons alliance », propose Jean Jaurès [44]. Et Anatole France, parmi d'autres d'un prestige moins universel, répond à l'invitation et éditorialise dans L'Humanité sa vision de l'art social : « Oui, l'art doit être pour tous, car il est de tous, et que tous le créent, l'artisan autant que l'artiste... » [45]
L'artiste souvent exprimait une réticence : devrait-il sacrifier au socialisme sa précieuse « liberté » créatrice (les staliniens diagnostiqueront dans cette réserve un signe indécrottable d'individualisme petit-bourgeois) ? Les socialistes de la Belle Époque prétendent comprendre ces réticences et renchérissent de promesses. Ils s'engagent pour le gouvernement collectiviste futur.
- Le gouvernement collectiviste (...) ne leur imposera aucune formule, aucune méthode officielle, il leur assurera une liberté absolue, se bornant dans leur jeunesse à favoriser l'éclosion de leur talent naissant et plus tard, à leur donner, selon leurs mérites, le nécessaire, l'aisance ou la fortune. [46]
C'étaient d'alléchantes promesses, mais il fallait peut-être lire entre les lignes. L'écrivain aurait « toute liberté », soit, mais il devrait aussi comprendre ce que la conjoncture attendait de lui, comme l'indique bien Marius Renard dans sa brochure sur la Littérature sociale : « S'il est sincère, [l'écrivain] plie son art aux exigences du moment (...) parce qu'il comprend qu'il doit apporter sa part dans l'œuvre sociale. » [47]
Cet « art pour tous », cet « art social », opposé aux perversions thématiques et formelles bourgeoises renouant avec son essence éternelle, puisque de tout temps « l'art des grands créateurs a été un art social » [48], qu'est-ce qui va enfin le caractériser ? Je passe sur diverses conjectures pour aller à l'essentiel, qui était à la fois évident et équivoque (comme il est de règle dans les idéologies). L'art véritable doit avoir un but et proclamer ce but : il doit éduquer et non divertir ou se complaire dans la gratuité : c'est le premier théorème. Le second : cet art, renouant avec la « vie », devra être réaliste. Tels [11] sont les deux axiomes qui forment le socle d'un discours militant qui, né dans le socialisme romantique, ira se figer dans la doctrine stalinienne qu'à la suite de Régine Robin, j'ai étudiée dans un récent ouvrage. [49] Les capitalistes, oisifs et parasitaires, veulent un art « gratuit », récréatif, divertissant, - susceptible de leur faire oublier leur triste rôle social. Le peuple n'a que faire d'inutilités et de vacuités formelles : il veut être « éduqué ». Aux « ouvrages sans but défini », Roger Marx oppose « l'art social » qui « s'exerce en fonction de la vie ». [50] À l'époque romantique, le clan des perruques répétait que la mission de l'art était de « moraliser » ; le socialiste au tournant du siècle confère au fond à l'art une mission analogue, « utile » et « noble » : « élever, charmer et ennoblir l'âme humaine » [51], se vouer à « l'éducation complète de l'homme et l'amélioration de la vie sociale ». [52] Marius Renard réclame de façon pesante l'avènement d'une littérature d'université populaire.
- Elle va vers l'examen de l'état social, vers des déductions de morale et d'enseignement profitables à tous (...) L'écrivain donne à son art une conception résolument sociologique et altruiste. (...) Quelle que soit la nature et la formule du roman de demain (...), il s'efforcera d'être une œuvre d'éducation. [53]
Mandaté pour « éduquer » et élever les masses, il semble difficile que l'art futur échappe au contrôle de l'État collectiviste. Mais ce mandat éducatif qui, dans son flou, n'est qu'une protestation contre un art bourgeois décrété « nombriliste », se complète d'un autre mot d'ordre dont l'histoire a été entreprise par Régine Robin : le postulat du réalisme. [54] L'art social qui « s'exerce en fonction de la vie » devra avoir un seul but : peindre le « réel ». [55] On représente les poètes sociaux « dédaignant le bleu », qui « burinent des rimes réalistes, vécues ». [56] J'ai étudié, à mon tour ce discours du réalisme dans l'entre-deux-guerres dans ses complexes équivoques : il ne peut être question de résumer ici des évidences confuses qui sont venues hanter les discours militants de générations successives. [57] On peut dire cependant ce qui découle de l'axiome. Des deux grands mots d'ordre s'ensuit une dérive d'exigences pressantes : l'art, éducatif et réaliste, ne pourra que se vouer à « dévoiler les plaies [12] sociales », il peindra donc - réalistement - les « luttes ouvrières » et les « convulsions dernières d'une société agonisante » [58], il dénoncera les iniquités et combattra les privilèges... « Écrivains, apostrophe Pelloutier, exprimez donc à toute heure votre colère contre les iniquités ; insultez au Pouvoir qui étouffe les opinions, outrage les plus respectables, les plus intimes de sentiments... flagellez ... marquez au fer rouge... » [59] L'artiste social ne manquera pas de sujets dignes de l'inspirer : « Quoi de plus beau que le tableau d'une grève avec ses passions et ses souffrances ? » [60]
Un dernier bloc d'idéologèmes, bien et abondamment attesté, vient dépeindre le bonheur de l'artiste et la renaissance de l'art après la Révolution. Les doctrinaires de la Seconde Internationale ont beaucoup pratiqué le tableau utopique. [61] « L'avènement du collectivisme — qui rendra tous les citoyens libres en les faisant égaux — sera pour l'art contemporain le signal de la délivrance et l'ère d'un nouvel essor. » [62] C'est que les théoriciens de la Seconde Internationale raisonnent dans la logique des grandes certitudes historiques où l'avenir distinctement conçu éclaire le présent obscur et indécis. Le ci-devant prolétaire, une fois émancipé, formera pour l'artiste un public immense et raffiné. « On ne peut raisonnablement prévoir le triomphe du prolétariat sans que ce prolétariat atteigne un degré de développement intellectuel, de compréhension des intérêts généraux qui, seul, rendrait possible sa victoire normale et définitive », écrit Emile Vandervelde et Jules Destrée prophétise avec grandiloquence : « l'art sera partout. Non seulement il formulera de façon magnifique l'élan général vers l'idéalité, mais il descendra aux objets usuels de la vie quotidienne. » [63]
Émancipé du « commercialisme » et n'étant plus asservi au goût corrompu d'une classe parasitaire, l'art allait donc connaître après la Révolution une bienheureuse renaissance. Ces prédictions étaient d'autant moins inutiles à développer que la thèse de la « mort de l'art » sous un État collectiviste était depuis longtemps (cela commence avec Louis Reybaud en 1848) un cheval de bataille de tous les réactionnaires. Un fameux politicien libéral allemand, Eugen Richter, dans ses dystopiques Socialdemokratische Zukunftsbilder (1891) avait dépeint ce que serait un art socialiste avec une ironie satirique qui avait profondément indigné.
Naturellement, on ne joue dans tous les théâtres que des pièces qui glorifient le nouveau régime et qui renouvellent d'une manière vivante le souvenir de l'infamie des exploiteurs et des capitalistes d'autrefois. À vrai dire, cela paraît à la longue un peu monotone, mais cela fortifie les bons sentiments. [64]
[13]
Les leaders socialistes, indignés des tableaux « diffamatoires » de Richter, auraient cependant bien fait de lire les pesants projets d'« application du système collectiviste » émanant de leurs penseurs les plus autorisés. L'effet de comique bureaucratique, — ici involontaire, — n'est pas moindre sur le lecteur de cette fin du XXe siècle.
- Les ouvrages seront soumis à l'examen d'un comité composé de tous les maîtres sans distinction d'école et appréciés par eux au seul point de vue de l'art en dehors de toute question de tendance. Celles qui seront admises seront imprimées aux frais de l'État et mises en vente. De plus leurs auteurs recevront aussitôt une pension. Quant aux écrivains dont les œuvres seront écartées par le comité, il leur restera la ressource de les faire imprimer à leurs frais. (...)
- Il conviendra de soumettre tous les ouvrages refusés par le Comité des auteurs à une commission de censure, chargée de délivrer le bon à imprimer et qui écartera impitoyablement les malpropretés. [65]
*
Mon analyse de l'idéologie de l'art social est certes simplifiée, incomplète, elle n'a voulu que dégager les thèses récurrentes qui forment un quasi-système, plein à la fois d'évidences et de contradictions où les idées vagues débouchent sur de fortes certitudes. Il faudrait poursuivre en décrivant à partir de ce paradigme le bricolage par le mouvement socialiste d'un contre-champ correspondant à cette littérature nouvelle que la doctrine appelait de ses vœux. Contre-champ ou contre-littérature où furent rassemblés - de grands romancier « récupérés » comme le Zola de Germinal, et des poètes académiques à l'inspiration « humanitaire » comme Sully-Prudhomme - des compagnons de route (avant la lettre) comme le vieux quarante-huitard Félix Pyat, le poète Clovis Hugues, - des naturalistes mineurs comme J.-H. Rosny aîné, Lucien Descaves, des poètes et chansonniers du peuple comme Eugène Pottier, J.-B. Clément, Jules Jouy et enfin, — ceux-ci vierges de toute étude, — une vaste cohorte d'écrivains départi, nouvellistes, dramaturges et poètes dont toute la production a été diffusée et louangée par les seuls organes du mouvement ouvrier. Il y a ici notamment les noms de nombreux militants aussi différents de tempérament et d'inspiration que Louise Michel et Georges Renard qui ont également produit une œuvre littéraire « engagée » [66]. En dehors de tout jugement à priori, cette littérature, ces milliers de vers et de lignes de prose qui « dénoncent » le mal social, l'exploitation capitaliste et « chantent » les luttes sociales mériteraient une étude qu'il n'est pas possible d'amorcer ici.
J'ai donc décrit quelque chose de non-avenu, exposé des thèses qui ont subi le démenti constant de l'évolution du champ artistique. L'idéologie (ou l'utopie) de l'art social est cependant revenue hanter [14] les modernismes successifs, des années 1830 aux années soixante de notre siècle. Il s'est alimenté à la certitude des militants comme à la mauvaise conscience des artistes. Cette idéologie comportait une part critique - dénonciation de l'art bourgeois, corrompu et décadent, coupé de la vie et fermé aux masses, se complaisant dans les « chinoiseries » formelles et le « malsain » - et comportait une contre-proposition radicale.
La doctrine de l'art social se présente comme une accusation globale et comme un simple remède — c'est-à-dire une alternative en même temps qu'une réconciliation nécessaire, inévitable à terme : réconciliation de l'art et du peuple, des « larges masses » proclamées avides de « jouissances esthétiques », remède à la névrose « individualiste » de l'art moderne, « égoïste », mis en tutelle par les « oisifs », fermé à la modernité véritable, fermé à 1'« universel ». Avec un lourd matérialisme, les socialistes ne cessèrent de répéter que l'art ne doit pas être dissocié des « autres formes » de l'activité « productive », des autres réalisations de ce qu'on caractérise comme 1'« effort musculaire, nerveux et cérébral » de l'homme. Sans doute, l'art est-il nécessairement conditionné par « l'époque et le milieu social » — ce qui voulait dire : à époque bourgeoise, art bourgeois — mais dans une époque de montée en puissance du « prolétariat conscient et organisé », dans une époque où l'artiste sentait peser intolérablement sur son labeur le joug de l'exploitation bourgeoise, ledit artiste ne pouvait que prendre conscience du fait que « la phase capitaliste de l'évolution humaine a détourné l'art de sa destination logique » et les meilleurs d'entre les artistes ne pourraient que rallier la cause de la classe révolutionnaire au lieu de créer « au profit exclusif de quelques privilégiés ». [67]
J'ai résumé des centaines de pages de thèses récurrentes dans les brochures, les revues de doctrine et les cours des universités populaires. Cette doctrine d'art social en venait à dire aussi ce que sera l'art au lendemain de la révolution prolétarienne. Et, ce disant, elle semble pour nous prédire avec une fâcheuse justesse ce que seront en effet les canons de l'esthétique stalinienne réaliste-socialiste. Ce que, spontanément, inventent d'abord entre 1880 et 1914 d'obscurs « cercles d'art social », réunissant des artistes mineurs et des militants « cérébraux » ; ce que confirment avec l'aplomb de l'évidence les résolutions des congrès des partis et des syndicats, soucieux de consacrer un paragraphe à « l'art émancipé » et de montrer que le prolétariat avait de justes revendications dans l'ordre des « besoins spirituels » et qu'il parlait aussi pour les « ouvriers de l'esprit », ce que mettent en doctrine les leaders français et belges, toutes ces thèses ont préfiguré, proposition pour proposition, l'esthétique réaliste-socialiste — à la possibilité près de faire appel au bras séculier d'un État pour en obtenir la réalisation. Le réalisme socialiste soviéto-stalinien n'a fait que reprendre des raisonnements, des protestations et des espoirs qui s'étaient spontanément développés tout au long de la Deuxième Internationale en Europe occidentale.
À la volonté militante de voir le monde comme unifié, intelligible et prochainement réconcilié correspond une appréhension étroite de la littérature, la littérature conçue comme « comédie humaine » et rien d'autre, ayant à inlassablement produire des procès-verbaux et des témoignages sur le « réel » — définition selon laquelle il serait tout à fait pertinent d'exiger d'elle que les luttes de la C.G.T. lui présentent plus d'intérêt que les « mots » d'Oriane de Guermantes. Or, cette conception encyclopédique du mandat littéraire ne correspond simplement à rien de ce que la littérature a jamais pu ou voulu faire. Si la littérature, du classique au moderne, n'a jamais eu pour fonction (sinon [15] occasionnellement et en apparence) de dresser des procès-verbaux, si la connaissance positive du « monde » ou de l'« âme » lui échappent parce que ce qu'elle peut est d'un autre ordre, alors toute la réflexion sur le juste « reflet » de la « vie » et toutes les exigences de « réalisme » tiennent du contresens, un contresens axiomatique dont les partis pris et formules toutes faites qu'il engendre sont les symptômes. Que le militant exige que la littérature lui parle des « choses » qui l'intéressent et pour lesquelles il se dit prêt à mourir, cela se conçoit, mais la critique militante part d'un axiome sur la nature de la littérature qui est une erreur de perspective. Exiger que la littérature éduque, dénonce, encourage, se mette au service de..., c'est être aveugle à ce qui, même dans les écrits « réalistes », y contredit l'apparence de clarté conclusive, de référence, de monosémie. Mais ces contresens ne permettent pas de se débarrasser de l'insolente question : pourquoi la littérature serait-elle incapable de servir à sa manière le vrai, le juste, de contribuer au bien, de dire le « bonheur » (comme le formulait Nizan) ? Et pourquoi ne faut-il pas le souhaiter ?
A. Bibliographie primaire
Albert, Charles. L'Art et la société. Paris : L'Art social, 1897.
L'Art social. Réd. Gabriel de la Salle. Paris, nov. 1891 -...1894 ?
L'art social. Dir. Fernand Pelloutier. Paris, juillet-décembre 1896.
Baillet, Eugène. De quelques ouvriers poètes : biographies et souvenirs. Paris : Labbé, 1898.
Baju, Anatole. L'Anarchie littéraire. Paris : Vanier, 1892.
Bellot, Etienne. Synthèse d'art social. Paris : Michalon, 1908.
Bernier, R. « Le socialisme et l'art », Revue socialiste, v. 13 : 1891. 599-604.
Brun, Charles. Le roman social en France au XIXème siècle. Paris : Giard & Brière, 1910.
La Chimère. Revue de littérature démocratique. Dir. Ch. Bourcier. Paris, sept. 1907-nov. 1909.
Clément, Jean-Baptiste. La chanson populaire. Paris : Banque ouvrière, 1900.
Les Coquelicots. Recueil poétique ouvert à tous les poètes ouvriers de France et d'Algérie. Paris, 1-5 1889-...1890.
Crouzet-Benaben, J.-P. Poésie philosophique et action sociale : Jean Lahor. Paris : Lemerre, 1908.
Le Décadent. Dir. Anatole Baju. [La revue opte avec véhémence pour l'art social en] 1889. [elle devient pour qq numéros La France littéraire].
Demolder, Eugène. Constantin Meunier. Bruxelles : Deman, 1901.
[16]
Destrée, Jules. Art et socialisme. Bruxelles : Brismée / Le Peuple, 1896.
L'Ère nouvelle. Dir. G. Diamandy. Paris,... 1893 -....
Grave, Jean. « L'art et les artistes », La Société future. Paris : Stock, 1895. Chap. XXIV.
Gros, J.-M. Le mouvement littéraire socialiste depuis 1830. Paris : A.-Michel, 1904.
Guyau, Yves. L'art au point de vue sociologique. Paris : Alcan, 1889.
Jaurès, Jean. « L'art et le socialisme », Le Mouvement socialiste, vol. I : 1900. 513-525 & 582-590 [repris dans ses Œuvres, VI\.
Lafargue, Paul. Critiques littéraires. Introd. de Jean Fréville. [Recueil posthume]. Paris : ESI, 1936.
Lahor, Jean (pseud. d'Henry Cazalis). L'art pour le peuple à défaut d'art par le peuple. Paris : Larousse, [1902 ?].
Lahor, Jean. Les habitations à bon marché et un art nouveau pour le peuple. Paris : Larousse, 1904.
Laverdant, [Désiré]. De la mission de l'art et du rôle des artistes. Salon de 1845. Paris : La Phalange, 1845.
Lazare, Bernard. L'Écrivain et l'art social. Paris : Bibliothèque de l'Art social, 1896.
Leblond, Marius-Ary. La société française sous la Troisième République d'après les romanciers contemporains... Les anarchistes et les socialistes. Paris : Alcan, 1905.
Livet, A. « La chanson rouge », Revue socialiste, v. 36 : 1902. 548-571.
Marmande, R. de. Les intellectuels devant les ouvriers. Paris : Du Jarric, 1907.
Marx, Roger. L'art social. Préface d'Anatole France. Paris : Fasquelle, 1913.
Morris, William. « L'art du peuple » [trad. de l'anglais], La Société nouvelle. Bruxelles, juillet-août 1894.
La Muse des Prévoyants, recueil poétique. Paris : Les Prévoyants de l'avenir, 1889-... ?
Normandy, Georges. La poésie sociale contemporaine. Cahors : Petite bibliothèque provinciale, 1905.
Pelloutier, Ferdinand. L'art et la révolte. Paris : Gauthey, 1896.
Plekhanoff, Georges.
Poinsot, M.-C. Le temple qu'on rebâtit : littérature et philosophie sociales. Paris : , 1908.
Proudhon, P.J. Du principe de l'art et de sa destination sociale. Paris : Lacroix, 1875. (Posthume).
[17]
Renard, Georges. La méthode scientifique de l'histoire littéraire. Paris : Baillière, 1900.
Renard, Marius. La littérature sociale. Gand : Volksdrukkerij, 1912.
Rolland, Romain. Le théâtre du peuple, essai d'esthétique d'un théâtre nouveau. Paris : Hachette, 1913.
Rosenthal, Léon. Les destinées de l'art social d'après P.-J. Proudhon. Paris : Giard & Brière, 1894.
Sorel, Georges. La valeur sociale de l'art. Conférence faite à l'École des hautes études sociales. Paris : Jacques, 1901. Voir aussi : « Sur l'art et sur les artistes », Propos de Georges Sorel recueillis par Jean Variot. Paris : Gallimard, 1935.
Vandervelde, Emile. Essais socialistes : L'alcoolisme. La religion. L'art. Paris : Alcan, 1906.
B. Brève bibliographie secondaire
Angenot, Marc. La critique au service de la Révolution. Montréal : Ciadest, 1996.
Aron, Paul. Les écrivains belges et le socialisme 1880-1913. Bruxelles : Labor, 1985.
Aron, Paul. La littérature prolétarienne en Belgique francophone depuis 1900. Bruxelles : Labor, 1995.
Cahiers Henry Poulaille. Bassac, 1989-...
Herbert, Eugenia W. The Artist and Social Reform, France and Belgium, 1885-1898. New Haven : Yale UP, 1961.
Masson, Pierre. Le Disciple et l'Insurgé. Roman et politique à la Belle Époque. Lyon : P.U. de Lyon, 1987.
Puissant, Jean. « La chanson sociale ou le pamphlet du pauvre », in Cent ans de droit social belge. Bruxelles : Bruylandt, 1986. 171-185.
Rancière, Jacques. La nuit des prolétaires. Paris : Fayard, 1981.
Thibert, Marguerite. Le rôle social de l'art d'après Saint-Simon. Paris : Rivière, 1925.
Thomas, Edmond. Voix d'en bas : la poésie ouvrière du XIXème siècle. Paris : Maspero, 1979.
Vicinus, M. The Industrial Muse. A Study of 19th-Century British Working-class Literature. London : CroomHelm, 1974.
Volker, Eckhard. Schriftsteller une Arbeiterbewegung in Frankreich. Literaturprogrammatik und Kulturpolitik zwischen Dreyfus-Affaire und Volksfront. Köln : , 1980.
© M. A.
[1] P. Nizan, « Dostoïevsky », Monde, 29 mars 1935, 8. Voir M. Angenot, La Critique au service de la Révolution, Montréal : Ciadest, 1996, 334.
[2] Laverdant, op cit., 21-22.
[3] « Gustave Courbet », Le Représentant du Peuple, 16 : 16 avril 1848, 1, signé P. Hawke.
[4] Max Raphaël, « Picasso », in Proudhon, Marx, Picasso, Paris : Excelsior, 1933.
[5] P.-J. Proudhon, Du principe de l'art et de sa destination sociale, Paris : Lacroix, 1875 (Posthume).
[6] Richard Wagner, Kunst und Revolution, Leipzig : Wigand, 1850, trad. fr. L'Art et la révolution, Bruxelles : Bibl. des Temps nouveaux, 1898.
[8] Le Peuple (Bruxelles), 8 décembre 1889, éditorial.
[9] Revue socialiste, vol. II : 1890, 102.
[12] E. Museux, L'Art social, déc. 1891, 26.
[13] Le Décadent, 1.2. 1889, 46-48.
[14] Idem, 15 mars 1889, 31.
[15] La France littéraire (nouveau titre du journal d'Anatole Baju à partir de ce numéro), 15 avril 1889, 8.
[16] Jules Destrée, Art et socialisme, Bruxelles : Brismée, 1896.
[17] Op. cit ., conclusion (Paris : Alcan, 1889).
[18] Le Socialisme (guediste), 14 : 16 février 1908, 2.
[20] Jaurès, « L'Art et le socialisme », 515 et 517.
[21] « Causerie », Égalité, 16.8.1890.
[22] Sixte Quenin, Comment nous sommes socialistes, Paris : Quillet, 1913, 187.
[23] Sixte Quenin, Comment nous sommes socialistes, Paris : Quillet, 1913, 187.
[28] Grandjouan, La Guerre sociale, 8-14 janvier 1908.
[29] Lepic, le Réveil des mineurs, 25 octobre 1890.
[31] Pelloutier, L'Art et la révolte, 14.
[33] La France littéraire, 7 : 1889.
[34] Revue socialiste, 1 : 1890, 101.
[36] Le Prolétariat (Paris, F.T.S.F.), 22.2.1890, 1.
[38] Thème développé par Marius Renard, La littérature sociale, Gand : Volksdrukkerij, 1912.
[39] La Chimère, août 1908, 1.
[40] R. Cabannes, La Cité (Toulouse, S.F.I.O.), 15 août 1908, éditeur.
[41] Les Temps nouveaux, 7 mars 1908, 1.
[42] L'Égalité, 20 juin 1889, 2.
[43] L'Égalité, 20 juin 1889, 2.
[44] Jaurès, « L'Art et le socialisme », 590.
[45] L'Humanité, 6 avril 1908, 1.
[46] X., Revue socialiste, v. 28 : 1898, 601.
[47] M. Renard, Littérature sociale, Gand, 1912.
[48] B. Lazare, L'Écrivain..., 8.
[49] La Critique au service de la Révolution, Montréal : Ciadest, 1996.
[50] L'Art social, Fasquelle, 1913.
[51] J. Volders, Le Peuple, 8 décembre 1889, 1.
[52] A. Baju, Le Décadent, no 31 : 1889.
[54] Le Réalisme socialiste, Paris : Payot, 1896.
[55] Roger Marx, L'Art social, 5.
[56] L'Égalité, 31 octobre 1889, sur le Club de l'art social.
[57] M. Angenot, « Doctrines d'art social et pratique picturale », in M. Biron et P. Popovic, Écrire la pauvreté, GREF, 1996, 159 et sqq.
[58] « Causeries littéraires », L'Égalité, 16 août 1890.
[59] F. Pelloutier, op. cit., 27.
[60] E. Montusès, Combat, 22 mars 1908.
[62] P.G. « À propos d'art », Le Socialisme, 16 février 1908.
[63] É. Vandervelde, Essais socialistes..., 243 et J. Destrée, L'Art..., 12.
[64] Op. cit., Berlin : Fortschritt AG, 1891, trad. fr. de 1895, 41.
[65] Lucien Deslinières, L'Application du système collectiviste, Paris : Revue socialiste, 1899, 357.
[66] Louise Michel liée aux milieux anarchistes mais dont la poésie victorhugolesque a été appréciée de tous. Voir par ex. L'Atlantide, Almananch de la question sociale 1891. Georges Renard, l'une des figures universitaires du socialisme français, publie notamment en 1892 le roman du passage d'un jeune bourgeois au socialisme, roman qui fournit un modèle qui a un bel avenir jusqu'à Aragon, la Conversion d'André Savenay, Paris : Dentu.
[67] « P.G. », Le Socialisme, 16 février 1908, 2.
|

