|
Georges-Arthur Goldschmidt
Traducteur, écrivain et essayiste
né en Allemagne en 1928 et naturalisé Français en 1949
HEIDEGGER ET LA LANGUE ALLEMANDE
IV. Heidegger et la langue allemande.
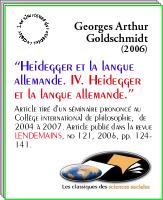
Article tiré d’un séminaire prononcé au Collège international de philosophie, de 2004 à 2007. Article publié dans la revue LENDEMAINS, no 121, 2006, pp. 124-141.
[124] Hans-Georg Gadamer dans son essai Heidegger et la langue écrit que « le monde entier retentit des propos d’un homme qui de son propre chef s’est exprimé de façon provocante sur l’impropriété des langues française, anglaise, italienne et espagnole à la philosophie. » Un peu plus loin il ajoute : « I1 n’est certes pas toujours agréable d’être contraint par la volonté dictatoriale de penseur (diktatorischer Denkerwille) d’un Heidegger de maltraiter la langue. Cela c’est incontestable. Mais il faut bien convenir justement d’un déplacement considérable de formules pétrifiées quand nous voyons les vivantes visions de la pensée empêtrées dans des règles et des usages linguistiques fixes et les stéréotypes des opinons. »
Il rappelle ensuite l’importance d’analyse du Dasein de la langue dans S/Z. Heidegger a voulu rompre avec l’usage conceptuel de la langue philosophique, passer du Bewusstsein, de la conscience, au Sein (Bewusstsein contient d’ailleurs déjà sein), à une langue philosophique nouvelle, d’ailleurs déjà largement inaugurée par Husserl dans ses « Jahrbücher für Philosophie und phänomenologische Forschung » dont S/Z formait le volume VIII, au point de rompre même avec la typographie classique. Le groupe autour de Husserl inventera ainsi pour l’éditeur Niemeyer une typographie volontairement située entre romain et gothique pour bien marquer ce renouvellement.
Il s’agissait pour Heidegger de sortir du langage classique de la philosophie et d’inventer un nouveau langage pour la tribu, le malheur c’est qu’en allemand c’est déjà pris, comme aurait dit Malaparte. On ne peut rien y inventer qui n’y soit déjà, la langue précède toujours celui qui s’y manifeste. L’abondance du vocabulaire composable, presque à volonté, à partir des 2500 racines de base, permet à la pensée de s’y déployer en toute facilité selon les pistes des associations verbales possibles. C’était un vieux problème déjà largement soulevé par Nietzsche et avant lui par Heine ou Schelling, comme nous l’avons vu lors du premier entretien.
Heidegger ouvre, à l’instar de Celan, des voies extraordinaires à la langue allemande, déjà largement parcourues ailleurs que dans le domaine proprement littéraire. Mais alors que la langue de Celan est encore à venir, une langue qui atteste qu’elle ne fut pas détruite par la nuit nazie, comme il l’a dit à Brême, la langue de Heidegger est sans avenir, fermée sur elle-même, tout au plus, soit autoritaire, soit archaïque. Bien loin de recourir aux mots tels quels, il recourt aux composés les plus denses et les plus puissants possibles où s’établissent des circulations de sens, mais qui souvent constituent des unités indissociables où le sens ne reste pas en suspens, en attente, mais se fait impératif si bien que les constituants des [125] mots s’épuisent. « Die Grundverfassung der Geschichtlichkeit » (la constitution fondamentale de l’historialité) est comme un cube impénétrable (§ 74) et « die Ausdrücklichkeit der Verweisungsbezüge die zur Bewandnisganzheit gehören » (§ 32, 149) (L’explicité en rapport de renvois indicatifs qui font partie de la totalité concernante) est infranchissable et se dresse devant le lecteur comme une muraille.
Cette langue est aussitôt elle-même figée dans ce qu’elle dénonce puisqu’on la reconnaît aussitôt. Dans son énoncé elle n’échappe en rien au linguistique.
Heidegger conduit par le rejet presque physique de la tradition et de ce qu’il considérait comme étant révolu, en vient à adopter un langage dont la tonalité et la grammaire affirmative ont la même origine que la lingua tertii imperii : à savoir, l’idée que seul l’allemand est apte à exprimer le philosophique, en effet, die Sprache n’a pas de vrai pluriel. Die Sprache c’est la langue-langage et die Sprachen ce sont les langues qui du coup perdent leur statut de die Sprache. D’où sinon tirerait-il l’ahurissante affirmation au dire de ses amis français, ceux-ci parlent allemand quand ils se mettent à penser, mais quel est cet allemand ?
Les révolutions stylistiques furent d’ailleurs nombreuses et simultanées alors en Allemagne et Heidegger est en ceci largement tributaire de l’ensemble de la Jugendbewegung et du Wandervogel. Heidegger est dans le droit fil de la formidable insurrection de la jeunesse avant et après la guerre de 14-18, la revue der Eigene joue un rôle capital dans ce climat d’intense nervosité, de retour à la nature et de protestation généralisée contre la modernisme, sans le contexte d’exaltation germanique et d’obsession du pur, (frisch, froh, frei) Heidegger est inexplicable.
Or, il se trouve que cette libération de la langue et des concepts retombe elle aussi là où elle ne voulait pas aller. Heidegger écrit une langue piégée par son intention même et c’est ce qui est si difficile à faire entendre en français. La formulation enferme aussitôt le formulé « Die Hinausgesprochenheit der Rede ist die Sprache. » (Le prononcé du discours est la langue) (§ 34 de S/Z, 161). Elle n’échappe en rien à la fixation verbale que S/Z dénonce par cette formule même, le suffixe -heit réinstitue un Seiendes inéluctable. Heidegger a beau dire que das Gerede, le bavardage, n’est pas péjoratif, il n’en inclut pas moins la structure dans son expression (Das Dasein hört, weil es versteht), l’être-là entend parce qu’il comprend) (163). Il correspond pourtant au Geschwätz que dénonce au même moment Friedrich Georg Jünger, le frère de l’autre : Ernst, dans son essai Aufmarsch des Nationalismus, qui est très proche de la pensée de Heidegger. Die Sprache est bien entendu l’allemand, mais tel que Heidegger l’entend, comme langue originaire, la Sprache telle qu’elle parle dans la Sage, la parole, en somme, la « natürliche Sprache » qui n’est plus qu’un reste dérangeant dans la langue utilitaire. Bien que ce ne soit pas explicitement dit dans Der Weg zur Sprache, c’est seulement au grec et à l’allemand que Heidegger semble accorder, en somme, ce Restbestand, ce Vorwegsein, qu’on ne voit jamais évoqué à partir d’autres langues telles que le français p. ex. Max Picard dont Heidegger s’est beaucoup inspiré, tant [126] dans Die Welt des Schweigens que dans Der Mensch und das Wort a montré dans une langue calme et magnifique, l’insaisissable silence qui règne dans la parole.
La langue n’est pas forcément ce que Heidegger décide et la « Destruktion » qu’il opère, vise en fait, comme l’écrit Gadamer, à ramener la terminologie à sa portée originaire. Mais ces expériences originaires ne sont formulables en tant que ursprüngliche Erfahrungen (99) que dans la langue où elles se trouvent formulées. Qu’en est-il des autres langues ?
(On peut d’ailleurs remarquer que Kant avait déjà tout dit à ce sujet dans Die Deutlichkeit der Grundsätze.) Pour Heidegger l’originel, le propre de la langue (das Eigentliche) n’est formulable qu’en allemand et de plus dans un certain allemand reconstitué et forcément artificiel, comme l’est finalement l’allemand de S/Z, malgré sa puissante évidence. La langue de Heidegger est avant tout une « Aussage », expression, notion dont Adorno dans Jargon de l’authenticité a montré la prétention à la vérité. Mais de même que Heidegger, Adorno tombe exactement dans les travers qu’il dénonce. Le livre d’Adorno dénonce sans cesse, mais ne montre guère ce qu’il dénonce. De plus, il ne faut pas oublier que là où le vocabulaire paraît le plus allemand, il y a au moins une chance sur deux qu’il soit d’origine latine.
C’est en 1934 et en 1942, dans ses séminaires sur Hölderlin, que la langue (Die Sprache) apparaît comme telle. Heidegger ne parle que de Die Sprache, l’allemand donc comme moyen d’accès privilégié au Seyn, comme s’il n’y avait pas de pluriel à la langue et qu’elle était donc unique, la seule à donner accès à la Dichtung et à la Sage, au poétique et au Dire. Anne-Marie Gethmann-Siefert en avait en 1988 fait une analyse très subtile et détaillée, elle cite ce passage caractéristique dans Heidegger und die praktische Philosophie (STW) (197). Dans le volume 39, cours sur Hölderlin, il écrit en effet « Indem der Wink der Götter gleichsam in die Grundmauern der Sprache eines Volkes durch den Dichter hineingebaut wird, ohne dass vielleicht zunächst das Volk dies ahnt, wird im geschichtlichen Dasein des Volkes das Seyn gestiftet, in dieses Seyn eine Weisung und Angewiesenheit gelegt und ihm hinterlegt. » (Dans la mesure même où le signe que font les dieux est comme maçonné dans les murailles de base d’un peuple par le poète sans que d’abord peut-être le peuple s’en doute, il lui est inauguré l’être dans l’existence historiale du peuple, dans cet être lui est donné et dévolu une indication et une prescription.)
Le problème de la traduction se pose de toutes façons et pour ce passage en ce qui concerne Weisung ou Angewiesenheit, les options peuvent être nombreuses, mais pour l’essentiel le problème est ailleurs, il est surtout dans les Grundmauern, il est dans le Dichter et le Volk qui, une fois de plus ici, peuvent se confondre avec la mission dévolue précisément au Volk en 1934. Le vocabulaire et la langue conçue comme état poétique, comme élancement, comme orientation effusive correspond hélas aux objectifs même de la mise en place de la LTI. Il y avait fusion entre poétique et politique comme de nombreux documents en attestent, comme si [127] le NS était la double réalisation du Volk par la confusion du politique et du poétique.
Le vocabulaire est un vocabulaire de propulsion, fait d’intensité et de puissance et qui invente les choses avec les mots. Il est vraiment « habité » comme on dit aujourd’hui, mais d’une intensité froide.
La radicalité de la langue, telle qu’elle s’exprime p. ex. dans les §§ 74 ou 75 s’accompagne de véritables explosions linguistiques, l’ekstatische Erstrecktheit du § 79, cette extension extatique conduit, en fait, à une sorte de contraction de langue qui la rend exclusive de tout ce qu’elle n’est pas. Ces forteresses linguistiques sont d’autant plus assurées qu’elles sont faites de combinaisons d’éléments constitutifs du vocabulaire de base, pris dans ses variations, mais telles justement qu’elles soient toujours dans un certain fil.
Tout se passe comme si la force de la pensée avait été piégée par la manière de se servir de la langue allemande, prise en l’occurrence dans sa pugnacité, dans l’affirmatif brandi comme un bloc de certitude.
Cette radicalité ne pouvait que rapprocher Heidegger du nazisme qu’il a pris – et tout le problème est bien là – pour ce qu’il n’était pas et ce qu’il n’était pas, c’était ce qu’y voyait Heidegger dont la langue est si profondément marquée, c’était cette deutsche Eigentlichkeit, telle qu’elle échappe à la Zersetzung judéo-occidentale, car Heidegger tombe ici dans les « olle Kamellen » d’une certaine pensée allemande, déjà analysée précédemment, ces vieilles obsessions, comme les expriment Spengler ou Spranger ou tant d’autres, mais auxquelles des penseurs de l’envergure de Wilhelm Dilthey ne se sont jamais laissé prendre, il suffit pour s’en assurer de lire das Erlebnis und die Dichtung pour d’ailleurs s’apercevoir qu’il existe un autre Hölderlin que celui de Heidegger.
Ce mythe d’une germanité, à la fois pure et efficace, en prise sur les valeurs fondamentales, qui ne tardera pas à devenir Zerströung, Verwüstung et surtout Vernichtung, destruction, dévastation, anéantissement, Heinrich Heine l’avait déjà magistralement analysée dans Histoire de la Religion et de la philosophie en Allemagne. De par son engagement dans le contemporain, il est impossible de détacher S/Z de ce contexte auquel à travers Yorck von Wartenburg, il fait lui même référence dans S/Z.
Ce livre est empreint d’une puissance qui se manifeste par une succession grammaticale de compléments de noms successifs ou d’emboîtements verbaux, p. ex. pris au hasard § 60, 296 : « Die im Gewissen=haben=wollen liegende Erschlossenheit des Daseins wird demnach konstituiert durch die Befindlichkeit der Angst, durch das Verstehen als Sichentwerfen auf das eigenste Schuldigsein und durch die Rede als Verschwiegenheit. » (L’accessibilité du dasein est de ce fait constituée par la localité de l’angoisse, par le comprendre en tant que projet de soi-même sur la culpabilité la plus propre et par le discours comme manière de silence). Ce sont des blocs verbaux serrés, denses qui ne laissent aucune place à une quelconque interruption, rien n’y reste en suspens, en blanc.
[128] Il suffit de lire S/Z à haute voix pour être frappé par le côté autoritaire et sans réplique de cette langue affirmative mais aussi la fermeté et la cohérence de la pensée. Heidegger, comme dans l’exemple cité, se sert souvent de la proposition qualificative, il n’est bien entendu pas le seul, qui permet de séparer l’article du nom auquel il se rapporte et de forcer l’attention, si bien qu’il n’y a pas d’échappatoire.
Tout ce § 34 sur la langue est somptueux, l’invention verbale de ce genre se dresse, dès lors, inexpugnable et magnifique, Heidegger institue ici un système verbal en prise totale, non sur la langue quotidienne, mais sur la langue aussitôt reconnaissable comme un style propre (ein eigener Stil), dont la transmissibilité, il est vrai par quoi nous retomberions dans le « man », n’est nullement assurée.
Le propre du philosophique étant de ne pas coïncider avec sa formulation, il est à craindre qu’une expression aussi décidée, aussi affirmative et autoritaire risque et c’est bien ce qui est arrivé, mais est-ce vraiment à l’insu de Heidegger, de se pétrifier dans un mode d’expression figé.
Heidegger prête foi à ses amis français qui lui affirment : « quand ils se mettent à penser, ils parlent allemand ; ils assurent qu’avec leur langue ils n’y arrivent pas. » Il n’y a pas de parenté aussi apparente entre le grec et le français qu’entre le grec et l’allemand, parenté qui seule permet la pensée à l’avis de Heidegger.
L’entretien du Spiegel est net à cet égard : on ne peut pas penser en français. Il est étonnant qu’un « penseur » du niveau de Heidegger puisse débiter de pareilles sottises. A l’origine, seule la langue grecque exprimait l’être et seul l’allemand, à l’avis de Heidegger, est apte à exprimer l’être, il est des langues comme le chinois et le japonais qui selon lui ont comme l’allemand une relation privilégiée à l’être. Etrange point de vue que de confondre une langue avec son usage. La langue est faite aussi et peut-être surtout du halo de ce qu’elle ne dit pas.
Die Sprache, car il ne s’agit plus simplement d’une langue, mais de la langue comme dirait Lacan, c’est-à-dire de l’allemand, s’assigne ici une mission d’authenticité tout à fait arbitraire. Goethe qui savait de quoi il parlait, est très net sur ce plan, au n° 1287 des Maximes et Réflexions il écrit : « [La langue] est un outil utilisable à toute fin et à volonté on peut l’employer tout aussi bien à une dialectique aussi pointue qu’elle égare, comme à une métaphysique confuse et embrouillée ; on en abuse aisément en phrases de prose ou de poésie creuses et vaines, oui, on essaie d’en faire des vers prosodiquement irréprochables et pourtant de pur non sens. »
Tout le problème est en effet là, le propre du philosophique est-il vraiment le propre de l’allemand, das Eigentliche, comme si avec l’allemand était das Eigentliche der Philosophie überhaupt, comme si l’allemand pouvait être le philosophique même, de même que l’expression du religieux en soi ? C’est que cerné de toutes parts, dans la difficulté historique à se constituer lui-même comme le signalait déjà Leibniz, l’allemand entouré de toutes parts par des groupes linguistiques hétérogènes, scandinaves, slaves, fino-hongrois, français et italiens a toujours été ressenti par [129] les poètes et les penseurs, les fameux Dichter und Denker qui deviendront les Richter und Henker, les juges et les bourreaux, comme la langue de l’âme, celle de l’intensité du soi, la seule à coïncider avec les effusions adolescentes, la seule enfin à pouvoir exprimer le fameux « absolu », la seule aussi à être parlée par un peuple, à ce point confondu avec sa langue, sinon avec son Boden sur lequel il est ständig (debout) sur le sol (Boden).
Il s’agissait pour Heidegger de trouver, en sorte comme Luther, une nouvelle langue, il s’agissait de réorienter l’expression, sinon la nature même du philosophique figé dans une rhétorique vieillie et figée. En ceci Heidegger eut en la personne de Husserl un subtil prédécesseur, Husserl a littéralement, sans jamais rien abandonner de la langue philosophique classique, rénové tout le vocabulaire en usage, il a rénové la langue de la tribu tout en conservant à l’allemand sa liquidité et son harmonie comme p. ex. dans die Krisis.
Hugo Ott a bien montré la nature et la portée de la rébellion de Heidegger. Il s’agissait d’une véritable insurrection de la pensée contre ce que Heidegger appelle avec mépris le « man », le Gerede, le bavardage, le n’importe quoi, appréciation d’autant plus légère qu’elle ne comportait aucune analyse. D’avance le ressentiment, car c’est peut-être aussi, à en croire Hugo Ott, ce qui guidait Heidegger, le vouait au malentendu linguistique. Depuis longtemps en place, la langue du ressentiment, mêlée souvent à celle de la jeunesse (le vocabulaire du Wandervogel) et de la revendication de l’authentique, était d’avance piégée ; vouée à tomber dans les filets de la LTI. D’une certaine manière Heidegger n’est pas si loin, à la fin de Marburg et au début de Fribourg, du Rausch, de l’ivresse, qui caractérisait toute la Jugendbewegung (mouvement de la jeunesse).
C’est le Volk et lui seul qui est détenteur de la langue. Mais que les choses soient encore une fois bien nettes, personne n’est plus loin que Heidegger de toute forme de racisme, il s’en est expliqué avec netteté, ne fut-ce que dans le texte « Die Geschichte des Seyns » (vol. 69, 223), ce non-racisme absolu s’inscrit en toute logique dans cette Histoire de l’Etre qu’il pose. Il y a même dans ce texte une mise en cause très nette de la politique raciale en tant que telle, elle fait partie d’une Kulturpolitik qui elle-même n’est qu’un moyen de légitimation du pouvoir (ein Mittel der Ermächtigung der Macht). Rien de plus étranger à Heidegger que toute forme de racisme primaire, mais il se trouve que sa mise en cause de la « métaphysique occidentale » est à ce point radicale qu’elle en prend des formes d’expression tout aussi radicales.
Mais il se trouve que la notion de Volk, telle qu’il l’envisage, n’est qu’une forme si on peut dire de la germanité, telle que précisément elle exclut ceux qu’elle désigne comme n’en faisant pas partie, en conformité absolue cependant avec la loi du 7 avril 1933, portant définition de l’appartenance à la fonction publique allemande.
Ici, hélas Volk et race se confondent dans leur fonction, le Volk est porteur de la langue, non d’une langue, mais de la langue et non au sens où l’entendait plaisamment Lacan, la langue n’étant que grecque ou allemande, le français étant exclu, il n’est pas une langue au sens propre comme Heidegger nous le donne à [130] entendre dans l’entretien du Spiegel où la sottise se joint à la prétention. Le plus étrange c’est que Heidegger prend ses propos au sérieux, voué qu’il est à cette idée que l’allemand est seul capable, comme le grec, de dire le philosophique. Le français est évidemment exclu de cette proximité à l’être, tout comme le latin.
Or, il se trouve que nulle langue fut aussi maltraitée que l’allemand, à travers l’histoire, c’est un sujet d’étonnement de voir toujours échouer les prises de parole politiques, comme si, en ce domaine, elle était interdite de parole. Au début du XIXe siècle un écrivain du nom de Karl Friedrich Jochmann, redécouvert par le germaniste Uwe Pörksen disait « Wir sind ein gemißhandeltes Volk, weil ein stummes, und wir haben keine Stimme im Rate der Völker, weil keine Sprache » (Nous sommes un peuple maltraité parce que nous sommes un peuple muet et nous n’avons pas de voix dans l’assemblée des nations parce que nous n’avons pas de langue.)
Dans ses Entretiens avec Eckerman Goethe, le 24 avril 1824 dit : « La spéculation philosophique est au total un obstacle pour les Allemands qui donne à leur style un aspect insensé, insaisissable, pâteux et qui ne cesse de tourner en rond. Plus ils s’abandonnent à certaines tendances philosophiques, plus mal ils écrivent. » Sans parler de ce que Heine et Nietzsche disent de l’incapacité des philosophes allemands à s’exprimer avec souplesse et charme. La langue de Heidegger est l’indice d’une crise profonde de l’état de langue lui-même.
L’Allemagne n’apparaît véritablement sur la scène internationale des belles-lettres qu’avec le Werther de Goethe en 1774, et politiquement seulement le 21 janvier 1871, dans la Galerie des glaces à Versailles. L’Allemagne a, tout au long de l’histoire, été frustrée d’elle-même, évincée de sa propre histoire, de plus jusqu’aux environs de 1750, n’existent à peu près que les écrits théologiques et surtout piétistes dont la langue philosophique sera profondément marquée. Cet immense pays n’avait aucune existence, il survivait après les plus épouvantables des guerres européennes, avant les grands génocides du XXe siècle, dans une léthargie qui dura près de deux cent cinquante ans. Ravagée en profondeur par la guerre de Trente Ans (1618-1648), elle végète et s’agite tout à la fois, prise entre une intense vie intellectuelle et le désert politique, l’Allemagne fourmille de journaux de toute sorte, mais dont la liberté d’expression politique est cependant très limitée.
En même temps, dans certains milieux, étudiants en particulier, circule le vieux rêve d’une Allemagne éternelle et invisible, seule détentrice d’une langue originelle. Dans un pays politiquement paralysé naît l’idée d’une Allemagne régénérée et régénératrice, telle que Fichte l’expose dans ses Discours à la nation allemande, qui seront l’objet du prochain séminaire. La démarche de pensée de Heidegger est bien connue, libérer la pensée pour retrouver en deçà peut-être plus qu’au delà de la métaphysique, telle qu’elle donne lieu à la pensée technique, le mouvement illimité et non mesurable en soi de l’être au sein duquel l’homme habite.
C’est précisément le recours à un vocabulaire volontairement expressif et constitué en vue de sa fin qui réalise la pensée de Heidegger en transformant le [131] Sein en Seiendes par l’insistance du vocabulaire à être à ce point signalétique. Heidegger succombe à une illusion linguistique, au point de croire que ce vocabulaire suffirait à la fois à caractériser la métaphysique, comme il l’entend, comme n’étant que dans l’étant et à y mettre fin. Heidegger se tend lui-même le piège d’une langue indiscrète que Herbert Marcuse appellerait affirmative.
L’ensemble des phrases de S/Z est construit sur le modèle de celle-ci qui ouvre le § 51, prise au hasard : « Die Herausstellung des alltäglichen durchschnittlichen Seins zum Tode orientiert sich an den früher gewonnenen Strukturen der Alltäglichkeit » (La surrection de l’être quotidien à la mort s’oriente selon les structures antérieurement acquises de la quotidienneté).
La plupart des phrases commencent par un article défini et un nom suivi d’un groupe nominal au génitif. L’ensemble de la terminologie utilise un effet de sidération, le mot Entschlossenheit, qui joue par sa proximité avec Erschlossenheit est imposé comme tel dans toute son évidente puissance affirmative. C’est une langue qui ne laisse aucune place à l’objection, à l’intervention d’autrui, c’est une langue d’exclusion, de condamnation, une langue d’intervention, mais sans aucune pitié ni tendresse, une langue dure, guerrière comme celle de son ami le nazi élégant Ernst Jünger, d’un paganisme granitique, une langue de dénonciation et pourtant aussi une langue splendide et magnifique comme dans ce texte inédit de 1939 Die Philosophie in der Besinnung auf sich selbst, comme s’il y avait une hésitation, intérieure, un seuil à partir duquel le philosophique succombe à la tentation de la confusion avec le politique, le pire, matérialisation presque païenne de la langue.
Toute la force du texte, sa Durchschlagskraft dirait-on, son impact, repose sur l’effet coup de poing de ces termes utilisés comme entités verbales fermées sur elles-mêmes et qui doivent, et c’est là toute leur portée, s’imposer par voie d’effet. Déjà les traits d’union, p. ex. de Das Sein=zum=Tode, confèrent aux mots une charge énergétique très grande mais qui ne les déborde pas et reste prise dans l’effet de frappe, d’autant plus qu’en allemand dans la typographie de S/Z qui est celle d’ailleurs des Jahrbücher für phänomenologische Forschung, le trait d’union est double. La lecture à voix haute de S/Z fait nettement apparaître le martèlement stylistique. L’exclusion de ceux qui ne comprennent pas ou « pensent », si toutefois on peut leur accorder ce verbe, est à la base du ton employé, tout au long des écrits de Heidegger. Ils sont destinés à foudroyer, mais à foudroyer par décision, non à leur insu. Ils sont programmatiquement farouches et il veut mieux être de leur côté. Dès 1922 Heidegger manifeste d’ailleurs un réel activisme philosophique non sans rapports avec sa langue.
Ce n’est pas tout de suite que le ton de commandement devient la caractéristique essentielle du style de Heidegger dont l’allemand devient de plus en plus glacé et autoritaire. Il y a à la base de cette façon de s’exprimer un présupposé d’irréfutabilité, en vue duquel est recouru à un emploi du vocabulaire dont les éléments nominaux sont regroupés autour d’un verbe d’affirmation ou de dénégation plus que de négation, soit « Das Dasein stürzt aus ihm selbst in es selbst, in die Bodenlosigkeit und Nichtigkeit der uneigentlichen Alltäglichkeit » (S/Z § 36, 178) [132] (L’existence choit d’elle-même en cela dans le sans-fond et la nullité de la quotidienneté inauthentique). « Das Verfallen bestimmt nicht nur existenzial das In=der=Welt=sein. Der Wirbel offenbart zugleich den Wurf- und Bewegheitscharakter der Geworfenheit, die in der Befindlichkeit des Daseins ihm sich selbst aufdrängen kann » (Le déclin ne détermine pas seulement de façon existenciale l’être-au-monde. Le tourbillon révèle en même temps le caractère jeté et de mobilité du fait d’être jeté, lequel dans le fait de se trouver quelque part de l’existence peut s’imposer à lui.) (S/Z, § 36, 179) Ces deux phrases extraites presque au hasard de S/Z sont révélatrices des procédés linguistiques qui fondent l’expression heideggerienne.
Tout repose sur l’alternance du positif et du négatif, la Bodenlosigkeit, le fait d’être privé de sol, (le suffixe -keit marque toujours l’état, un peu comme -idité en français liquidité = Flüssigkeit). La Bodenlosigkeit s’oppose à la Bodenständigkeit, le fait d’être implanté sur le sol, la Bodenständigkeit est allemande, propre même à la Forêt-Noire, elle est de l’ordre de la vérité, nous l’avons vu, toute la conception de la Eigentlichkeit (authenticité) repose sur la Bodenständigkeit. Bodenständigkeit est aussi une notion de base du texte par lequel Heidegger demande aux Allemands de voter en masse pour Hitler aux élections du 11 novembre 1933 où, malgré les pressions formidables, Hitler n’obtint pas même les scores de Mussolini.
Nichtigkeit renforce ce sens négatif, Nichtigkeit, état de rien, nullité, insignifiance. Tout auditeur savait ce que voulait dire Bodenlosigkeit et ce que visait ce mot, il visait une pensée censément, sans attaches, venue d’ailleurs, des mauvais lieux de la République Française en particulier, car ce discours heideggerien est profondément anti-républicain. Au passage remarquons que l’allemand ne peut dire ni rien ni jamais, les deux termes sont toujours négatifs, (nie, nichts), ce qui situe la négation autrement qu’en français.
La nullité d’une vie quotidienne inauthentique (Die Nichtigkeit der uneigentlichen Alltäglichkeit). En fait et tout le § 38 repose là dessus, Heidegger désigne ses ennemis sans que cette Nichtigkeit soit jamais définie et sans que ces ennemis ne soient nommés. Mais en 1927, on sait par trop bien qui ils sont, il suffit de suivre le NSDAP du regard. L’Uneigentlichkeit des Daseins, le quotidien inauthentique, celle du Gerede et de la Neugier, du bavardage et de la curiosité, on sait trop bien qui elle caractérise et ses auditeurs étudiants de l’époque, sa troupe de choc, son Stosstrupp de seize étudiants qu’il projette d’envoyer chahuter Nicolaï Hartmann, comme le rapporte Hugo Ott, eux ne s’y trompent pas, les juifs en particulier sont visés par Gerede et Neugier, se disent-ils, même si ce n’est pas le cas. C’est par eux et par le demokratisches Pack, la racaille démocratique, que se fait le Verfallen, le déclin, l’effondrement contemporain. Heidegger est tout à fait dans le ton de ses camarades.
Ce sont à cette époque, en particulier, des attributs qui caractérisent toujours les juifs allemands, sauf que Heidegger les manie avec subtilité, sans jamais tomber dans le Rassenwahn vulgaire, mais l’appuyant indirectement, d’autant plus puisque c’est par essence qu’ils entraînent le Verfallen. C’est sur ses auditeurs et lec-[133]teurs que Heidegger compte pour la compréhension et l’interprétation directes à défaut d’encourager au coup de main. Wenn aber das Dasein selbst im Gerede und der öffentlichen Ausgelegtheit ihm selbst die Möglichkeit vorgibt, sich im Man zu verlieren, der Bodenlosigkeit zu verfallen, dann, dann sagt das : das Dasein bereitet ihm selbst die ständige Versuchung zum Verfallen. Das=in=der=Welt=sein ist an ihm selbst versucherisch.(177) (Mais quand le dasein lui-même dans le bavardage et l’étalage prétend se donner à lui-même la possibilité de se perdre dans le « on » et de sombrer dans le manque de sol (le déracinement), cela veut dire alors : le dasein, se prépare à lui-même la permanente tentation du déclin. L’être au monde est en lui-même tentateur.) L’auditeur reconnaît d’emblée les siens, comme il les reconnaît dans la Zweideutigkeit, l’ambiguïté du § 37. La Bodenlosigkeit s’applique aux vaterlandslosen Gesellen, aux sans patrie, à la freischwebende Intelligenz, l’intelligence flottante, la pensée cosmopolite, c’est-à-dire simplement la pensée critique. Nous l’avons vu, la Bodenlosigkeit s’oppose à la Bodenständigkeit, celle de son ami le paysan au regard clair à qui il va s’adresser pour savoir s’il doit accepter son « Ruf » sa proposition de nomination à Berlin, c’est le texte célèbre « Warum bleiben wir in der Provinz ».
La langue de Heidegger est dans certains textes empreinte d’une évidente grandiloquence où le gonflement verbal autoritaire et indiscutable est destiné à faire impression et risque de cacher les intuitions admirables qui en jaillissent.
D’autres textes sont proprement philosophiques et admirables comme Die Philosophie un texte inédit de 1939 où la Entscheidung devient au sein du philosophique ce qu’elle est hélas sur le plan politique.
La langue de Heidegger est à la fois très proche de son basculement dans le politique tel qu’il est censé correspondre à la révolution nationale et à la fois tout à fait ailleurs, dans Bauen, Wohnen, Denken, p. ex. entre beaucoup d’autres, un texte solennel et raide écrit dans cet allemand gonflé et vide qu’on connaît trop bien.
« Wie spricht der Mensch ? Er spricht indem er der Sprache entspricht. Denn eigentlich spricht die Sprache. Die Sterblichen sprechen immer nur indem sie entsprechen und so ihr Wesen dem Zuspruch der Sprache versprochen haben » (Comment l’homme parle-t-il ? Il parle en tant qu’il correspond à la langue, l’exprime. Car en réalité c’est la langue qui parle. Les mortels ne parlent qu’en tant qu’ils parlent en appropriation et qu’ainsi ils ont voué leur essence à la consécration, à l’approbation de la langue).
Sur trente-cinq mots que compte cette phrase onze sont des variations de sprechen = parler. C’est un exercice purement mécanique, répétable p. ex. avec le verbe werfen, cher à Heidegger (la Geworfenheit) « Wie wirft der Mensch ? Er wirft indem er dem Wurf entspricht. Denn eigentlich wirft der Wurf. Die Sterblichen werfen immer nur in dem sie entwerfen und so ihr Wesen dem Zuwurf des Wurfes verworfen haben ». Il suffit en français de remplacer le verbe « parler » de l’exemple antérieur par le verbe « jeter », utilisé dans ce pastiche pour obtenir un passage de [134] fonctionnement identique sinon de sens différent (on y retrouve aussi le « hegen », soigner, en vue de la reproduction, cher à Walter Darré).
Dans le texte de 1962, Zeit und Sein, il est largement recouru au jeu d’associations verbales sur geben, donner, p. ex., geben -ergeben, Gabe, « Es gibt » qui ouvre sur schicken, destiner, das Geschick, la destination, das Geschickhafte, le destinal, Schickung, l’envoi du destin, Schickliche, ce qui convient, de même un peu plus loin toute une page joue sur tous les composés possibles de wesen, être Anwesen, Anwesenheit, Abwesen plus loin tout joue sur Ereignis et eigen dont d’ailleurs les racines ne sont pas les mêmes. Le § 48 est une belle analyse verbale de Ausstand dont toutes les variables sont utilisées.
Il est curieux que dans l’inépuisable matériau linguistique de l’allemand Heidegger ait fort peu recouru à un terme tel que le verbe weisen, jeter dehors, jemanden vor die Tür weisen, initier, conduire, indiquer, on peut ainsi facilement pasticher et inventer ce qui suit : « Das Zugewiesene ist eine Weisung deren Zugewiesenes als Vorweisung hinweist auf noch nicht Ausgewiesenes welches als das noch Auszuweisende auf den Wink des Nachweisens als Verweis weist » (L’attribué-indiqué est une indication dont l’attribué est comme une indication qui indique quelque chose de non identifié qui en tant que non encore élucidé attend un signe de son établissement). Nachweisen en tant qu’indice-avertissement, Das Zuweisende ou Zugewiesene, n’est après tout pas si loin du Ausstand an Sein-Können en tant que Zuhandenes. On en tirerait de magnifiques réflexions linguistiques. Cela aurait pu être de Heidegger.
Le texte Der Weg zur Sprache de même repose non seulement sur les variations innombrables de sprechen, mais lui aussi sur eigen et Ereignis et sa similitude avec eigen alors que les deux mots n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Heidegger joue à la fois sur les glissements de sens et sur les similitudes sonores, il joue avec la matérialité concrète et morphologique plus d’ailleurs que syntaxique de l’allemand. « Im Schicken des Geschicks, Anwesen von Abwesen » (54) ou « Gleichwohl bekundet sich das Schickliche im Geschick, das Gehörige im Zusammengehören der Epoche » (Pourtant s’annonce dans la destination ce qui répond au destin, et dans l’appartenance mutuelle des époques ce qui convient en elles, je reprends ici la traduction de François Fédier).
Il est certain que dans des associations de ce genre, la langue vient au devant de qui s’en sert. La pensée ici se fait au fil des glissements morphologiques fournis par la langue. Il est vrai que ce genre d’exercice ne fut jamais pratiqué en philosophie avant Heidegger. La trop grande facilité de ce genre d’associations qu’on peut faire à volonté a toujours été évitée par les philosophes et même par Fichte dans sa Wissenschaftslehre. Il fallait dans la langue une résistance et une tentation tout à la fois, comme si chacun avait eu à l’esprit la présence de ces sollicitations linguistiques et que le propre de la pensée ait été de ne pas s’y laisser glisser.
Or Heidegger s’y abandonne comme si après le grand égarement, c’était à la langue de parler à sa place, comme si c’était la langue qui contenait la pensée, comme si la langue allemande était une sorte d’entité sacrée. La question est alors [135] de savoir si la LTI est aussi la destination même de la langue, vision redoutable et terrifiante, vision fausse et absurde car l’allemand est une langue comme toutes les autres mais dont les usagers ont sinistrement abusé et qu’ils ont abusé jusqu’à lui donner un caractère mortel qui n’est en aucun cas le sien. D’où vient de plus l’étonnante appropriation de la langue philosophique de Heidegger à ses projets politiques comme on le verra au prochain séminaire. Quel est le sens de pareil égarement ?
L’inépuisable subtilité des compositions de mots risque bien de pouvoir se substituer une fois que la ligne associative en est donnée à la pensée elle-même, comme si celle-ci était plus dans la langue que dans la pensée, comme si la langue était une sorte de « es » extérieur à l’homme, une sorte de matière prophétique qu’il suffit d’entendre. Mais s’il en est ainsi, d’où vient-il alors qu’on puisse y entendre le politique tel que l’y entendit Heidegger ?
La langue (die Sprache) qui joue un rôle capital dans la pensée de Heidegger est dans sa définition même tributaire de cette mécanique verbale. Non, encore une fois, qu’il s’agisse de mettre en cause la vision heideggerienne de la langue mais force est de constater que c’est justement cette langue même qui fait obstacle, qu’il s’est littéralement trompé de langue, que l’échec est l’usage qu’il fait de l’allemand, que cet allemand là l’emprisonne, l’enferme et le conduira à ce qui est avant tout peut-être une méprise mais contemporaine de la mise à mort de la langue allemande. Il est arrivé à la langue allemande des malheurs qui n’ont à ce point frappé aucune autre langue, tout se passe comme si au cours de son histoire on lui avait toujours, quelques exceptions mises à part comme Schopenhauer ou Nietzsche sinon Freud, refusé un mode d’expression autre que fatidique, sombre et abyssal. Goethe, qui savait un peu d’allemand, n’avait par hasard horreur du langage philosophique. Il savait trop bien à quoi s’exposait la langue allemande aux mains des philosophes et ce n’est ni Heine, ni Nietzsche qui l’ont démenti.
Dans une lettre récemment retrouvée, datée du 13 IV 1944, adressée au théologien Paul Tillich et publiée par Die Zeit le 20 Juin 2002, Thomas Mann écrit : « Heidegger – ce nazi par existence, je n’ai jamais pu le souffrir. Cette fois cet échantillon de son effroyable jargon philosophique (Schreckensjargon) que vous donnez, m’aurait presque fait tomber la revue des mains. » « Jemeinigkeit » (la miennité, le-mien-être-à-moi) qui apparaît au début de S/Z au § 9, page 42, et est une modalité du In=der=Welt=sein. D’abord je tins cela pour une tournure berlinoise qui aurait quelque chose à voir, avec « gemein » (méchant ou commun). Et c’est en effet le cas. De tels excès injurieux du « Démon de la langue allemande » (des « Dämons der deutschen Sprache ») (j’enjolive, j’enjolive, Beschönigung répété) ne devraient pas être montrés à des étrangers respectueux de leur langue. Schopenhauer aurait dit son fait à ce High-brow Sudler, ce criminel violeur de langue (Sprachschänder). Dans le Doktor Faustus Thomas Mann fait dire au diable que sa langue préférée est décidément l’allemand.
[136] Puis très rapidement, dès 1945, on assiste à cet étonnant effondrement linguistique des trente années suivantes, comme s’il y avait volonté de retour à une langue enracinée dans le lieu dialectal. Mais comme le dit Ludwig Hohl : « Dialekt hindert den geistigen Fortschritt » (Le dialecte gêne le progrès mental.)
Des textes comme ceux des années cinquante sont une étrange retombée à la fois grandiloquente et d’autre part avariée par la LTI, d’où peut-être ces jeux de langue qui semblent exprimer une sorte de peur panique de la langue devenue une armature, un Gestell protecteur qui assume presque seul ce qu’on ne peut plus dire. Il s’agit d’un égarement qui interdira à Heidegger toute expression valable, dès lors rien de plus tragique que cette parole consumée, envolée, morte, cette langue pétrifiée, stérilisée.
Depuis 1927 cette langue se paralyse progressivement, se répète dans une grammaire toujours identique, peu à peu devenue invariable, raidie. Rien de plus curieux que d’étudier les constructions syntaxiques de ces textes.
Ainsi dans Der Weg zur Sprache (Le chemin vers la langue) qui fait partie de Unterwegs zur Sprache (En route vers la langue) et qui a paru séparément, en 1959, dans un recueil collectif, avec des textes de Romano Guardini, Emil Pretorius et d’autres, on est frappé de retrouver exactement les mêmes jeux de mots que dans Die Technik, dans Bauen, Wohnen, Denken ou bien d’autres textes de cette période. Dans la IIe partie p. ex. on trouve, en une seule page, toutes les variations possibles sur le seul verbe sprechen, or encore une fois, un seul verbe peut donner lieu à toutes les variantes possibles, selon préfixes ou suffixes et autant de noms communs, sprechen donne dans ce passage die Sprache, angesprochen, adressé, et das Angesprochene, nom commun, ce qui est adressé, besprochen, commenté, durchgesprochen, examiné à fond, die Sprechenden, ceux qui parlent, das Gesprochene, ce qui a été dit (quatre fois), das Ausgesprochene, ce qui a été exprimé, das Zugeprochene, ce qui a été attribué, das Ungesprochene, le non dit, et le compte n’y est pas. Bien entendu la traduction, quelle qu’elle soit, ne saurait en rien rendre compte de ces feintes langagières où la « Pensée », puisque pensée il y a, se réfugie derrière les mots et les laisse faire.
Il s’agit, bien entendu, d’explorer le trajet qui va de ce qui reste ungesprochen, ce dont vient la parole à ce qui a été dit, das Gesprochene, mais c’est essentiellement la langue qui parle. Tout le texte repose sur des variables grammaticales et acoustiques purement mécaniques et qui passent de l’une à l’autre selon les associations de sens, ainsi il est naturel de trouver lauten à la page suivante, ce verbe signifie vouloir dire, s’énoncer, et s’associe naturellement à parler, cela donne Verlautbarung, das Lautende, das Geläut, la tonalité, qui permet de faire revenir Stimmung, et Heidegger après avoir longtemps joué sur die Sprechenden und ihr Sprechen et das Ungesprochene qui reste en suspens dans das Zugesprochene, montre parfaitement qu’il n’est en rien dupe de son propre jeu ; « denn das phonetisch-akustisch-physiologische Erklären der Lautung erfährt nicht deren Herkunft aus dem Geläut der Stille und die hierdurch erbrachte Be-stimmung des Lautens. » [137] (102) (car l’explication phonétique-acoustique-physiologique de l’énoncé ne fait pas l’expérience de sa provenance de la sonorité du silence et l’accord de l’énoncé qui en résulte.)
Ce qui en effet fait cette Bestimmung, ce supplément de voix (Be-) est le propre de cette langue là et qui n’est pas de l’ordre du traduisible. Or c’est pourtant cette sorte de verticalité qui est en cause comme contenu ultime de la pensée, là wo denken be-stimmt, là donc où la pensée se trouverait en accord avec son énoncé réservé à cette seule langue, qu’est-ce à dire ?
On aurait pu tout autant faire jouer un autre verbe tel que halten (tenir) dont les variables auraient autant produit de sens caché et d’accord, das Enthalten hält vor, was heisst das, es ent-hält, es ent-fernt das Gehaltene als das Enthaltene welches vorhält als das noch vor-Enthaltene (l’abstention retient, qu’est-ce à dire, elle re-tient éloigne ce qui est tenu comme le contenu qui re-tient ce qui est encore avant d’être contenu (!)).
Avec une grande habileté Heidegger utilise tous les glissements verbaux que la grammaire met à sa disposition, on va ainsi de sagen à zeigen (Die Zeige). La langue apparaît dès lors comme une entité différente de celui qui la parle et il est naturel d’en voir surgir, malgré Humboldt, l’idée d’appartenance donc de vocation poétique (Dichtung) de la langue.
Il y a une étrange passivité derrière ce mur épais derrière lequel semble se réfugier une pensée qui ne parvient plus à se frayer son chemin dans les Holzwege, les impasses, auxquelles elle s’est volontairement livrée. Dans tous les textes de Heidegger circule une sorte d’avant-garde motorisée issue du gros de l’armée, dans les Holzwege, il y en a beaucoup d’autres qui préparent ainsi leur mise en tas, comme scheinen dans la seconde partie de Hegels Begriff der Erfahrung, p. ex. Aufriss, un contour géométrique suscité par ce qui précède et qui permet de faire venir, der Riss, la déchirure, et umreissen, contourner etc.
De nouveau tous les composés avec particules séparables sont ici possibles. Riss donne l’idée de durchfügen qui en est le contraire, tendre des contreforts intérieurs, et bien sûr Gefüge, de même qu’à la page suivante sagen permettra die Sage et das Sagen et tout est ainsi à l’avenant.
Tout le style de Heidegger est ainsi fait de phrases sur lesquelles l’auditeur autorisé ne pourra que méditer, mais qui d’emblée excluent tout ce qui n’est pas elles. La radicalité absolue de la pensée de Heidegger, son ailleurs et toute sa grandeur est là, elle se manifeste dès S/Z par une provocation linguistique ; on n’a jamais parlé ainsi en philosophie. Mais la provocation en allemand est die Herausforderung, ce qui est l’exact contenu de la pensée de « ex-vocare appeler au dehors » (sors de là si t’es un homme): révéler ce que la Vergessenheit recouvre.
Or, cette surrection, ce n’est pas par hasard que Sprache et Dichtung s’équivalent, est au départ déviée, infléchie, par la langue qu’elle emploie. Il est étrange que Heidegger n’ait pas vu, comme il le voyait pour le reste, que sa langue elle-même est prisonnière de ce qu’il dit, d’où après 1945, cette langue presque atone et exsangue dont la volonté de sobriété équivaut à l’épuisement.
[138] L’allemand est une langue maltraitée et Heidegger est l’un de ceux qui l’ont le plus violentée, hors de toute empathie, de toute compassion pour ceux à qui elle s’adresse. Sa langue est une langue exécutrice, faite pour les hautes œuvres, une langue de condamnation, à prétentions d’infaillibilité. Ce qui est dit dans S/Z est sans recours et n’appartient qu’à S/Z et ne laisse entrer ou sortir personne. Heidegger a voulu une langue farouche, tranchante.
Après 45, soudain tout change ; la langue farouche et autoritaire est soudain à la fois atone et doucereuse, style plat, façon Joseph Prudhomme ; mais toutes deux, la langue tank et la langue douceâtre sont toutes deux issues du même ressentiment fondamental, ni Sehnsucht, ni Heimweh, mais quelque chose issu, de la Wucht, il y a du Wurzelmensch, de la Kraftprobe en lui.
Heidegger a un peu de Rübezahl et de Rumpelstilzchen, une sorte d’expansion circulaire dont atteste la foule de mots en -heit, des Denkklötze. Du granitique on passe au râpeux mièvre.
Comme dans tous les textes de cette époque, Heidegger ne cesse d’en revenir à la Bodenständigkeit, ce fameux « enracinement ». Il est d’ailleurs remarquable que le terme français en dit encore plus, lui il s’enracine là où le terme allemand est simplement debout, c’est encore une fois l’essentielle spatialité de la langue.
Ce qui est étonnant dans ce texte, c’est la patine du vocabulaire dont la « simplicité » est fabriquée comme telle, c’est de la Betulichkeit, de la mièvrerie « L’homme d’aujourd’hui prend la fuite devant la pensée. » (14), écrit-il dans Gelassenheit : « Der heutige Mensch ist auf der Flucht vor dem Denken. », ces trois derniers mots en italiques, où d’ailleurs la spatialité est de nouveau marquée par « auf » joint à Flucht qui restitue véritablement le mouvement de fuite. C’est une succession de propositions simples et toutes affirmatives. Das rechnende Denken hält nie still, kommt nicht zur Besinnung, son essence, c’est le Betrieb der sich häufenden Ergebnisse und ihrer Verrechnung nachjagt, qui ne cesse de courir derrière l’encaissement des résultats accumulés (Häufung et nachjagen sont des termes qu’on rencontre aussi bien dans le Stürmer des frères Strasser et qui ne purent échapper aux auditeurs de la conférence de 1938 intitulée Die Zeit des Weldbildes et reproduite dans les Holzwege).
« La pensée calculante ne s’arrête jamais, elle n’a pas de répit, ne médite jamais. » Tout est ainsi fait d’une succession de constatations injonctives et qui excluent tout examen, toute discussion, c’est à prendre ou à laisser, d’où les indépendantes binaires qui sont une constituante de base de la LTI, comme l’a bien montré, hélas en allemand, le germaniste Lutz Winckler. On en revient, en effet, toujours au même point : on peut faire comprendre dans une langue ce qui se déroule dans une autre, mais on ne peut le faire sentir qu’à ceux qui la parlent (la savoir ne suffit pas). C’est parce qu’une langue ne déborde pas que sa portée est si difficile à faire sentir.
En outre, dans cette phrase on retrouve, et ce n’est pas le seul endroit du texte, le fameux « rechnen », la pensée calculante, dont tout le monde sait bien qu’elle est le propre des juifs, les juifs comptent et calculent, le terme, une fois de plus, n’est [139] pas là par hasard et est immédiatement compris comme tel par le lecteur allemand, en plus Heidegger écrit « hält nie still », allusion à la fameuse nervosité juive, à l’agitation juive. Ici s’exprime le conflit capital entre germanité et « modernité ». En réalité, l’entrée dans l’époque contemporaine d’une Allemagne enfin existante en 1870 crée un déséquilibre très reconnaissable, si bien que le soudain décalage fait apparaître le divorce radical entre une Allemagne repliée sur elle-même et la soudaine confrontation à l’Europe, ce contexte est d’autant moins négligeable que Heidegger ne cesse de s’y référer.
Tous les textes plus ou moins racistes de l’époque se servent de ce même cliché que Heidegger emploie en parfaite connaissance de cause. Le Juif n’est jamais besinnlich, un terme difficile à traduire en français qui n’aime pas l’indiscrétion et l’étalage trop visible de sentiments apprêtés, comme le disait déjà Nietzsche ; la Besinnlichkeit, c’est l’état de méditation pensive visible par le voisin, eine besinnliche Stunde im Gartenlokal, une heure un peu méditative où on pense aux belles choses dans l’auberge de plein air. On y est collectivement à l’abri, on y boit de la bière et on y chante ensemble et on autorise l’inconnu en bretelles et culotte courte au sich dazusetzen, sur le banc avec tout le monde à s’asseoir en plus. L’atmosphère alors devient beschaulich, sinon lauschig, car tous les niveaux de langue, qu’un mot aussi piégé que besinnlich implique, jouent avec lui et l’accompagnent. Il y a dans ces propos tout un contexte politique très précis qui ne peut qu’échapper au lecteur français.
Il y a là toute une terminologie qu’on n’ose plus employer depuis que le nazisme a détruit la langue allemande. Et Heidegger recourt de propos délibéré au vocabulaire le plus sensible de la langue allemande par lequel il se rattache de propos délibéré à tout ce qui a constitué la germanité du nazisme, la mignardise, la Betulichkeit qu’on retrouve chez tous les écrivains spécifiques NS, tels que Hermann Burte et Hans Friedrich Blunck ou Bruno Brehm et tant d’autres qui participent de la même Rührseligkeit, du même Blubo.
Mais Gelassenheit est, par ailleurs, un des exemples les plus parlants de la paralysie linguistique qui a saisi Heidegger après 1945, comme si son engagement au sein du nazisme lui avait, à la lettre, coupé la parole, la lui avait retranchée, l’avait gelée en lui, comme s’il racontait mieux que personne, en personne et par sa personne le crime commis contre la langue allemande qui traînera derrière elle jusqu’à la fin des temps cette inguérissable blessure.
Dès l’abord, Heidegger avait fait le pari de la langue, surtout avec S/Z qui et c’est bien là le pari, était écrit contre la tradition philosophique représentée par Nicolaï Hartmann (qui lui sera un « Mitläufer », un comparse) et autres, ce qu’on appelle « Die Umstellung vom "Bewusstsein" aufs Existieren » (le passage de la conscience à l’existence), un véritable programme d’action politico-philosophique, mais dont très rapidement Heidegger sera le sujet au lieu d’en être l’acteur. On ne peut entreprendre ici l’étude précise de ce que S/Z impliquait d’adhésion et d’abdication.
[140] Après 1945, on l’a vu, à la suite de l’irréparable catastrophe, la langue devient doucereuse et banale, au comble du kitsch comme dans le texte célèbre de la conférence Das Ding, du 6 juin 1950, date curieuse d’ailleurs. On y lit une accumulation des jeux de mots habituels sur Ring, l’anneau, et ringen, lutter, et gering, moindre, sur Reifen, anneau, et Reigen, ronde, sur das Ding dingt et die Be-Dingten, qu’il est vain de vouloir traduire. Des mots simples et certains volontairement surannés Bach, Spange, Krug, Buch, Bild, Krone, Kreuz, Bank, Steg ou Ring font croire à la pensée, ce sont de vieux attributs de la germanité littéraire. L’allemand est devenu pesant, aussi lourd et naïf que celui de Friederike Kempner, le cygne de Silésie dont le poème
- Es ringt
-
- Es ringt der Regen mit dem Winde
- Es ringt der Segen mit dem Fluch
- Es ringt das Alter mit dem Kinde
- Es ringt die Sage mit dem Buch
-
- vaut bien le
- Wälder lagern
- Bäche stürzen
- Felsen dauern
- Regen rinnt
-
- Fluren warten
- Brunnen quellen
- Winde wohnen
- Segen sinnt
de Heidegger. On ne voit pas bien pourquoi les vers de la malheureuse Friederike ont fait se tordre l’Allemagne entière et pourquoi on devrait prendre pour de la poésie majeure ce distique de Heidegger.
D’où vient-il que Heidegger se soit laissé piéger par un certain usage de la langue allemande, ou était-ce délibérément, qu’il avait choisi cet usage là comme étant le philosophique même dans la totale confusion avec cette forme spécifique de la langue ? Tout semble indiquer que Heidegger a été saisi par une véritable ivresse linguistique destinée à situer une pensée d’une totale précision, toujours au clair d’elle-même mais, qui peut-être pour cette raison, ne trouvera jamais d’issue verbale correspondante et il se trouve que Heidegger avait à sa disposition une langue qui paraissait pleinement répondre à son attente, qu’il pouvait plier à sa pensée, sauf que la langue l’a entraîné dans une dérive qui en fait mesurer la résistance puisqu’il a fallu, en somme, lui tordre le cou pour la faire parler ou plutôt [141] dégorger, à se demander ce qui se serait passé sans le conflit avec Husserl, sans le ressentiment.
L’étrange, c’est que la langue de Heidegger s’effondre avec ce qui en a été le moteur, non tant le nazisme, mais son côtoiement. Sa langue était destinée à exprimer ce qui fait aussi l’essence du nazisme.
De plus elle perpétue aux yeux du lecteur français le côté fatidique et impérieux de la langue. Ce n’est qu’une manière de plus de la maltraiter. A la limite, comme le rappelait la citation de Thomas Mann, Heidegger a contribué à la destruction d’un allemand vivant, tel qu’il n’est pas près de réintégrer les instances intellectuelles françaises. L’allemand est une langue comme toutes les autres, mais toujours victime de sa faillite de parole.
Pour Heidegger se pose le problème même de la langue comme telle, telle que Spinoza l’envisage au § 88 du Traité de la Réforme de l’entendement, en tant qu’elle reflète le déploiement de l’imagination aux dépens de l’entendement. C’est le problême que soulèvera Leibniz cinquante ans plus tard justement à propos de la langue allemande.
Si dès l’abord Heidegger a confondu sa langue avec le nazisme, c’est que la confusion, loin d’être une « embardée », est à coup sûr constitutive, mais de quoi ? Heidegger sait mieux que nul autre que le langage s’alimente de ce qu’il ne sait pas dire, mais pas plus qu’un autre, il n’a pu capter ce que le langage ne dira jamais, puisque la langue, telle qu’il l’entend, est ce qui n’est pas de l’ordre du Zweckhaften comme le dit Max Picard (Der Mensch und das Wort, 58).
Hamann, « le mage du Nord » disait : « Rede, dass ich dich höre » (Parle que je t’endende.)
Fin du quatrième article de cinq.
|

