| [6]
Les démocraties sont-elles gouvernables ?
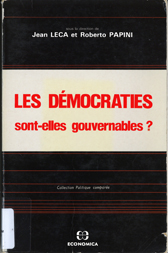 Présentation Présentation
par Roberto Papini
Secrétaire Général de l’Institut International Jacques Maritain
Durant les années 50, le développement politique et social du monde occidental et le début d’émancipation du tiers monde ont nourri un optimisme d’autant plus illusoire que les futurologues pronostiquaient une croissance continue. Les difficultés économiques des années 70 et le malaise social qui s’en suivait sonnèrent le glas de cette euphorie.
Ce phénomène de crise accentué par ailleurs par le développement scientifique et technologique a suscité bon nombre d’analyses, mais peu de thérapeutiques convaincantes. Et ce désarroi des politiques économiques face au mal à traiter apparaît dans la pratique des divers gouvernements.
Face à ces difficultés, les pays en voie de développement ont subi une véritable décomposition, tandis que les pays industriels, relativement mieux armés grâce notamment à l’accumulation opérée durant les années précédentes, ont connu des dégâts plus limités. Selon des modalités différentes, ceux-ci se sont engagés dans la voie difficile de l’austérité, après avoir pris conscience que le temps des croissances fortes était révolu.
Pour faire face à la gravité de la situation, il apparaît nécessaire de mettre en œuvre une stratégie polymorphe qui agirait sur plusieurs facteurs, notamment en renforçant la part de la recherche et celle des investissements afin de développer la vitalité des entreprises. Les sommes disponibles n’étant plus extensibles, il s’agit de bousculer les droits acquis, les conséquences politiques et sociales d’une telle attitude étant facilement prévisibles.
La fin de l’espoir en une issue rapide a provoqué une remise en cause de l’État-providence, qui s’est accompagnée, à son tour, d’une critique de la démocratie représentative, considérée comme un obstacle à la rationalisation économique. Toute une littérature scientifique, suivant des approches différentes, a apporté des arguments savants à de telles analyses, en amenant de « l’eau au moulin » de ceux qui dans ce volume, sont [6] souvent appelés, et pour cause, les tenants de l’idéologie de la crise (c’est-à-dire, l’idéologie qui commande une certaine lecture de la crise elle-même, en vue d’une « normalisation sociale »).
Pour schématiser, les termes de la question sont exprimés ainsi par Louis Baeck dans un chapitre de ce livre : « les contradictions structurelles de nos sociétés résultent de l’incompatibilité entre les exigences fonctionnelles de la démocratie politique et les exigences du développement du capitalisme libéral ».
Face à ce défi, nombre de politologues préconisent un État plus fort (et une société plus « apathique »), tandis que d’autres rêvent d’une société plus forte et plus autonome (et d’un État moins interventionniste). Tous s’accordent plus ou moins explicitement quant à l’opportunité de revoir les modalités de l’État-providence et certains veulent même limiter l’« expansion démocratique » qui, outre des raisons purement économiques, serait l’une des causes majeures de l’ingouvernabilité de nos sociétés. [1]
Quelle que soit la stratégie globale la plus apte à provoquer la reprise économique, il n’y a pas de doute que le système social a souvent « surchargé » l’État au-delà de ses possibilités. Cette crise socio-politique doit être l’occasion d’une réflexion approfondie, tant au niveau de la théorie de l’État que du modèle de développement économique et de l’organisation sociale. En effet, la portée et la nature de cette crise vont bien au-delà du problème de la gouvernabilité et touchent aux racines mêmes de la vie au sein de nos sociétés.
Peu satisfait des analyses avancées, l’Institut International « Jacques Maritain » [2] a constitué une commission internationale qui, partant d’une inspiration personnaliste, apporte sa contribution au débat en cours dans les sociétés occidentales. Les résultats des travaux de cette commission sont consignés dans ce livre.
Quelques questions préalables
Il semble utile de poser quelques questions préliminaires :
– Le fonctionnement général de nos démocraties est-il le premier responsable de la situation ? Ou bien, d’autres facteurs entrent-ils en ligne de compte, et particulièrement les contradictions inhérentes au système [7] capitaliste, comme le prétendent certains et non plus seulement les néomarxistes ? Par exemple, le désordre financier international, la concurrence des nouvelles puissances économiques, la diminution de la part de la recherche et de la productivité, le non-décollage – sauf exception – des pays en voie de développement, l’imprévoyance des entrepreneurs durant les années de prospérité, et surtout, les mutations technologiques et leurs conséquences sociales.
– De plus, au-delà des « règles » et des « exigences » du capitalisme libéral – pourtant fortement évolué – et du débat actuel entre ceux qu’on pourrait appeler les « monétaristes » et les « productivistes », pourquoi ne pas envisager des correctifs, même importants au processus de développement [3], de manière qu’entre modèle social et modèle politique, il n’y ait pas ruptures mais au contraire continuité ? Il n’est pas question d’ailleurs de nier que le processus de développement des démocraties occidentales a joué un rôle dans la désintégration sociale en cours depuis les années 60.
– On ne peut pas négliger les responsabilités sociales et politiques du système économique capitaliste. Dans ses formes les plus dures, il est non seulement lié à des politiques économiques et sociales, mais aussi à des politiques institutionnelles de nombreux régimes autoritaires de l’Amérique Latine. Au-delà de leur héritage colonial et post-colonial, ces régimes sont inspirés soit par la doctrine de la « sécurité nationale », soit par la théorie de la « démocratie protégée ».
Mais cette crise, malgré son ampleur et ses conséquences, n’a-t-elle pas des aspects salutaires ? C’est à travers les tensions que la crise a provoquées et les transformations qu’elle a suscitées que les idéologies et les mentalités ont été remises en question, tout comme certaines structures politiques, sociales et administratives. Tout cela a ouvert la voie à la recherche de nouveaux modèles sociaux.
– Enfin, même si l’on reconnaît les acquis positifs de notre démocratie politique – et nous croyons être de ceux qui sont bien conscients des phénomènes élitistes qui la limitent – on ne saurait exagérer ses possibilités. Nos pères avaient progressivement établi un système démocratique qui avait pour tâches essentielles de défendre les frontières extérieures et l’ordre public aussi bien que d’empêcher le fonctionnement incorrect du marché ; aujourd’hui le même système est surchargé de mille revendications particulières. Conçu pour des fonctions générales, il a dû faire face à des fonctions multiples et [8] spécialisées. [4]. C’est ainsi qu’il s’est déréglé. Mais pourquoi la réalisation historique actuelle de l’esprit démocratique n’admettrait-elle pas d’autres issues ? Pourquoi la tension permanente entre l’individu et la collectivité ne pourrait-elle pas se résoudre dans de nouvelles formes de démocratie ?
Au-delà de la crise, l’homme
La philosophie politique ne peut pas se borner à l’étude des phénomènes sociaux. Sa tâche est aussi de comprendre les mutations anthropologiques de l’homme contemporain dans sa quête du sens de la vie (et de la mort). Pour les sciences sociales contemporaines, l’Homme est comme chacun le sait une abstraction, dont la mort, bien que non datable avec précision, n’en est pas moins tenue pour certaine. Sur le cadavre de cet encombrant « concept idéaliste » ont pullulé les hommes « historiques », leurs « groupes », leurs « rôles », leurs « intérêts », leurs « stratégies » (toutes plus ou moins inconscientes), les « structures » et les « systèmes » qui les fabriquaient. Ce refus de parler de l’homme, aussi justifié soit-il au regard des exigences d’une connaissance des objets sociaux et de leur mécanisme de fonctionnement, n’est-il pas la manifestation d’un enfermement culturel ? Quant au repli actuel de l’homme lui-même, il peut apparaître comme le résultat d’une radicalisation des égoïsmes et des intimismes. Mais n’est-il pas plutôt une défense vis-à-vis de certains aspects de la « rationalisation technique » de la politique, de sa façon toujours plus froide, plus impersonnelle, « cybernétique » d’aborder les problèmes de nos sociétés ?
L’Homme contemporain a une conscience aiguë de cette crise, il sent plus ou moins confusément qu’elle n’est pas seulement économique et politique, mais qu’elle s’associe à une crise des valeurs, d’une certaine culture et d’une certaine rationalité, voire même une crise de civilisation. L’homme, plus lucide, a désormais compris que la mort de ses propres valeurs et du « Dieu-personne » est aussi le début de sa propre mort.
Dans cette attente névrotique pour sortir du tunnel (mais le common-man l’attend-il encore ? Est-il capable d’attiser son espérance ? En somme, l’homme est-il naturellement démocrate ?), l’homme contemporain est en proie à une insécurité et à une fragilité qui le cantonnent dans la défensive et le rendent sceptique au sujet des promesses de salut terrestre, peu disposé donc à s’engager dans les changements dont il ne perçoit les contours que de façon vague et contradictoire, ce qui porte cet homme « libéré » des contraintes de sa condition à se sentir « objet » plus que « sujet ». Tant qu’il se sentira aliéné, il sera dans un état de névrose sociale, cause première de l’ingouvernabilité en politique.
[9]
La remise en cause de l’État-providence, on l’a déjà dit, a aussi ses aspects salutaires : elle ouvre, entre autres, des « espaces » mutiples au corps social et politique, ce qui permet d’entrevoir de nouvelles formes d’autogestion et de nouvelles solidarités dont l’objectif n’est pas toujours le profit. Les économistes insistent, eux aussi, sur l’importance de l’« économie sociale » et de l’« économie souterraine ». Tous ces signes, même dans leur ambiguïté, sont issus d’une volonté de réforme ou à tout le moins témoignent-ils de pratiques nouvelles et peut-être préfigurent-ils une perspective de guérison. Ceux qui ont la responsabilité de la conduite de nos sociétés, les hommes politiques en premier lieu, mais aussi les acteurs sociaux et culturels, devraient être attentifs à ces nouvelles dimensions, signes de revitalisation du corps social.
La reprise ne saurait avoir lieu en tout cas, sans la participation des intéressés – les citoyens –, sans une diffusion réelle des responsabilités de manière à ce que chaque catégorie sociale soit mise dans la situation d’assumer pleinement son rôle. Les « gouvernants » devraient avoir quelque méfiance vis-à-vis des conseillers qui suggèrent des solutions de malthusianisme démocratique, comme celle de favoriser « l’apathie » du corps politique, alors que l’effort devrait viser plutôt à la libération des énergies sociales, à la recherche difficile et continue du consensus social, à la conquête de la légitimité et de la confiance de la part des citoyens.
Ceux qui prétendent résoudre nos difficultés en préconisant une plus faible participation politique, semblent ne pas avoir saisi que l’enjeu est essentiellement politique, dans le sens le plus fort du terme. Il est vrai que la démocratie de la « délibération permanente » est fatale à la démocratie tout court, mais il est aussi vrai, on l’a affirmé depuis toujours, que le désintérêt des citoyens est tout aussi néfaste. La politique ne doit pas être une superstructure, mais l’expression d’une vie sociale active et rénovée. À cette fin, il faut développer les moyens par lesquels les espaces de régénération du social trouvent une expression politique.
Dans cette perspective, on comprend mieux que la « gouvernabilité » n’est pas la seule finalité de l’État. Comme l’écrivait Maritain dans les années 50 : « la raison primordiale pour laquelle les hommes, unis dans une société politique, ont besoin de l’État, c’est l’ordre et la justice. D’autre part, la justice sociale est le besoin crucial des sociétés modernes. En conséquence, le devoir primordial de l’État moderne est la mise en vigueur de la justice sociale » [5]. En réalité, « la force n’est suprêmement forte que si la justice, non pas la force, est la règle suprême » [6].
L’émergence historique de la démocratie
À travers les révolutions anglaise, américaine, française et les luttes du mouvement ouvrier et du mouvement catholique, on a durement [10] combattu pour l’affirmation progressive de la démocratie politique et sociale. Dans l’après-guerre en Europe, elle s’est consolidée avec le compromis keynésien entre capitalisme et masses travailleuses, surtout grâce à la médiation des partis socio-démocrates et sociaux-chrétiens. La situation est plus complexe aux États-Unis où la contestation du capitalisme a toujours été moins aiguë et où le Welfare State n’a jamais été accepté unanimement. Ce compromis a « domestiqué » le capitalisme libéral au point que certains ont parlé de capitalisme démocratique.
L’idéal démocratique s’est ainsi frayé un lent chemin en s’incarnant dans des formes différentes et progressivement plus avancées – il suffit de penser au passage du suffrage censitaire au suffrage universel – s’assurant de ce fait des conquêtes historiques dont la valeur est irremplaçable : libertés politiques et civiles, dimension pluraliste et laïque de l’État, reconnaissance des droits de l’homme, etc. Il faut cependant avoir présent à l’esprit que, de par sa racine rationaliste et bourgeoise, la démocratie conquise a conservé une structure fondamentalement élitiste. Comme l’écrivait Maritain : « La tragédie des démocraties modernes consiste dans le fait qu’elles n’ont pas encore réussi à réaliser la démocratie » [7].
Les réactions de certains politologues face à la crise, surtout aux États-Unis, ne sont-elles pas la conséquence de la défense de cette démocratie associée étroitement au destin du capitalisme libéral ? Quant aux pays du « socialisme réel », on sait qu’ils ont été capables de ne réaliser que des caricatures de « démocratie populaire ».
L’idée démocratique dont tous semblent se réclamer aujourd’hui est une vérité politique que chacun interprète ou manipule à sa manière. Irrationalismes divers, tentatives de destruction et d’exclusion, ou au contraire de mise en ordre au nom des exigences de la technique, tout (ou presque) s’autorise de la revendication démocratique. La meilleure défense de la démocratie et ses progrès éventuels dépend d’une nouvelle manière de penser, d’une philosophie de la démocratie qui ait une conception réaliste de l’homme et qui lui réserve sa juste place dans la société. Une philosophie qui évite aussi bien l’écueil de l’apathie politique (au bénéfice du privé) que celui de la surpolitisation (comme si l’unique salut résidait dans la politique), toutes deux redoutables pour la cité démocratique ; une philosophie qui assigne à l’action politique le statut qui lui est propre. Une philosophie qui tienne compte de tous les aspects de la vie humaine sans refuser pour autant de penser le problème du gouvernement, c’est-à-dire celui de la décision publique, de ses mécanismes et de ses responsables.
[11]
La « gouvernabilité » doit être conçue en fonction de cette démocratie et non l’inverse. Dans cette perspective on ne saurait se limiter au fonctionnement correct de l’État, fondé sur une théorie « instrumentale » et non « totalisante » de l’appareil étatique, mais il faut aussi être attentif aux mouvements de l’ensemble de la société.
Sans être un politologue « anarchiste », Maritain pariait sur une lente maturation du corps social de manière à prendre en charge les activités que l’État, dans l’après-guerre, avait progressivement assumées par suppléance. Il souhaitait « un mouvement de progressive décentralisation et de “désétatisation” de la vie sociale, tendant à l’avènement de quelque nouveau régime personnaliste et pluraliste… toutes les formes organiques de l’activité sociale et économique, même les plus vastes et les plus étendues, procéderaient d’en bas, de la libre initiative et de la mutuelle tension des groupes particuliers, des syndicats, des associations, des groupes fédérés de producteurs et de consommateurs… institutions nées de la liberté, dont le libre jeu exprimerait la vitalité d’une société vraiment juste dans ses structures fondamentales » [8].
Vue de façon statique, comme une pieuse recette pour la démocratie parfaite, cette formule apparaît bien idéaliste dans un monde où « les formes organiques de l’activité sociale » apparaissent précisément en crise d’identité. Mais ce pari n’est-il pas finalement le meilleur afin que soit accepté un nouveau pacte social selon lequel les divers groupes sociaux et les divers corporatismes acceptent de limiter leurs requêtes et de jouer de manière responsable leur jeu social et politique en échange d’une garantie minimale de sécurité politique, économique et sociale ? Ne faudrait-il pas songer sérieusement à une démocratie qui soit avant tout « intelligible » aux citoyens parce que l’aventure démocratique est une tâche commune à toute la société ? En même temps, ne faudrait-il pas également viser au développement de la démocratie par une connaissance solide de ses valeurs propres ? Il y a là une responsabilité toute particulière du monde de la culture.
La démocratie n’a-t-elle pas également une valeur universelle ? Tous les hommes ne sont-ils pas en effet, les destinataires du message de justice et de liberté qu’elle recèle ? Mais combien y a-t-il aujourd’hui de pays démocratiques ?
Il semble que dans ce volume, s’offrent de nouvelles possibilités de réflexion. Nous vivons la naissance d’une nouvelle modernité. Nous avons bien saisi que le réel n’est pas un cadre organisé d’essences immuables, mais plutôt la fusion entre « nature » et « aventure » ; ce qui signifie que l’histoire et le changement pénètrent la nature et sa compréhension. Cette idée est primordiale pour comprendre l’évolution de nos sociétés industrielles et de nos systèmes politiques.
L’avenir est donc relativement ouvert aux projections humaines mais à nous de maîtriser les changements et de décider où nous voulons conduire nos démocraties.
[12]
[1] Ces attitudes ont également provoqué des réactions vigoureuses. Je me contenterai de citer la position de l’ex-ministre français du Plan, Michel Rocard : « Véritable école du fatalisme, l’idéologie néo-libérale cherche à rétablir des processus d’accumulation au détriment des salariés et des travailleurs indépendants, en affaiblissant leur capacité de résistance. Le coût social d’une telle politique devient vite insupportable car elle provoque l’éclatement du monde du travail aussi bien dans l’agriculture que dans l’industrie et les services. Son efficacité économique est au demeurant plus que douteuse puisque la modération temporaire de l’inflation exige, aujourd’hui plus qu’hier encore, la mobilisation de tous les acteurs de la vie économique ». Michel Rocard, « Du bon usage de la rigueur », Le Monde, 14 juillet 1982.
[2] L’Institut International « Jacques Maritain » est une association culturelle qui réunit des intellectuels d’inspiration personnaliste. Il a son siège à Rome et des Sections Nationales dans plusieurs pays. Son but est de contribuer à l’étude et au débat de quelques-unes des questions contemporaines actuellement discutées dans les domaines de la philosophie et des sciences sociales.
[3] « Produire autrement d’autres valeurs d’usage dans un monde éclaté où chaque société redéfinit ses besoins en fonction de son milieu et de ses cultures propres, c’est là aujourd’hui une simple vue de l’esprit. Mais cela peut aussi apparaître demain, comme la simple politique de sortie de la crise », F. Partant, La fin du développement, Paris, 1982.
« La croissance est momentanément arrêtée parce que, parmi les pays plus avancés, aucun n’est encore parvenu à jeter les bases d’une nouvelle organisation économique, politique et sociale. C’est une cohérence d’ensemble qu’il faut désormais trouver entre les modes de production, de consommation, de gestion du temps, de répartition des ressources et d’intervention étatique qui sont exigés par la troisième révolution industrielle », G. Lafay, « Les principaux mécanismes de la crise industrielle », Projet, mars 1983.
[4] Luhmann observe que dans l’État libéral la relation gouvernement-citoyens était réglementée par un feedback négatif : le système éliminait automatiquement, sans discussion, les déviations. Gouverner était donc plus facile. L’État démocratique et pluraliste est par contre réglementé par un feedback positif : toutes les demandes, en principe, sont légitimées, d’où l’extrême politisation de ces demandes.
[5] J. Maritain, L’Homme et l’État, Paris, 1965, p. 19.
[6] Idem, p. 55. Les débats comme celui sur la « philosophie pratique » dans la République Fédérale allemande montrent que le problème des valeurs est toujours au cœur de la politique.
[7] J. Maritain, Christianisme et Démocratie, New York, 1943, p. 31.
À son tour, Emmanuel Mounier écrivait : « Appelons démocratie avec tous les qualitatifs et superlatifs qu’il faudra pour ne pas le confondre avec ses minuscules contre-façons, le régime qui repose sur la responsabilité et l’organisation fonctionnelle de toutes les personnes constituant la communauté sociale. Alors, oui, nous sommes du côté de la démocratie. Ajoutons que déviée de ses origines par ses premiers idéologues, puis étranglée au berceau par le monde de l’argent, cette démocratie là n’a jamais été réalisée dans les faits, qu’elle l’est à peine dans les esprits ». Lignes de position, février 1934, Œuvres, Tome I, p. 194.
[8] J. Maritain, L’Homme et l’État, op. cit., p. 22.
|

