|
“Nationalisme et vie économique.”
In Revue d'histoire de l'Amérique française, Vol. 22, no 4, mars 1969, pp. 587-610. Institut d'histoire de l'Amérique française. Commentaire d’Alfred Dubuc, pp. 611-615.
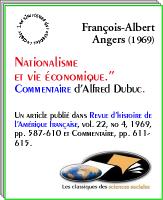
- Les auteurs [588]
François-Albert Angers, “Nationalisme et vie économique”, pp. 589-610. [589]
Alfred Dubuc, “Commentaire”, pp. 611-615. [611]
[588]
LES AUTEURS

François-Albert Angers
- Économiste et professeur.
- Etudes au Collège des Frères du Sacré-Cœur, Montmagny, à l'École des Hautes Études commerciales de Montréal, à l'École libre des Sciences politiques (Paris).
- Licencié en Sciences commerciales. Diplômé en Sciences politiques (Paris).
- Directeur de l'Institut d'Économie appliquée à l'École des Hautes Etudes commerciales de Montréal.
- Président de la Ligue d'Action Nationale.
- Président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.
- Oeuvres :
- Initiation à l'économie politique
- Essai sur la centralisation
- La sécurité sociale et les problèmes constitutionnels — 2 vol.
Le problème fiscal et les relations fédérales-provinciales — 1 vol. — (annexes au Rapport de la Commission Royale d'enquête du Québec sur les problèmes constitutionnels)
Auteur de nombreux articles parus dans l'Actualité économique, Culture, L'Action nationale, Canadian Journal of Economics and Political Science, etc.
Voir aussi : "L'évolution économique du Canada et du Québec depuis la Confédération", paru dans notre Revue d'histoire de l'Amérique française — numéro spécial "Cent ans d'histoire 1867-1967".
Alfred Dubuc
- Licencié en Droit de l'Université de Montréal (1953) et en Sciences politiques et sociales de l'Université de Louvain (1957). Docteur de l'École pratique des Hautes Etudes de Paris (1959).
- Professeur au Département d'Économique de l'Université de Montréal.
A publié :
"Les classes sociales au Canada 1760-1840" dans Annales E.S.C. (été 1967) ;
- "The decline of Confederation and the new nationalism", dans Nationalism in Canada (Toronto, McGraw-Hill, 1966) ;
- "Fondements économiques de la Confédération canadienne", dans Socialisme '65.
[589]
François Albert ANGERS
[1909-2003]
Professeur d’économie à l’École des Hautes Études Commerciales (HEC)
de l'Université de Montréal.
“Nationalisme
et vie économique.”
In Revue d'histoire de l'Amérique française, Vol. 22, no 4, mars 1969, pp. 587-610. Institut d'histoire de l'Amérique française. Commentaire d’Alfred Dubuc, pp. 611-615.

Ce n'est pas d'aujourd'hui, ni de récemment que les problèmes économiques ont pris leur place et leur sens dans la vie des Canadiens français considérés comme collectivité désireuse de survivre avec ses caractéristiques propres. Déjà, en 1917, M. Edouard Montpetit donnait, à l'Action française que venait de créer la Ligue d'Action française, son article liminaire où il lançait le thème "La question nationale est d'abord une question économique". Et en cela, il ne faisait que frapper en formule lapidaire, en slogan, des idées qu'avait propagées Errol Bouchette vingt-cinq ans auparavant dans sa série d'écrits sur l’"Indépendance économique du Canada français", et qu'avait soutenues Etienne Parent, encore plus d'un demi-siècle antérieurement.
Mais une, ou même quelques hirondelles, ne font pas le printemps. Et le ton même des écrits de ces trois phares dans l'évolution de la conscience économique au Canada français démontre, qu'à leur avis, en tout cas, la collectivité elle-même n'était pas suffisamment consciente de cet aspect du problème de la survie nationale. C'est sur le ton de l’éveilleur, de l'alerte à sonner devant un danger menaçant mais inaperçu, que ces hommes parlent. Le premier, Étienne Parent, dénonce, dans notre société de l'époque, une nostalgie de la noblesse d'ancien régime qui crée chez les parents, pour leurs enfants, une aspiration d'anoblissement dont la seule issue au Bas-Canada est l'accession aux professions libérales, plus spécialement à la prêtrise et au droit ; notre société d'alors aurait été plus désireuse de se donner une noblesse qu'une bourgeoisie, avec toutes les différences d'attitude d'Ancien Régime que cela comporte vis-à-vis du développement et du maniement des affaires. Le second, Errol Bouchette, lancera le cri d'alarme contre une invasion imminente des capitaux américains au début du 20e siècle ; il insistera sur la nécessité d'une action, au besoin gouvernementale, [590] en vue de centraliser l'épargne canadienne-française et de la diriger vers la mise en valeur de nos ressources naturelles et vers le développement économique sous notre contrôle plutôt que sous contrôle étranger. Le troisième, Edouard Montpetit, sera l'apôtre de la solidarité économique, donnant à la conception de la question une dimension plus spécifiquement nationaliste à une période où il ne s'agit plus seulement, comme au temps d'Etienne Parent ou d'Errol Bouchette, d'organiser la vie économique d'un pays encore en friche, donc libre, mais de coaliser les forces pour reconquérir des positions maintenant occupées par d'autres. En définitive donc, chacun d'entre eux a lutté contre l'état d'esprit qui prévalait en son temps face à l'état des choses qui lui paraissaient faire obstacle à notre épanouissement économique considéré comme instrument nécessaire de survie nationale.
Il y a lieu cependant, à mon sens, de se garder d'accorder une importance trop grande — sans bien sûr tomber dans l'erreur de la minimiser — aux écrits d'apostolat en particulier, ou d'action politique en général, pour juger de l'état et des possibilités véritables d'une société dans un moment historique donné. Et ceci parce que forcément, ce genre d'écrits s'occupe naturellement davantage, et parfois très exclusivement, à souligner les déficiences par rapport à un état de perfection. On veut indiquer des voies à suivre, stimuler à l'action, et on néglige ou sous-estime par là momentanément l'état réel des choses sous d'autres aspects, comme les réalisations véritables à signaler pour pouvoir se faire une idée historiquement complète et juste de la situation.
Au surplus ce type d'écrits, quand il revêt même une allure plus scientifique dans son souci d'analyse complète, tend à intellectualiser plus qu'à actualiser les choses. Par suite, ils posent les problèmes dans l'absolu d'un état idéal, sans s'attacher aux possibilités réelles du moment ou aux exigences de temps, ne se proposant que d'exprimer une vision, d'indiquer les avenues à prendre, en laissant aux hommes d'action les soucis de la mise en œuvre.
[591]
Il m'apparaît, à moi, pour avoir maintenant vécu une période importante de cette histoire, celle de l'influence Montpetit, et m'être penché occasionnellement sur les deux autres, que notre société n'a pas méprisé l'économique au point où on le prétend aujourd'hui en formulant des hypothèses de vraisemblances sur des textes, d'ailleurs le plus souvent partiels, tronqués, des Parent, des Bouchette, des Mgr Paquet, des Montpetit et des Minville. Quant au visage que l'on se fait de la société canadienne-française à travers les écrits de ces hommes, la vérité historique qu'ils expriment c'est probablement que comme tous les peuples de tous les temps nous n'avons pas su, face aux problèmes que nous devions affronter (mais ce sont ces problèmes qui sont à la clef de l'interprétation valable), être à la hauteur des visions de ceux qui étaient nos prophètes. Nous n'avons pas souscrit d'emblée et massivement aux solutions valables qu'ils nous proposaient, mais qui auraient exigé que tout un peuple sache vivre en constant état d'héroïsme, ou soit capable de se donner des chefs héroïques pour le conduire à sa terre promise. Or cela même, le pouvions-nous d'ailleurs dans l'état de Conquête et de jeu démocratique que nous devions assumer ?
Même au temps d'Etienne Parent, alors que notre goût pour une société fondée sur une classe de nobles était probablement aussi réel que cet auteur le dit, il est loin d'être clair que nous méprisions en bloc la richesse et les affaires au point d'entraver le développement chez nous d'une bourgeoisie d'argent. L'idéal élevé que peut entretenir une société de ses classes de prestige n'empêche pas pour autant qu'on s'y préoccupe aussi bien des exigences de la vie matérielle. Cela existe pour les personnes, en foi de quoi ce ne sont pas toujours les artistes les plus idéalistes ou les prêtres qui sont les plus dégagés des questions d'argent ; et dans une société, la diversité des talents fait toujours qu'en dépit de tout idéal autre, des gens préfèrent s'adonner aux occupations d'argent plutôt qu'aux occupations de prestige sans se croire ni être considérés comme des parias. Les écrits mêmes d'Etienne Parent témoignent qu'en son temps et jusqu'aux premières années du 20e siècle, l'activité économique des Canadiens français se révélait très satisfaisante, très en progrès, et [592] peut-être en passe de prendre une place au soleil fort enviable face à la concurrence anglo-canadienne. Il est peu probable que ce soit un sermon de Mgr Paquet qui soit la cause du renversement qui s'est produit ensuite.
La cause du renversement, Errol Bouchette en avait vu clairement la menace et il avait crié casse-cou à temps : la nation américaine est riche à ne plus savoir quoi faire de son argent ; les capitaux américains sont là à nos portes comme un raz-de-marée qui s'amène et qui déferlera sur nous dans les toutes prochaines années (nous étions alors en 1900) ; il nous faut tout de suite une planification de l'épargne et de l'investissement, disait-il dès lors dans les termes de l'époque. Est-ce par mépris de l'importance de l'économique qu'on ne l'a pas entendu ?
Naturellement, on ne saurait, dans l'absolu du moins, chercher à donner raison à une société et à des gouvernants de n'avoir pas su faire le plus, de n'avoir pas correspondu à l'idéal, quand il fallait le plus et l'idéal pour sauver une situation. Mais encore le pouvaient-ils ? Car il semble se dégager de l'histoire de cette époque, tel qu'en particulier Robert Rumilly nous en fournit tout le détail dans sa monumentale Histoire de la Province de Québec, que ce sont d'autres préoccupations économiques, et non pas le mépris des questions économiques qui ont dicté une orientation différente de la politique. Et des préoccupations économiques d'ordre nationaliste aussi bien ; de l'ordre de la nécessité de parer au plus pressé, d'assurer la survivance physique de la collectivité elle-même avant de songer à de meilleurs modes d'organisation de sa vie.
Nos essayistes et nos historiens des dernières années ont, à mon sens, trop sous-estimé l'importance d'une situation qui prévalait alors, qui était le résultat de toute la politique d'étranglement du Canada français pratiquée par le conquérant avant la Confédération au sujet des terres et du peuplement du Québec, de toute la politique d'orientation du développement économique vers l'Ontario et l'Ouest après la Confédération : le phénomène d'émigration massive des Canadiens français du Québec vers les États-Unis ou vers l'Ouest. L'émigration vers l'Ouest apparaissait [593] d'ailleurs comme un moindre mal, vu que ces francophones restaient Canadiens ; et c'est au Québec même qu'on l'organisait afin de disposer ailleurs qu'aux États-Unis d'un excédent de population qui ne trouvait pas à s'employer dans le Québec.
Avant le problème de "l'Indépendance économique du Canada français" dont Errol Bouchette voyait toute l'importance incontestable pour notre survie, il y avait, à ce moment-là, plus immédiat, plus urgent, d'une urgence extrême même, celui du développement économique du Québec à un rythme suffisant pour permettre d'y retenir sa population francophone et sauver l'existence d'un foyer national canadien-français de dimension démographique viable. Ce problème crucial, tout indique, au contraire de la prétention du mépris des questions économiques par notre société, que nos dirigeants politiques l'ont saisi ; et que c'est consciemment que pendant quarante ans le régime libéral dans le Québec s'est appliqué à le résoudre en invitant les capitaux américains à industrialiser le Québec par l'exploitation de nos ressources naturelles à leur profit et pratiquement sans condition. Personnellement, j'ai souvent entendu l'argument employé à la défense du régime Taschereau contre les détracteurs de sa politique, considérée par tout un élément comme néfaste au point de vue de l'avenir politique et de l'équilibre social ; et l'histoire de Rumilly apporte des arguments qui démontrent une conception de cet ordre remontant à 1896 et à l'inauguration d'une politique consciente d'industrialisation à ces fins par le gouvernement Marchand. Ce fut probablement une politique de panique qui aurait pu être plus habilement conduite, mais cette attitude panique montre qu'on avait parfaitement compris l'extrême urgence d'une solution économique adéquate à notre problème de survie nationale.
Errol Bouchette n'en avait pas moins raison dans l'absolu : et nous payons aujourd'hui les conséquences d'une politique d'industrialisation idéalement inconsidérée dans une perspective nationaliste. Les détracteurs du régime Taschereau n'en avaient pas moins raison dans leur critique d'une déruralisation, d'une [594] urbanisation et d'une prolétarisation massive du Canada français par une révolution industrielle qui s'est produite au Québec d'une façon aussi désordonnée et paupérisante qu'en Angleterre même ; et il faut trouver un peu légère et irréaliste l'accusation d’"agriculturisme" que l'on porte contre ces critiques de déséquilibres dont nous portons aujourd'hui les conséquences dans la "dénationalisation" qui caractérise notre classe ouvrière. Mais, au concret, il reste à se demander si une politique de mobilisation des ressources de la collectivité canadienne-française selon la proposition d'Errol Bouchette eût permis un développement assez accéléré, en dépit même de l'effort héroïque qu'il aurait fallu mettre pour atteindre l'objectif démographique de la retenue au Québec des 5,000,000 de francophones qui y vivent actuellement. Il reste aussi à se demander si une meilleure planification de cette politique économique démographique aurait été possible, à l'époque, à un gouvernement du Québec, dans le cadre de la Confédération et de la mentalité anglo-canadienne du temps. L'aventure de Mercier permet d'en douter.
Ces considérations historiques sur le cas canadien-français dans l'histoire des collectivités, des "nationalités", fait déjà ressortir des impératifs probants de ce que tout nationalisme appelle une conception particulière et une politique appropriée des questions économiques. Le grand débat universel entre les deux théories de l'équilibre économique international, soit par le libre-échange, soit par la protection, en témoigne. La thèse du libre-échange, que l'on peut démontrer dans certaines limites être la plus favorable à un haut niveau de vie généralisé, a toujours échoué en pratique surtout parce qu'elle s'est révélée incompatible avec les exigences nationales. Il faut, pour l'existence d'une nation, la persistance d'un certain noyau de population sur un certain territoire, et une activité de développement économique qui assure à cette population la possibilité de vivre et de prospérer dans les limites du territoire national. La mobilité des facteurs, sans considération des frontières qu'exige une théorie de la liberté du commerce international, peut se révéler totalement incompatible avec des impératifs de vie nationale. Et le problème [595] est du même ordre s'il s'agit de la vie de deux ou plusieurs collectivités nationales à l'intérieur de territoires que l'on a fédérés, c'est-à-dire placés dans la position de totale liberté du commerce inter-territorial.
Quand Edouard Montpetit proclamait que "notre question nationale était devenue d'abord une question économique", il proposait donc un thème et une exigence qui étaient appropriés à la situation des Canadiens français de 1917 ; et d'ailleurs autant à celle d'aujourd'hui, puisqu'au cours des cinquante dernières années nous n'avons pas réussi à doubler le cap du problème national ainsi posé. Mais Edouard Montpetit avait trop de culture et de sens de la culture pour signifier littéralement dans l'absolu ce qu'il disait. Toute question nationale est tout d'abord une question de culture distincte, de vouloir vivre collectif de cette culture distincte, d'attachement à une culture donnée qui comporte presque toujours des sacrifices en termes de pure économie. Mais à tout ce qui vit, il faut une base économique pour la vie même ; et au surplus, il sera normal que l'on veuille réaliser dans ce milieu national le maximum possible de prospérité économique : voire considérer que cette culture ne vaut plus d'être conservée si elle est incompatible avec un certain niveau de prospérité, minimum qui est d'ailleurs souvent très bas ou impalpable tellement est fort au cœur de l'homme l'attachement aux idéaux culturels.
Mais il y a plus profond, et c'est à cette profondeur que Montpetit voulait nous conduire. Il y a que la culture s'exprime et se vit dans des institutions qui elles-mêmes moulent la pensée et forment la culture dans son processus d'évolution, y compris les institutions économiques. Selon Montpetit, notre question nationale était devenue d'abord une question économique, parce qu'au point d'aliénation de nos institutions économiques où nous en étions rendus, notre culture était menacée de disparition, d'assimilation par l'action d'institutions économiques entièrement dominées par les normes d'une culture étrangère. C'est là, dans cette aliénation acceptée, que se révélait la faiblesse des politiques économiques nationalistes d'alors, qui [596] nous sauvaient la vie dans l'immédiat, mais de façon telle que la culture nationale même restait gravement menacée d'assimilation à long terme.
Malgré sa justesse profonde, le slogan de l'économique d'abord formulé par Montpetit, n'a pas été pendant longtemps sans causer beaucoup de mal chez nous, par l'utilisation qu'en ont fait tous les adversaires du nationalisme canadien-français, et tout particulièrement chez les Canadiens français. Dans les milieux d'affaires comme dans beaucoup de milieux intellectuels où l'internationalisme était à la mode, on affectait au nom de ce primat de mépriser toutes ces campagnes, ces luttes "nationalistes" pour la défense de la langue, de l'école, des droits constitutionnels. "Soyons forts économiquement, c'est d'abord ce qui compte ; le reste viendra tout seul ensuite." Mais comment être forts économiquement ? Et comment l'être dans une identification nationale si l'on ne donne pas d'abord à la nationalité les moyens de son identification ?
À cette époque encore récente, l'objection était balayée d'un revers de la main, sans être même considérée. On aimait à se payer de mots lieux communs qui permettraient que personne ne se dérange : acquérons de la compétence et nous finirons par avoir notre place au soleil comme les autres. De là à incriminer de notre infériorité économique, la mentalité trop "agriculturiste" ou trop classique de notre société, le manque de considération accordé à l'homme d'affaires et qui aurait incité les jeunes à préférer les professions libérales, les insuffisances de notre système d'enseignement, etc., il n'y avait qu'un pas. Et au fond, ces "hypothèses" indiquaient une fausse conception du problème au départ ; un raisonnement de vie nationale collective qui serait fondé sur des succès individuels dans le jeu de la concurrence, d'où une sorte de théorie implicite de la survie nationale par l'action et le rayonnement de surhommes à former, sans préoccupation des données du milieu ambiant. Ceux-là qui appuyaient tout sur l'économique n'avaient même pas accepté la thèse de la "solidarité économique" de Montpetit qu'ils rejetaient comme "étroite d'esprit" en fonction de leur philosophie économique [597] imprégnée du libéralisme économique ambiant du continent américain. La plupart n'avaient même guère que mépris pour les formules coopératives qui restaient compatibles avec les règles de la libre entreprise et qui, dans un tel cadre, constituaient la seule possibilité de construire une communauté économique nationalement identifiable.
Les plus logiques restaient les socialistes qui, tout en adhérant d'une façon absolue au primat de l'économique, trouvaient, dans la socialisation plus ou moins généralisée, une forme d'apparence simple et facile de reprise du contrôle de l'économique par la collectivité. Mais leur facilité n'était que l'illusion d'une sous-estimation du jeu des forces politiques dans une situation au surplus aussi complexe que celle d'un Québec doublement dominé par une majorité anglo-canadienne à l'échelle de la politique fédérale et par le capitalisme anglo-américain pour tout ce qui concerne ses sources de vie économiques et financières.
Heureusement, le sursaut de la conscience nationale des années '60 a passablement dissipé toutes ces équivoques. Et l'on voit aujourd'hui un bon nombre de ceux qui défendaient ces thèses antinationalistes autrefois, être les plus ardents batailleurs de l'heure actuelle pour la défense des droits linguistiques et constitutionnels. Les progrès de l'indépendantisme ont aussi fait faire des progrès à la prise de conscience du sens politique collectif des problèmes nationaux, et c'est heureux. Le sens de communauté distincte, d'appartenance à cette communauté, de vie propre de cette communauté, qui s'était passablement dissous chez nous sous l'effet de la vie commune avec la communauté anglo-canadienne, a repris sa place. Ce ne fut pas à proprement parler une résurrection ni même un réveil du nationalisme canadien-français qui n'était jamais mort, ni n'avait jamais vraiment dormi, puisque toujours au Canada français tous ou à peu près nous tenions à survivre et le disions hautement dans tous les camps. Ce fut tout simplement la fin heureuse des équivoques, de la confusion dans les idées entretenues par une situation complexe et en vertu de quoi nous poursuivions l'illogisme d'un idéal dans l'incongruité et l'inefficacité des moyens dont on attendait illusoirement le triomphe.
[598]
Mais cette période de confusion dont nous sortons n'a rien réglé du problème auquel M. Montpetit voulait nous éveiller. Bien au contraire, il n'a fait que s'accentuer depuis, mais nos chances de le régler sont maintenant meilleures en dépit du poids devenu plus lourd du contrôle étranger, à la fois parce que notre prise de conscience collective nous permettra de voir plus clairement les solutions, et parce que le climat d'esprit colonial a beaucoup évolué dans le monde en même temps que dans la mentalité anglo-canadienne.
Mais puisque nous sommes sortis des brumes de nos confusions, il importe maintenant que nous les dissipions complètement et que nous considérions notre problème tel qu'il doit l'être pleinement et sans plus chercher à nous payer de mots, que ce soit au profit d'une idéale unité canadienne qui doit être subordonnée à notre vie si nous prétendons vivre, ou des intérêts de parti qui doivent maintenant savoir céder devant l'intérêt national, ou des intérêts privés qui deviennent de plus en plus solidaires de cette collectivité prenant conscience d'elle-même et qui n'ont d'avenir que dans l'optique de cette solidarité.
Les exigences du nationalisme sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles exigent qu'une collectivité puisse conduire et contrôler le plein développement de sa vie nationale ; ce qui n'exclut pas des solutions d'association ou de fédération, mais ne les autorise qu'à des conditions bien spécifiques et sans jeux de mots. Dans l'ordre économique, la première et la principale exigence, c'est un développement économique suffisant pour pouvoir assurer du travail à tous ses ressortissants à l'intérieur du territoire national, qui en l'occurrence ne peut être que le Québec, même si nous tenons pour la structure politique générale canadienne. C'est le problème crucial dont la solution, pour les années 1896 à 1940, a été rendue possible par l'existence d'une Confédération plutôt que d'une Union canadienne ; et par l'action d'un gouvernement du Québec conscient, malgré ses fautes, d'une urgence à laquelle un gouvernement central ou unitaire eût pu donner une tout autre solution.
[599]
Réglé pour l'essentiel, ce problème d'ailleurs est loin de l'être d'une façon complètement satisfaisante, puisque systématiquement nous devons constater que le Québec est une région où le taux de chômage est en tout temps plus élevé que dans toute autre province à l'Ouest. La pression économique d'une politique canadienne, qu'elle soit ou non critiquable dans ses mesures objectives, continue donc de jouer dans le sens d'une dispersion, d'un mouvement vers le centre et l'Ouest du Canada, de la population québécoise, et concurremment d'une pression sur les salaires pour un niveau de vie plus bas. Cela peut n'être pas complètement intolérable, mais ne saurait être tolérable que dans certaines limites.
C'est dire que si on est sérieux de part et d'autre, de notre part à vouloir vraiment un nationalisme culturel québécois, et de la part des Anglo-Canadiens à accepter vraiment le fait français en tant que nous restons partie du Canada, il ne peut pas être posé en principe qu'une politique économique canadienne puisse s'appliquer uniformément au Québec comme à toutes les autres provinces. D'ailleurs le problème et cette nécessité ne font que s'accentuer si l'on porte la question, au-delà du simple taux de chômage, à celui du développement pour la prospérité, c'est-à-dire pour la possibilité de l'égalisation des niveaux de vie entre les régions du Canada. Dans un pays où tout le territoire n'est occupé que par une nation, n'est régi que par un nationalisme, la politique uniforme règle ce problème d'égalisation par la mobilité de la main-d'œuvre, c'est-à-dire le déplacement des travailleurs des régions à haut taux de chômage et à bas niveau de vie vers les régions de pleine croissance et de haute activité. Ce régime est forcément inacceptable en principe là où vivent ensemble, dans diverses parties d'un territoire politiquement unifié, deux ou plusieurs nationalismes ; et en pratique, on le verra alors soutenu et défendu contre les prétentions des autres par celui des nationalismes qui est le plus fort et qui se verra, par ce procédé, en position d'absorber à son profit les autres nationalismes par la dispersion et la noyade de leurs ressources démographiques dans sa masse propre.
[600]
Sur le plan de la politique démographique nationale pour le Canada français, la politique d'industrialisation des années 1896-1940 n'a d'ailleurs pas tout réglé. Elle a paré au plus pressé, grâce à des circonstances favorables — l'abondance de nos ressources inexploitées et la disponibilité du capital américain — ; mais a laissé le problème fondamental entièrement ouvert. Aujourd'hui que la mise en valeur de nos ressources naturelles est passablement avancée et que les conséquences de la domination du capital étranger arrivent au point critique, il faut d'urgence réaliser le programme proposé par Errol Bouchette de la reconquête du contrôle de notre économie et de notre politique économique. Dans l'état actuel des choses et du vocabulaire économique, cela exige deux conditions tant que nous sommes à l'intérieur du Canada :
- a) la reconnaissance formelle par le gouvernement central de la nécessité d'une politique économique canadienne binationale ;
- b) des pouvoirs suffisamment étendus et complets au gouvernement du Québec (y compris certaines formes de contrôle du type douanier) pour qu'il puisse planifier son développement économique de façon à assurer du travail dans le Québec à la population du Québec.
C'est là un minimum de départ conditionné rigoureusement par les exigences démographiques d'un nationalisme canadien-français. Au-delà, se pose tout de suite comme second problème principal, le niveau de prospérité et de vie qu'il sera possible d'assurer à la population du territoire québécois. Niveau de prospérité qui signifie d'abord une conjoncture économique suffisamment favorable pour que le taux de chômage ne soit pas plus élevé dans le Québec que dans l'Ontario ; niveau de vie qui signifie que, dans le choix des activités qui assureront du travail à tous, le développement puisse librement s'orienter, dans toute la mesure des possibilités naturelles du Québec, vers les activités les plus productives, les plus aptes à payer de hauts salaires.
[601]
Or en cela, et en théorie économique générale, à partir du moment où il faut considérer un tel problème dans les cadres d'un espace dit non homogène, c'est-à-dire, pour simplifier, inclus dans un espace plus grand sans délimitation et sans frontière, tel un pays particulier considéré en fonction d'un monde unifié économiquement, ou similairement le Québec à l'intérieur du Canada, l'application du libéralisme économique est totalement incompatible avec de tels objectifs, à moins que l'espace en question ne soit l'espace favorisé par les circonstances entre les autres. Or tel n'est pas le cas du Québec. Donc ...
L'espace favorisé par les circonstances — en l'occurrence, au Canada, c'est l'Ontario — c'est celui dont la situation naturelle est telle que le jeu de la libre circulation des biens, des capitaux, des hommes, tend à y amener et à y concentrer la majeure et la meilleure partie des activités économiques. Celui-là n'a en effet qu'à laisser faire... pour tout avoir. Mais les autres ? Il est bien évident que s'il existe des raisons, dont les raisons nationales, de leur donner une consistance propre, une homogénéité, il faudra absolument procéder aux interventions appropriées nécessaires pour entraver la libre circulation avec les autres espaces dans toute la mesure où cela est incompatible avec cette consistance et cette homogénéité ; en même temps d'ailleurs que pour la plus grande égalisation possible des niveaux de vie, il faudra éviter l'autarcie et rester ouvert à la protection de tous les éléments de libre circulation qui ne sont pas indispensables à la survie nationale et qui contribueront à une vie nationale épanouie par le plus haut niveau de vie possible.
C'est cet aspect fondamental de l'activité économique qu'oublient trop aisément les critiques qui veulent se faire fort de démontrer que la séparation du Québec et sa constitution en État souverain ne peut aboutir qu'à une réduction du niveau de vie au Québec. Au plan superficiel de leurs thèses et mémoires, ils formulent toute une série d'hypothèses de comportement finalement prises comme certaines, alors qu'en réalité leur actualisation dépendra de toute une série d'agissements et de jeux d'intérêt en très bonne part imprévisibles et qui peuvent suivre [602] un déroulement tout autre ; tous leurs échafaudages n'ont donc de sens que si, effectivement, tout allait se passer selon leurs hypothèses, ce qui par définition n'est pas certain. Et à partir de là et au fond, sont formulées des prévisions appuyées sur la théorie libérale des relations internationales, sans considération aucune de la situation propre du Québec, ni d'ailleurs des conditions faites au Québec par la politique canadienne sous la Confédération.
On raisonne comme si Québec était l'espace privilégié du Canada et comme si, par suite, son intégration au grand tout canadien devait lui apporter automatiquement un afflux d'activité supérieur à celui qu'il peut perdre du fait des particularités dans le jeu des coûts comparés. Or jusqu'ici l'évolution des événements au Canada a prouvé que la situation du Québec conduit à l'effet exactement contraire, c'est-à-dire à un développement en quelque sorte marginal ou latéral en fonction d'un centre d'activité privilégié par excellence qui est l'Ontario. Dans de telles conditions de base, les chances sont fortes qu'une politique économique habile du type protectionniste favorise plus le développement du Québec séparé que l'intégration au Canada, de la même façon qu'il a fallu aux États-Unis l'indépendance et une politique protectionniste contre l'Angleterre pour réaliser leur plein développement économique au XVIIIe siècle.
Outre ces conditions fondamentales déjà favorables à la séparation, les critiques de la "baisse du niveau de vie" oublient aussi le style particulier, désavantageux au développement du Québec, qu'a revêtu la politique canadienne sous le régime confédératif. C'est un point que j'ai déjà essayé de mettre en valeur plusieurs fois au cours des dernières années, notamment dans l'article publié au numéro du centenaire de la Confédération de la Revue d'Histoire de l'Amérique française, et auquel les analystes paraissent continuer de n'apporter aucune attention en dépit de son importance majeure. Je le rappellerai rapidement ici.
Tout le monde sait et a dit que le Canada fut une création politique dont les structures géographiques est-ouest étaient déjà antinomiques par rapport aux tendances naturelles nord-sud [603] des régions. Tout le monde reconnaît aussi que la construction de nos chemins de fer fut une affaire politique, antiéconomique, et dont le poids financier a lourdement porté sur toute l'histoire de la Confédération, et notamment sur le coût énorme pour l'Est des relations Est-Ouest. Pourtant, après avoir énuméré ces faits d'histoire économique, on les oublie complètement quand vient le moment d'analyser les problèmes économiques de la vie canadienne. Une théorie économique trop modélisée et trop abstraite se contente de vouloir tout juger d'une réalité donnée, comme la réalité canadienne, sans tenir compte des conditions particulières qui ne relèvent pas des modèles devenus traditionnels d'interprétation générale. Pourtant, une théorie économique réelle, c'est-à-dire réaliste, ne saurait négliger dans l'interprétation des faits, l'importance des structures d'investissement, tout particulièrement celles des cadres et alors principalement l'organisation des moyens de transport, comme pôle ou orientation du développement économique.
Or le Canada présente un cas extraordinaire par son ampleur d'une structure d'investissement au niveau des moyens de transport, créée de toutes pièces pour des fins à peu près exclusivement politiques et dont les conséquences sur l'orientation du développement canadien ont constitué le facteur-clef, à la fois par ses effets positifs d'attirance du développement vers l'Ouest canadien plutôt que d'intensification du centre et du nord-québécois, et par ses effets négatifs de retard dans la création de structures de développement québécoises en raison des charges financières déjà engagées ailleurs et de la nécessité de les bonifier et de les amortir avant de pouvoir en entreprendre d'autres. D'ailleurs, quand cette digestion faite, vint le moment, dans les années récentes, d'un nouvel effort, ce fut dans la canalisation du Saint-Laurent, de nouveau en faveur de l'Ontario et de l'Ouest, que les nouvelles ressources financières considérables d'aménagement fondamental furent engagées.
Cette politique économique consciente ou inconsciente, commandée ou non par des exigences purement anti-américaines ou aussi bien anti-québécoises à cause des Canadiens français, peu [604] importe, n'en a pas moins eu la conséquence de faire du Québec un lieu de passage pour le développement de l'Ontario et de l'Ouest plutôt qu'une région sur laquelle se serait centré le développement, parce que la moins éloignée des voies de communications les plus économiques, notamment le Saint-Laurent. En ce sens, le Québec dans la Confédération s'est trouvé condamné à rester une région sous-développée par rapport à sa position, à ses ressources, donc à ce qu'on appelle en économie sa "vocation naturelle", contrecarrée par des interventions humaines volontaires et économiquement irrationnelles, en l'occurrence la politique fédérale. Dans de telles conditions qui ont créé un état de choses où le système des relations établies et des économies d'échelle favorise maintenant l'Ontario, il est assez clair que la "séparation" apparaît, le plus objectivement du monde, comme le moyen de permettre au Québec de devenir à coup sûr une région capable de centrer son développement sur elle-même et de procéder à la mise en valeur systématique de ses virtualités propres.
Cela ne veut cependant pas dire que la "séparation" est en tout et absolument, donc nécessairement, la meilleure formule. C'est alors qu'apparaît, mais seulement alors, l'avantage possible de la participation à un type de marché commun plutôt qu'à l'individualisme souverainiste. Mais cet avantage n'a de sens ici qu'à partir d'une acceptation des réalités de base par tous les partenaires du marché, à savoir que les conditions initiales et le fonctionnement de ce marché commun doivent être tels que les unités participantes, ici spécifiquement le Québec, y gardent toute la mesure de contrôle, de possibilité de planification de leur politique qui correspondent avec les exigences de leur situation, dont les objectifs nationalistes légitimes d'un peuple qui veut vivre sa culture propre.
C'est dire que dans la situation où se trouve le Québec, telle que nous venons de l'apercevoir, aucune participation à la Confédération canadienne ne peut lui être favorable dans l'esprit de tension, de lutte, d'opposition, de contestation de ses droits, qui prévaut depuis toujours au niveau du gouvernement central et [605] de la mentalité anglo-canadienne. Cette structure n'est viable pour le Québec qu'à partir de la reconnaissance totale et activement sympathique de ses droits, dans un souci de complète collaboration pour une politique canadienne, particulière au Québec au besoin, qui lui permette de poursuivre son développement économique selon les exigences de ses objectifs nationaux.
C'est dire que si, incontestablement et plus que jamais, "la question nationale au Québec est d'abord une question économique" par le fond et l'essentiel dans la présente conjoncture historique, et cela en ce sens que nous avons atteint le point où ce sont les structures économiques qui menacent avant tout la culture par leur influence assimilatrice, il n'en reste pas moins que dans l'ordre chronologique des réalisations "le politique d'abord" garde toute sa valeur et son actualité. Et en ce sens, dans notre situation, c'est la lutte constitutionnelle qui constitue l'avant-poste, la première ligne de front, la ligne d'importance actuelle vitale pour la sauvegarde de tout le reste, dans notre combat pour la vie et la liberté nationales. Il en est ainsi parce que la position du Québec est telle que son développement économique et sa prospérité exigent une politique de direction ou de planification consciente qui est impossible si une autorité politique quelconque sur le territoire ne dispose pas des pouvoirs nécessaires pour la rendre efficace. Il est à noter que cela, le quatrième phare de l'éveil de notre conscience économique à toutes les dimensions de notre problème, Esdras Minville, l'avait fortement établi et précisé dans une conférence prononcée dès 1927, que l'on trouve dans L'Actualité économique de cette année-là, et dont les conceptions comme les directives n'ont pas encore été épuisées ni vraiment dépassées par ceux qui en ces dernières années ont repris ces idées à la suite du courant de pensée européen d'après-guerre.
En cette remise en place des facteurs en jeu dans les relations entre nationalisme et vie économique, je voudrais insister sur deux révisions, deux rajustements qu'il importerait de réaliser dans notre pensée économique d'hier et d'aujourd'hui concernant, d'une part le capital étranger, et [606] d'autre part les possibilités d'un secteur coopératif de développement économique.
L'on sait que depuis le début du siècle, c'est contre l'invasion du capital étranger, contre son rôle néfaste pour l'avenir de notre culture qu'a porté une bonne partie de l'impact des luttes nationalistes au Québec. Et la façon dont on a laissé, même sollicité ce capital étranger de s'établir au Québec, justifie à peu près entièrement les critiques sévères portées, les dénonciations violentes qu'on a formulées. Bien plus que l'industrialisation elle-même comme l'ont prétendu en forçant la réalité les partisans de la thèse "agriculturaliste", c'est à une certaine forme d'industrialisation, d'urbanisation, de prolétarisation qu'on s'est attaqué. Même si des exagérations de langage permettent de découvrir des bouts de textes qui justifient en apparence cette thèse "agriculturiste", la lecture attentive ou simplement complète des divers textes de la plupart des auteurs incriminés montre vite une pensée beaucoup plus profonde et plus juste, qui a su voir les réels dangers dont était menacé notre avenir national dans ce tourbillon de "progrès" dominé par la mainmise totale du capital américain sur nos ressources physiques et sur nos disponibilités humaines. Encore plus que contre l'industrialisation, cette lutte avait été dirigée contre l'invasion de notre culture par l’American way of life, et de la façon la plus déplorable du déracinement et de la dévalorisation sociale.
Toutefois, dans ces exagérations commandées par l'urgence et la gravité de la situation, il y a eu aussi tendance à la montée d'une opposition au capital étranger en soi, à la volonté de l'effort de développement par soi-même quasi exclusivement. Il est à noter que dans les conditions d'impuissance politique partielle où nous étions réduits, à la fois par les limites aux pouvoirs provinciaux et par les luttes centralisatrices fédérales, c'était là l'expression d'une sagesse profonde devant l'impossibilité où nous nous trouvions de mettre vraiment cet outil à notre service. Disons que la violence des dénonciations a simplement fait oublier que dans notre situation particulière, ce capital étranger accapareur fut quand même notre puissant allié dans [607] notre victoire démographique. On peut dire que dans l'état actuel des choses, ce rôle du capital américain chez nous n'est pas terminé et que nous pourrions fort bien avoir encore besoin de lui (à titre de contribution neutre et non sectaire) pour pallier aux réactions vengeresses des Anglo-Canadiens devant notre affirmation, et qui pourront amorcer la fuite des capitaux du Québec, même contre leurs propres intérêts, à cause de leur profond sectarisme anti-français.
À tout événement, en prenant le problème de plus haut, on ne saurait sous-estimer la nécessité, pour une jeune et petite nation, surtout très évoluée en termes de civilisation comme la nôtre, et dans un monde où les progrès économiques sont si rapides, de pouvoir compter sur l'apport du capital étranger, du capital des nations déjà arrivées, pour son développement à un rythme satisfaisant. Mais cette nécessité même commande pour cette nation, un statut politique suffisamment complet pour pouvoir négocier librement et sans les oppositions ou les contradictions d'un pouvoir supérieur, les conditions d'admission des capitaux étrangers sur le territoire national. Autrement on en est réduit au dilemme que nous avons connu de devoir sacrifier les intérêts majeurs et plus profonds aux exigences d'urgence créées par les situations superficielles mais non moins vitales. Dans un cadre politique approprié qui reste à créer au Canada pour le Québec, la question du capital étranger pourra et devra être abordée d'une façon à la fois plus sereine et plus ferme. Une fois le pouvoir politique bien établi, le contrôle de l'économie par les autorités nationales n'exige plus son élimination ni même sa réduction à un rôle secondaire.
Le second point, celui d'un intérêt plus vivace, plus actif pour un secteur de développement coopératif, relève du fait qu'une nation est avant tout une communauté vivante, qui n'est pas par elle-même dépourvue de moyens d'action efficace sur le plan économique avant même d'avoir un État ; cet État n'est finalement que l'expression d'une vie communautaire déjà existante et suffisamment forte pour le créer contre les oppositions des forces contraires environnantes. Et il y en a toujours. Même [608] sur le plan économique, il n'est donc pas absolument vrai qu'il faut d'abord et sans autre possibilité le concours actif de l'État pour réaliser l'indépendance économique nationale. Le moyen dont dispose la communauté pour y arriver par sa seule vie propre et sans le concours de l'État, sauf sa neutralité ou un degré suffisant de non hostilité à son égard, c'est l'action coopérative dans tous les secteurs de la vie économique, et tout particulièrement dans le secteur de la consommation dont les intégrations peuvent finir progressivement par englober toute la vie industrielle. C'est ainsi qu'un pays comme la Finlande a pu faire économiquement la nique à la domination russe et faire du développement coopératif un élément significatif de la reconquête de son indépendance politique. La Chine d'avant l'arrivée au pouvoir de Mao Tsé-Toung était également en passe d'obtenir des succès remarquables par des développements coopératifs contre la longue domination des puissances étrangères sur son territoire politiquement indépendant en apparence.
Chez nous au Québec, ces choses commençaient à être comprises et le progrès des idées et des institutions coopératives était bien en voie vers 1940, lorsque son élan fut enrayé par les exigences de guerre. Au cours de la guerre, les nouvelles théories économiques keynésiennes et planificatrices détournèrent les esprits de telles solutions qui ne sortaient pas des "modèles" que proposait la théorie et qui reposaient sur des forces trop obscures pour être facilement manipulables par des technocrates désireux de pouvoir et d'action "scientifique". Pourtant les faits, des faits mondiaux qu'on se pique presque d'ignorer, sont là qui prouvent l'efficacité possible de tels développements. Il serait donc souhaitable que sans nier aux technocrates leur place dans la construction d'une politique économique nécessaire de l'État, ceux-ci apportent le concours de leur intérêt et leur appui à l'action spontanée et authentique de la communauté dûment éclairée et stimulée par la connaissance de ses possibilités. J'oserais dire que l'une des clefs majeures de l'idée de participation est là, surtout dans la situation propre du Québec.
[609]
Car notre situation reste ambiguë et le demeurera encore forcément assez longtemps ; et cela même si nous arrivions assez vite à l'indépendance politique. L'État de quelque pays que ce soit a beau être souverain, il n'est pas pour autant "indépendant" de toutes les forces politiques et sociales qui s'exercent sur lui ; et cela d'autant plus qu'il est l'État d'une petite nation, alors qu'il subit fortement les pressions extérieures en même temps que les pressions intérieures.
L'État du Québec en particulier n'est pas près de se "libérer" du capital étranger, et d'autant moins qu'il devra presque certainement s'en servir comme d'un allié pour couvrir les difficultés économiques temporaires qui pourront résulter de sa lutte constitutionnelle nécessaire. C'est dire que nous ne pouvons pas nous payer de l'illusion qu'il ne sera pas nécessaire de composer dans une certaine mesure avec nos appuis financiers et de subir l'influence de leurs pressions sur les politiques étatistes de tous ordres. Toutes les politiques d'État que l'on pourrait envisager dans l'abstrait pour régler nos problèmes ne seront pas, de ce fait puissant parmi d'autres déjà difficiles, applicables rapidement. La concurrence ou la mainmise des entreprises d'État en particulier, que l'on peut concevoir comme un moyen d'établir progressivement notre indépendance économique, se heurtera à des résistances de tous ordres qui les condamnent d'avance, comme éléments politiques, à ne pouvoir être qu'un très long cheminement, sinon même un inefficace piétinement.
D'autre part, il faut bien se rendre compte que la reconquête de l'économie par le développement d'un secteur capitaliste canadien-français ne présente pas non plus de très brillantes perspectives lorsqu'il s'agit d'arriver par là à un pouvoir, à une influence réelle. Les conditions mêmes dans lesquelles nos entrepreneurs doivent assumer cette concurrence reportent forcément à très loin le moment où ils pourront vraiment représenter une force, si jamais... Sans compter qu'en raison des idées nouvelles qui circulent dans notre société, comme d'ailleurs un peu partout dans le monde, une telle action ne rencontre pas tellement la faveur des hommes politiques à tendance intellectuelle, [610] non plus que des technocrates qui occupent les avenues du pouvoir et y conditionnent les décisions. Le coopératisme se présente alors comme la formule intermédiaire d'initiative privée à saveur suffisamment sociale pour être acceptable à tous autant qu'incontestable au nom de la concurrence, en même temps qu'échappant aux pressions du grand capitalisme qui ne peut la récuser, ni vraiment enrayer ses progrès, parce que ces progrès reposent sur une volonté sociale et sur des motivations relativement imperméables à la concurrence capitaliste, sauf au seul niveau d'ailleurs très sain de l'efficacité des services.
Il y a donc incontestablement telle chose que des relations très étroites entre nationalisme et vie économique. J'ai essayé, dans cet exposé, d'en faire ressortir à la fois les données théoriques et les applications concrètes à notre cas. C'est pourquoi d'ailleurs tous les adeptes ou les adorateurs des ou de leurs théories économiques générales sont assez souvent des adversaires parfois féroces des nationalistes. Ils dérangent terriblement les théories générales, car ils exigent des spécifications, des particularisations aux exigences politiques, culturelles et au milieu, qui ne sont guère satisfaisantes pour l'esprit forcément simplificateur du théoricien. Mais en définitive la théorie n'a de sens et n'est véritable théorie que si elle explique la vie telle qu'elle est. Et la vie, semble-t-il, ne s'accommodera pas facilement de considérer l'efficacité et la satisfaction économique comme les seuls critères de bonheur humain. Tant qu'il en sera ainsi, les nationalismes auront la vie dure ; car pour aussi longtemps, les hommes ne voudront pas vivre seulement de "pain" mais aussi et avant tout de "la parole de Dieu", telle qu'ils la comprendront, c'est-à-dire d'idéaux culturels qui n'ont pas fini d'être divers. De même, ceux qui veulent vraiment respecter la liberté devront apprendre à en parler non seulement en termes de libertés individuelles de parole, de conscience, etc., mais aussi de libertés collectives parmi lesquelles il faudra compter la liberté des collectivités de construire leur régime économique selon les besoins de leur culture exprimée dans des cadres nationaux qui en garantissent l'existence et la vie.
François-Albert Angers
[611]
“Nationalisme et vie économique.
COMMENTAIRE
Alfred Dubuc
In Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 22, no 4, mars 1969, pp. 611-615. Institut d'histoire de l'Amérique française.

Mes hésitations furent nombreuses devant la nature des commentaires que je pouvais me permettre. Il m'était loisible, d'une part, de me confiner aux strictes exigences du formalisme académique, m'arrêtant au mot à mot du texte, interrogeant rigoureusement son exposé pour savoir si M. Angers avait bien rendu toute la pensée des auteurs qu'il cite. Cela eut constitué une élégante dérobade et eut apparu, dans ce colloque, pédant et ennuyeux.
J'aurais pu, à l'opposé, prendre la contrepartie des positions politiques de M. Angers et, me définissant, soit comme fédéraliste soit comme séparatiste de gauche — j'avais le choix — lui chercher querelle. Mais j'écartai cette solution, peut-être par simple stratégie, considérant que M. Angers est plus dur batailleur que moi. La crainte, dit-on, est le commencement de la sagesse.
Cette sagesse, pour moi, consistera à poser simplement la question de savoir si la société québécoise a correspondu, historiquement, dans toutes ses dimensions, à la définition qu'en donne M. le Professeur Angers et qui était celle des auteurs dont il a traité. Car la réalité québécoise que j'étudie, moi, à titre d'historien et d'économiste, ne correspond pas en tous points à celle qui ressort de sa définition. Je proposerai l'hypothèse qu'il y a plus qu'une seule réalité québécoise.
Je n'affirme pas que la définition de M. Angers ne correspond pas à la réalité québécoise. Elle correspond, je crois, à sa réalité, à lui. Sa définition est issue d'un ensemble de doctrines et d'idéologies, proposé à notre société, à travers le temps, par la succession des auteurs que M. le professeur Angers propose à notre réflexion et dans le sillage desquels il se situe lui-même. Je me permettrai de contester un seul point de sa communication : celle suivant laquelle il y aurait un tel monolithisme de la société québécoise qu'un seul problème puisse, à un moment donné de son histoire politique, recevoir l'unanimité des définitions et inspirer une concentration globale de toutes les énergies. Il me permettra de le contester, sans devoir penser pour autant, que je prétende l'avoir convaincu.
J'exprimerai, de plus, la proposition, que la société québécoise a atteint un tel degré de richesse culturelle que toute définition de cette société ayant pour but d'inspirer un projet politique ne peut être que partielle, tant sont nombreux et diversifiés les groupes qui la composent, les intérêts et les conflits qui opposent ceux-ci et tant sont devenus grands le pouvoir de discussion et l'efficacité de l'action de ces groupes dans leurs affrontements.
Dans le domaine du projet économique, celui où se situe notre discussion, les choix qui s'offrent à la société québécoise sont, en effet, nombreux et diversifiés. Non pas, je le répète, que ces choix s'offrent tous ensemble, simultanément, les uns substituts des autres ou complémentaires les uns des autres. Mais parce que les groupes qui structurent notre société sont plus nombreux et que leurs intérêts sont diversifiés, voire même opposés.
[612]
Je me permettrai de ne pas regarder les projets économiques des divers groupes tenant du fédéralisme. Non pas qu'ils n'attirent pas notre attention et ne méritent pas notre intérêt, loin de là. Mais je voudrais, en m'attachant à démontrer qu'il y a plus d'un projet dit "nationaliste", rendre plus probante ma démonstration du pluralisme de la société québécoise.
Je retiendrai de la communication de M. Angers quatre problèmes principaux :
- 1° La politique de développement
- 2° La politique industrielle
- 3° La politique démographique
- 4° Le système économique
1° La politique de développement
Pour M. François-Albert Angers, "toute question nationale est tout
d'abord une question d'attachement à une culture donnée qui comporte presque toujours des sacrifices en termes de pure économie".
À ses yeux, les valeurs du nationalisme sont telles qu'elles compenseraient pour un abaissement du niveau de vie. Pourtant, cette affirmation pourrait constituer, aux yeux de certains, un aveu flagrant de l'incapacité pour le Québec d'assurer son développement économique au rythme des nations industrielles.
Pour certains groupes, en effet, l'hypothèse de la séparation du Québec — puisque c'est bien de celle-ci qu'il s'agit — ne pourrait être soutenue que moyennant la certitude que le développement économique en serait favorisé ou, du moins, n'en serait pas entravé. Une fois acquise cette assurance — et seulement alors — le problème économique fondamental de la séparation deviendrait quasi exclusivement celui du coût de l'opération. Ce coût pourrait être important ou minime, suivant les circonstances qui accompagneraient, dans le Québec et hors du Québec, l'acte même de séparation. Serait-il très bas, que se poserait encore le problème de savoir qui paierait ce coût, comment s'en répartirait le fardeau suivant les classes sociales. Les groupes qui raisonnent de la sorte considèrent que les classes ouvrière et paysanne ont payé plus souvent qu'à leur tour, à travers l'histoire, le coût des bouleversements politiques. Ainsi ces groupes peuvent expliquer certains aspects du phénomène que M. Angers appelle "la dénationalisation de la classe ouvrière'. Et ils savent que, étant donnée la structure de répartition des revenus, le coût supplémentaire que devrait payer le Québec, au dire même de M. Angers, pour la défense de ses valeurs nationales, risquerait de n'être pas réparti de la façon la plus équitable.
2° La politique industrielle
M. le professeur Angers préconise, dans sa communication, une politique de protection tarifaire, semblable à celle des nations qui se sont industrialisées depuis le XVIIIe siècle et qui serait de nature à favoriser le développement d'une industrie manufacturière.
[613]
Ce projet est loin de faire l'unanimité au Québec. Certains, en effet, constatant la faible efficacité de cette politique dans l'histoire économique du Canada et prenant acte des développements considérables de la technologie industrielle moderne, répugnent à préconiser une politique qui risquerait d'avoir pour effet de maintenir élevés les coûts de production et d'abaisser les standards de productivité, c'est-à-dire de hausser les prix et le coût de la vie et d'abaisser les revenus. Il serait pour eux plus avantageux de considérer dans toutes ses dimensions le marché à l'intérieur duquel évolue le Québec et sur lequel s'échangent les facteurs de production et les produits. A leurs yeux, il serait préférable pour le Québec de spécialiser certaines de ses productions et d'échanger dans le cadre d'un marché nord-américain, voire même, selon certains, nord-atlantique. Les recours au tarif ne pourraient constituer que des solutions temporaires et partielles, là seulement où il pourrait être démontré qu'une hausse temporaire des coûts serait plus que compensée par une hausse plus que proportionnelle de l'emploi, des revenus et de l'épargne, mais ne pourraient jamais faire l'objet d'une politique générale de développement industriel. Selon eux, l'hypothèse d'un Québec autarcique donnerait beau jeu aux critiques des groupes préconisant le fédéralisme. Elle ne répondrait pas à la norme d'un taux acceptable de développement.
3° La politique démographique
À l'instar des auteurs qu'il cite, M. Angers fait appel à une politique démographique nationale, susceptible de sauver notre population française de l'envahissement anglo-saxon. Il souligne : "les exigences démographiques d'un nationalisme canadien-français".
Certains groupes, à l'opposé, examinant le chômage et la pauvreté relative de la population québécoise, remettent en cause cette politique. Ils préfèrent analyser l'optimum de population en fonction des possibilités d'investissement, du niveau de l'emploi, du niveau des revenus et du volume de la consommation des biens et des services.
Les groupes voient d'ailleurs un rapport entre la forte natalité de la population québécoise et le développement privilégié de certains secteurs industriels utilisant relativement beaucoup de travailleurs, comme les textiles et l'industrie légère, mais ne leur versant que des salaires très bas.
Ils reconnaissent d'ailleurs, que ce taux élevé de natalité fut favorisé par la collusion des objectifs nationalistes de la multiplication des Québécois et des objectifs religieux de la multiplication des élus. Mais il leur apparaît que la chute récente de ce taux de natalité de 29.7 en 1957 à 17.3 en 1967 rend aujourd'hui futile tout appel à des objectifs nationalistes de politique démographique. Les revirements doctrinaux de l'Eglise catholique ne leur semblent pas devoir provoquer des effets considérables.
4° Le système économique
M. Angers se situe dans un cadre de pensée globalement respectueux des structures fondamentales du système capitaliste. Il reconnaît, cependant, [614] qu'il faille apporter des réserves, des adoucissements au jeu des mécanismes du marché. Mais les seuls critères de redressement qu'il propose sont inspirés, non pas des normes de la plus grande efficacité économique, mais de préoccupations n'ayant pour effet que de restreindre le marché de certains facteurs et de certains produits aux dimensions du Québec.
Il n'y a, au Québec, sur ce problème, aucune unanimité. Certains préconisent le respect intégral des mécanismes de l'allocation individuelle des ressources. On en retrouve parmi les fédéralistes et parmi les nationalistes, si on peut me permettre cette distinction injuste. Mais on retrouve aussi des groupes nationalistes mettant en question les structures du système capitaliste et dont la pensée n'est pas la même que celle de M. Angers.
Car il existe des milieux qui, au nom de la plus grande rationalité du développement économique et de la plus grande efficacité de la promotion sociale et culturelle, proposent une critique fondamentale du système. Les contradictions du système, le gaspillage des ressources, l'aliénation des travailleurs et des consommateurs, l'incapacité du calcul des coûts sociaux du développement : telles seraient les faiblesses fondamentales qui permettraient d'inspirer la recherche d'institutions économiques plus cohérentes.
Dans ces milieux, on considère irrecevable une critique qui s'attache uniquement à inspirer une politique cherchant à restreindre les dimensions du marché, à augmenter les coûts de production, à abaisser la productivité et à freiner la hausse des revenus.
*
* *
Voilà quatre problèmes principaux, tirés de la communication de M. le professeur Angers, sur lesquels j'ai voulu attirer votre attention. Vous avez compris que je n'ai pas la prétention d'avoir épuisé, en soulevant ces questions de politique économique, toute la richesse de son texte. Mais je ne crois pas avoir tronqué sa pensée en faisant ressortir ainsi quatre éléments-vedettes.
Je crois avoir démontré clairement que, au niveau des politiques économiques susceptibles d'inspirer son nationalisme, la société québécoise ne présente pas une homogénéité suffisante pour assurer l'acceptation générale des critères proposés pour définir la question nationale. La réalité québécoise est multiple, les groupes sociaux sont diversifiés, les intérêts sont opposés, les politiques irréconciliables.
Mon projet était de démontrer que, sur quatre plans fondamentaux de la pensée économique du Québec, il est impossible de trouver une unanimité quelconque, malgré le prestige des personnages historiques qui ont contribué à façonner un aspect de cette pensée.
Au fait, la conception d'Edouard Montpetit d'une solidarité économique devant inspirer une coalition de toutes les forces de la collectivité ne trouve pas de fondement dans la réalité sociale et culturelle de son époque. À la vérité, ce problème prend la dimension de toute la profondeur du temps historique de l'évolution de la société québécoise. Des recherches récentes [615] sur le Québec de la fin du XVIIIe et du XIXe siècles permettent de mettre en doute l'existence de cette homogénéité, de ce monolithisme idéologique.
M. Angers déplore le fait que "... nous n'avons pas su, face aux problèmes que nous devions affronter..., être à la hauteur des visions de ceux qui étaient nos prophètes". S'il est vrai, comme je le crois, que la réalité québécoise fut multiple et différenciée, déjà, aux XIXe siècle, préparant ce qu'elle est au XXe, alors, ce qu'il faut déplorer, c'est que les leaders de certains groupes de notre société, se montrant incapables de définir l'ensemble des problèmes de notre communauté nationale, ne furent pas à la hauteur des problèmes qu'ils affrontaient.
Les visions du monde sont, dans la société québécoise, nombreuses, riches, diversifiées. M. Angers en a proposé une, j'ai suggéré qu'il pouvait y en avoir d'autres. Ces idéologies, ces mondes s'affrontent et, par interrelations dialectiques, plutôt que par complémentarité, se compénètrent, se complètent. Toute définition de la société québécoise qui prétend inspirer un projet politique ne peut être que partielle, fût-elle axée sur la réalité économique.
J'ai voulu, par mon commentaire, préciser que la définition de M. Angers participe de cette difficulté et, sans arrogance, suggérer que d'autres définitions existent de la société québécoise, peut-être tout aussi partielles, mais non moins acceptables.
Je crois ne pas avoir dérogé à l'obligation de respect qui m'était imposé pour ce que représente, pour notre communauté nationale, M. le professeur François-Albert Angers.
Alfred Dubuc
|

