|
Georges BALANDIER
“Réflexions sur le fait politique :
le cas des sociétés africaines”.
Un article publié dans les Cahiers internationaux de sociologie, vol. 37, juillet-décembre 1964, pp. 23-50. Paris : Les Presses universitaires de France.
- Le choix du fait politique
- L'élucidation du fait politique traditionnel.
- Les critères et les définitions.
- Les aspects du fait politique.
- Les aspects et les attributs du pouvoir.
- La terminologie politique.
- Le vocabulaire politique indigène.
- La théorie indigène et la pratique politique.
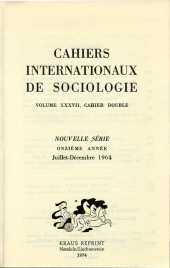
Le choix du fait politique [1].

Les sociétés établies en Afrique, au sud du Sahara, proposent dans leur état actuel, et à travers leur histoire, une extrême variété de formes politiques. Elles ont conduit des expériences fort diversifiées en matière de gouvernement des hommes ; elles continuent à le faire en donnant à l'oeuvre de construction nationale des orientations variées. Elles constituent le plus extraordinaire laboratoire dont puissent rêver les chercheurs attachés à l'élucidation du phénomène politique. En un même temps - sinon en un même lieu - il est possible de considérer une série de cas, qui s'ouvre avec les sociétés présentant une sorte de minimum sociologique : les campements pygmées et négrilles, qui se ferme avec les États traditionnels et les États modernes résultant de la décolonisation.
Cette richesse autrefois soupçonnée est maintenant reconnue, bien que l'inventaire des systèmes politiques traditionnels soit loin d'être terminé. En fait, grâce aux recherches entreprises au cours des vingt dernières années, plus d'une centaine de « cas »sont décrits et peuvent être soumis à un traitement scientifique. Une région a cependant bénéficié d'une sorte de privilège : celle qui correspond au haut Nil et aux grands lacs de l'Afrique orientale. Si les sociétés à autorité centralisée y dominent, la variété des systèmes politiques y reste cependant apparente. On y trouve toute une gamme de sociétés à gouvernement diffus - dont les Nuer, étudiés par E. Evans-Pritchard, créateurs d'une « anarchie ordonnée » ; on y trouve aussi des sociétés à chefferies et, surtout, des États traditionnels ayant élaboré des solutions différentes en fait de centralisation du pouvoir. Dans un petit ouvrage récemment publié, Primitive Government, Lucy Mair expose ces divers systèmes en même temps qu'elle apporte les éléments d'une anthropologie politique [2].
Les sociétés d'Afrique occidentale - mises à part quelques exceptions, dont les Ashanti et les Haoussa - n'ont pas été l'objet d'études aussi méthodiques, en ce qui concerne leurs anciennes organisations politiques. Par contre, leurs expériences politiques modernes, en raison de J'avance acquise en matière d'indépendance et de construction de la nation, sont de plus en plus envisagées sous l'aspect de la connaissance scientifique. Qu'il s'agisse de caractériser les régimes et les institutions, les partis politiques et les idéologies, ou qu'il s'agisse de reconnaître les adaptations et « traductions » que le contexte africain leur a imposées.
Ces remarques initiales suggèrent une première difficulté contrariant l'étude des phénomènes politiques africains. Non seulement la documentation utilisable est inégalement riche, et différemment orientée selon les régions, mais l'histoire africaine au cours des siècles et des années passées a imposé aux agencements politiques une structure, ainsi qu'une organisation très hétérogènes. Ces agencements sont constitués d'éléments se référant à des périodes différentes : les périodes précoloniale, coloniale et postcoloniale. Les expressions politiques modernes coexistent avec des manifestations et des structures anciennes, elles-mêmes transformées par suite des bouleversements résultant de la colonisation. Cette triple complexité ne peut être méconnue sans risques scientifiques, bien qu'il ne soit pas facile de la maîtriser.
Une telle constatation conduit à poser le problème des rapports entre régimes politiques traditionnels et organisations politiques modernes, à penser que la séparation n'est pas nette entre les uns et les autres. La discontinuité est moins accentuée qu'on pourrait l'estimer en s'en tenant aux seules apparences. Mais on ne saurait se satisfaire d'une simple affirmation. Dans son ouvrage consacré au royaume Ganda [3], David Apter met en garde contre les significations implicites du terme : traditionnel. Il note que ce qualificatif en est venu à évoquer « un système culturel fixé, emprisonné dans le passé ». Il s'efforce, à l'encontre de cette interprétation vicieuse, de mettre en évidence « les aspects dynamiques du traditionalisme », de repérer, au cours de l'histoire, les changements ayant affecté l'ordre dit traditionnel. Dans le cas particulier des Ba-Ganda, D. Apter montre que le dynamisme de leur système politique ancien résulte de la tension existant entre deux modalités de l'autorité et deux séries de valeurs. D'un côté, les clans et leur conception du pouvoir ; de l'autre côté, la hiérarchie politique organisée à partir du souverain - le kabaka ; le débat se poursuit encore, sous-jacent aux aménagements modernistes effectués durant les dernières années.
Le système politique traditionnel apparaît ainsi comme affecté par les tensions et les conflits, comme toujours agissant malgré les vicissitudes subies. Il oriente, pour une part et partout, la vie politique moderne. Ses incidences peuvent aussi être saisies à un autre niveau. Les responsables des nouvelles nations africaines n'ont pu imposer, par contrainte et d'un coup, une philosophie et des organisations politiques totalement étrangères ; en quelque sorte importées. Ils ont dû effectuer un travail d'adaptation et de « traduction » en recourant à l'équipement politique traditionnel. Le parti politique obéit à cette exigence, au point de n'exprimer parfois que des rapports de force entre groupes ethniques - ainsi que le manifeste d'une façon presque caricaturale le Congo-Léopoldville. Le personnage du leader se modèle souvent sur les types d'autorité que recelait l'ordre ancien : celui du souverain qui ordonne en accord avec les dieux et les ancêtres, celui du prophète ou du messie qui annonce et provoque les temps nouveaux. Enfin, lorsqu'il s'agit de vulgariser l'idéologie, de diffuser les symboles à signification politique, d'organiser le rituel de la « religion politique », la référence à certains modèles traditionnels opère également. Et cela, même dans les pays où les gouvernements ont provoqué l'élimination ou l'abaissement des chefs de vieux style.
Ces indications sommaires visent à suggérer le jeu des relations entre traditionalisme et modernisme. On ne peut tracer une frontière, séparer l'anthropologie politique (qui semble plus tournée vers le passé) de la sociologie politique (qui paraît plus orientée vers les expressions actuelles de la vie politique). Toutes deux abordent, par des accès différents, les mêmes phénomènes, si complexes que l'intervention conjuguée des deux disciplines reste nécessaire.
En considérant le fait politique en Afrique noire, il ne s'agit point de céder à une mode - bien que l'actualité y incite. Il convient de se soumettre à une nécessité scientifique. L'effacement de la domination coloniale a « dégelé » la vie politique africaine. À l'échelle du continent, ou presque, de multiples expériences sont en cours : la tâche des sciences sociales n'est pas de les abandonner aux historiens de l'avenir, mais de les étudier dès maintenant. D'autre part, le niveau des phénomènes politiques apparaît comme l'un des plus propices à l'étude. Il permet d'accéder à de larges ensembles de faits et de relations ; il synthétise dans la mesure où tout système politique exprime la société et la civilisation qu'il ordonne et défend contre les assauts de divers ordres ; il met en présence d'ensembles réels plus que d'ensembles logiquement constitués. Par ailleurs, le secteur politique est un de ceux qui portent le plus les marques de l'histoire, un de ceux où se saisissent le mieux les incompatibilités, les contradictions et tensions inhérentes à toute société. En ce sens, un tel niveau de la réalité sociale a une importance stratégique pour une sociologie et une anthropologie qui se voudraient ouvertes à l'histoire, respectueuses du dynamisme des structures et tendues vers la saisie des phénomènes sociaux totaux.
L'élucidation du fait politique traditionnel.

Dans le cas des sociétés dites traditionnelles, la mise en évidence du fait politique n'est pas toujours facile, cependant que le choix des critères le caractérisant et des concepts le définissant pose des problèmes de méthode. Avant d'envisager ces questions, il importe de recenser les difficultés qui furent reconnues dès l'instant où les anthropologues ont étudié, en Afrique, les régimes politiques traditionnels.
1° En première place, les difficultés qui tiennent au vocabulaire. Celui-ci manque de rigueur et révèle, d'un auteur à l'autre, des différences d'interprétation qui sont plus que des nuances. Des concepts, tels que : structures et relations politiques, systèmes et organisations politiques, pouvoir et autorité, communauté politique, état et gouvernement, etc., sont régis par des définitions très diverses. Ils se réfèrent à des théories explicites et implicites du fait politique qu'il importe de tirer au clair. Une étude systématique du vocabulaire, et des critères utilisés pour caractériser les phénomènes politiques, s'impose dès le début de toute réflexion de portée générale.
2° Le problème initial - mises à part les questions de caractère conceptuel - est celui du repérage et de la délimitation du fait politique dans les sociétés africaines. Il n'est pas simple par nature : dans la mesure même où les phénomènes politiques expriment et synthétisent des relations très diverses. Il est encore compliqué lorsqu'il s'agit des sociétés traditionnelles et des formes dites « primitives » du gouvernement.
Dans les sociétés où la vie politique n'est pas nettement différenciée, il subsiste un rapport étroit entre les relations fondées sur la parenté et la descendance et celles qui sont d'ordre politique. D'une manière très grossière, on pourrait dire que les mêmes groupes et les mêmes partenaires se présentent sous des aspects différents (ceux de la parenté et de la descendance, ceux de l'activité économique, ceux de l'action rituelle, ceux de l'expression politique) selon les situations. Comme dans une pièce à un seul acteur. Il faut d'ailleurs préciser que les relations de parenté et de descendance ne perdent pas leurs significations et fonctions politiques dès l'instant où le gouvernement se différencie, où l'État commence à s'organiser. Dans leur étude de deux formations étatiques voisines - en Ouganda - celles des Soga et des Ba-Ganda -Lloyd Fallers et David Apter ont bien manifesté l'incompatibilité partielle subsistant entre la structure des clans et lignages et la structure étatique [4]. Toutes deux assument des fonctions politiques, et le problème des « frontières » du domaine politique reste en partie posé.
Ce problème des limites existe également par rapport aux éléments de la culture qui concernent directement ou indirectement la vie politique. Le mythe comporte une part d'idéologie ; il est, selon la formule de B. Malinowski, une « charte sociale » exprimant « la forme existante de la société avec son système de distribution du pouvoir, du privilège et de la propriété » ; il a une fonction justificatrice dont savent jouer les gardiens de la tradition et les détenteurs de l'autorité. Il se situe donc dans le champ de l'étude politique. De même que le rite, en certaines de ses manifestations, lorsqu'il s'agit de rituels qui sont exclusivement (cas des cultes et procédures relatifs à la royauté) ou inclusivement (cas du culte des ancêtres) les instruments sacrés du pouvoir. Enfin, le problème de délimitation du fait politique se retrouve au niveau des phénomènes économiques, et des processus assurant la circulation des femmes. Certains privilèges économiques (droit éminent sur les terres, droit sur les marchés, etc.) et certaines contreparties économiques (obligation d'assistance et de générosité) sont associés à l'exercice du pouvoir. Il est aussi des affrontements économiques, de même nature que le potlatch indien, qui mettent en jeu le prestige et le pouvoir des chefs ou des notables ; plusieurs sociétés d'Afrique centrale en fournissent des exemples. En marge de ces observations, on doit rappeler que la détention du pouvoir s'accompagne d'une exceptionnelle capacité d'intervention dans le système des échanges matrimoniaux ; moins pour capitaliser des épouses que pour capitaliser des alliances et des « obligés ».
3° S'il reste difficile de délimiter les phénomènes politiques, le classement des « systèmes » au sein desquels ils s'ordonnent apparaît aussi comme une entreprise malaisée. La typologie risque d'être ou trop simple ou trop complexe ; dans les deux cas, elle paraît d'une utilité limitée. Le classement dichotomique retenu dans l'ouvrage collectif African Political Systems - sociétés à pouvoir diffus ou sans État et sociétés àpouvoir centralisé ou à État - ne représente qu'une commodité trompeuse [5]. En fait, on peut constituer une série de types s'étendant des systèmes politiques à gouvernement « minimal » « bandes » des Bushmen et des Bergdama en Afrique du Sud) jusqu'aux systèmes politiques à État nettement constitué (et dont le royaume Ganda est un excellent exemple). En progressant d'un type vers l'autre, le pouvoir politique se différencie, s'organise de manière plus complexe et se centralise. Il n'est donc pas facile d'établir des distinctions rigoureuses et l'on peut se trouver inutilement incité à multiplier les types et les sous-types. La tâche est d'autant moins simple qu'un même ensemble ethnique - celui des Ibo de la Nigeria méridionale, par exemple - peut présenter des variantes accentuées à partir d'un même modèle de structure politique.
4˚ Les difficultés atteignent leur maximum dès l'instant où l'on doit rechercher des corrélations significatives. Peut-on lier les divers types de systèmes politiques à des caractéristiques ou facteurs historiques (migrations et conquête), ethniques (pluralisme), démographiques et dimensionnelles (densités et taille) et économiques ? C'est là une question qui ne peut recevoir sa réponse qu'à la suite d'une analyse méthodique des cas scientifiquement étudiés.
Les critères et les définitions.

L'interprétation du fait politique, dans le cas des sociétés africaines traditionnelles, a d'abord été conduite à partir des enseignements « communs » de la philosophie politique et des premiers apports théoriques de l'anthropologie sociale concernant les formes « primitives » du gouvernement. Au départ, c'est la conception même du phénomène politique qui est en cause. Elle repose sur la distinction sommaire établie entre les sociétés estimées « primitives », où les rapports de parenté (réels et fictifs) régissent la structure sociale, et les sociétés dites « civilisées », dont les frontières ne sont plus du domaine de la parenté mais du domaine de la géographie. La localisation en un territoire donné prévaut ici sur la situation au sein d'un système de parenté et de descendance. Il n'est plus utile de retracer l'histoire - souvent faite - de cette théorie qui conduit pratiquement à exclure du domaine politique tout un ensemble de sociétés. Elle a son origine dans les travaux de Sir Henry Maine (Ancient Law) et de L. Morgan (Ancient Society), qui oppose l'état de société (societas) fondé sur la tribu et ses divisions, à l'état de société politique (civitas) instauré sur la base du territoire et de la propriété. Une telle manière de voir a longtemps régi la pensée théorique des sociologues, même modernes : en 1947, R. Mac Iver situe encore le « gouvernement tribal » face à « toutes les autres formes politiques » [6] ; et la pensée de certains géographes : E.-F. Gautier, dans son étude des cadres géographiques de l'Afrique occidentale, met en opposition le « patriotisme biologique » et le « patriotisme géographique » [7]
Les travaux récents des anthropologues ont révélé la fausseté d'une telle dichotomie. La parenté et la descendance ne constituent pas - même dans les sociétés à gouvernement « minimal » - la seule base de la solidarité. Le facteur territorial agit, comme l'a montré I. Schapera, même dans le cas des groupes ethniques simplement organisés par « bandes » : ainsi chez les Bushmen et les Bergdama de l'Afrique du Sud [8]. En fait, les erreurs initiales de l'anthropologie politique s'expliquent par une démarche qui fut d'abord orientée vers l'examen des institutions et organisations politiques - R. Lowie, dans son Traité de Sociologie primitive, définit insolitement le domaine politique par « l'ensemble des fonctions législatives, exécutives et judiciaires » - plus que vers l'élucidation de la nature du phénomène politique.. Faute d'avoir déterminé ce dernier nettement, il devenait impossible de déceler ses caractéristiques communes sous la diversité des formes d'organisation.
Les aspects du fait politique.

Dans la littérature anthropologique, les définitions du fait politique sont plus implicites qu'explicites ; et les éléments qui servent à le spécifier se trouvent en quelque sorte éparpillés à travers les oeuvres. Peut-on tenter leur regroupement sans constituer un rassemblement hétéroclite ?
1° Les notions de pouvoir et de coercition occupent une position centrale. Quelques références à des ouvrages africanistes récents, ou classiques, le montrent. M.G. Smith (étude du gouvernement en pays haoussa) observe que « le pouvoir caractérise l'action politique » et précise que le pouvoir est « la capacité d'agir effectivement sur les personnes et les choses » (en recourant aussi bien à la suggestion qu'à la coercition) [9]. Lucy Mair (étude générale des formes du gouvernement dit primitif) affirme que l'État commence dès que des « groupes de parenté privilégiés » sont « capables d'imposer leur volonté » aux autres groupes [10]. Radcliffe-Brown, dans sa préface à African Political Systems, définit l'organisation politique par l'exercice d'une autorité coercitive « qui recourt, ou peut recourir, à la force physique ». Ces constatations paraissent bien insuffisantes. Elles laissent de côté la question, plus essentielle, des causes et des attributs du pouvoir.
2° Le pouvoir est au service d'une structure sociale qui ne peut se maintenir par la seule intervention de la « coutume », par une sorte de conformité automatique aux règles. Lucy Mair le souligne : « Il n'existe aucune société où les règles soient automatiquement respectées » [11]. D'autre part, toute société réalise un équilibre approximatif ; elle est donc vulnérable. Le pouvoir a pour fonction de la défendre contre ses propres faiblesses, de la conserver en « état » pourrait-on dire ; et, au besoin, d'aménager les adaptations qui ne sont pas en contradiction avec ses principes fondamentaux. Enfin, dès l'instant où les rapports sociaux débordent les rapports de la parenté, il intervient entre les individus et les groupes une compétition plus ou moins apparente ; chacun visant à orienter les décisions de la collectivité dans le sens de ses intérêts. Et Lucy Mair, présentant des remarques très semblables, les conclut en affirmant : « C'est ceci, la politique » [12]. En fait, l'équilibre des intérêts reste toujours menacé par la compétition -quel que soit le niveau où s'exprime cette dernière. Le pouvoir politique apparaît, à la fois, comme un produit de la compétition et comme un moyen de la contenir. Smith le note, après d'autres, en définissant le système politique comme « un mode de compétition ».
Il convient de résumer de manière schématique ce premier ensemble de constatations. Le pouvoir politique est inhérent à toute société : il assure le respect des règles qui la fondent ; il la défend contre ses propres imperfections ; il limite, en son sein, les effets de la compétition entre les individus et les groupes. C'est d'ailleurs à l'ensemble de ces fonctions que se réfèrent implicitement la plupart des auteurs ; et notamment les responsables de l'ouvrage collectif African Political Systems : l'organisation politique est « cette partie de l'organisation générale qui concerne le maintien ou l'établissement de l'ordre social, à l'intérieur d'un cadre territorial » [13]. La fonction conservatrice du pouvoir est généralement soulignée. Sous une autre forme, on pourrait dire que le pouvoir politique résulte, pour toute société, de la nécessité de lutter contre l'entropie qui la menace de désordre - comme elle menace tout système.
Mais il ne faut pas en conclure que cette défense, contre le désordre potentiel, ne recourt qu'à un seul moyen (la coercition) et ne peut qu'être conférée à un « gouvernement » bien différencié. Tous les mécanismes qui contribuent à maintenir (ou à recréer) la « coopération interne » sont en cause et sont à considérer. Les rituels, les cérémonies assurant une remise à neuf périodique ou occasionnelle de la société sont, autant que les souverains et les chefs, les instruments d'une action politique ainsi entendue.
3° Nous venons d'examiner certaines des causes internes qui révèlent le pouvoir en tant que nécessité à laquelle toute société se trouve soumise. Il est un autre aspect, non moins essentiel, qui est de caractère relationnel. Toute société, directement ou « à distance », se trouve en rapport avec d'autres sociétés qu'elle considère comme étrangères, et souvent comme hostiles ou dangereuses pour sa sécurité et sa souveraineté. Par rapport à cette menace « du dehors », la société est non seulement conduite à organiser sa défense, mais aussi à exalter son unité, sa cohésion et ses traits distinctifs. Le pouvoir, nécessaire pour des raisons d'ordre interne à l'instant évoquées, prend forme et se renforce sous la pression des dangers extérieurs - réels et/ou supposés. Le pouvoir, et les symboles qui lui sont attachés, donnent ainsi à la société les moyens d'affirmer sa cohésion interne et d'exprimer son identité ; les moyens de se situer et de se protéger vis-à-vis de ce qui lui est « étranger ».
De multiples faits justifient cette manière de voir. Il suffit d'en rapporter ici quelques-uns. Le pouvoir a un champ d'application, il se réfère à une unité politique ou « communauté politique » - selon la formule de Schapera dans son étude du gouvernement au sein des sociétés tribales [14]. Or, cette communauté politique se définit surtout par des critères d'ordre externe ; elle a ses frontières (plus ou moins nettes) tracées par rapport à ses voisines ; elle représente « une unité dirigeant ses affaires indépendamment de tout contrôle extérieur » ; elle constitue l'unité la plus vaste au sein de laquelle les conflits peuvent être réglés par arbitrage, par compensation ou par recours à une forme hautement réglementée de la violence : le feud, selon la terminologie des auteurs anglo-saxons. Hors d'elle - au-delà de ses frontières - le conflit devient la guerre : le domaine de la violence libérée commence où ses limites finissent. Le pouvoir, et l'unité politique à laquelle il s'applique, ne prennent toutes leurs significations que si l'on tient compte, à la fois, des nécessités internes et des nécessités externes. Certaines circonstances montrent bien ce double système de rapports, ce double aspect du pouvoir qui est toujours orienté vers le dedans et vers le dehors. Dans nombre de sociétés de type clanique, où le pouvoir reste à l'état diffus, l'ordre des faits politiques se saisit mieux par référence aux relations extérieures que par référence aux relations internes. Ceci est net dans le cas des Nuer du Soudan oriental étudiés par E. Evans-Pritchard. Les différents niveaux d'expression du fait politique se définissent en quelque sorte d'après la nature des rapports externes : opposition contrôlée et arbitrage entre lignages liés par l'ordre généalogique, la parenté ou l'alliance ; opposition et hostilité réglementée (ne visant que le bétail) dans le cadre des rapports entre tribus ; méfiance permanente et guerre (recherchant les captifs, le bétail et les stocks des greniers) vis-à-vis des « étrangers », des non-Nuer. De même, dans son étude des Somali éleveurs, I.M. Lewis a mis en évidence le fait que les relations à « contenu » politique sont caractérisées par opposition [15]. Ce sont les rapports de puissance - supériorité numérique et potentiel militaire - qui régissent d'abord les relations entre lignages et entre clans, qui déterminent l'extension des diverses unités politiques et la hiérarchie de fait ordonnant ces dernières. Le facteur externe est ici le principal déterminant du statut politique.
Un autre trait aide à manifester ce facteur et son importance. Dans la plupart des sociétés où le pouvoir n'est pas centralisé, ce dernier prend des aspects différents, et met souvent en cause des agents différents, selon qu'il s'agit du temps de paix ou du temps de guerre. Dans le premier cas, le pouvoir paraît faible et ses détenteurs sont surtout représentants du groupe et symboles d'unité, arbitres ou conciliateurs. Dans le second cas, le pouvoir se renforce et devient coercitif ; il exprime le potentiel militaire du groupe ; il porte à un maximum la cohésion interne, face au danger extérieur. Ainsi, chez les Fang traditionnels du Gabon et du Cameroun, le notable situé à la tête des lignages devait être une personnalité « forte » tout autant qu'une personnalité conforme aux prééminences généalogiques. Sa « force » étant contenue lorsque les affaires internes se trouvaient en cause, étant libérée lorsqu'il intervenait face aux groupes étrangers ; et dans ces dernières circonstances, des substitutions de personnalités pouvaient s'imposer.
Ce qui vient d'être dit ne s'applique pas aux seules sociétés sans gouvernement différencié. Le pouvoir présente toujours cette double orientation : vers le maintien de l'« ordre »intérieur, d'une part ; vers le renforcement des relations « externes », d'autre part. Cette double orientation peut s'exprimer par une double polarisation du pouvoir. Un exemple (africain, mais il en est d'autres possibles) donnera une forme concrète à cette constatation. Celui de la chefferie en pays bamiléké, au Cameroun. Les deux figures dominantes de la chefferie traditionnelle sont : le chef (fo) et le premier dignitaire (kwipu) qui était essentiellement chef de guerre. Le premier apparaît comme facteur d'unité, gardien de l'ordre établi, conciliateur et intercesseur auprès des ancêtres et des divinités les plus agissantes. Le second est davantage tourné vers l'extérieur, chargé de veiller aux menaces du dehors et d'assurer l'entretien du potentiel militaire. Ces deux pouvoirs sont d'une certaine manière en compétition, jouant l'un vis-à-vis de l'autre un rôle de contrepoids. En bref, un tel exemple montre bien l'interférence des facteurs externes en matière de qualification et d'organisation du pouvoir.
4° Un dernier point. Le pouvoir - si faible soit-il - implique une dissymétrie, inégalement accentuée selon les sociétés, au sein des rapports sociaux. Si ces derniers pouvaient s'instaurer sur la base d'une parfaite réciprocité, l'équilibre social serait automatique et le pouvoir n'aurait aucune raison interne de se manifester. Il n'en est rien, bien sûr, et le pouvoir se renforce dans la mesure où les inégalités s'affirment. L'exemple des sociétés africaines qui ont pu être envisagées comme « égalitaires » révèle, à la fois, la généralité du phénomène et son expression la plus atténuée. Selon le sexe, l'âge, la situation généalogique - voire les qualités personnelles - des prééminences se sont établies. Ainsi, chez les Nuer, où le pouvoir se trouve réduit à son minimum, les dissymétries sont peu marquées mais néanmoins présentes : prééminence de certains clans et de certains individus appartenant aux lignages spécialisés dans la gestion des rituels concernant le bétail. Ailleurs, dans le cas des Fang autrefois présentés comme créateurs d'une « société anarchique », les inégalités deviennent plus apparentes et des mécanismes à action insidieuse ont pu opérer à l'encontre de tous ceux qui outrepassaient les limites de l'inégalité tolérée. Mais c'est dans les sociétés où les hiérarchies sociales sont nettes - évoquant des classes à l'état rudimentaire ou des castes - que se manifeste, en toute clarté, la relation entre le pouvoir et les dissymétries affectant les rapports sociaux. Cette relation est d'ailleurs l'un des éléments permettant d'expliquer l'ambiguïté du pouvoir politique.
Les aspects et les attributs du pouvoir.

Le pouvoir politique vient d'être envisagé en tant que nécessité, par référence à l'ordre interne qu'il maintient et aux relations extérieures qu'il contrôle ; il vient d'être examiné, aussi, en tant que phénomène lié à une caractéristique des structures sociales : leur dissymétrie plus ou moins accentuée, leur potentiel variable d'inégalité. Cet examen ne suffit pas ; il doit être poussé jusqu'à la mise en évidence des aspects et attributs fondamentaux du pouvoir.
1˚ Dans toutes les sociétés, le pouvoir politique n'est jamais complètement désacralisé ; et s'il s'agit des sociétés dites traditionnelles, le rapport au sacré s'impose avec une sorte d'évidence. À tel point qu'un anthropologue et africaniste belge, Luc de Heusch, a pu affirmer dans une formule provoquante : « La science politique relève de l'histoire comparée des religions » [16]. Le sacré est inhérent à tout pouvoir. Par l'intermédiaire de ce dernier, la société est saisie en tant qu'unité, en tant qu'ordre et permanence ; elle est appréhendée sous une forme idéalisée, comme garante de sécurité collective et comme pur reflet de la coutume ou de la loi ; elle est éprouvée sous l'aspect d'une valeur suprême et contraignante ; elle devient ainsi la matérialisation d'une transcendance s'imposant aux individus et aux groupes particuliers. On pourrait reprendre, à propos du pouvoir, l'argumentation utilisée par Émile Durkheim dans son étude des « formes élémentaires de la vie religieuse ». Le rapport du pouvoir à la société n'est pas essentiellement différent du rapport établi, selon lui, entre le « totem » australien et le clan. Et cette relation est évidemment chargée de sacralité.
Si nous considérons les faits africains, les manifestations de ce rapport indestructible entre le pouvoir et le sacré sont nombreuses ; indestructible, car il ne suffit pas de tuer les rois divins pour l'abolir. Dans les sociétés de type clanique, le culte des ancêtres assure en général la sacralisation d'un pouvoir encore mal différencié. Le « chef » de clan ou de lignage est le point de liaison entre le clan (ou lignage) actuel, constitué par les vivants, et le clan (ou lignage) idéalisé, sacralisé, symbolisé par la totalité des ancêtres. Il transmet la parole des ancêtres aux vivants, celle des vivants aux ancêtres. Il se trouve partiellement « en marge », et dans une position de supériorité, par rapport au système social dont il assure la sauvegarde. C'est par cette « distance » que se manifeste sa participation à l'ordre du sacré, et c'est une telle participation qui légitime sa suprématie, ses privilèges et ses obligations. L'imbrication du sacré et du politique est déjà incontestable.
Meyer Fortes, se référant surtout aux Tallensi du Ghana, a montré que le culte des ancêtres se comprend moins par rapport à une métaphysique, et à une éthique, que par rapport à la société qui l'accomplit - c'est-à-dire au système de descendance qui caractérise cette société, aux régimes politico-juridique et économique qui lui sont associés. Mieux, M. Fortes a mis en évidence un aspect hautement révélateur de cette imbrication du politique et du sacré. Seuls les défunts ayant disposé d'un statut particulier, ayant reçu une charge, deviennent des ancêtres qui bénéficient d'un culte et sont investis d'un « pouvoir surnaturel » ; et ils ne sont tels que dans la mesure où ils ont laissé un « dépositaire » (formule de M. Fortes) parmi les vivants - un dépositaire qui a hérité de leurs prérogatives et de leurs biens et qui est le gardien de leur culte. Ainsi se trouve accentuée la solidarité existant entre les défunts éminents (ceux qui ont acquis la qualité d'ancêtres) et les vivants éminents (ceux qui se trouvent détenteurs de charges et de privilèges). Une démonstration, conduite « en finesse », se retrouve dans le livre de Meyer Fortes, publié en 1959 : Oedipus and Job.
L'exemple tallensi n'est pas exceptionnel. Une étude récente de J. Middleton - Lugbara Religion, 1960 - rapporte des faits de même nature à propos des Lugbara établis à cheval sur l'Ouganda et le Congo. Dès les premières pages de son ouvrage, J. Middleton affirme les relations étroites existant entre « le rituel et l'autorité ». Il précise sans ambiguïté :
- « Le culte des morts est intimement lié au maintien de l'autorité dans le lignage... Les hommes âgés tentent de protéger leur autorité contre les revendications d'indépendance de leurs cadets, et le conflit conséquent est conçu très largement en termes mystiques et rituels... J'ai trouvé que c'est ce contexte qui rend intelligible ce qui n'apparaît, à première vue, que comme un comportement rituel contradictoire des Lugbara » [17].
Middleton montre concrètement les relations, à double sens, qui opèrent entre système rituel et structure sociale. D'une part, les rituels justifient la structure sociale existante et contribuent au maintien de cette dernière ; d'autre part, les rituels peuvent servir de moyen aux individus qui veulent acquérir un pouvoir et légitimer leur position. Sous ce dernier aspect, J. Middleton indique : « Un homme qui a la capacité d'invoquer efficacement les ancêtres peut être accepté en tant que véritable « aîné »... » ; c'est-à-dire détenteur de prééminence [18]. En ces circonstances, le sacré devient la source, la justification et la légitimation ultime du pouvoir. Pour en terminer avec cette évocation d'une société clanique, qui a des homologues nombreux, rapportons une formule frappante, forgée par J. Middleton : « Dieu, les morts et les sorciers entrent dans le système d'autorité, autant que les hommes vivants. »
Si l'on envisage, non plus les sociétés de type clanique, mais celles où existe une centralisation du pouvoir, le rapport entre ce dernier et l'ordre du sacré devient beaucoup plus visible. Cette relation s'exprime selon des formes diversifiées : tantôt l'accentuation est de caractère magique, au détriment des aspects proprement religieux ; tantôt les assises religieuses du pouvoir sont les plus apparentes. L. de Heusch a ainsi été incité à opposer les royautés africaines de « polarité magique » aux royautés africaines de « polarité religieuse » [19]. En réalité, le contraste ne se manifeste jamais d'une manière rigoureuse - et exclusive.
L'examen de la « situation » du souverain, au sein des structures politiques, des structures rituelles et de la structure sociale globale, révèle concrètement les phénomènes à l'instant évoqués. Le souverain régnant est l'unique - d'une certaine manière, hors parenté et hors lignage ; il est au-dessus de tous et il règne pour tous. C'est ce que soulignent les Kuba du Congo en reconnaissant que le roi se trouve au sommet de la société, mais à distance, en solitaire absolu. Un symbolisme opérant à différents niveaux évoque cette situation ; des pratiques (de l'ordre du cérémonial et du rituel) contribuent à la maintenir avec une vigueur extrême.
L'univers au sein duquel s'insère le souverain est plus celui du mythe que celui de la société « banale ». Il vit séparé matériellement : les enclos des palais royaux ou des chefferies le montrent - chez les Mossi, les Ba-Kongo anciens, les Bamiléké, etc. II vit au contact des symboles qui sont les attributs de la royauté et les signes d'une légitime détention (tambours ou tabourets sacrés). Il est au centre d'un cérémonial qui manifeste sa position à la fois supérieure et séparée, et en même temps le caractère sacré de sa personne ; ce protocole atteint, par exemple, son plus haut niveau symbolique avec le Mog Naba, souverain des Mossi.
La nature non commune de la personnalité du souverain est souvent révélée par les rituels qui accompagnent la prise du pouvoir. Ainsi, par la relation incestueuse, exprimée symboliquement, entre le souverain et la reine mère ou la reine soeur ; telle que L. de Heusch l'a envisagée dans le cas des états traditionnels d'Afrique orientale [20]. En rompant l'interdit fondamental - la première des règles sociales - le souverain se situe en marge des rapports sociaux dont il doit assurer la sauvegarde. Il se trouve ainsi hors des relations sociales particulières, notamment celles qu'instaurent la parenté et la descendance, dont il s'est exclu d'une manière symbolique. Il devient le fondateur d'une structure sociale nouvelle, le symbole d'un pouvoir élargi au-delà de la parenté et devenu contraignant. Cette interprétation est également proposée par L. de Heusch, dans l'article déjà cité : « Cet acte rituel [l'inceste royal] est manifestement, au niveau de l'État, un acte magique de fondation, l'affirmation d'un ordre nouveau fondé sur la négation (partielle) de l'ordre familial ancien avec lequel il faut composer » [21].
En de nombreuses circonstances, les rites, et les mythes auxquels ces derniers se réfèrent, manifestent le souverain en tant que personnalité exceptionnelle. Dans certains cas, dans les royautés à accentuation religieuse, il est le descendant et le mandataire des dieux ; ainsi, pour les Yorouba de la ville d'Oyo (Nigeria), la dynastie royale est issue du dieu Shango, l'une des plus importantes parmi les divinités célestes. Dans de nombreux cas, dans les royautés à accentuation magique, le souverain est identifié à l'État, au pays, à l'ensemble du peuple sur lequel il règne. Ce qui implique qu'il se maintienne dans un état constant de santé physique et de pureté rituelle : car il se trouve au point de convergence des forces sociales et des grandes forces naturelles. Des exemples sont fournis par la plupart des organisations étatiques de la région interlacustre en Afrique orientale ; et notamment par les Nyoro qu'étudia John Beattie - le roi est pour ces derniers symbole et gardien de la vie, de la vigueur créatrice et de la fertilité, symbole de l'ordre et de la pérennité [22]. Toutes ces allusions suffisent à montrer la forte sacralisation du pouvoir. Et il arrive que le pouvoir - en tant qu'abstraction - le principe monarchique soit divinisé ; le pouvoir s'empare alors du roi, et non l'inverse. Les Shillouk du Soudan nilotique le montrent avec netteté : lors d'un combat fictif, l'esprit qui est le principe même de la monarchie (et qu'une statue matérialise) triomphe en battant l'armée du nouveau souverain ; « la royauté capture le roi », selon la formule d'E. Evans-Pritchard [23].
La relation du pouvoir au sacré subsiste, dans le cadre de la vie politique moderne de ces sociétés, parce que le sacré est toujours inhérent au pouvoir. Les mouvements prophétiques ou messianiques, apparus en diverses parties de l'Afrique christianisée au cours de la période coloniale, ont provoqué l'émergence d'un nouveau type de leader, en même temps que la naissance des religions de salut et du nationalisme sacré. Et pour une période plus récente - celle qui est postérieure à l'Indépendance - l'étude des leaders qui symbolisent la nation nouvelle révèle, dans la plupart des cas, l'imbrication du politique et du sacré. La personnalité du « chef » est sacralisée (le président Sékou Touré a été présenté comme un « don divin à la Guinée »), voire semi-divinisé (le Dr Kwamé Nkrumah est officiellement le « sauveur », et son « immortalité » a même été affirmée). Par le même processus, l'État et le régime politique instaurés acquièrent certaines qualités du sacré, et la fondation de la nation apparaît alors comme un événement religieux. C'est à partir de telles constatations que l'anthropologue et politicologue américain, D. Apter, a pu définir la notion de « religion politique » [24].
2˚ Le second aspect à mettre en évidence est ce qu'on pourrait appeler l'ambiguïté du pouvoir. Ce dernier apparaît comme une nécessité inhérente à toute vie en société ; il exprime la contrainte exercée par celle-ci sur l'individu ; il est d'autant plus contraignant qu'il recèle en lui une part du sacré. Sa coercition est donc grande ; au point d'être estimée dangereuse pour ceux qui doivent le subir. Certaines sociétés, en conséquence, disposent d'un pouvoir qui est, à tout moment, désamorcé de ses menaces et de ses risques. C'est le cas des sociétés indiennes traditionnelles où le chef - dit-on - a l'obligation « de manifester à chaque instant l'innocence de sa fonction ».
Ce cas extrême montre assez que le pouvoir connaît des limites et, surtout, qu'il requiert le consentement. C. Lévi-Strauss a accentué cette caractéristique, en affirmant : « Le consentement est le fondement psychologique du pouvoir, mais dans la vie quotidienne, il s'exprime par, et trouve sa mesure dans, un jeu de prestations et de contre-prestations..., qui fait de la réciprocité un autre attribut fondamental du pouvoir » [25].
Le terme réciprocité permet le malentendu ; mais il est certain que tout pouvoir politique comporte une contrepartie qui trace, en même temps, ses limites. Cette contrepartie est un ensemble de responsabilités et d'obligations, fort diverses selon les régimes politiques en cause : paix et arbitrage, défense de la tradition et de la coutume, générosité, prospérité du pays et des hommes, accord des ancêtres ou des dieux, etc. D'une manière plus générale, on peut dire que le pouvoir doit se justifier en entretenant un état de sécurité et de prospérité collectives. C'est le prix à payer par les détenteurs du pouvoir ; un prix qui n'est jamais intégralement payé.
Mais l'ambiguïté du pouvoir a d'autres causes que celles à l'instant suggérées. Dans la mesure même où le pouvoir implique une inégalité sociale plus ou moins apparente, dans la mesure où il assure des privilèges à ses détenteurs, il est toujours, bien qu'à des degrés variables, contesté. Il est, à la fois, accepté (comme garant de l'ordre et de la sécurité), révéré (en raison de ses implications sacrées) et contesté (parce qu'il justifie et entretient l'inégalité). Tous les régimes politiques manifestent cette ambiguïté, en Afrique et ailleurs. Dans les sociétés africaines sans centralisation du pouvoir - par exemple celles des Fang et des peuples voisins au Gabon et au Congo -des mécanismes correcteurs menacent de mort quiconque abuse de son pouvoir ou de sa richesse. Dans certaines des sociétés à État, les tensions résultant de l'inégalité des conditions sont libérées en des circonstances déterminées - et il semble alors que les rapporte sociaux se trouvent, d'un coup, inversés. Mais ce renversement est maîtrisé, parce qu'il reste organisé dans le cadre de rituels appropries - qui peuvent, sous cet aspect, être dits rituels de rébellion [26]. La ruse suprême du pouvoir est ici de se contester rituellement, pour mieux se consolider effectivement.
La terminologie politique.

On ne peut entreprendre une étude satisfaisante du fait politique africain, si l'on ne procède à une évaluation critique de la terminologie et des définitions élaborées par les spécialistes. Cette nécessité a été rappelée dès le début de cette étude. Elle ne suffit pas, cependant : l'examen du vocabulaire indigène, concernant les relations et les fonctions politiques, s'impose tout autant ; il n'a jamais été effectué de manière systématique, mais on ne saurait douter de la richesse des enseignements qu'il comporte. Les deux démarches sont complémentaires. Une analyse, même fragmentaire - la seule qui soit ici possible -, le révèle.
La plupart des auteurs mentionnent la difficulté éprouvée à définir d'une manière rigoureuse le domaine proprement politique. Et cela pour des raisons déjà évoquées : l'activité politique n'est pas nettement différenciée des autres formes de l'action collective (économiques, religieuses, par exemple), l'indifférenciation étant portée à son maximum dans le cas des sociétés de type clanique. D'autre part, l'action politique ne se réfère pas seulement à des unités sociales spécialisées (État, gouvernement, etc.) ou à des fonctions spécialisées (celles du souverain, du chef, etc.) ; elle concerne bien plus que ces unités sociales et bien plus que ces fonctions. On ne saurait donc tracer facilement les frontières du domaine politique, ou caractériser celui-ci à partir des unités sociales et des fonctions spécialisées. Ces dernières permettent, au mieux, de définir l'organisation politique ; mais non l'ensemble des phénomènes à signification politique.
En présence de ces difficultés, les réactions furent diverses. Certaines conduisent à contourner l'obstacle - à déterminer ce qu'est l'organisation politique ou encore la communauté politique, mais non ce qu'est le fait politique. Lorsque le problème est abordé, les définitions explicites ou implicites renvoient pour la plupart aux notions de pouvoir ou de compétition. Quelques-unes d'entre elles peuvent être citées, ou reprises (parce qu'elles ont déjà été mises en cause), à titre exemplaire.
Pour Lloyd Fallers, le fait politique se réfère à des institutions ; ces dernières étant entendues comme un système de normes qui régissent des comportements socialement approuvés. Selon cette interprétation, l'ordre des phénomènes politiques est constitué par l'ensemble des « institutions » gouvernant l'utilisation légitime du pouvoir [27].
Smith, dans le chapitre initial de son étude des Haoussa de Zaria (Nigeria) [28], définit l'ordre de l'action politique comme un système de relations de puissance impliquant compétition, coalition et compromis. Ou encore : « Le pouvoir caractérise l'action politique » ; ce qui propose une version plus concise de la formule précédente. Smith, reconnaissant les risques d'une définition se fondant sur une notion restée ambiguë, s'efforce de préciser le concept de pouvoir. Il caractérise ce dernier, « dans l'abstrait », en tant que « capacité à agir effectivement sur les personnes et sur les choses ». Et il fait de la force l'une des « formes d'expression » du pouvoir, l'une des « manifestations concrètes » du pouvoir, le moyen ultime permettant de maintenir l'équilibre social ou de contrôler les changements afin de limiter leurs incidences sur les rapports sociaux existant. Il convient de compléter ces remarques en indiquant que M.G. Smith accorde une grande place à la notion de compétition - aux côtés de celle de pouvoir - pour caractériser l'action politique. Selon lui, le pouvoir n'est jamais entièrement détenu (« monopolisé ») par un groupe restreint, et la compétition pour parvenir au niveau où sont prises les décisions politiques majeures ne cesse jamais. Une citation éclaire et complète cette affirmation : « Puisque l'action politique se définit et s'exprime par la compétition pour le pouvoir, c'est en dernière analyse la compétition pour le pouvoir suprême qui est diacritique. »
C'est également à partir du conflit d'intérêts, et de la compétition pour influencer ou orienter les décisions de la collectivité, que Lucy Mair caractérise le domaine de la politique [29]. Elle précise : « Dans ces champs de relations sociales plus vastes [celles qui dépassent la parenté et les rapports personnels directs], il y a toujours et partout des personnes dont les intérêts sont en conflit et en compétition, qui s'efforcent de. faire régler les litiges à leur avantage et d'orienter les décisions de la communauté en accord avec leurs intérêts. C'est cela, la politique » [30]. Et un autre anthropologue anglais, J. Barnes, observe que l'action politique s'exprime toujours par « l'opposition de groupes et de personnes en compétition ».
Les citations pourraient être multipliées ; surtout en retenant celles qui se reportent implicitement aux notions qui viennent d'être considérées. C'est le cas, lorsque les responsables du volume collectif African Political Systems situent l'organisation politique par rapport à la régulation de l'emploi de la force, par rapport aux tendances divergentes et aux conflits d'intérêt qui doivent être contenus ou « équilibrés ». En bref, la réflexion sur la nature du fait politique a conduit les anthropologues à mieux tenir compte du rôle des oppositions, du conflit et de la compétition au sein des sociétés traditionnelles. Elle les a incités à envisager les rapports sociaux non seulement sous l'aspect des structures « fixées », mais aussi sous l'aspect des dynamismes sous-jacents à ces structures. Cette réflexion est cependant restée en deçà d'une étude poussée de la nature et des attributs du pouvoir.
Les difficultés se retrouvent à un autre niveau : lorsqu'il s'agit de définir le gouvernement, les conditions et les moyens de l'exercice du pouvoir ; et cela, parce que nombre de sociétés traditionnelles africaines ne disposent pas d'un appareil étatique nettement constitué. Si, comme Fortes et Evans-Pritchard dans leur introduction à l'ouvrage collectif cité, on caractérise le gouvernement par l'existence « d'une autorité centralisée, d'une machine administrative et d'institutions judiciaires différenciées », on est contraint de considérer que nombre des sociétés traditionnelles ne répondent pas à cette exigence. Et il faut alors établir une dichotomie grossière séparant les sociétés à gouvernement (et à État) des autres. C'est pour éviter ce risque, et mieux se conformer aux données de l'expérience, que les études plus récentes s'en tiennent à une acception large du terme.
Ainsi, I. Schapera précise : « Le gouvernement, dans ses aspects formels, implique toujours la direction et le contrôle des affaires publiques par une ou plusieurs personnes dont c'est la fonction régulière » [31]. De son côté, M.G. Smith propose une définition très proche de la précédente, mais plus complète. Il écrit : « Le gouvernement est l'administration, la direction et le contrôle des affaires publiques d'une unité ou d'un groupe social donné. C'est à la fois un processus, une structure et un système d'idées. » Dans la mesure où le gouvernement comporte, en même temps, décision d'ordre politique et exécution des décisions, il convient de distinguer l'action politique (niveau des décisions) de l'action administrative (niveau de la traduction de ces dernières, en termes d'action, et de l'exécution). Au-delà, il est nécessaire de différencier le pouvoir qui caractérise l'action politique et l'autorité qui caractérise l'administration ; l'autorité apparaissant comme « un droit dérivé ou délégué » (Smith), comme contenue par des règles très strictes qui délimitent le champ de son application.
Dès lors que l'interprétation de la notion de gouvernement est suffisamment large pour pouvoir s'appliquer à toutes les sociétés, la distinction des différentes formes du gouvernement s'impose. Le sociologue ou l'anthropologue ne peut se satisfaire, comme le fait R. Mac Iver [32], d'opposer le « gouvernement primitif » (ou « tribal ») aux gouvernements de caractère moderne. Lucy Mair, à partir de l'étude des sociétés traditionnelles de l'Afrique orientale, introduit des distinctions significatives. Elle envisage : le gouvernement minimal (minimal selon trois sens : étroitesse de la « communauté politique », petit nombre des détenteurs de pouvoir et d'autorité, faiblesse du pouvoir et de l'autorité) ; le gouvernement diffus (dans le cas des sociétés où les détenteurs de pouvoir et d'autorité varient selon les circonstances de la vie collective) ; le gouvernement étatique. Cette démarche de L. Mair n'est certes pas isolée, elle est évoquée ici à titre d'exemple.
Les problèmes de terminologie paraissent moins ardus dès qu'il s'agit de définir les relations ou les unités sociales de caractère politique. Un accord assez large s'établit alors - bien que toutes les ambiguïtés soient loin d'être levées. Il suffit d'évoquer les plus connues de ces définitions.
Selon J. Middleton et D. Tait [33], « les relations politiques sont celles par lesquelles des personnes et des groupes exercent le pouvoir ou l'autorité, pour le maintien de l'ordre social à l'intérieur d'un cadre territorial ». Et les auteurs précisent que ces relations sont de deux ordres ; les unes sont orientées vers l'extérieur - elles opèrent entre unités politiques distinctes et sont essentiellement de type antagoniste ; les autres sont internes - elles interviennent au sein de l'unité politique dont elles assurent le maintien de la cohésion.
Ces relations constituent ensemble un système ou une structure politique, elles s'expriment par le truchement d'une organisation politique. Les trois termes sont en fait mal différenciés, les uns par rapport aux autres, et ensemble par rapport au précédent. Leurs définitions se recouvrent. Ainsi, celle du système politique par G. Almond et J. Coleman : « Le système d'interactions, existant dans toutes les sociétés indépendantes, qui accomplit les fonctions d'intégration et d'adaptation par l'emploi, ou la menace d'emploi plus ou moins légitime, de la contrainte physique » [34]. Ainsi, la conception de l'organisation politique d'après A. Radcliffe-Brown : celle-ci devenant, selon la formule déjà rapportée, « cette partie de l'organisation générale qui concerne le maintien ou l'établissement de l'ordre social, à l'intérieur d'un cadre territorial, par l'exercice organisé de l'autorité coercitive qui recourt, ou a la possibilité de le faire, à la force physique » [35]. Les similitudes entre ces diverses interprétations sont frappantes.
Nous achèverons cette revue sommaire, en examinant deux notions qui sont d'usage fréquent en anthropologie et sociologie politiques ; celles d'unité et de communauté politiques. Un des collaborateurs de African Political Systems (G. Wagner) présente l'« unité politique » comme « le groupe des gens qui sont soumis, d'une manière permanente et organisée, à une direction (leadership) dans le but de se conserver en tant qu'unité » - distincte et indépendante faudrait-il ajouter. De son côté, I. Schapera définit la communauté politique en des termes parents ; elle est « un groupe de gens organisés au sein d'une seule unité et dirigeant ses affaires indépendamment de tout contrôle extérieur » [36] - l'accent portant sur le critère de l'indépendance vis-à-vis de ses homologues.
Une fois de plus, les notions ne sont pas suffisamment différenciées. Cet inventaire partiel de la terminologie manifeste assez les ambiguïtés et les recouvrements qui subsistent. Il fournit néanmoins des points de repères. Il suggère surtout qu'un examen poussé des deux termes-clés -pouvoir et politique - conditionne le degré de rigueur des définitions sur lesquelles se fondent l'anthropologie et la sociologie politiques.
Le vocabulaire politique indigène.

L'approfondissement de ces notions, l'élaboration de concepts plus raffinés doivent, par ailleurs, être recherchés à partir d'une étude méthodique du vocabulaire et des théories politiques indigènes ; que ces dernières soient explicites ou implicites importe peu.
Le vocabulaire propose des termes désignant le pouvoir et l'autorité, les prééminences et les fonctions politiques, les relations qui occupent une position centrale au sein des agencements politiques. Un exemple suffit à montrer l'intérêt d'un examen systématique de ce vocabulaire.
Les Mossi de la Haute-Volta disposent de deux termes parallèles évoquant l'idée de pouvoir : naba et soba. Le premier de ces termes se retrouve dans toute une série de titres définissant les fonctions politiques. En première place, dans l'expression désignant le souverain : Mog (univers des Mossi) naba (celui qui commande à), celui qui « ordonne » (dans les deux sens du mot) le monde connu des Mossi. Ensuite, dans la dénomination des principaux fonctionnaires et des délégués du souverain dans les provinces ; ainsi dit-on : wid naba (chef de la cavalerie), larl naba (chef des tombeaux royaux et conseiller privilégié du souverain), kamsâg naba (chef des eunuques), etc., ou ling naba pour désigner le chef de village.
Le terme soba apparaît dans une autre série d'expressions. Il peut s'appliquer au souverain qui est dit : pãg (de pãga = force) soba (détenteur et propriétaire, maître), celui qui est le détenteur de la toute-puissance ; car la notion de souveraineté est associée à celles de force, de puissance, de pouvoir inconditionnel. Soba dénomme également l'« ancien » du lignage, qui dispose d'une autorité, et celui qui assure une fonction rituelle vis-à-vis des ancêtres à l'intérieur du patrilignage. Ce terme s'applique aussi à un personnage important, connu sous le nom de maître de la terre ou ting (tinga = terre) soba. Le ting soba, gardien des lieux sacrés, a la charge d'offrir les sacrifices à la terre et aux divinités de ces lieux ; il ne dispose pas du pouvoir politique, mais celui-ci a besoin de son intervention rituelle ; en fait, il est l'héritier des anciens chefs autochtones qui furent soumis à la conquête, puis à la domination des fondateurs de l'État mossi. Enfin, la qualité de soba ne se trouve évoquée que de manière exceptionnelle lorsque sont désignés les « fonctionnaires » du pouvoir central. C'est le cas pour le tap soba, chef de la guerre, premier des fonctionnaires et le seul à être d'origine aristocratique ; il est le détenteur de la force militaire (et de certaines prérogatives rituelles), le seul notable ayant la capacité d'intervenir contre un vassal récalcitrant.
Ces deux séries de termes, et de fonctions, sont significatives des conceptions politiques des Mossi et plus généralement de la nature du pouvoir. Le pouvoir proprement politique, détenu par l'État, relayé par les fonctionnaires d'autorité de la capitale et des provinces, est désigné par le terme naba. Les pouvoirs associés à une maîtrise rituelle, ou à un état ancien de la société (le vieux système des patrilignages) ou à une activité marginale, ou exceptionnelle (l'activité militaire), sont évoqués par le terme soba. Les diverses expressions du pouvoir, et son ambiguïté, se retrouvent à travers l'analyse du vocabulaire politique. Et l'on voit notamment que le souverain se situe à la rencontre des deux séries de pouvoirs, il les unifie - de même manière qu'il symbolise l'unité d'un peuple mossi pourtant fort hétérogène par ses éléments constitutifs.
Ce n'est là qu'un exemple rapidement considéré. Le même travail d'étude terminologique devrait être entrepris à partir d'autres cas, à partir aussi d'autres expressions du fait politique et notamment des termes qui désignent la prééminence ou la relation de dépendance personnelle. La linguistique peut ainsi devenir l'un des outils de l'anthropologie et de la sociologie politiques.
La théorie indigène
et la pratique politique.

Les sociétés africaines traditionnelles, bien qu'elles n'aient guère constitué d'archives ou édifié de bibliothèques, n'en ont pas moins été un objet de réflexion pour ceux qui ont la charge de leur « bon fonctionnement ». Elles ne sont dépourvues ni de théories les expliquant, ni d'idéologies les justifiant. Seulement, ces théories et ces idéologies ne s'expriment pas, comme les nôtres, d'une manière directe et contradictoire. Elles sont plus diffuses, elles recourent davantage à l'expression symbolique, elles utilisent de façon presque exclusive l'argument d'autorité (la référence à la tradition, aux ancêtres, etc.).
Les mythes apparaissent comme riches de ces informations « théoriques » ; à tel point que les africanistes français, dont M. Griaule était l'inspirateur, ont placé le mythe au centre de. leurs recherches ; ce dernier est considéré, parfois avec excès, comme la clé de toute connaissance de la société ou de la culture. Ce qui ne paraît pas contestable, c'est que le mythe a une fonction justificatrice dont usent (et abusent) les détenteurs et bénéficiaires du pouvoir. Il se modifie même pour s'adapter aux conditions nouvelles - aider à la résistance aux changements ou donner la garantie de la tradition aux rapports sociaux et politiques qui viennent de s'établir. Un exemple : dans l'ancien royaume du Ruanda, le pouvoir était « monopolisé » par la minorité conquérante formée par les pasteurs tutsi ; cette aristocratie d'origine étrangère s'imposant à une majorité de paysans autochtones (les Hutu) et à des groupements dispersés de chasseurs twa a caractères pygmoïdes. Chacun de ces groupes a constitué une pseudo-caste s'inscrivant dans une hiérarchie rigoureuse, qui place les Tutsi au sommet et les Twa à la base. Les mythes ont justifié cet ordre des choses en le présentant comme originel, antérieur à l'histoire ; le mythe de création, dans sa rédaction première, donne aux trois groupes une origine commune tout en rejetant les Twa hors de la culture et de la société « civilisée », et les Hutu hors du domaine où s'exerce le pouvoir. Le mythe traduit, dans son langage, la hiérarchie sociale fondamentale, tout en affirmant une unité qui est celle de l'État construit par la minorité conquérante. À une époque récente, durant les années qui ont précédé l'Indépendance et le renversement de la monarchie, les paysans hutu se sont insurgés et ont revendiqué l'égalité des conditions. L'aristocratie tutsi a résisté et quelques-uns de ses représentants les plus éminents ont modifié le mythe d'origine pour nier l'appartenance à une souche commune, et rappeler le fait historique de la conquête qui a réduit les autochtones à l'état de « servage ». On saisit ainsi combien le mythe est lié aux rapports sociaux et politiques, combien ses modifications se modèlent sur la transformation de ces rapports.
Le rituel et le cérémonial, par les symboles qu'ils mettent en œuvre et les prééminences qu'ils révèlent, permettent de saisir les aspects fondamentaux de la théorie implicite régissant les relations sociales et la répartition du pouvoir. C'est ainsi que J. Beattie a tenté de reconstituer la « philosophie politique » des Nyoro, créateurs d'un petit royaume de 110 000 sujets en Afrique orientale. Après avoir considéré les mythes qui présentent l'ordre social et la détention de pouvoir comme conformes au plan du Dieu créateur, Beattie envisage les rites et procédures solennelles qui concernent soit le souverain (mukama), soit le fonctionnement du système d'autorité. De cette double étude, il peut déduire les principes « constitutionnels » et les conceptions générales régissant la vie politique des Nyoro. C'est une recherche ayant une valeur exemplaire qui requiert un examen attentif.
En dehors de ces deux niveaux d'observation en quelque sorte privilégiés, il existe d'autres possibilités d'information relatives à la théorie indigène. Le savoir des détenteurs des traditions historiques et des généalogistes (gardiens, par exemple, des généalogies royales) représente l'une d'entre elles. La littérature orale en est une autre : des légendes et des contes, des proverbes se réfèrent directement ou allusivement aux rapports sociaux et aux relations de puissance, et la littérature plus spontanée des « griots » peut comporter autant de critiques que de louanges des puissants. Enfin, le recours à la linguistique, à l'examen des termes désignant les rapports sociaux fondamentaux, les relations et les fonctions politiques, doit compléter les démarches précédemment mentionnées.
Une dernière remarque - capitale - reste à faire. Les principes régissant la société, et son système politique, peuvent aussi être saisis d'une manière directe. La « théorie » n'est pas entièrement implicite, elle est pour une part élaborée avec des moyens qui nous sont plus familiers. Les chefs, les notables, les gens du commun les plus expérimentés savent exprimer les principes gouvernant leur société et le pouvoir au sein de cette dernière. Par attaque indirecte, ou par attaque directe, la théorie politique indigène peut donc être abordée. Deux exemples permettent d'illustrer cette affirmation.
Les Alur se trouvent situés au nord du lac Albert, pour la majorité en Ouganda, pour le reste au Congo. Ils sont nombreux à plus de 200 000, nombre auquel s'ajoutent les groupes ethniques auxquels ils ont imposé leur domination et dont le chiffre de population total avoisine 150 000. C'est un cas d'emprise politique à grande échelle, effectuée à la faveur d'institutions politiques plus spécialisées et plus efficaces que celles dont disposent les groupes soumis ; une entreprise de domination qui fut stimulée par le sens qu'ont les Alur de leur supériorité vis-à-vis de leurs voisins et de leur vocation à diriger les autres peuples. Ils ont conduit cette entreprise sans disposer d'un appareil étatique, mais en constituant des chefferies autour de chefs, à fonctions rituelles et politiques, qui appartiennent à un clan détenteur du pouvoir et se transmettent de père en fils la « qualité »particulière aux dirigeants.
L'étude des Alur a été effectuée par A. Southall, qui a publié ses résultats dans un ouvrage intitulé : Alur Society [37] ; le sous-titre précisant que l'analyse envisage principalement les « processus et les types de domination ». En fait, l'organisation politique des Alur et les réflexions théoriques qu'elle provoque sont au centre de cette recherche.
A. Southall examine la théorie politique des Alur. Il observe, au départ, que les diverses « traditions » locales comportent des thèmes révélateurs de cette dernière ; mais en quelque sorte « en vrac », sans qu'un système théorique cohérent ait été ébauché. Cependant, l'enquête a montré que les chefs et les gens d'expérience se réfèrent explicitement à des principes, de caractère général, qui définissent en partie le système politique. Ces « principes politiques principaux » peuvent être formulés de la manière suivante : le chef doit assurer la protection de ses sujets, à la fois, contre les ennemis du dehors el contre les membres de la communauté qui sont les plus privilégiés ou les plus puissants ; chaque fraction de clan doit accepter d'accueillir, en son sein, un fils de chef, et le considérer comme son propre dépositaire du pouvoir suprême ; les sociétés qui n'avaient pas de chefs doivent avoir le désir d'en obtenir un en acceptant la domination de celles qui en disposent ; le pouvoir doit demeurer sans interruption dans la ligne de descendance directe ; les gouvernants et les gouvernés ont des obligations réciproques : d'hospitalité, d'une part, de tribut et de service, d'autre part.
Des principes importants sont, par ailleurs, exprimés symboliquement et non d'une manière explicite. Ainsi, la pluie symbolise le bien-être matériel, et la capacité du chef à démontrer son contrôle sur cette dernière constitue un test de son pouvoir effectif. De même, son rôle rituel à l'égard des autels de la chefferie est la condition du « bien-être moral » de ses sujets. Si bien que, dans l'esprit de ces derniers, ces deux fonctions apparaissent comme définissant « la responsabilité ultime de tout chef ».
Ayant exposé ces principes, Southall remarque justement que la pratique n'est pas conforme à la « théorie ». Il existe une discordance, de l'une à l'autre, en dépit de l'insistance avec laquelle les Alur affirment le respect des règles spécifiques de leur société. Ces dernières n'apparaissent pas comme exprimant ce qui doit nécessairement être (une sorte de charte ou de constitution révérée), mais comme traçant une image générale de la société lorsque celle-ci est considérée dans l'abstrait. Elles ont autant une valeur explicative qu'une valeur d'orientation de l'action.
Ce qu'il importe de souligner - pour en finir avec cet exemple - c'est que les principes à l'instant cités permettent de se représenter la « structure » du pouvoir dans la pensée des Alur. Soit, sous une forme schématique, le système de représentations suivant :

Et l'on voit que cette interprétation retrouve certains des éléments précédemment envisagés en tentant de définir la nature du pouvoir.
L'étude, déjà mentionnée, de J. Beattie confirme l'efficacité d'une démarche qui s'efforce de construire la théorie politique sous-jacente aux rites, procédures et symboles concernant le pouvoir. Dans le cas des Nyoro, le souverain (mukama) est l'élément central de cette théorie. Ce sont les caractéristiques sacrées de son pouvoir et de sa personne qui se trouvent principalement manifestées - par des contraintes et obligations rituelles multiples. Le roi est source de vie pour le pays et pour le peuple ; l'activité civilisatrice, dont il est l'animateur et le gardien, est d'abord une lutte contre la mort, une victoire de la vie et de la fécondité. Les « preuves » de cette liaison intime entre l'être du souverain et l'être de la société nyoro, la force du roi et la prospérité du peuple, sont nombreuses. Lors de son intronisation, un faux-roi (un « roi de moquerie ») est mis à mort et enterré dans la salle du trône, « afin de tromper la mort et de protéger le souverain réel contre le mal ». Dans le cadre de son existence quotidienne, tout contact avec la maladie ou la mort lui est interdit. Et lorsque sa vitalité décline, il doit mettre fin à ses jours par le poison ou se faire tuer par une de ses femmes.
D'autre part, le mukama et son entourage ont l'obligation de se maintenir en état de pureté rituelle : par des cérémonies de purification au moment de l'accession au trône, par l'élimination des aliments de « bas rang », l'éloignement des personnes qui ne sont pas sexuellement pures, etc. Ces exigences sont expliquées par la nécessité de traiter correctement le pouvoir, d'origine sacrée, connu sous le nom de mahano ; pouvoir qui place toutes choses selon l'ordre convenable, mais qui peut être cause de désordre si son traitement rituel n'est pas correct. Ainsi, le souverain est-il créateur et gardien d'un ordre qui s'impose si puissamment qu'il est sacralisé. C'est la puissance de l'ordre social qui s'exprime par le truchement du roi.
Le cérémonial, pour sa part, manifeste le caractère à la fois séparé et supérieur du souverain. Il lui fait attribuer des noms spéciaux et des titres honorifiques ; il impose un vocabulaire spécial concernant exclusivement sa personne et ses activités ; il définit les attitudes de respect, etc. Lors de l'accession au trône, les comportements prescrits et divers symboles expriment les fonctions du roi au plan proprement politique. Le souverain reçoit des objets - bâton de commandement, lance, arc et poignard - qui manifestent la légitimité de son pouvoir et sa vigueur à défendre son peuple. Il reçoit un tribut symbolique qui exprime le caractère territorial de son pouvoir, et il procède à un jet de flèches selon les quatre points cardinaux en nommant les territoires qui lui sont soumis. Enfin, il règle solennellement un litige afin de se montrer en tant que conciliateur et juge suprême.
Toutes ces données sont ici simplifiées, mais leur signification n'est pas faussée. Elles se classent en deux séries qui mettent en évidence les aspects sacrés du pouvoir (très accentués) et les fonctions politiques et profanes qui définissent la magistrature suprême (voir graphique p. 50).
La liaison de ces deux séries de caractéristiques se décèle aussi dans la procédure par laquelle le souverain attribue une part d'autorité à ses représentants locaux, et aux notables des lignages. Il délègue à la fois l'autorité politique et l'autorité rituelle (associée à la notion de mahano), sans laquelle la première n'est ni légitime, ni créatrice d'ordre. En ce cas de la société nyoro, on voit combien le sacré, la puissance contraignante du pouvoir et la légitimité, sans laquelle le pouvoir devient cause de désordre, sont étroitement associés.
La « théorie » politique des Nyoro ne se réduit pas aux aspects révélés par les mythes, les rituels et les symboles. Elle est exprimée d'une manière plus directe. Notamment à l'occasion de l'enseignement qui est imposé au roi lors de son accession au pouvoir ; il lui est prescrit de gouverner pacifiquement, avec sagesse et justice, de venir en aide à tous ses sujets, etc. Ce sont les obligations du pouvoir, à l'égard du peuple, qui paraissent alors mises en évidence. La contrainte de la société, en tant que « puissance morale », la contrainte de « l'ordre », en tant que valeur suprême, dont le pouvoir est l'agent et l'unique gardien, trouvent ici leurs limites. Leurs limites de principe. Par ailleurs, l'étude du fonctionnement du régime politique montre que le pouvoir du souverain n'est pas inconditionnel. Des équilibres sociaux et politiques opèrent dans le but de contenir le pouvoir royal. Et il s'agit, cette fois, de limites de fait. L'ambiguïté du pouvoir, fort de toutes les ressources du sacré, et pourtant tenu entre certaines bornes parce que redouté, se décèle chez les Nyoro, comme ailleurs.

Les deux exemples considérés confirment la possibilité de reconstituer la « théorie indigène » expliquant et justifiant les rapports sociaux et les relations de pouvoir. Il reste, après cette tâche, à entreprendre un examen critique : une étude recherchant dans quelle mesure cette théorie est contestée et envisageant les discordances entre la théorie et la pratique. Car c'est à ce niveau que se préparent les modifications structurelles significatives. Il s'agit alors d'un autre ordre de réflexion, celui de la dynamique propre aux phénomènes politiques.
Faculté des Lettres et Sciences humaines de Paris.
[1] Le terme « politique » s'applique ici aux phénomènes concernant le gouvernement des sociétés humaines, que l'État soit ou ne soit pas nettement constitué. Il est retenu avec une acception large et concerne : a) les formes d'organisation du pouvoir ; b) les stratégies résultant de la compétition des individus et des groupes (policy au sens anglo-saxon) ; c) à un moindre degré, la « connaissance politique » au sens où l'entend G. Gurvitch.
[2] Lucy MAIR, Primitive Government, London, 1962.
[3] David APTER, The Political Kingdom in Uganda, Princeton, 1961.
[4] Lloyd FALLER, Bantu Bureaucracy, Cambridge, 1956, et David APTER, op, cit.
[5] M. FORTES et E.E. EVANS-PRITCHARD, édit., African Political Systems, London, 1955.
[6] R.M. Mac IVER, The Web of Government, 1947.
[7] E.-F. GAUTIER, L'Afrique noire occidentale, Paris, 1943.
[8] E. SCHAPERA, Government and Politics in Tribal Societies, London, 1956.
[9] M.G. SMITH, Government in Zazzau, London, 1960.
[14] I. SCHAPFRA, Government and Politics in Tribal Societies, London, 1956.
[15] I.M. LEWIS, A Pastoral Democracy, London, 1961.
[16] Luc de HEUSCH, Pour une dialectique de la sacralité du pouvoir, in Le pouvoir et le sacré, Bruxelles, Institut de Sociologie, Annales du Centre d'Étude des Religions, 1, 1962.
[17] J. MIDDLETON, Lugbara Religion, London, 1960.
[19] Luc de HEUSCH, op. cit.
[20] Luc de HEUSCH, Essais sur le symbolisme de l'inceste royal en Afrique, Bruxelles, Institut de Sociologie, Études ethnologiques, 1, 1958.
[21] « Pour une dialectique de la sacralité du pouvoir », op. cit.
[22] John BEATTIE, Bunyoro. An African Kingdom, New York, 1960.
[23] E.E. EVANS-PRITCHARD, The Divine Kingship of the Shilluk. 1948.
[24] David E. APTER, Political Religion in the New Nations, in Clifford GEERTZ (édit.), Old Societies and New States, 1963.
[25] Claude LÉVI-STRAUSS, Tristes tropiques, 1955.
[26] Max GLUCKMAN, Order and Rebellion in Tribal Africa, London, 1963.
[27] Lloyd FALLERS, Bantu Bureaucracy, Cambridge, 1956.
[28] M.G. SMITH, op. cit.
[29] Lucy MAIR, Primitive Government, London, 1962.
[31] I. SCHAPERA, Government and Politics in Tribal Societies, London, 1956.
[32] R.M. Mac IVER, The Web of Government, 1947.
[33] J. MIDDLETON et D. TAIT, Tribes without Rulers, London, 1958.
[34] G. ALMOND et J. COLEMAN, The Politics of the Developing Areas, New Jersey, 1960.
[35] A. RADCLIFFE-BROWN, Préface à African Political Systems.
[37] A. SOUTHALL, Alur Society, A Study in Process and Types of Domination, Cambridge, 1953.
|

