|
Louis Balthazar
“La dynamique du nationalisme québécois”.
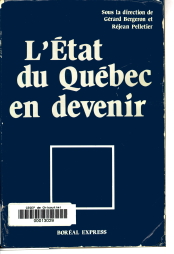 Un texte publié dans l'ouvrage sous la direction de Gérard Bergeron et Réjean Pelletier, L'État du Québec en devenir, chapitre 2, pp. 37-58. Montréal: Les Éditions du Boréal Express, 1980, 413 pp. Un texte publié dans l'ouvrage sous la direction de Gérard Bergeron et Réjean Pelletier, L'État du Québec en devenir, chapitre 2, pp. 37-58. Montréal: Les Éditions du Boréal Express, 1980, 413 pp.
- Introduction
-
- Mobilisation sociale et nationalisme moderne
- Sécularisation et déclin du pouvoir ecclésial
- Le Québec, « expression politique du Canada français »
- Le Québec et son rival
- Un nationalisme envahissant
-
- Conclusion
Introduction

Il y a bien peu de gens, s'il en fut, qui, après la mort de Maurice Duplessis et surtout après la victoire du Parti libéral, le 22 juin 1960, croyaient que le nationalisme allait réapparaître au Québec avec une intensité toute nouvelle au début de la période qui s'amorçait. Au cours des années cinquante, comme l'a souligné Gérard Bergeron dans le chapitre qui précède [1], les membres de l'intelligentsia québécoise s'étaient appliqués à dénoncer l'imposture du vieux nationalisme canadien-français qu'avaient habilement récupéré Duplessis et son Union nationale. Il faut dire que ce nationalisme se définissait le plus souvent par rapport à une tradition d'immobilisme (« Au pays du Québec, rien ne doit changer »), à un catholicisme conservateur et à des valeurs d'ancien régime. Il était rarement parvenu, au cours de l'histoire, à insuffler quelque dynamisme aux institutions politiques contrôlées par les Canadiens français.
L'accession au pouvoir d'une nouvelle équipe résolue à introduire le Québec dans l'âge moderne allait sonner le glas de ce nationalisme traditionnel, ou tout au moins consacrer son dépérissement en tant qu'idéologie dominante.
De là à croire que le nationalisme tout court était dépassé, il n'y avait qu'un pas que plusieurs ont franchi, encouragés par le grand courant antinationaliste qui avait suivi la Seconde Guerre mondiale, déclenchée par l'exacerbation des nationalismes de droite en Europe.
Pourtant, quelques mois à peine après l'arrivée au pouvoir des artisans de la Révolution tranquille, un nouveau nationalisme allait faire surface, plus fort, plus envahissant, plus contagieux que ne l'avait jamais été le nationalisme traditionnel.
Ce qu'on a appelé à l'époque « néo-nationalisme », pour bien le distinguer de l'idéologie de la survivance, reposait avant tout sur une nouvelle définition de l'État québécois, une conception plus dynamique de son rôle, qu'on a voulu exprimer par la substitution du mot « État » à celui de « province » pour désigner la société politique québécoise. Le gouvernement qui entreprenait la tâche de mettre sur pied tout un train de réformes visant à moderniser les structures sociales du Québec se devait d'encourager une valorisation de plus en plus grande de la fonction étatique. Les élites qui l'appuyaient ont réagi avec enthousiasme et se sont appliquées à leur tour à populariser la notion que tout ce qui apparaissait comme progressiste découlait des actions du gouvernement. Les multiples interventions de l'État dans la trame sociale durent bientôt trouver une justification grandiose dans une mission originale attribuée au seul État francophone d'Amérique du Nord. On peut donc dire que les élites politiques de la Révolution tranquille ont été amenées à ressusciter l'idée nationaliste pour s'assurer une plus forte légitimité auprès de la population sur laquelle ils agissaient. Le jour où l'on a pu définir le gouvernement comme un instrument de l'émancipation d'un peuple, la croissance de l'appareil d'État n'apparaissait plus seulement comme acceptable, mais comme nécessaire pour ne pas dire sacralisée.
Il ne serait pas juste toutefois d'affirmer que le nationalisme québécois (ou néo-nationalisme) a été créé de toutes pièces par un gouvernement vorace en mal de légitimation. De profondes mutations sociales avaient déjà préparé la voie tant à ce nationalisme qu'au gouvernement qui allait l'exploiter. C'est pourquoi dans les lignes qui suivent, nous traiterons d'abord du phénomène de la « mobilisation sociale » comme facteur de nationalisme, puis de son inévitable corollaire, la sécularisation qui entraîne le déclin du pouvoir religieux. Nous pourrons ensuite mieux comprendre comment l'État québécois a puisé l'essentiel de son dynamisme à même un nationalisme qui stimule l'intervention politique autant qu'il s'en voit renforcé. Nous nous arrêterons, en quatrième lieu, à l'obstacle majeur sur la voie de ce dynamisme de l'État québécois, les visées non moins envahissantes d'un État central canadien toujours appliqué à la vassalisation du gouvernement du Québec. Nous verrons enfin comment le nationalisme québécois n'en a pas moins marqué de son empreinte l'ensemble de la société.
Mobilisation sociale et nationalisme moderne

Le nationalisme traditionnel des Canadiens français était axé sur une ethnie, celle des descendants des colons français du 18e siècle, dont la population était concentrée dans la province de Québec mais s'étendait également à d'autres provinces du Canada et même à certains États américains. En revanche, le nouveau nationalisme, qui apparaît au moment de la Révolution tranquille, tient essentiellement au territoire québécois. Tandis que le nationalisme canadien-français s'attachait à la conservation d'anciennes valeurs, à la survivance d'une race, le nationalisme québécois s'appuie sur la modernisation de l'appareil étatique du Québec et sur l'évolution d'une société, de plus en plus consciente d'être distincte de la grande société anglophone de l'Amérique du Nord.
Cette rupture d'avec l'ancien idéal ethnique et l'accent nouveau porté sur le Québec ne s'expliquent pas par une sorte de volonté nouvelle de repli sur eux-mêmes, de la part des Québécois francophones, qui aurait signifié l'abandon des minorités françaises ailleurs en Amérique, mais bien plutôt par le phénomène de l'intensification des communications propres à la modernisation.
Cela apparaît clairement si l'on accepte de définir, à la suite de Karl Deutsch, la nation comme « un peuple en possession d'un État [2] » et un peuple comme un réseau de communications intenses et fréquentes. De ces définitions, ressortent deux éléments essentiels d'une nation : les communications de type moderne et l'appareil politique qui tend à contrôler ces communications. Or, il n'existe, en Amérique du Nord, qu'un seul réseau de communications francophone, et c'est l'État québécois. Voilà pourquoi le sentiment national a refait surface au moment même où les communications devenaient plus intenses et plus fréquentes et au moment où l'État du Québec modernisé, devait chercher à contrôler de façon positive le réseau de communications.
L'après-guerre a entraîné un progrès foudroyant dans le domaine des communications. Les Canadiens français, voyant leur niveau de vie s'élever, ont pu utiliser massivement les moyens de transport modernes, en particulier l'automobile. Le téléphone, la radio, sont devenus pour eux d'usage courant et, à partir de 1952, la télévision transforme complètement leur vie en projetant quotidiennement, dans la plupart des régions du Québec, une sorte d'image d'eux-mêmes, une image inévitablement beaucoup plus nette et surtout plus accessible que celle que leurs élites leur peignaient auparavant. L'intensification des communications avait eu pour conséquences de rapprocher les populations et d'intégrer les individus à un ensemble social plus vaste. Or, pour les Canadiens français vivant au Québec, cet ensemble social se situe d'abord et avant tout au Québec, tandis que, pour les autres, cet ensemble est, bien entendu, un univers anglophone. Ainsi l'intensification des communications aura produit deux effets diamétralement opposés suivant que des francophones vivaient au Québec ou ailleurs au Canada. Pour les uns, elle les rapproche des autres francophones et accentue leur allégeance culturelle ; pour les autres, elle les intègre davantage à la société anglophone et accélère leur assimilation. Ce phénomène est d'autant plus frappant qu'il se manifeste en dépit d'une intention tout à fait opposée de la part du gouvernement canadien qui s'était arrogé le contrôle des communications. La Société Radio-Canada, par exemple, avait reçu pour mission de contribuer à l'unité canadienne en rapprochant tous les Canadiens les uns des autres. Mais, comme on avait dû créer forcément deux réseaux, la société d'État n'a pu que rapprocher, par le réseau français, les Québécois les uns des autres. Car, en dépit de la politique officielle, le réseau français a été d'abord et avant tout un réseau québécois. Il ne parvint que très tardivement à atteindre les francophones hors Québec, à un moment où déjà le réseau anglais avait fait son oeuvre et où le medium français subissait l'interférence d'une gamme impressionnante de messages anglophones ; et encore, ce medium demeurait essentiellement québécois. Comment pouvait-il en être autrement du seul fait de la concentration de la population francophone (et, par conséquent, de celle des communicateurs francophones) en territoire québécois ? Cette seule concentration, bien plus qu'un certain nationalisme ou chauvinisme des employés de Radio-Canada, suffit à expliquer que ce réseau français soit devenu un agent important d'une nouvelle conscience nationale québécoise.
Si l'on envisage le Québec comme un réseau de communications, on comprend donc facilement que les Québécois de 1960 soient devenus plus rapprochés les uns des autres, tandis que leurs frères de race d'ailleurs au Canada devenaient plus éloignés. C'est la modernisation même du Québec qui tisse la trame de l'appartenance québécoise. Non pas que les Québécois se soient repliés sur eux-mêmes, au contraire : ils deviennent plus mobiles et plus ouverts que jamais. C'est cette mobilité et cette ouverture qui apportent aux Québécois une nouvelle conscience d'eux-mêmes comme peuple, parce qu'elles soulignent leurs traits communs en les confrontant avec un environnement étranger.
En d'autres termes, les Québécois ont subi, d'abord lentement durant la première moitié du 20e siècle, puis de façon massive durant les années cinquante, le phénomène de la « mobilisation sociale », c'est-à-dire le passage d'une situation d'isolement relatif aux transactions intenses et fréquentes de type urbain [3]. Cette mobilisation sociale s'est traduite, de façon significative, par l'urbanisation mais elle déborde ce phénomène. Car même le paysan qui échappe à la ruée vers les villes peut être « mobilisé socialement ». L'usage fréquent des nouveaux modes de communication l'engage à s'intégrer au grand ensemble québécois.
La mobilisation sociale ainsi entendue peut engendrer l'assimilation au groupe qui contrôle les transactions économiques et sociales (dans le cas présent, les anglophones du Québec, les élites économiques de Montréal, métropole canadienne). Elle peut aussi donner lieu à une résistance face à ce groupe de la part des nouveaux mobilisés. Or, il se trouve, d'après les données recueillies par Deutsch, que dans la plupart des sociétés modernes, la mobilisation sociale progresse cinq fois plus rapidement que l'assimilation [4]. C'est exactement ce qui s'est produit au Québec. Les Québécois francophones ont été amenés à utiliser les moyens de communication modernes de façon tellement rapide qu'ils se sont heurtés soudainement à la dure réalité : au cœur même du territoire québécois, la langue des communications importantes n'était pas la leur.
Dans un monde de transactions multiples, le phénomène linguistique revêt une importance toute nouvelle. Car la plupart de ces transactions se font nécessairement par le canal d'une langue qui est elle-même l'expression d'une culture. Il n'est donc pas étonnant que, dès la fin des années cinquante, un nombre de plus en plus grand de Québécois francophones se soient mis à exprimer des revendications d'ordre linguistique avec une vigueur toute nouvelle et à plusieurs niveaux. Ces Québécois exigeaient tout naturellement que les communications dans lesquelles ils se trouvaient désormais engages se poursuivent dans leur langue à eux et selon leur culture à eux. Ils aspiraient en définitive au contrôle de ces communications par des membres de leur groupe majoritaire. Quand une telle aspiration se manifeste, il y a nationalisme.
Mais pour que ce nationalisme apparaisse clairement, il aura fallu en outre que les Québécois se donnent un véritable instrument de contrôle. Cet instrument ne pouvait être que l'État québécois, puisque les autres points de rassemblement de cette société, l'Église, la région, le village, avaient perdu leur signification dans un univers de mobilisation sociale. C'est donc par le biais d'une sorte d'étatisme, d'une responsabilité accrue accordée au gouvernement de la province qui devait se traduire par une intervention plus grande du pouvoir politique dans divers secteurs de la société québécoise, que devait apparaître le nationalisme québécois.
Pierre Elliott Trudeau écrivait, en 1961, dans un article intitulé « L'aliénation nationaliste » : « Nous avons grandi, et nos pères avant nous, et leurs pères avant eux, sous un État provincial dont l'essentiel de la politique a été d'aliéner les meilleures et les plus accessibles de nos ressources naturelles et d'abdiquer toute juridiction sur l'organisation sociale et l'orientation culturelle des Canadiens français. Cette politique [...] nous a été imposée par nos élites clérico-bourgeoises : de tout temps celles-ci ont empêché de s'accréditer parmi nous la notion d'État dont la fonction eût été d'intervenir activement dans le processus historique et d'orienter positivement les forces communautaires vers le bien général... [5] ».
Voilà un bon résumé de l'ensemble des critiques que l'intelligentsia québécoise avait adressées au gouvernement Duplessis. En 1960, derrière le slogan populaire « C'est le temps que ça change », il fallait lire une volonté nette d'intervention accrue du pouvoir politique québécois, de la part des nouvelles élites qui avaient trouvé place au sein du Parti libéral. Il n'était pas encore question de nationalisme comme tel. Mais il devenait inévitable qu'un État plus interventionniste au sommet d'une société fraîchement mobilisée aspire à devenir l'agent central du réseau de communications québécois. C'est en cela que consiste essentiellement le nationalisme moderne, celui qui allait apparaître au Québec dès le début d'une Révolution tranquille qui s'était voulue d'abord économique et sociale. Les Québécois allaient se manifester vraiment comme « un peuple en possession d'un État ».
Sécularisation et déclin du pouvoir ecclésial

Le pouvoir de l'Église constituait un obstacle majeur à cette nouvelle valorisation de l'État. Depuis plus d'un siècle, en effet, l'Église catholique s'était progressivement assurée un contrôle quasi absolu sur l'éducation, la culture et l'assistance sociale. Rappelons seulement que toutes les universités francophones, la très grande majorité des collèges et des écoles étaient confessionnels catholiques, que peu de mouvements culturels sortaient de l'orbite du catholicisme, que les hôpitaux, les institutions de bienfaisance et d'assistance sociale, une grande centrale syndicale, les organisations de loisirs se trouvaient aussi sous l'égide du clergé ou des communautés religieuses.
D'ailleurs, l'Église avait été, en quelque sorte, depuis environ 1840, la clef de voûte du nationalisme canadien-français, le rassemblement d'un peuple. Il était impensable qu'on se dise nationaliste au Canada français sans accepter tout au moins le rôle essentiel qu'y tenait l'Église.
Or, la mobilisation sociale allait rendre ce leadership ecclésial et le contrôle qui l'accompagnait de plus en plus difficile. Car ce phénomène entraîne un processus irréversible de sécularisation. L'intensification des communications de type urbain rend les relations humaines plus anonymes et les situe bien au-delà des communautés de base, notamment les paroisses, sur lesquelles l'Église s'appuyait. L'être mobilisé devient inévitablement plus autonome, moins susceptible de valoriser son appartenance à des ensembles restreints comme la famille, la paroisse, la région. S'il continue d'appartenir à un mouvement religieux et de manifester concrètement son adhésion à une foi, cela prendra une signification de plus en plus spirituelle et se traduira de moins en moins de façon visible à l'intérieur des structures sociales.
En d'autres termes, la mobilisation sociale a tendance à briser la solidarité religieuse au profit du pluralisme des options spirituelles. L'État devient la seule organisation capable de répondre, de façon globale, aux besoins sociaux des individus et de créer une nouvelle solidarité à un niveau plus large et plus neutre.
C'est ce qui s'est produit au Québec durant la période que nous étudions ici. La confessionnalité a été remise en question à peu près partout : syndicats, hôpitaux, organismes culturels, universités, collèges, etc. Parfois, l'Église a dû abandonner son contrôle sous la pression des faits ; en d'autres occasions, elle l'a fait de plus ou moins bonne grâce, tantôt de son gré, tantôt après de dures luttes menées par les éléments les plus conservateurs du clergé. Dans certains cas, la confessionnalité a été maintenue coûte que coûte, même si la pratique enlevait tout son sens à l'étiquette. Toujours, c'est l'État qui assumait graduellement et tout naturellement les rôles jadis joués par l'Église en matière d'éducation, de culture, d'assistance sociale, de redistribution des richesses.
Quelles que furent ses prétentions, l'Église devenait incapable de jouer ses rôles traditionnels, d'abord parce qu'elle n'était pas équipée, de par sa nature même, pour répondre aux nouveaux besoins d'une société élargie et aussi parce que, conséquence du déclin de son prestige, ses effectifs diminuaient sensiblement. On assista, au cours de cette période, à une vague exceptionnelle de défections au sein du clergé et des communautés religieuses et à une baisse considérable des entrées. Ainsi, un collège pouvait bien demeurer confessionnel, mais la rareté du personnel religieux faisait en sorte que la grande majorité des enseignants étaient des laïcs à qui il devenait de plus en plus difficile d'imposer une profession de foi.
De plus, il s'était trouvé que bon nombre de clercs et religieux, même s'ils n'abandonnaient pas leur état, devinrent conscients du changement social qui s'opérait et se firent les protagonistes d'une nouvelle interprétation du rôle de l'Église. Pour eux, la tutelle historique de l'Église sur la société québécoise, bien loin d'être louable et légitime, représentait une véritable aberration théologique, un fardeau inutile et nuisible. Ces jeunes clercs et religieux se sont souvent alignés avec les laïcs les plus anticléricaux pour réclamer la déconfessionnalisation des institutions tout en prônant une spiritualisation des fonctions ecclésiales et en dénonçant l'ingérence de l'Église dans le temporel.
Le pontificat de jean XXIII et surtout le Concile Vatican II vinrent accentuer cette nouvelle tendance. Partout dans l'Église catholique soufflait un vent de renouveau. On parlait beaucoup de pluralisme, d'oecuménisme, de tolérance religieuse, d'ouverture au monde contemporain, de non-ingérence, etc. Il était inévitable que ce nouveau courant produise un effet profond sur l'Église québécoise et rende à peu près impossible une guerre religieuse, que la conjoncture eût sans doute provoquée à une autre époque.
Il n'y eut donc pas de durcissement généralisé de la part des clercs. Ce qui ne veut pas dire que des résistances, parfois assez virulentes, ne se sont pas manifestées. Si le changement s'est opéré assez rapidement en comparaison avec d'autres sociétés, il s'est tout de même réalisé plutôt graduellement. En 1960, la nouvelle équipe libérale, qui devait produire le gouvernement qui allait arracher en douce beaucoup de pouvoir à l'Église, s'était présentée en faisant état des allégeances religieuses de ses membres. Un peu plus tard, le premier ministre jean Lesage déclarait sans ambages que jamais, sous son gouvernement, ne serait créé un ministère de l'Éducation, entendant par là sans doute que l'État ne devait pas s'immiscer dans une sphère de juridiction ecclésiale. Quand, malgré tout, fut déposé le projet de loi à l'effet de créer ce ministère, les évêques et plusieurs membres du clergé menèrent une lutte acharnée contre le projet d'abord, puis en faveur de certains amendements devant garantir la confessionnalité des écoles. En 1966, le gouvernement libéral, artisan de la Révolution tranquille, subit une défaite électorale attribuable, au moins en partie, à une certaine lassitude des électeurs face aux changements que subissait la société québécoise. L'Union nationale se faisait forte de garantir une plus grande fidélité aux traditions et paraissait, en raison de son passé, assez près d'un certain conservatisme religieux. Les cégeps, non confessionnels, furent quand même créés sous l'Union nationale et les Universités de Montréal et Laval abandonnèrent leur statut d'universités catholiques. En 1968, le gouvernement créait une université d'État, l'Université du Québec, et mettait sur pied un conseil des universités. Quant aux écoles primaires et secondaires du secteur public francophone, elles demeureront officiellement confessionnelles jusqu'à ce jour, en dépit d'un climat pluraliste sans cesse croissant.
Ces lenteurs illustrent bien l'inévitable retard des politiques sur les pratiques. Le Québec se sécularisait progressivement même si, officiellement, on se refusait à l'admettre, de peur de heurter la bonne conscience de la population et de réveiller un certain sentiment de culpabilité encore mal étouffé. Qu'on prenne pour seul exemple de cette sécularisation la baisse progressive de la pratique religieuse au cours de la période et une diminution notable de références au religieux dans le discours politique. Il ne fut plus nécessaire, après 1966, d'utiliser la religion dans une campagne électorale.
Le déclin de la légitimation religieuse laissait un vide qui devait être comblé. Ce sont l'étatisme et le nationalisme qui occupèrent très tôt, presque spontanément, la place abandonnée par l'Église. L'État allait entrer graduellement dans les sphères de l'éducation, de la culture et des affaires sociales. La ferveur jadis entretenue par l'allégeance religieuse fut remplacée par la ferveur nationale. Les congrès eucharistiques et les défilés de la Fête-Dieu n'existaient plus. Les Québécois s'adonnaient à d'autres célébrations alimentées par leurs chansonniers presque tous inspirés par le nouveau nationalisme. Les fêtes de la Saint-Jean prirent la place des grands ralliements religieux.
On a souvent répété que le nationalisme québécois des années soixante et soixante-dix tenait lieu d'une nouvelle religion, que les jeunes générations nationalistes étaient tout aussi intransigeantes quant à l'idéal national et indépendantiste que leurs aînés l'avaient été pour le catholicisme, que des dogmes nouveaux avaient succédé aux anciens. Ces affirmations contiennent, à n'en pas douter, une part de vérité ; mais elles ne rendent pas vraiment compte des mutations de la société québécoise. Car le passage du collectivisme religieux au nationalisme signifie bien plus qu'un simple changement de religion. Le Québec a cessé d'être dominé par l'autorité religieuse, non par lassitude à l'endroit de cette autorité, non pas en raison des critiques qu'on pouvait lui adresser, mais bien parce que la mobilisation sociale ne permettait plus l'exercice d'un tel type d'autorité. Le Québec moderne ne peut plus définir son identité par référence au religieux. Le nationalisme est un phénomène d'affirmation d'une identité collective laïque. Il se situe à un niveau autre que l'allégeance religieuse. C'est là tout au plus un langage métaphorique. Car si le nationalisme remplace la religion comme point de rassemblement d'un peuple, c'est qu'il apporte autre chose que la religion.
Voyons maintenant comment ce nationalisme s'est défini au niveau de la politique québécoise.
Le Québec, « expression politique
du Canada français »

Monsieur Jean Lesage déclarait en 1964 : « ... nous croyons que le Québec est l'expression politique du Canada français et qu'il joue le rôle de mère-patrie de tous ceux qui, au pays, parlent notre langue [6] ».
Le premier ministre du Québec donnait alors, par ces mots, tout son sens à la québécisation du nationalisme des Canadiens français dont nous parlions plus haut. L'identité canadienne-française, mûrie et renforcée par la mobilisation sociale, était en quête d'une expression politique. Car c'est au niveau politique, et à ce seul niveau, que cette identité pouvait se signifier, s'affirmer et trouver les moyens de son épanouissement. Aucune institution, pas même l'Église, n'était assez forte et assez englobante pour parler au nom des Canadiens français, si ce n'est le gouvernement du Québec. Or, ce gouvernement venait de naître pour ainsi dire. Entendons par là que le pouvoir québécois avait commencé d'agir comme agit un État moderne. Il s'était donné une véritable fonction publique et avait déjà tracé les voies de sa responsabilité à l'égard de la société québécoise et de sa majorité francophone.
En somme, l'État du Québec se présentait comme un État national. Monsieur Lesage ne pouvait signifier autre chose en affirmant que le Québec jouait « le rôle de mère-patrie de tous ceux qui, au pays, parlent notre langue ». Seul un État national peut vraiment jouer un pareil rôle, c'est-à-dire celui d'une métropole par rapport à sa diaspora.
Jean-Jacques Bertrand allait plus tard souligner la même réalité de façon moins directe quand il affirmait, après avoir rappelé l'existence de « deux collectivités, deux peuples, deux nations » au Canada : « Sans le Québec, il pourrait encore y avoir des universités françaises, mais il n'y aurait plus vraiment le Canada français [7]. » En d'autres termes, le Québec est le coeur de la nation canadienne-française. Le gouvernement du Québec est donc plus qu'un simple gouvernement provincial, en raison de sa responsabilité à l'endroit d'une nation. Cela fait du Québec, à toutes fins pratiques, un État national.
Cet État national devenait donc le grand instrument d'émancipation de la nation canadienne-française. C'est lui qui devait permettre aux francophones du Québec de prendre en main leur destinée. Sur tous les plans, cet État a pris l'initiative : culture (création du ministère des Affaires culturelles), éducation (création du ministère de l'Éducation), affaires sociales (plusieurs programmes dont les plus marquants ont été l'assurance-hospitalisation et l'assurance-santé). C'est au plan économique, surtout, que l'action de l'État apparut davantage dans une perspective nationaliste. Il s'était toujours trouvé des orateurs, au cours de l'histoire, pour invoquer la nécessité pour les Canadiens français de reconquérir leur économie. Mais jamais les gouvernements ne s'étaient mis à l’œuvre dans ce domaine comme ils l'ont fait depuis 1960.
Cette intervention n'avait rien de doctrinaire et elle ne se présentait pas comme un véritable étatisme, encore moins comme une voie socialiste. Elle procédait simplement d'une lecture réaliste de la situation du peuple canadien-français dominé économiquement et sans autre moyen de redresser cette situation que celui de l'intervention étatique.
- « Les Québécois, disait J. Lesage en 1963, n'ont qu'une seule institution puissante: leur gouvernement. Et maintenant, ils veulent se servir de cette institution pour construire l'ère nouvelle à laquelle ils ne pourraient pas aspirer autrement [8]. »
Autrement dit, le seul grand capitaliste francophone capable tant soit peu de rivaliser avec les grandes entreprises anglophones d'Amérique du Nord, c'était l'État québécois. Cet État s'est donc mis à l’œuvre. Entre autres actions, retenons seulement les deux plus spectaculaires, la nationalisation du réseau hydro-électrique qui a fait de l'Hydro-Québec la première grande entreprise contrôlée par des francophones et, ce qu'on a appelé le projet du siècle, la construction de barrages à la Baie James. Ces deux opérations se sont avérées rentables pour les Québécois, en dépit des critiques qu'on leur a adressées sur un plan strictement économique. Mais elles ont fait plus : elles ont alimenté positivement le nationalisme dans la mesure où elles ont donné aux Québécois le sentiment de pouvoir réaliser de grands projets. Elles leur ont donné surtout un accès à des réseaux économiques dont, jusque là, ils se sentaient exclus.
Sans doute, l'action économique de l'État québécois n'a pas éliminé l'infériorité des francophones dans l'industrie, la finance et le commerce. Mais elle a au moins suscité des espoirs et permis de réels progrès. Les francophones québécois sont aujourd'hui plus près qu'ils ne l'étaient en 1960 d'un véritable contrôle de leur économie. Il est difficile de penser que cela aurait pu se produire sans l'action de l'État et la conscience de cet État d'agir au nom d'une nation.
Cette conscience et cette résolution se sont manifestées de bien des façons et se sont exprimées par divers slogans : « un Québec fort », « Québec d'abord », « une province pas comme les autres », « un statut particulier », « égalité ou indépendance », « souveraineté culturelle ». Toujours, que ce soit dans l'enthousiasme de la Révolution tranquille, dans l'assurance de Daniel Johnson, les hésitations ou la bonne foi de Jean-Jacques Bertrand ou même, a travers les professions de foi fédéralistes de Robert Bourassa, apparaissait cette idée centrale d'un État québécois devant être doté de tous les pouvoirs lui permettant d'assumer sa responsabilité à l'endroit d'une nation [9].
La nation dite canadienne-française allait s'identifier de plus en plus au territoire québécois. Cela était bien naturel dans la mesure où le principal moteur du dynamisme national était l'État québécois ayant juridiction sur son seul territoire, même s'il voulait bien jouer le rôle de métropole, au plan culturel, par rapport aux francophones des autres provinces. Ainsi, inévitablement, le territoire succédait à l'ethnie dans la définition du nationalisme.
- « Autrefois, disait Daniel Johnson, on parlait assez couramment de deux races. Si nous préférons utiliser aujourd'hui le mot « nation », c'est précisément parce qu'il évoque une dimension infiniment plus vaste que celle de l'origine ethnique : la dimension culturelle [10]. »
L'ethnie est une conception statique. On ne peut rien changer à sa généalogie. La culture est au contraire une notion dynamique. Une culture est constamment nourrie par les rapports sociaux et les communications. À l'époque de la mobilisation sociale, la culture est soutenue et encouragée par l'action d'un gouvernement sur un territoire donné. Dans le cas qui nous intéresse, c'est en territoire québécois qu'une culture francophone vit et se développe. En conséquence, la culture canadienne-française devient peu à peu, à toutes fins pratiques, la culture québécoise. Entre 1960 et 1976, une nation québécoise est née.
Une telle mutation ne pouvait que mettre en lumière le problème des minorités, d'abord celui des minorités francophones disséminées à travers le Canada, puis celui de la minorité anglophone du Québec.
Depuis longtemps, la population canadienne-française vivant en dehors du Québec était soumise à un taux d'assimilation assez élevé. Mais on pouvait toujours attribuer cette assimilation à l'indifférence, voire à l'hostilité des gouvernements provinciaux anglophones qui se refusaient à reconnaître à cette population les droits qu'elle revendiquait. Tout en espérant un sort meilleur, on pouvait toujours cependant s'appuyer sur une certaine fidélité à la langue et à la religion des ancêtres. Il avait été possible en effet aux Canadiens français de survivre dans la mesure où ils vivaient dans des enclaves plus ou moins étanches. Une paroisse francophone a pu longtemps constituer un milieu de vie unifié, un ensemble relativement autonome au point de demeurer presque imperméable au milieu anglophone environnant. Mais l'accélération de la mobilisation sociale vint bouleverser cette situation. Comme nous le notions plus haut, ce qui a produit au Québec une plus grande homogénéisation de la population francophone et un resserrement des liens entre Canadiens français devait détruire ailleurs l'autonomie de ces foyers de vie francophone. Au moment où les habitants du Québec devenaient plus québécois, ceux de l'Ontario devenaient plus ontariens.
Malgré tout, la population francophone hors Québec demeurait assez nombreuse et ses élites assez tenaces (encouragées souvent par un soutien tout à fait spécial de la part du gouvernement fédéral) pour reprocher aux Québécois de se dissocier d'elle en axant toutes leurs énergies sur l'État et le territoire du Québec. Mais, en vertu des raisons mentionnées plus haut, il ne pouvait pas en être autrement. Le jour où les francophones du Québec prenaient conscience d'être une majorité, ils ne pouvaient plus partager le sort d'une minorité avec leurs frères non québécois. Ils pouvaient cependant faire rayonner leur vitalité hors du Québec et étendre, en quelque sorte, le réseau de communications québécois outre-frontières. Et c'est bien ce qui s'est produit. C'est, en grande partie, en s'abreuvant à la source québécoise que les minorités françaises du Canada ont pu conserver ici et là une certaine identité culturelle. Ceci peut être dit sans condescendance de la part des Québécois. Ces derniers n'ont d'autre charisme que celui d'être assez nombreux pour constituer une véritable culture vivante et surtout pour contrôler un gouvernement.
Le cas des Acadiens doit être mis à part. Bien que victimes d'injustices et de discriminations tout au long de leur histoire, ils constituent, au Nouveau-Brunswick, une population assez nombreuse et compacte pour demeurer fidèles à des traditions qui leur confèrent une sorte d'identité nationale distincte de celle du Québec. Mais encore ici l'absence d'un réel contrôle sur un gouvernement n'a pas permis aux Acadiens de constituer un véritable réseau de communications. Et c'est, pour une bonne part, l'exemple québécois qui a favorisé l'éclosion d'un nouveau nationalisme et la création d'un parti acadien qui aspire à l'érection d'une province acadienne et, par là, d'un autre État francophone.
Le problème de la minorité anglophone s'est posé plus tard. Car cette population, en vertu de sa situation privilégiée, a mis du temps à prendre conscience de son statut minoritaire. D'ailleurs, privilèges mis à part, aussi longtemps que les Québécois francophones se disaient Canadiens français, il était bien normal que les anglophones, de leur côté, se disent Canadiens, le qualificatif d'anglais étant superflu du simple fait que le Canada était gouverné et contrôlé par une majorité anglophone. Les Québécois de langue anglaise faisaient donc tout bonnement partie de la majorité anglophone du pays et se percevaient bien nettement comme tels.
Mais à partir du moment où l'État du Québec se définit une responsabilité spéciale à l'endroit de sa majorité francophone et que cette dernière prit conscience de sa force en s'attribuant le nom de Québécois, il fallut bien que les anglophones deviennent une minorité québécoise. En raison de leur statut économique et de leur absence d'intérêt à la politique québécoise (notons qu'ils demeuraient toujours bien branchés sur le réseau de communications canadien, un réseau dont la ville de Montréal avait longtemps été le centre), les anglophones du Québec n'ont pas véritablement pris conscience du phénomène. Ils interprétaient les déclarations des premiers ministres du Québec et le nouveau nationalisme québécois comme une flambée passagère d'une rhétorique canadienne-française qu'ils n'avaient jamais prise au sérieux.
Le nationalisme québécois demeurait pourtant bien vivant. Outre le dynamisme nouveau de l'État, il inspirait des mouvements indépendantistes et même certaines formes de terrorisme. On réclamait ici et là l'unilinguisme, un McGill français, des raisons sociales francophones, etc. Déjà certaines élites anglophones s'inquiétaient, se résignaient avec plus ou moins bonne grâce à apprendre le français. Mais il fallut la législation sur la langue (la loi 22 de 1975, puis la loi 101 en 1977) pour provoquer la pénible prise de conscience d'être une minorité et de devoir s'intégrer (non pas nécessairement s'assimiler) à une majorité francophone un peu (bien qu'inévitable ment à un moindre degré en raison du contexte) comme les minorités françaises s'intégraient ailleurs.
La dynamique de l'État québécois, État national, n'a de sens que si cette intégration se produit. Le nationalisme québécois n'étant pas ethnique par sa nature, cette intégration est possible, bien que très difficile pour une population qui n'y était pas du tout préparée.
Il faut dire aussi que les Canadiens français du Québec, de leur côté, n'étaient pas mieux préparés à se concevoir autrement qu'en termes ethniques et qu'ils ont continué à affecter d'une telle connotation le vocable de Québécois qu'ils s'attribuaient. Pourtant, le nouveau vocable ne peut avoir d'autre signification que territoriale et culturelle. Une réalité nouvelle est apparue, celle d'un Québec jouissant d'un minimum d'autonomie dans les faits sinon de droit. Cette réalité n'a rien d'un phénomène ethnique, elle est issue du développement d'un système de communication, d'un certain dynamisme d'ordre culturel. Mais les populations sont le plus souvent en retard par rapport aux réalités qu'elles ont elles-mêmes engendrées. Tant que les Québécois francophones continueront de se percevoir comme des Canadiens français, il sera plutôt difficile de convaincre les anglophones qu'ils peuvent devenir des Québécois à part entière.
La dynamique de l'État québécois conduit-elle à la souveraineté entière du Québec ? En bonne logique, il faudrait répondre oui. En fait, il a toujours été question d'indépendance du Québec au cours de cette période, bien que ce ne fut jamais la politique officielle des gouvernements. Le mouvement indépendantiste, né timidement en 1958 comme un mouvement de droite, s'est alimenté au néo-nationalisme des années soixante et a pu bientôt s'identifier à des aspirations de gauche. Le mouvement avait assez de succès pour que les gouvernements lui fassent de l'oeil à l'occasion.
Déjà, en 1963, un membre du gouvernement Lesage (il faut dire qu'il s'appelait René Lévesque) déclarait : « Si nous n'arrivons pas, nous du Québec, à faire accepter le binationalisme, il faudra penser à nous séparer [11] ». Plus tard, Daniel Johnson publiait un ouvrage sous le titre : Égalité ou indépendance. Et même Robert Bourassa pouvait brandir la menace séparatiste dans ses négociations avec le premier ministre du Canada. On a dit qu'il comptait, en 1976, sur une forte opposition du Parti québécois pour pouvoir s'opposer plus résolument aux visées du gouvernement fédéral.
Mais l'axe central des politiques québécoises n'était pas indépendantiste. Il s'agissait seulement d'obtenir pour l'État québécois tous les pouvoirs lui permettant d'assumer ses responsabilités à l'endroit d'un peuple. Fallait-il conférer au Québec le statut d'État-nation qui ne s'entend guère sans la souveraineté ? Aucun gouvernement de 1960 à 1976 n'est allé jusque-là. Chacun a espéré que cet État québécois se construise au sein de la Confédération canadienne. Mais tout s'est passé comme si on était tellement affairé à construire cet État que son statut constitutionnel demeurait au second plan. L'essentiel de la dynamique québécoise, comme cet ouvrage le démontrera amplement, consistera à aménager une société nouvelle, distincte de celle du Canada anglais, bien qu'en étroite relation avec elle.
Ce travail s'est avéré assez accaparant pour qu'on puisse se permettre de retarder l'échéance du grand choix constitutionnel. Il a fallu quand même faire face au géant fédéral à tous les détours du chemin. Car à la logique québécoise s'opposait une logique toute aussi ferme, celle de l'État national de tous les Canadiens.
Le Québec et son rival

Tant et aussi longtemps que les élites canadiennes -anglaises se contentaient de définir le Canada comme une fière composante de l'Empire ou du Commonwealth britannique et renonçaient en conséquence à considérer le pays comme une nation, le nationalisme canadien-français ne constituait pas une véritable menace à l'équilibre précaire de la Confédération canadienne. Les Canadiens français -pouvaient se dire une nation, ils demeuraient toujours sujets britanniques et, sauf en de rares exceptions (comme aux moments des deux crises de la conscription), d'assez loyaux sujets. L'État fédéral, en temps de paix, demeurait assez distant, assez peu interventionniste pour permettre aux provinces qui le souhaitaient de conserver l'illusion d'une certaine « souveraineté », d'autant plus que les gouvernements provinciaux, celui du Québec notamment, exerçaient en pratique peu de pouvoir.
Mais à compter de la fin de la Première Guerre mondiale, le Canada accédait peu à peu à l'autonomie et prenait conscience, face à la Grande-Bretagne, de sa vocation proprement nord-américaine. Le statut de Westminster sanctionnait, en 1931, la souveraineté du Dominion. Le gouvernement du Canada pouvait désormais agir comme un gouvernement moderne et s'appliquer à construire une nation canadienne. Au même moment, la crise économique sonnait le glas du laissez-faire libéral et provoquait l'avènement du Welfare State. Au Canada, comme ailleurs, l'État devient plus interventionniste : il faut redistribuer la richesse, stimuler l'économie, venir en aide aux défavorisés, assurer la sécurité des citoyens, etc. Le gouvernement fédéral met sur pied des programmes d'aide sociale, tels que les pensions de vieillesse, les allocations familiales. De plus, fort de la vocation qu'il s'était donnée dès le début de la Confédération dans le domaine des transports (ferroviaires surtout), il avait pris l'initiative dans le champ des communications qui s'élargissait de plus en plus sous l'effet du progrès technique : radiodiffusion (Radlo-Canada), cinéma (Office national du film), aviation civile (Trans-Canada Airlines devenu plus tard Air Canada), projet de route transcanadienne.. Des commissions d'enquête (Rowell-Sirois, Massey) allaient contribuer à accentuer ce mouvement et accorder de nouvelles responsabilités au gouvernement central, notamment en matière de culture. Enfin, l'engagement du Canada dans le second conflit mondial nécessite encore une plus grande centralisation du pouvoir politique. Le gouvernement pourra sortir de la guerre comme un véritable géant par rapport à ses homologues provinciaux. De plus en plus, l’État fédéral devenait un État-nation moderne, préoccupé du bien-être de tous les Canadiens, soucieux de rapprocher les citoyens du Canada les uns des autres et de présider en définitive à l'épanouissement d'une grande nation canadienne.
Face à cet envahissement, auquel s'appliquait une fonction publique croissant sans cesse en qualité et en nombre, le gouvernement provincial du Québec opposait une fin de non-recevoir, des protestations multiples mais, comme il n'offrait aucune solution de rechange, demeurait incapable, pour l'essentiel, d'endiguer le courant.
C'est dans ce contexte qu'apparut en 1960 un État québécois soucieux d'intervenir à son tour dans la dynamique sociale et bientôt conscient de ses responsabilités « nationales ». On s'en est réjoui à Ottawa, mais pour bien peu de temps. Car l'accession du Québec à l'âge moderne le plaçait inévitablement en concurrence avec le pouvoir fédéral. Comme à peu près toutes les politiques issues du grand courant de modernisation de l'appareil étatique fédéral étaient de constitutionnalité douteuse, les gouvernements du Québec ne cesseront, entre 1960 et 1976, de défier ces politiques au nom de la nouvelle prétention de l'État québécois à des responsabilités particulières à l'endroit d'une nation et surtout au nom de sa volonté de créer un véritable réseau de communications québécois.
Il est significatif qu'après les batailles fiscales, les querelles de juridiction en matière de régimes de rentes, de relations internationales, de politiques sociales, ce soit sur le plan des communications que les dissensions aient été les plus vives entre Ottawa et Québec, peu avant 1976. Car ce sont les communications qui constituent vraiment l'ossature d'une société moderne ; ce sont elles qui permettent à une nation de se constituer et de s'affermir. C'est grâce à son contrôle sur les communications qu'un État moderne rassemble les éléments épars d'une société et préside à l'affirmation d'une identité collective.
Il était donc naturel que chaque gouvernement québécois, dans son désir de construction d'un Québec moderne, État national des Canadiens français, s'oppose au gouvernement fédéral. jean Lesage, ancien membre du très centralisateur gouvernement de Louis Saint-Laurent, aura eu le bonheur de se trouver en face d'un gouvernement conservateur présidé par John Diefenbaker, absolument imperméable aux nouvelles aspirations québécoises (ses 50 députés québécois, dont certains étaient d'authentiques nationalistes, n'y pouvaient strictement rien). Cela lui permit de s'attaquer avec plus d'ardeur à la centralisation qu'il avait jadis endossée. Daniel Johnson affirmera bien haut la volonté québécoise à la Conférence inter-provinciale de Toronto en 1967, puis aux conférences fédérales -provinciales de 1968. Jean-Jacques Bertrand marchera dans la foulée de son prédécesseur. Et même Robert Bourassa, tout en se faisant le champion du fédéralisme, refusera le projet fédéral de rapatriement de la Constitution à Victoria, en 1971, engagera la bataille des communications et proclamera la « souveraineté culturelle » du Québec. On a souvent souligné l'ambiguïté de cette dernière formule. Elle avait au moins l'avantage d'opposer un démenti québécois à la formidable panoplie de politiques fédérales en matière de culture. La seule souveraineté culturelle du Québec signifierait, entre autres, le démantèlement du Conseil des arts, de l'Office national du film, de Radio-Canada et de tout l'arsenal de la diplomatie culturelle aux Affaires extérieures. Les membres du gouvernement fédéral ont bien compris que cette « souveraineté culturelle », si mal définie et si timidement affirmée fut-elle, constituait une véritable menace. Ils se sont en effet employés à la tourner en dérision, non sans un certain succès, puisqu'elle provenait d'un gouvernement qui perdait de plus en plus de sa crédibilité et que la « souveraineté culturelle » était aussi ridiculisée au Québec, pour des raisons diamétralement opposées.
Le pouvoir québécois était donc devenu plus qu'un simple contestataire, comme il l'avait été sous Duplessis. Il se posait désormais comme un rival, il entendait jouer, dans plusieurs secteurs vitaux relatifs à ses responsabilités nationales, un rôle qu'Ottawa s'était accoutumé à considérer comme le sien. On pouvait d'ailleurs se targuer, dans la capitale fédérale, d'avoir fait davantage pour le progrès de la culture canadienne-française qu'aucun gouvernement provincial québécois. L'élite québécoise s'était d'ailleurs habituée, au cours des années cinquante surtout, à considérer que les politiques progressistes ne pouvaient venir que d'Ottawa. C'est à Ottawa seulement que s'était développée une fonction publique éclairée, à l'abri du petit patronage local.
Or, voici que Québec relevait le défi de renverser cet ordre de choses. De façon assez rapide et spectaculaire, la fonction publique québécoise s'est mise à s'enrichir des meilleurs talents issus des universités du Québec en plein élan, issus aussi de la capitale fédérale où des fonctionnaires francophones n'arrivaient pas à imposer leur langue de travail. Très tôt, la rivalité Québec-Ottawa est devenue une rivalité bureaucratique. Les nouveaux agents d'un secteur public québécois en croissance vertigineuse n'entendaient pas se contenter d'exercer les pouvoirs tronqués auxquels l'administration publique provinciale était réduite. Ils devinrent donc les artisans les plus résolus du nouveau nationalisme. Leur dynamisme, leur passion du pouvoir les amenaient à proposer, sinon à imposer, à leurs patrons, des exigences de plus en plus articulées vis-à-vis du pouvoir fédéral. Ce serait sans doute trop réduire ce nationalisme que d'en faire une simple lutte de pouvoir conçue par des administrateurs ambitieux. Car le phénomène, en plus de puiser dans les racines profondes de la conscience collective, s'est manifesté bien au-delà des officines gouvernementales. Mais il est bien vrai que l'administration publique a constitué le centre nerveux de l'affrontement Québec-Ottawa.
Les fonctionnaires fédéraux n'ont jamais accepté, de leur côté, les nouvelles revendications québécoises, non pas tellement, comme on l'a toujours dit, parce qu'elles menaçaient de faire éclater la Confédération, mais parce qu'elles signifiaient une perte de pouvoir qui remettait en cause des fonctions qu'on s'était habitué à considérer comme essentielles. Pour certains d'entre eux, les nouvelles prétentions québécoises les invitaient à se faire hara-kiri, une opération rarement acceptable en milieu bureaucratique.
On s'est donc empresse à contrecarrer de toutes sortes de façons l'ambition québécoise fondamentale, celle qui consistait à présider aux destinées de la francophonie canadienne identifiée à la nation québécoise. Il fallait démontrer que le Canada était aussi la patrie des Canadiens français ou, en d'autres termes, que les francophones pouvaient se sentir chez eux partout au Canada. La vaste enquête royale sur le bilinguisme et le biculturalisme fut mise sur pied précisément pour relever ce défi. Elle n'en devait pas moins aboutir à un rapport qui mettait en relief le concept de majorité, ce qui revenait à dire que la majorité québécoise était le point d'appui de la culture francophone au Canada. La loi sur les langues officielles ramenait la question à de moins dangereuses considérations : elle voulait seulement démontrer qu'un francophone pouvait se sentir canadien au même titre qu'un anglophone en faisant en sorte que la langue française ait droit de cité partout au Canada. En d'autres termes, on voulait mettre sur pied un véritable réseau de communications francophone à la largeur du Canada, ce qui revenait à annuler la prétention essentielle du gouvernement québécois. Les minorités françaises de l'Ontario, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick devinrent tout à coup les points de mire du pouvoir outaouais. La radio française de Vancouver, la francophonie torontoise et, au premier chef, le French power à Ottawa furent cités comme des exemples typiques d'une responsabilité outaouaise à l'endroit du fait français et comme une réfutation définitive des aspirations québécoises. On s'appliquait encore à manipuler les statistiques en affirmant, par exemple, à l'étranger que près d'un million de francophones vivaient en Ontario et que près de la moitié de la population du Nouveau-Brunswick était de langue française. Il eut été aussi juste, mais combien moins frappant de dire que les francophones comptaient pour dix pour cent en Ontario et se dénombraient à environ 300 000 au Nouveau-Brunswick !
Jamais donc l'aspiration québécoise essentielle (le Québec, expression politique du Canada français) ne fut, je ne dis pas reconnue, mais seulement discutée dans les milieux fédéraux. Cette aspiration comme telle, il faut toujours le souligner, n'était pas séparatiste. Elle fut défendue par quatre premiers ministres fédéralistes. Il n'est certes pas impensable d'imaginer une Confédération canadienne où le Québec serait défini comme essentiellement français et le reste du pays comme essentiellement anglais, ce qui est bien près de correspondre à la réalité. Mais pourtant, c'est ce type de clivage qui est toujours apparu à Ottawa comme l'hérésie suprême. Tout indique même que cette « hérésie », et l'abandon de fonctions qu'elle entraîne avec elle pour le gouvernement d'Ottawa, est envisagée par plusieurs comme un mal plus redoutable que l'indépendance du Québec elle-même. Voilà pourquoi sans doute on insiste, en bonne orthodoxie fédéraliste, pour forcer les Québécois à l'impossible dilemme : l'indépendance ou la Confédération existante.
Pourtant, la grande majorité des Québécois s'est toujours refusée à poser le problème en ces termes extrêmes. Un fort mouvement indépendantiste, incarné surtout dans le Rassemblement pour l'indépendance nationale, s'est attiré des appuis importants au cours des années soixante. Mais jamais il n'a véritablement mordu sur le pouvoir : il n'a recueilli que neuf pour cent des votes en 1966. Quand le mouvement indépendantiste, à la faveur du durcissement des positions outaouaises sous Pierre Elliott Trudeau, se rallia autour d'un parti appelé à un appui croissant de l'électorat et à la prise du pouvoir en 1976, il dut sacrifier beaucoup de la pureté de son idéal. René Lévesque insista, dès 1967, pour accoler le mot association à celui de souveraineté. Et la force de l'indépendantisme du Parti québécois est en proportion inverse de sa popularité. (Autrement dit, plus le Parti québécois s'est imposé à la population, moins il devait insister sur l'idéal d'indépendance.)
Puisque jamais plus de vingt pour cent de Québécois n'ont favorisé la souveraineté complète, le nationalisme québécois doit nécessairement se situer en deçà de cet idéal. Il n'est donc pas incompatible avec un certain canadianisme. En affirmant bien haut leur identité collective, en se donnant un État national bien à eux, les Québécois veulent continuer de manifester une certaine allégeance à l'État fédéral. Ce paradoxe s'est exprimé fréquemment par un appui massif à la présence de francophones à Ottawa au moment même où les gouvernements québécois étaient élus à partir de plates-formes nationalistes.
Peut-être ce paradoxe se résout-il dans une réalité qu'on n'a guère soulignée au cours des vingt dernières années. C'est qu'à bien des égards, la Révolution tranquille a contribué à introduire le Québec dans la modernité nord-américaine et a rendu les Québécois plus aptes à partager des valeurs avec les autres Canadiens et les a en quelque sorte intégrés davantage au Canada. Qui pourrait nier que les Québécois connaissent mieux le Canada anglais aujourd'hui qu'en 1960, voyagent davantage à travers le pays et que leur mode de vie est moins différent de celui des Canadiens anglais qu'il l'était il y a vingt ans ?
Il n'est pas contradictoire que le nationalisme accompagne cette réalité. Au contraire, l'aspiration nationaliste peut bien être une sorte de réaction à l'intégration qu'on veut compenser, sans la rejeter tout à fait, par une affirmation plus intense de l'identité collective.
Dans cette perspective, la construction d'un réseau de communications québécois ne doit pas être vue comme une façon d'annihiler toute forme d'intégration à un ensemble plus grand mais de faire en sorte que l'ouverture aux autres puisse se réaliser selon des voies qui permettent aux Québécois francophones de s'exprimer tels qu'ils sont, sans devoir renoncer à leur propre culture.
Tout s'est donc passé comme si les Québécois entendaient jouer sur deux plans : un renforcement du pouvoir québécois, une vocation nationale attribuée à l'État québécois ; mais aussi une sorte de bouée de sauvetage au niveau fédéral, au cas où les choses iraient trop mal à Québec. C'est là une autre question qui dépend probablement davantage des Canadiens anglais que des Québécois. Il importait seulement de souligner ici que le nationalisme s'est accommodé jusqu'ici, non pas du statu quo de la Confédération, mais d'une espérance qu'un État national du Québec puisse exister au sein d'une Confédération canadienne décentralisée.
Un nationalisme envahissant

Le nationalisme n'a pas été qu'une réponse aux empiétements du pouvoir fédéral. Il s'est manifesté à tous les niveaux de la société et il devenait peut-être inévitable qu'il se manifeste au moment même où la société québécoise subissait les transformations profondes qui remettaient en question les traditions les plus tenaces. C'est d'ailleurs, comme nous le soulignions plus haut, parce que d'anciennes solidarités s'écroulaient que le nationalisme moderne est apparu.
Dans cette perspective, le nationalisme peut être envisagé, au Québec comme ailleurs, comme une réaction au stress provoqué par la modernisation des structures sociales. À l'intérieur de ces nouvelles structures anonymes, l'individu, habitué à un entourage familier et réconfortant, se sent déboussolé et éprouve le besoin de renouer contact, d'une nouvelle façon, avec la tradition. Le nationalisme lui permet de redéfinir son enracinement sans pour autant lui faire renoncer aux avantages de la modernisation. Ainsi, par exemple, on peut se trouver à la fois devant un appareil de télévision et se plaire à l'évocation du folklore, passer une soirée à la Place des arts de Montréal et replonger dans un passé révolu en applaudissant aux chansons de Gilles Vigneault. Ce n'est donc pas par hasard que les artistes ont exprimé avec une ferveur nouvelle et avec une constance presque universelle l'aspiration du Québec à la souveraineté. Par la magie des mots, de la musique ou des formes, ils ont entretenu, avec plus de vigueur encore que les politiciens, l'identité collective d'un peuple en mal de croissance. Ils répondaient sans doute à des sentiments profonds de la population et conféraient par là au nationalisme une authenticité qu'on ne trouvait pas chez les leaders politiques. On peut toujours accuser ces derniers de manipuler les masses et de mettre le nationalisme au service de leurs ambitions. Il est plus difficile de porter la même accusation envers les artistes.
D'ailleurs, au-delà d'un ordre politique quasi omniprésent, le nationalisme a été à l’œuvre presque partout dans la société québécoise, à l'école, dans les syndicats, dans l'économie, dans les associations à but non lucratif. Partout, on retrouvait la même conscience d'être Québécois, de construire une société originale en Amérique du Nord.
Au sein de la plupart des organisations canadiennes, qu'elles soient d'ordre académique, sportif, commercial, technique, sont nées des ailes québécoises revendiquant une sorte de statut particulier au nom d'une manière proprement québécoise de penser et de faire les choses. Comme au plan politique, on ne désirait pas le plus souvent couper tous les liens avec la structure canadienne. Et dans la plupart des cas, des formules de compromis ont été inventées permettant aux Québécois de se donner une double allégeance. On pouvait presque toujours être à la fois membre de l'association canadienne et d'une nouvelle organisation québécoise francophone. Rarement la bilinguisation des grandes associations a satisfait aux exigences des Québécois. On a voulu d'abord travailler en français entre Québécois et ensuite s'associer aux anglophones le plus souvent dans leur langue.
Le nationalisme a été plus fervent, plus sonore, plus intense chez les jeunes que dans tout autre groupe. Les étudiants, en particulier, introduits tout à coup dans les grandes structures anonymes des polyvalentes, des cégeps et des universités géantes, se sont accrochés passionnément à l'idéal nationaliste qui leur permettait de découvrir une nouvelle solidarité et une raison d'être au milieu des bouleversements que subissait leur curriculum. De plus, il leur était possible de contester, de se révolter tout en étant nationalistes, ce qui aurait été à peu près impensable pour leurs parents à une époque où le nationalisme était presque indissociable ment lié au conservatisme.
Car le nationalisme québécois nouvelle vague pouvait fort bien, sans se renier, épouser les idées les plus à gauche. À la grande stupeur de l'équipe de la revue Cité libre qui, au cours des années cinquante, avait associé sa remise en question des institutions au rejet du nationalisme, la rédaction de Parti pris devançait ses aînés de plusieurs coudées vers la gauche et donnait en même temps à la révolution qu'elle prônait une couleur nationaliste. On inventait - ou on cherchait à inventer - un marxisme à la québécoise à l'instar des néo-marxistes européens.
Non pas que le nationalisme québécois ait été monopolisé par la gauche. Bien au contraire, si l'on considère par exemple l'idéologie qui prévalait au sein des sociétés Saint-JeanBaptiste ou encore à l'assemblée des États généraux du Canada français (où le virage québécois a été effectué de façon fort significative vers 1967), on demeure persuadé que le nationalisme ouvrait largement ses portes à la droite. Mais il était devenu possible d'être à la fois de gauche et nationaliste. En fait, le nationalisme québécois, comme la plupart de ses contreparties contemporaines, voulait transcender les clivages idéologiques et rassembler toutes les énergies d'un peuple.
On ne pouvait pas non plus accuser de bonne foi et en connaissance de cause le mouvement national d'engendrer une sorte d'isolationnisme ou de fermeture de la société québécoise. C'est plutôt le contraire qui était vrai. C'est à la faveur d'une ouverture au monde contemporain que le néo-nationalisme québécois est né. Les premiers indépendantistes s'appuyaient sur la décolonisation à l'échelle mondiale pour faire valoir leur doctrine. Le gouvernement québécois affirmait sa responsabilité nationale au moment même où il se souciait d'établir des liens avec d'autres régions du monde. Les deux phénomènes se sont même renforcés et stimulés l'un l'autre. C'est en découvrant le monde que les Québécois ont éprouvé le besoin de se donner une identité et c'est en désirant affirmer cette identité qu'ils ont voulu occuper le champ des relations internationales. C'est d'ailleurs au niveau de l'extension des compétences de l'État québécois à la sphère internationale que le conflit Ottawa-Québec s'est fait le plus virulent.
Ainsi donc le nationalisme québécois s'était alimenté à tout ce qui lui permettait de répondre aux accusations qu'on lui portait. Il avait dépassé le conservatisme inhérent à la pensée nationaliste canadienne-française, il se manifestait au-delà des murs d'une société fermée, il accompagnait et renforçait tout ce qu'on s'était habitué à considérer comme un dépassement de l'idéologie nationaliste. Il avait même évacué, au moins dans sa logique interne sinon dans les mentalités, la notion d'ethnicité qui menace toujours de glisser vers le racisme.
Conclusion

Cette période se termine le 15 novembre 1976, journée historique de la prise du pouvoir par un parti souverainiste. Il était peut-être inévitable que le mouvement déclenché en 1960 aboutisse à la formation d'un gouvernement voué à l'idéal de la souveraineté, surtout si l'on considère qu'Ottawa ne s'était jamais vraiment préoccupé de répondre aux aspirations fondamentales des gouvernements québécois, exprimées depuis 1960.
L'avènement du Parti québécois au pouvoir a été considéré comme une rupture. Un changement de gouvernement en est toujours une, d'une certaine manière. Mais, à bien des égards, au moins du point de vue de ce qui fait l'objet de ce chapitre, cet événement s'inscrit dans une continuité. Il est fort plausible de soutenir que le Parti québécois (au moins tel que perçu par l'électorat) est bien davantage l'héritier de la Révolution tranquille que des mouvements indépendantistes. Ce parti a été fondé par des hommes qui avaient combattu pour assurer au Québec un statut d'État national au sein de la Confédération canadienne et que les refus d'Ottawa avaient désenchantés. L'insistance avec laquelle le nouveau gouvernement a sans cesse rappelé qu'il entendait promouvoir une nouvelle association bien plutôt qu'une séparation, laisse croire qu'il poursuit toujours l'idée centrale du nationalisme québécois, telle qu'exposée plus haut.
La souveraineté-association, prônée par ce gouvernement, peut être vue comme l'aboutissement logique de la dynamique nationaliste de l'État québécois, l'établissement d'un véritable État national souverain à l'intérieur d'une nouvelle union canadienne reposant sur la dualité. Il n'est pas moins plausible de concevoir que l'État du Québec puisse continuer de jouer son rôle dans le cadre d'un fédéralisme renouvelé où la souveraineté québécoise demeurerait limitée. Déjà la charte de la langue française, devenue loi, a contribué fortement à accréditer l'idée d'un Québec français juxtaposé au Canada anglais, sans pour cela que le Québec soit devenu un État souverain. Le projet de souveraineté-association lui-même, présenté comme un objet de négociation, n'est peut-être pas autre chose qu'un instrument privilégié en vue d'imposer un renouvellement du fédéralisme canadien propre à satisfaire aux aspirations québécoises.
Quoi qu'il en soit, le nationalisme québécois, dans la mesure où il continue d'inspirer la dynamique de l'État du Québec, semble devoir s'accommoder pour longtemps de l'union canadienne, sous une forme ou sous une autre.
Les chapitres qui suivent nous montreront cette dynamique à l’œuvre.
[2] Voir Karl W. Deutsch, Tides Among Nations, New York, MacMillan (The Free Press), 1979, p. 301. Également du même auteur, Nationalism and Social Communication, Cambridge, Mass. The MIT Press, 1966.
[3] Voir Karl W. Deutsch, op. cit., pp. 302-303.
[4] Voir Karl W. Deutsch, op. cit., pp. 304-305.
[5] Cité libre, 12 :35, mars 1961, pp. 3-4.
[6] 20 septembre 1964, cité par Claude Morin dans Le combat québécois, Montréal, Boréal Express, 1973, p. 68.
[7] Discours à la Conférence constitutionnelle canadienne, Ottawa, 10-12 février 1969, cité par Giuseppe Turi, Les problèmes culturels du Québec, Montréal, La Presse, 1974, p.
[8] Le Devoir, 10 octobre 1963, p. 8.
[9] Voir Claude Morin, op. cit., p. 60.
[10] Allocution d'ouverture à la Conférence interprovinciale tenue à Toronto du 27 au 30 septembre 1967, cité par Giuseppe Turi, op. cit., p. 52.
[11] Le Devoir, 4 novembre 1963, p. 1.
|

