| [23]
Louis BALTHAZAR
Université Laval
“Les nombreux visages
du nationalisme québécois.”
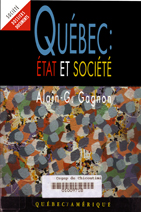
Un texte publié dans l’ouvrage sous la direction d’Alain-G. Gagnon, Québec: État et société. Tome I, première partie: Le nationalisme québécois et la réforme constitutionnelle, chapitre 1, pp. 23-40. Montréal: Les Éditions Qué-bec/Amérique, 1994, 509 pp. Collection: Société: dossiers documents.
Pour le meilleur et pour le pire, le nationalisme n'a jamais cessé d'accompagner l'existence collective des francophones du Québec. Au moment même où on annonçait la disparition des mouvements d'affirmation ou de revendication fondés sur la conscience nationale, d'autres manifestations de nationalisme faisaient surface. Tout se passe comme s'il s'agissait d'un phénomène destiné à revenir en force dès lors qu'on cesse d'en tenir compte. Cela vaut pour l'ensemble du monde autant que pour le Québec. Ainsi, dès 1983, Anthony D. Smith (1983, p. XXXVI) prévoyait l'émergence de nombreux mouvements nationalistes au cours des années à venir. L'effondrement soudain des régimes communistes a conféré à cet énoncé une force et une pertinence particulière, bien au-delà de ce que quiconque pouvait entrevoir. Le nationalisme est donc plus vivant et plus contagieux que jamais au Québec et en divers points du globe. Nous aurions bien tort cependant d'embrasser d'un seul regard et d'assimiler les unes aux autres les diverses manifestations nationalistes.
Au Québec même, le nationalisme s'est montré sous des visages fort différents. Il est donc nécessaire, avant toute tentative d'évaluation du phénomène, d'établir la signification de concepts aussi vagues et généraux que nation et nationalisme, pour en venir à coiffer les diverses facettes de leurs applications. L'examen de quelques théories explicatives pourra aussi contribuer à l'intelligence du passage d'un nationalisme traditionnel canadien-français à un nationalisme québécois de type moderne, qui s'est manifesté de diverses façons. C'est la forme modérée qui a été la plus proche de faire l'objet d'un consensus dans la majorité de la population. Enfin, au cours des années 1980, ce nationalisme majoritaire a pris des allures nouvelles.
Définitions et théories, nationalisme canadien-français, émergence d'une identité québécoise, éléments du consensus modéré et nouveaux paramètres feront donc l'objet de ce chapitre [1].
QU'EST-CE QUE LE NATIONALISME ?
On trouve dans la littérature d'innombrables définitions du nationalisme, très différentes les unes des autres, parfois même contradictoires. Pour la plupart, ces définitions sont négatives et renvoient à une doctrine perverse, à un comportement fanatique, à un dévouement total à la nation considérée comme un tout parfaitement englobant devant encourager la haine de tous ceux qui n'appartiennent pas à cet ensemble. De telles définitions ne peuvent guère être utiles à l'analyste canadien qui [24] cherche à comprendre le comportement de personnes qui se laissent rarement aller à de tels excès. Qu'il s'agisse du nationalisme canadien, de celui des Québécois ou de celui des autochtones, il est plutôt rare qu'on puisse les caractériser par un sentiment d'appartenance intransigeant, haineux et incompatible avec l'ouverture à l'extérieur.
Personne ne saurait nier cependant que le nationalisme ait souvent produit d'horribles résultats, tout particulièrement lorsqu'il a été associé à des régimes fascistes, notamment dans la première moitié du XXe siècle. La meilleure définition sera donc celle qui sera assez neutre pour ne pas anticiper les bons ou les mauvais effets du phénomène. Anthony D. Smith (1976, p. 1) nous offre une telle définition : « Un mouvement idéologique en vue de la conquête et du maintien de l'autonomie, de la cohésion et de l'individualité d'un groupe social considéré par ses membres comme une nation en fait ou en puissance [2] ».
Le nationalisme apparaît donc, à Smith et à plusieurs autres, à la fois comme un mouvement et comme une idéologie. Smith (1983, p. 21) évoque une doctrine nationaliste selon laquelle les nations ne se réalisent que dans des États qui leur correspondent et la loyauté à l'État-nation doit primer toutes les autres. Voilà une idéologie à laquelle beaucoup de nationalistes québécois ne sont pas disposés à souscrire. Par ailleurs, le nationalisme peut fort bien être considéré comme une coquille vide susceptible de recevoir des contenus idéologiques divers. Libéralisme, fascisme, socialisme ont été tour à tour associés au nationalisme, comme l'a bien montré Léon Dion (1975) dans le cas du Québec.
Tout en acceptant les autres éléments de la définition de Smith, il semble donc préférable d'en retirer le mot « idéologique » et de considérer le nationalisme comme un mouvement qui ne relève, comme tel, d'aucune idéologie particulière mais bien plutôt d'une valorisation de l'appartenance nationale plus ou moins intense selon les cas.
Cela nous ramène au mot nation. Voilà un concept plus fluide encore que celui de nationalisme. Dans son acception contemporaine, qui ne remonte qu'à environ deux cents ans, la nation trouve son sens dans le « Contrat social » tel qu'il a été conçu par Jean-Jacques Rousseau et appliqué ensuite à l'État de la Révolution française. Le cri de « Vive la nation » lancé à Valmy par les soldats révolutionnaires devint presque instantanément un mythe fort puissant qui se propagea rapidement à travers l'Europe et, plus tard, à travers le monde.
La nation a été repensée par la suite, non plus comme une création artificielle mais comme un fait de nature enraciné dans l'histoire. Contrairement aux Français et aux Américains, qui envisageaient l'appartenance nationale comme résultat de la volonté libre, les intellectuels allemands ont défini la nation en fonction des origines ethniques et culturelles. Ernest Renan leur opposa la formule du « plébiscite de tous les jours ». C'est là un idéal de citoyenneté et d'égalité qu'on peut encore aujourd'hui confronter aux manifestations ethnocentristes du nationalisme.
Le concept de nation demeure tellement arbitraire que bien des auteurs n'y ont vu autre chose qu'une conception purement subjective de la communauté (Seton-Watson, 1977, p. 5). On peut tout de même relever quelques facteurs qui permettent le plus souvent à des personnes de se constituer en nation : des habitudes de vie, des liens culturels qui perdurent depuis un certain temps dans la trame d'une histoire commune. Sans durcir indûment le concept, tout en lui conservant ses notes subjectives évidentes, il est [25] donc possible de lui attribuer quelques éléments objectifs comme la culture commune, l'histoire commune, des aspirations partagées, un territoire donné et, le plus souvent, une organisation politique au moins embryonnaire.
On a souvent décrit la nation comme un produit imaginaire, une pure construction de l'esprit, une illusion entretenue dans la population par des élites en mal de pouvoir. Il est bien vrai que le sentiment national a toujours été, pour une bonne part, le produit d'un certain conditionnement social. Mais comme cela est également vrai pour tous les mouvements sociaux et politiques, pour à peu près tous les regroupements imaginables, on n'est guère plus instruit sur le sens du concept de nation quand on a établi son caractère artificiel. Car il se trouve peu de personnes aujourd'hui pour considérer la nation comme un donné naturel ou comme une essence éternelle ! Par contre, on peut mettre en évidence les fondements sociologiques sur lesquels s'appuie le plus souvent la construction nationale. Quelques théories ont été élaborées dans ce sens et nous éclairent sur le passage d'une forme de nationalisme à une autre.
Pour Karl Deutsch (1966, 1979), le nationalisme doit s'entendre surtout comme un produit des communications modernes, plus particulièrement de ce qu'il dénomme mobilisation sociale, c'est-à-dire le passage d'une économie de subsistance et de l'isolement aux pratiques résultant de la technologie moderne et des progrès des moyens de communication (1979, p. 302). Tant que des populations demeurent non mobilisées, regroupées dans de petites localités, où les individus communiquent relativement peu entre eux et très peu avec l'extérieur, l'appartenance nationale ne peut être très signifiante. En revanche, au moment où un grand nombre de personnes est mobilisé par des communications intenses et fréquentes de type urbain (bien que cela ne se produise pas nécessairement dans les villes), les anciennes formes de solidarité comme la famille, l'organisation religieuse, le village ou la région perdent leur pertinence et leur force d'attraction. Ces personnes seront facilement happées par de nouvelles allégeances. C'est alors qu'une langue et une culture communes à de grands ensembles sociaux anonymes constituent des points de ralliement nouveaux. « Plus le besoin est grand de communiquer pour faire sa vie, plus grande est l'importance de la langue et plus grande sera la motivation de préférer sa propre langue. »(Deutsch, 1979, p. 303). Voilà qui correspond assez bien à la situation québécoise de l'après-guerre, comme on le verra plus bas. Une population récemment et rapidement mobilisée peut éprouver une sorte de choc quand elle se trouve subitement face à la domination des moyens de communication moderne par une minorité linguistique. Un tel choc peut se traduire en nationalisme.
Ernest Gellner souligne aussi l'importance d'une langue maternelle enseignée à l'école et largement utilisée par des élites dans la production du nationalisme. « On assiste à la mise en place d'une société anonyme et impersonnelle [...] dont la cohésion dépend surtout d'une culture commune [...], là où se trouvait une structure complexe de groupes locaux, pétris de culture populaire [...] » (1989, p. 88). Pour Gellner, le nationalisme est une construction mais il reflète le phénomène réel de la modernisation et de l'urbanisation : « Si la mobilité et la communication hors contexte deviennent l'essence de la vie sociale, la culture dans laquelle on a appris à communiquer devient le centre de l'identité. » (1989, p. 94).
Les nations sont donc aménagées, consolidées, construites, mais elles s'appuient habituellement sur des liens culturels bien établis et sur le besoin nouveau [26] qu'éprouvent les populations de se regrouper pour se retrouver dans l'univers dense des communications modernes devenues nécessaires.
Ces théories peuvent bien rendre compte de la montée du nationalisme moderne dans les sociétés industrialisées. Mais elles ne nous renseignent guère sur les formes plus traditionnelles de nationalisme. Il nous faut, pour cela, porter le regard sur le nationalisme qui s'est développé au centre de l'Europe au XIXe siècle. Hans Köhn a bien dépeint ce phénomène. Alors que la Révolution française avait lancé l'idée d'une nation égalitaire fondée sur les droits et libertés tels qu'ils avaient été conçus par la philosophie des lumières, les Allemands et autres Européens du centre et de l'est ont réagi en opposant un sentiment national enraciné dans les traditions culturelles et le Volksgeist comme moteurs d'énergie et de solidarité préexistant à l'organisation politique (Köhn, 1956, p. 4). L'État français avait créé la nation française. La nation germanique allait créer l'État allemand. Cette réaction traditionaliste face à la modernité correspond assez bien à ce qu'on a appelé nationalisme au Québec entre 1840 et 1960. Voyons ce qu'il en restait durant les années de l'après-guerre antérieures à la révolution tranquille.
LE NATIONALISME CANADIEN-FRANÇAIS
Le nationalisme traditionnel était à la fois omniprésent et remis en question au Québec durant la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Ce nationalisme alimentait l'idéologie dominante, mais il devenait de plus en plus anachronique et en contradiction avec la vie quotidienne de la plupart des Canadiens français du Québec. Conçu pour animer une société rurale et attachée à ses traditions, un tel nationalisme perdait inévitablement sa pertinence auprès d'une population urbanisée et livrée aux effets spectaculaires de l'industrialisation.
Il peut apparaître même plutôt paradoxal que l'idéologie traditionnelle puisse encore animer le nationalisme officiel des Canadiens français dans une province déjà fortement industrialisée et dont la majorité de la population habitait la ville au moins depuis 1921. Les élites bourgeoises et cléricales du Québec ont réussi, à l'encontre de l'évolution sociale, à perpétuer l'idéal traditionnel pendant une trentaine d'années. Cela est dû, en grande partie, au fait que la population francophone du Québec accédait très lentement à la prise de conscience des nouvelles conditions de vie, ayant été plutôt imperméable dans l'ensemble à l'esprit du libéralisme économique. Ainsi, à l'intérieur même des villes, les vieilles structures paroissiales conçues en fonction de la vie rurale ont pu encadrer pendant plusieurs années les populations canadiennes-françaises du Québec. L'industrialisation ambiante était subie bien qu'acceptée, toujours considérée comme étant naturellement du ressort des Anglais tandis que les Canadiens français étaient encouragés à se concentrer sur la survivance, c'est-à-dire la préservation de leurs traditions culturelles, lesquelles s'exprimaient surtout à travers la langue et la religion. Ces consignes n'étaient pas suivies par tous. Mais elles n'ont pas été sérieusement remises en question par une idéologie bien articulée avant la Deuxième Guerre mondiale.
On peut dégager cinq traits caractéristiques de ce nationalisme traditionnel. D'abord, il était beaucoup plus culturel que politique. Non pas qu'il ait été absent des [27] tribunes politiques. Bien au contraire, les nationalistes canadiens-français se sont fait entendre au Parlement d'Ottawa aussi bien qu'à l'Assemblée nationale du Québec. On se souvient des combats livrés, entre autres, par Honoré Mercier et Henri Bourassa. Mais il est révélateur de noter que ce nationalisme a rarement atteint le niveau des réalisations politiques et qu'il n'a jamais produit une puissante organisation politique. Les tentatives du Parti national d'Henri Bourassa en 1911, de l'Action libérale nationale en 1935, du Bloc populaire en 1944 et 1945, sont demeurées plutôt improductives et sujettes à être récupérées par la politique partisane. Lionel Groulx, le plus prestigieux leader nationaliste des années 1930, était un prêtre qui n'a jamais osé faire le saut en politique. C'est Maurice Duplessis qui a habilement récolté les fruits du mouvement nationaliste de son époque. Quoi qu'on en dise, sa politique fut bien plus pragmatique que nationaliste.
Ensuite, le nationalisme canadien-français est demeuré dépourvu d'une véritable dimension économique. Il n'encourageait pas ses adeptes à s'engager dans des activités économiques en vue de la promotion des intérêts nationaux. Sans doute quelques voix ont crié dans le désert, comme Errol Bouchette et Édouard Montpetit. Alphonse Desjardins a lancé avec succès le mouvement coopératif, mais ce mouvement est longtemps demeuré confiné aux structures paroissiales sans imprimer d'effets majeurs sur l'économie québécoise dans son ensemble. Quelques nationalistes, au cours des années 1930, se sont préoccupés du secteur des ressources naturelles et ont fait campagne pour la nationalisation de la production hydro-électrique. Mais quels succès ont-ils obtenus ? Il faudra attendre 1944 pour voir apparaître Hydro-Québec, dont le territoire se limitait alors à quelques régions.
Bien davantage que l'économie, la religion occupait une place de choix dans le nationalisme de l'époque. L'identité canadienne-française était indissolublement liée au catholicisme. Encore ici, les dissidences n'ont pas fait défaut. On a toujours compté des libres penseurs au Canada français. Mais on ne peut les considérer que comme l'exception qui confirme la règle, tant on leur a fait la vie dure. Toujours le message nationaliste était affecté de sa référence obligée aux traditions catholiques les plus rigides. La langue française était considérée comme « gardienne de la foi ». Encore au début des années 1960, certaines élites pouvaient affirmer que « le Canada français sera catholique ou ne sera pas [3] ».
En outre, ce nationalisme traditionnel était essentiellement replié sur lui-même. Bien sûr, cette caractéristique, pas plus que les précédentes, n'était universelle. Le gouvernement du Québec s'est donné des représentants à Paris, à Londres, à Bruxelles et à New York, à des époques diverses. Certains premiers ministres ont voyagé hors du pays. D'autres, comme Gouin et Taschereau, se sont montrés très ouverts à l'endroit des chefs de grandes entreprises britanniques et américaines. Mais rarement les leaders nationalistes se sont-ils intéressés à la conjoncture internationale. Leur première préoccupation, c'était la protection des Canadiens français contre les influences extérieures : l'Amérique du Nord anglophone, l'immigration, l'Europe laïque. Seuls le Vatican, la France catholique et les entreprises missionnaires constituaient des fenêtres sur le monde dans cet édifice fermé.
En conséquence, la nation canadienne-française demeurait peu accueillante aux nouveaux venus. Mis à part les Irlandais catholiques et quelques autres ethnies de [28] même foi, peu d'immigrants pouvaient s'intégrer au Canada français. La nation était conçue comme une entité ethnique. Son homogénéité raciale était souvent soulignée, bien que la population canadienne-française ait été fortement métissée par de nombreux mariages avec des Amérindiens.
Telle était l'image de la nation qu'entretenaient encore les élites québécoises entre 1945 et 1960. Mais cette image correspondait de moins en moins à la conscience populaire. Particulièrement auprès des jeunes, le discours nationaliste n'obtenait guère de succès au cours de ces années de l'après-guerre. Le gouvernement de Maurice Duplessis reprenait ce discours comme une sorte de rituel, mais il se gardait bien de le prendre au pied de la lettre. Car il ne correspondait plus aux besoins d'une société qui devenait de plus en plus complexe et dynamique.
Les cinq traits du nationalisme canadien-français ont été remis en question, critiqués, contredits au sein de la société québécoise au cours de ces années. Ainsi, à l'encontre de Duplessis qui se contentait de protéger les compétences constitutionnelles de la province, on s'est mis à promouvoir, dans certains milieux, une autonomie positive et signifiante. En 1953, les Chambres de commerce ont exercé assez de pression auprès du gouvernement du Québec pour que ce dernier prenne les devants en récupérant son pouvoir de taxation directe et mette sur pied une Commission d'enquête sur les problèmes constitutionnels. Le rapport de cette Commission, présidée par le juge Thomas Tremblay, fut déposé en 1956 et devint plus tard une sorte de bible de la révolution tranquille en matière constitutionnelle. Deux solutions étaient proposées dans ce document quant à l'avenir du Québec : décentralisation des pouvoirs ou statut particulier. Le destin du Canada français était désormais lié à celui du Québec. Cela annonçait la politisation du nationalisme.
De plus, comme en témoignait l'intérêt nouveau porté aux pouvoirs fiscaux, les questions financières et économiques faisaient surface durant cette ère de prospérité. Un certain matérialisme se manifestait à l'intérieur d'une société que le progrès économique rendait effervescente et peu attentive au message éthéré des élites traditionnelles.
Sur le front religieux, le questionnement se faisait plus discret. On dénonçait la collusion entre certaines autorités cléricales et le pouvoir politique. Mais l'omniprésence des leaders religieux était moins critiquée que l'usage de la religion pour des objectifs temporels. Le pluralisme religieux s'affirmait peu à peu à l'encontre du discours cléricaliste.
Les Canadiens français sortaient lentement de leur cocon. Quelques jeunes voyageaient en Europe, étudiaient en France. La télévision ouvrait une fenêtre sur le monde. Un reporter du nom de René Lévesque animait une émission fort populaire portant presque exclusivement sur les questions internationales. Les Canadiens français découvraient des occasions de franchir les frontières de leurs régions.
La conscience ethnique était ébranlée par les contacts plus fréquents avec les anglophones et les immigrants de la région de Montréal. Pour certains, cela se traduisait par l'assimilation. Pour d'autres, cela entraînait une aspiration nouvelle à l'affirmation nationale. Le mot « culture » remplaçait le mot « race » désormais banni après les révélations des horreurs du régime nazi.
À l'endroit du vieux nationalisme, toujours prêché par les élites officielles, la critique prenait deux formes différentes. L'une prônait le rejet total au nom du libéralisme [29] ou de la social-démocratie : cet antinationalisme était bien représenté par la revue Cité libre et ses rédacteurs les mieux connus, Pierre Elliott Trudeau et Gérard Pelletier. Des institutions fédérales comme Radio-Canada, l'Office national du film et le Conseil des Arts leur paraissaient beaucoup plus prometteuses pour le développement de la culture francophone que les organisations québécoises archaïques toujours dominées par l'Église. L'autre forme de critique opposait à l'idéologie traditionnelle un nouveau nationalisme politique, économique, laïque, territorial et ouvert sur le monde. Des personnes comme André Laurendeau, Jean-Marc Léger, Michel Brunet incarnaient bien ce courant de pensée dans les pages de L'Action nationale et du journal Le Devoir. Les fédéralistes se manifestaient davantage à Radio-Canada et à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval.
La révolution tranquille devait être, au moins dans ses débuts, à compter de 1960, un amalgame de ces deux attitudes. Fédéralistes et nationalistes avaient appelé de leurs vœux et ont appuyé avec ferveur les réformes qui répondaient aux besoins criants de la société et de la politique québécoises. À mesure que se développera et prendra forme le nouveau nationalisme, les fédéralistes les plus attachés à la primauté des institutions canadiennes se démarqueront du mouvement québécois.
LE DÉVELOPPEMENT
DU NATIONALISME QUÉBÉCOIS
Le nouveau nationalisme des années 1960 peut être considéré, dans une certaine mesure, comme le prolongement du nationalisme canadien-français traditionnel. Autant, sinon davantage, que ce dernier, il était voué à la préservation d'une nation française en Amérique du Nord. Mais, à plus d'un titre, il s'engageait sur des voies radicalement différentes. Pour plusieurs de ses adeptes, ce nouveau nationalisme ne pouvait être embrassé sans qu'on ait auparavant répudié l'ancien.
Comment peut-on rendre compte des progrès rapides de ce mouvement chez des personnes qui étaient devenues tout à fait allergiques au message nationaliste des générations précédentes ? Les théories de Deutsch et de Gellner, dont il a été question plus haut, peuvent nous apporter quelques lumières.
Comme on l'a vu, les Canadiens français du Québec avaient été urbanisés, donc mobilisés dans un certain sens, depuis le début du siècle. Mais comme ils tardaient à en prendre conscience, ils étaient demeurés relativement isolés, s'insérant assez peu dans les systèmes modernes de communication. La crise économique des années 1930 avait aussi retardé l'inévitable cassure de ce monde fermé. Deux phénomènes l'ont déclenchée après la Deuxième Guerre mondiale : l'usage généralisé de l'automobile et l'avènement de la télévision. Au cours des années 1950, une majorité de Canadiens français ont accédé à l'univers des communications. Ils ont pris conscience, plus vivement que jamais, du fait que ces communications étaient contrôlées, au Québec même, par des anglophones. Le téléphone interurbain, le transport ferroviaire, l'aviation, l'hôtellerie des grandes villes, la restauration, les grands magasins de Montréal, le monde des affaires et de la finance étaient presque entièrement soumis à l'usage obligé de la langue anglaise. Tout cela dans la très française province de Québec.
[30]
Comme Deutsch l'a bien montré, l'aliénation d'une population mise face à la domination d'une langue qui ne lui est pas familière peut avoir deux effets opposés. Comme cela s'est produit, dans une certaine mesure, au Québec mais surtout dans les autres provinces canadiennes, on peut s'assimiler à la langue dominante. Mais l'assimilation se poursuit beaucoup plus lentement que la mobilisation sociale de telle sorte que, d'après les données recueillies par Deutsch au cours des années 1950, quatre personnes sur cinq sont mobilisées sans être assimilées. Ces personnes sont susceptibles de devenir des recrues d'un mouvement nationaliste (Deutsch, 1979, p. 305). C'est le second effet du choc langagier produit par la mobilisation sociale.
Au Canada, ces deux effets se sont manifestés fort différemment. Hors du Québec, vu la faible proportion des francophones à l'intérieur des aires de communication, l'assimilation s'est produite presque aussi rapidement que la mobilisation sociale. Ainsi, quand Saint-Boniface, au Manitoba, devient une banlieue de Winnipeg, les francophones se rallient à l'usage de l'anglais en grande majorité. En général, la loi qui semble s'imposer aux francophones à l'extérieur du Québec est la suivante : plus on est éloigné du réseau québécois, plus le taux d'assimilation est élevé.
Au Québec, par contre, en raison de la masse critique des francophones, le nationalisme l'a emporté largement sur l'assimilation. Au cours des années 1950, pour citer un exemple bien typique, des artistes francophones, en nombre croissant, se retrouvèrent à Radio-Canada, qui leur offrait des occasions d'expression aussi abondantes que nouvelles. Il fallait tout à coup produire une programmation quotidienne complète sans s'appuyer sur aucune source étrangère. Montréal devint un lieu exceptionnel de production culturelle francophone. Tous ces artistes enthousiastes et effervescents se retrouvaient dans des studios situés dans un quartier on ne peut plus anglophone du Montréal d'alors : l'ancien boulevard Dorchester, entre les rues Bishop et Mackay. Quel choc pour ces communicateurs par excellence, fervents utilisateurs de la langue française, que de faire face subitement à 1'unilinguisme anglophone dans les restaurants et bars d'une ville officiellement bilingue. René Lévesque (le boulevard porte maintenant son nom) affirmait que son nationalisme datait de cette période, en particulier de la grève des réalisateurs de 1958, alors que les francophones de Radio-Canada se sont sentis isolés de leurs collègues anglophones de Toronto.
Il est paradoxal que la Société Radio-Canada, une institution fédérale conçue pour rapprocher tous les Canadiens, soit devenue peu à peu un milieu de propagation du nationalisme. Dès 1952, quand la télévision est apparue, on s'est vu forcé de créer deux réseaux et de faire face à la réalité : les francophones du Canada étaient fortement concentrés au Québec. Le réseau français de Radio-Canada devait donc prendre forme d'abord sur le territoire québécois. En attendant qu'on trouve les moyens d'étendre le réseau aux autres régions du pays où se trouvaient des francophones, le réseau français demeurait proprement québécois et jouait le rôle d'un agent de cohésion pour le Québec. Voilà que de Gaspé à Hull, de Jonquière à Sherbrooke, les Québécois se voyaient tous dans un même miroir et prenaient conscience de former une nation. Si une nation québécoise a pu être créée, construite, imaginée, cela s'est fait, pour une bonne part, à l'intérieur d'une institution contrôlée par le gouvernement fédéral ! Radio-Canada ne parvint même pas à rapprocher les Québécois de langue anglaise de la majorité francophone. Car les anglophones ont mis beaucoup de temps à profiter de [31] l'occasion pour s'intégrer au Québec français, mieux connaître sa culture et sa langue. Encore aujourd'hui, il se trouve un plus grand nombre de francophones adeptes des médias anglophones que d'Anglo-Québécois intéressés aux médias de langue française.
Les Canadiens français du Québec ont donc éprouvé, plus ou moins explicitement, le besoin de créer et de promouvoir leur propre réseau de communication, c'est-à-dire leur propre nation sur le territoire québécois. Ils en vinrent à prendre conscience, comme l'exemple de Radio-Canada en témoigne de façon éloquente, que ce réseau de communication coïncidait, pratiquement, avec le territoire québécois. Si le Canada français devait produire un réseau moderne et dynamique, il ne pouvait guère le faire en dehors du Québec. C'est probablement ce que Jean Lesage reconnaissait quand il déclarait en 1964 : « Nous croyons que le Québec est l'expression politique du Canada français et qu'il joue le rôle de mère-patrie de tous ceux qui, au pays, parlent notre langue. » (Morin, 1973, p. 68-69) Jean-Jacques Bertrand tenait un discours semblable : « Sans le Québec, il y aurait des minorités françaises, mais il n'y aurait pas de Canada français. » (Morin, 1973, p. 69) Seul le Québec pouvait être le lieu d'une société globale francophone, moderne et bien organisée. Voilà comment est apparu un nationalisme proprement québécois.
Voilà aussi comment ont été établis les fondements d'un nouveau rôle assigné à l'État du Québec. Car il apparaissait alors indubitable que le protagoniste par excellence de la nouvelle nation devait être le gouvernement de la province de Québec. Comme les changements de la révolution tranquille prenaient forme sous la direction d'une fonction publique renouvelée et aguerrie, une nouvelle classe moyenne faisait surface et allait se donner des moyens pour légitimer son autorité. Quoi de mieux que ce nouveau sens de la communauté qui se manifestait chez les Québécois francophones ? Il fallait favoriser et promouvoir cette nouvelle allégeance québécoise. On a donc conçu un rôle tout à fait particulier pour le gouvernement du Québec : celui de présider à l'épanouissement d'une culture unique et spécifique. Car ce gouvernement était le seul qui fût vraiment francophone sur le confinent nord-américain. « Les Québécois n'ont qu'une seule institution puissante : leur gouvernement. Et maintenant, ils veulent se servir de cette institution pour construire l'ère nouvelle à laquelle ils ne pourraient pas aspirer autrement. » Ainsi parlait Lesage en 1963 (Le Devoir, 10 octobre 1963, p. 8). Les leaders politiques du Québec étaient donc bien engagés dans la construction nationale. Le nouveau nationalisme se développait autour de la notion d'un gouvernement provincial désormais ennobli par une nouvelle désignation : « L'État du Québec ».
Ernest Gellner (1989, p. 16) note fort à propos que « le nationalisme n'émerge que dans les milieux où l'on considère comme déjà acquise l'existence de l'État ». On pourrait aller plus loin et affirmer que plus l'État est présent, puissant et interventionniste, plus le nationalisme s'avère intense. Cela peut signifier une utilisation du mouvement pour justifier ou rationaliser des interventions étatiques. Mais cela peut vouloir dire aussi que la conscience nationale se développe en réaction à l'intervention de l'État et à ses efforts constants pour favoriser l'homogénéité. Le nationalisme peut être étatique ou antiétatique ou les deux à la fois, comme celui du Québec.
Car la croissance de l'État québécois durant la révolution tranquille ne doit pas nous faire oublier le contexte plus large d'un État canadien en progression fulgurante [32] surtout depuis 1945. Ottawa avait connu sa révolution tranquille au cours des années de l'après-guerre, bien que cela se soit produit d'une façon moins subite et moins spectaculaire que dans le Québec des années 1960. Toute une classe de fonctionnaires, d'intellectuels et de politiciens s'était engagée, depuis un certain temps, dans la construction d'une véritable nation canadienne moderne. Cela remontait aux années 1930, dans la foulée du statut de Westminster et de l'accession du Canada à la souveraineté entière. Le rapport Rowell-Sirois, déposé en 1940, correspondait aux aspirations de cette classe et proposait que le gouvernement fédéral assume des responsabilités jusque-là dévolues aux provinces pour appliquer des « normes nationales » comme l'assurance-chômage et la redistribution de la richesse à l'échelle du pays.
L'application de ces « normes nationales » s'est faite après la guerre dans une atmosphère nouvelle de fierté et de nationalisme croissant. Sous la houlette d'un premier ministre canadien-français, le Canada se présentait comme une puissance moyenne. La citoyenneté canadienne était établie en 1947, le Conseil des Arts du Canada était créé en 1957 et le gouvernement fédéral s'ingérait dans les domaines de la culture et de l'éducation. Les mots « nation » et « national »devenaient partie du vocabulaire courant à Ottawa et, de plus en plus, dans l'ensemble du Canada anglais. Une grande nation canadienne émergeait.
La commission Tremblay, mentionnée plus haut, avait été créée par le gouvernement du Québec pour offrir un contrepoids aux nouvelles politiques outaouaises et au nationalisme qu'elles incarnaient. De toute évidence, les Canadiens français du Québec ne se sentaient pas à l'aise à l'intérieur de cette nation canadienne qui ne correspondait pas à leur sentiment d'appartenance. La révolution tranquille peut donc être considérée, dans une large mesure, comme une réaction à l'État-providence canadien et à son nationalisme. Presque toutes les nouvelles politiques québécoises peuvent être vues comme des répliques aux actions d'Ottawa. En fait, plusieurs artisans du renouveau québécois avaient été formés dans la capitale fédérale. Au keynésianisme outaouais, on en opposait un autre à Québec. Comme on l'a vu plus haut dans le cas de Radio-Canada, une entreprise « nationale » canadienne a pu indirectement servir aux fins du nationalisme québécois. On pourrait en inférer la proposition suivante : plus le Canada cherche à créer son unité, plus le Québec affirme la sienne. Il est donc possible de considérer le nationalisme québécois comme un produit inattendu du nationalisme canadien. L'État-nation canadien a engendré l'État-nation du Québec.
N'est-ce pas là un des grands paradoxes de l'histoire du Canada ? Les plus célèbres architectes de « l'unité nationale », les premiers ministres issus du Québec, Wilfrid Laurier, Louis Saint-Laurent et Pierre Elliott Trudeau, ont tous mieux réussi à cimenter l'unité du Canada anglais qu'à créer une nouvelle conscience canadienne chez leurs compatriotes québécois. Tout populaires qu'ils aient été au Québec (obtenant toujours d'énormes majorités parlementaires), ils ont invariablement fini par renforcer le nationalisme des leurs. Le Parti national d'Henri Bourassa a été créé en réaction aux politiques de Laurier et, comme on l'a vu précédemment, le rapport Tremblay et l'esprit de la révolution tranquille sont des réponses au canadianisme des années Saint-Laurent. Quant à Trudeau, il est bien évident que son concept de Canada uni et bilingue et sa Charte des droits et libertés ont été beaucoup mieux accueillis au Canada anglais qu'au [33] Québec. Le nationalisme d'après Meech n'est-il pas une réaction tardive aux manœuvres du premier ministre canadien en 1981 et 1982 ?
On pourrait même pousser le paradoxe plus loin encore en affirmant que, dans une certaine mesure, ce nouveau Canada, issu de l'évolution récente, est plus français (dans un sens bien particulier) que la fédération plutôt pragmatique et fonctionnelle qui évoluait au cours des premières décennies du XXe siècle. Christian Dufour (1989) a déjà souligné ce phénomène d'un Canada devenu tout à coup plus déclaratoire et porté vers l'affirmation des principes, avec une Charte des droits et libertés bien plus près du modèle franco-américain que de la tradition britannique. En se rapprochant ainsi de la conception jacobine de la souveraineté indivisible, le Canada jetait de l'huile sur le feu du nationalisme québécois, susceptible d'être entraîné à son tour sur la voie du jacobinisme.
Le Canada en est donc venu à ressembler plus que jamais aux États-Unis, au système même qu'on s'était donné pour vocation de répudier. Il n'y aurait pas de Canada aujourd'hui si les Canadiens français, forts de leur reconnaissance comme société distincte par l'Acte de Québec, n'avaient refusé de se joindre à la révolution américaine comme les loyalistes devaient le faire aussi pour leurs propres raisons. Il n'y aurait pas de Canada si des sujets britanniques n'avaient renoncé à se constituer en nation en Amérique du Nord.
Les Québécois sont toujours désireux de participer à une forme de fédération canadienne, mais leur nationalisme les incite à ne pas accorder leur allégeance à une nation canadienne indivisible, selon le modèle américain. Même une nation québécoise tout à fait souveraine ne semble pas correspondre aux aspirations de la majorité. Comment donc définir ce nationalisme qui a pris forme au cours des années 1960 et qui correspond aux vœux de la majorité des Québécois ?
LES TRAITS DU NATIONALISME
QUÉBÉCOIS MAJORITAIRE
Assez étrangement, les Québécois n'ont jamais accepté massivement, du moins au cours des années 1970 et 1980, les idéaux que leur proposaient leurs leaders politiques les plus célèbres. Pierre Elliott Trudeau et René Lévesque figurent certainement parmi les politiciens les plus remarquables que le Québec ait connus. Le premier était sans doute plus admiré qu'adulé, mais il a réussi à rallier le vote des Québécois dans toutes les batailles électorales auxquelles il s'est livré, dont la plus importante, le référendum de 1980. Les Québécois n'en ont pas pour cela endossé sa conception d'un Canada bilingue, multiculturel, animé par un centre puissant et constituant une nation plus grande et plus signifiante que la somme de ses parties. Ceux qui ont été séduits par le slogan référendaire, « MON NON EST QUÉBÉCOIS », ne croyaient pas devoir renoncer à leur allégeance québécoise en refusant la souveraineté-association. Trudeau errait quand il annonçait la fin du nationalisme québécois au lendemain de sa victoire. Claude Ryan et les leaders du OUI auraient corrigé le premier ministre canadien s'il les avait consultés. Le même Ryan, loyal fédéraliste, s'est opposé fortement au processus de rapatriement de la constitution mis en œuvre par Trudeau. Comme chef du Parti [34] libéral du Québec, il n'a pas voulu participer aux cérémonies officielles de la ratification de cette constitution en avril 1982. Par la voix de leur Assemblée nationale (renouvelée en avril 1981), les Québécois ont répudié le nouveau Canada tel qu'il avait été conçu par Pierre Elliott Trudeau.
René Lévesque a été fort populaire au Québec. Il a été porté au pouvoir en 1976, puis encore en 1981, malgré sa défaite au référendum de 1980. Mais les Québécois lui ont refusé son projet de souveraineté-association pour lequel il avait lutté durant treize ans.
En conséquence, durant toute la décennie de 1970, les Québécois ont été écartelés, par l'action de leurs chefs vénérés, entre deux options. Leur nationalisme refusait le fédéralisme centralisé, mais il s'arrêtait à la formule de Jean Lesage : « Québec expression politique du Canada français ». On voulait un État national québécois mais à l'intérieur du Canada. Déjà, en 1966, Daniel Johnson avait énoncé une réponse claire et nette à la fameuse question « What does Quebec want ? » :
- Comme point d'appui d'une nation, il (le Québec) veut être maître de ses décisions en ce qui a trait à la croissance humaine de ses citoyens (c'est-à-dire à l'éducation, à la sécurité sociale et à la santé sous toutes leurs formes), à leur affirmation économique (c'est-à-dire au pouvoir de mettre sur pied les instruments économiques et financiers qu'ils croient nécessaires), à leur épanouissement culturel (c'est-à-dire non seulement aux arts et aux lettres, mais aussi à la langue française) et au rayonnement de la communauté québécoise (c'est-à-dire aux relations avec certains pays et organismes internationaux) (Morin, 1973, p. 66).
Voilà le type d'autonomie jugée nécessaire, semble-t-il, par une majorité de Québécois. Ce jugement prend la forme du nationalisme parce qu'il est régulièrement battu en brèche par Ottawa et par les autres provinces canadiennes. Comme l'écrivait Claude Morin, tous les leaders québécois :
- [...] ont inexorablement été fidèles (au moins dans leurs déclarations officielles) à ce qu'on pourrait appeler « une certaine idée du Québec ». Et cette « certaine idée du Québec » n'est au fond que la notion mal exprimée et longtemps hésitante d'un « Québec certain ». Elle n'a de toute façon rien à voir avec un quelconque régionalisme attardé. Mais, cela, Ottawa ne l'a jamais compris. Et probablement, en toute honnêteté [...] Le nationalisme québécois, cette recherche séculaire et instinctive du « pays du Québec », ne correspond absolument en rien aux paramètres de l'équation fédérale normale (Morin, 1973, p. 60-61).
Quelque vingt ans plus tard, ces lignes sont aussi valides et pertinentes qu'elles l'étaient au début des années 1970. Même si cette « certaine idée du Québec » n'a jamais été reconnue par le reste du Canada, il faut bien souligner que le thème d'une « société distincte » au Québec fait partie de l'histoire du pays depuis 1774. Ce thème a été associé, par le rapport préliminaire de la Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme en 1965, au concept des deux majorités. Il est réapparu dans le rapport du groupe de travail sur l'unité canadienne (Pepin-Robarts) en 1979 : « Le Québec est différent et devrait détenir les pouvoirs nécessaires à la préservation et au développement de son caractère distinct au sein d'un Canada viable. » (Commission de l'unité canadienne, 1979, p. 92).
[35]
En 1987, ce caractère distinct était finalement reconnu officiellement par le gouvernement fédéral et par les neuf premiers ministres des autres provinces. Il a été rejeté, en définitive, en 1990, non pas tellement par deux petites législatures récalcitrantes que par une forte majorité de l'opinion publique au Canada anglais. Le premier ministre Bourassa n'avait plus d'autre choix que de déclarer alors : « Les Québécois sont libres d'assumer leur propre destin, de déterminer leur statut politique et d'assurer leur développement économique, social et culturel. » Au-delà des aspects techniques qui ont servi au rejet des accords du lac Meech, c'est le nouveau Canada, animé par l'esprit de la Charte des droits et libertés, qui a écarté, comme un corps étranger, l'expression minimale de l'idée moderne du Québec. Il n'est pas étonnant que le nationalisme québécois en ait été ravivé.
La Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, présidée par Michel Bélanger et Jean Campeau, devint alors le canal par excellence des aspirations nationalistes des Québécois au cours de l'automne et de l'hiver 1990-1991. La commission Bélanger-Campeau a donné lieu à un remarquable consensus qui reflétait le nationalisme de la majorité : ou les revendications québécoises classiques étaient reconnues ou l'on devrait recourir à la souveraineté, même si elle n'était pas le premier choix. Le rapport de la Commission, contrastant avec le rapport Allaire du Parti libéral du Québec déposé un mois plus tôt, ne dressait pas une longue liste de pouvoirs revendiqués par le Québec. Il se contentait d'énoncer les paramètres qui faisaient écho aux propos de Daniel Johnson, vingt-cinq ans auparavant. Les changements nécessaires à la constitution devaient comporter :
- – la nécessité d'instaurer entre le Québec et les autres parties du Canada une nouvelle relation fondée sur la reconnaissance et le respect de l'identité des Québécoises et des Québécois et de leur droit à la différence ;
- – un partage des compétences et responsabilités qui garantisse au Québec une autorité exclusive à l'égard des matières et secteurs qui font déjà partie de ses champs de compétence exclusive, ce qui implique, entre autres, l'abolition dans ces secteurs du pouvoir fédéral de dépenser et l'élimination des chevauchements d'intervention ;
- – l'attribution au Québec, à titre exclusif, de compétences et responsabilités liées à son développement social, économique et culturel ainsi qu'au domaine de la langue [...] (Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, 1991, p. 54-55).
Le nationalisme majoritaire des Québécois s'est encore exprimé dans le vote référendaire de rejet de l'accord constitutionnel de Charlottetown, à l'automne de 1992. Le caractère vague de cet accord, surtout en ce qui a trait au partage des compétences, le projet de création d'un Sénat où le Québec aurait été proprement relégué à une représentation minime et d'autres aspects inquiétants l'ont emporté sur la bonne volonté québécoise à l'endroit du Canada et sur une reconnaissance frileuse de la société distincte.
En résumé, le nationalisme québécois traduit une volonté commune d'existence collective et l'aspiration à la reconnaissance politique de cette existence. Advenant cette reconnaissance et une certaine sécurité quant au caractère français du Québec, les Québécois accorderont volontiers leur allégeance au Canada. Quand l'idée de souveraineté devient populaire au sein de la population québécoise, cela ne reflète rien d'autre [36] que le pessimisme quant à la possibilité de voir cette reconnaissance entérinée par les autres Canadiens. Les nationalistes québécois, en majorité, ne considèrent pas la souveraineté comme une fin en soi mais comme un recours ultime. D'ailleurs, les changements sociaux intervenus au cours des années 1980 ont fait que le concept d'un Québec fort et celui d'un Québec souverain ont évolué considérablement. Un nouveau nationalisme a pris forme.
LE NOUVEAU NATIONALISME
Après le référendum de 1980, le Québec a été en proie à une sorte de malaise, non seulement au sein de cette population assez nombreuse qui avait voté oui mais aussi chez plusieurs qui avaient opté pour le non. Car on ne savait plus trop à quoi on aurait pu dire oui. Le navire québécois semblait voguer à la dérive. Un Lévesque travaillant à assurer au Québec un meilleur statut dans le fédéralisme canadien n'avait guère plus de crédibilité qu'un Trudeau qui prétendait respecter l'autonomie des provinces. Le coup de force de novembre 1981 qui avait isolé le Québec n'avait pas soulevé de grandes protestations dans une population plutôt abattue. La constitution proclamée en 1982 fut tout simplement ignorée par les Québécois. Il faut dire qu'une récession économique, la plus sévère depuis les années 1930, avait créé une atmosphère de morosité qui rappelait l'échec des Patriotes en 1838. Le Parti québécois survivait, mais l'esprit de la révolution tranquille s'était évaporé. Les Québécois ne paraissaient pas aussi outragés par la constitution de 1982 que leurs ancêtres l'avaient été par le rapport Durham. Mais les effets de cette constitution allaient être aussi durement ressentis que ceux du rapport de 1839.
Comme jadis en 1840, une nouvelle élite devait prendre la relève et s'imposer à la collectivité. La classe des gens d'affaires a fini par occuper la place des politiciens et des haut fonctionnaires dans la considération populaire. L'atmosphère des années 1980 et 1990 est propre au désenchantement quant au rôle de l'État. Alors que le référendum de 1980 signifiait un « non » au projet de souveraineté-association et que la constitution représentait un autre « non » à un Québec fort au sein du Canada, la récession portait avec elle un « non » au leadership du gouvernement du Québec. Le nationalisme québécois s'était développé autour d'un État du Québec inspiré du keynésianisme de la révolution tranquille, un véritable État national susceptible d'accéder à la souveraineté si nécessaire. Vers 1982, ce rêve s'est évanoui et la classe politique a perdu son prestige. Dans le contexte international du néo-libéralisme, les Québécois allaient se tourner vers les leaders de l'entreprise privée comme source d'inspiration. Cette nouvelle élite était elle-même animée par une sorte de nationalisme.
La classe des nouveaux entrepreneurs québécois peut être vue comme un fruit mûr de la révolution tranquille. Contrairement à ce qu'on croyait, les politiques économiques des gouvernements québécois des années 1960 et 1970 étaient bien plus propices à produire une société libérale qu'à alimenter la social-démocratie. On avait annoncé une économie mixte où l'État jouerait un grand rôle. Mais les grandes politiques étatiques ont surtout contribué à créer, puis à consolider l'entreprise privée francophone. Hydro-Québec, une entreprise d'État, a favorisé la progression de l'esprit entrepreneurial [37] auprès des ingénieurs et des administrateurs qu'elle formait. La Société générale de financement (SGF) a été créée pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises. La Caisse de dépôt et placement créée pour des fins analogues, a suscité de spectaculaires prises de contrôle de la part de gens d'affaires francophones. Plusieurs sociétés gouvernementales ont par la suite été privatisées.
Le nationalisme québécois s'était manifesté surtout sur les plans politique et culturel. Mais ses effets économiques, évoluant plus lentement, ont fini par se révéler plus durables et peut-être plus importants. Tout naturellement, les grands commis de l'État qui faisaient la fierté de la révolution tranquille sont devenus les grands financiers des années 1980.
Comme tous les entrepreneurs privés, les gens d'affaires du Québec ont eu tendance à dévaloriser le rôle de l'État, bien qu'ils aient contracté une grande dette envers ce même État. Mais ils n'ont pas oublié, pour la plupart, leur allégeance québécoise, surtout lorsqu'ils ont dû faire face aux élites économiques anglo-canadiennes. Comme la révolution tranquille avait mis sur pied un réseau de communication francophone, un nouveau réseau économique francophone allait favoriser chez les hommes et femmes d'affaires un certain alignement québécois. Ces personnes n'ont pas agi comme les hérauts classiques du nationalisme. Mais ils ont eu tendance à valoriser leur allégeance québécoise et à promouvoir la reconnaissance du Québec comme société distincte.
Le mouvement coopératif s'était développé sur une voie parallèle. Il évoluait comme une entreprise privée d'une nature toute particulière et s'associait volontiers au nationalisme en raison de ses origines et de ses objectifs fondamentaux. La montée des entreprises privées québécoises a conféré un nouveau prestige au Mouvement Desjardins qui, tout en demeurant un symbole des succès économiques québécois, apparaît de plus en plus comme une grande entreprise privée au même titre que les autres. Le nationalisme de ses leaders n'en devient que plus évident.
Les gens d'affaires, tout en demeurant très influents auprès du gouvernement québécois (qu'il fût libéral ou péquiste), ont conféré peu à peu une nouvelle orientation au nationalisme québécois. Comme interprètes des grands courants mondiaux contemporains, interdépendance économique et mondialisation, ils ont contribué à accentuer cet aspect du nationalisme qui s'ouvrait sur l'association et sur les échanges internationaux. Le libre-échange avec les États-Unis et ensuite avec le Mexique faisait l'objet d'un appui généralisé chez les nationalistes. Pour la plupart des membres de la nouvelle élite, l'union canadienne devrait toutefois être préservée.
Cette vision semble assez bien reflétée au sein de la majorité de la population québécoise. Elle tend à produire un nouveau type d'identité, celle d'un peuple fier de ses réussites, jaloux de sa culture mais plus tourné que jamais vers l'extérieur. En 1988, par exemple, les Québécois ont pu, du même souffle, exercer des pressions sur le gouvernement Bourassa pour qu'il maintienne des restrictions quant à la langue de l'affichage commercial et appuyer le gouvernement Mulroney sur sa politique libre-échangiste. Il existe certainement un lien entre la sécurité linguistique et l'ouverture sur le monde.
Les meilleures réussites économiques québécoises, cela est devenu évident, sont liées aux exportations et à une présence dynamique à l'étranger. En raison des succès de sociétés comme Bombardier, SNC-Lavalin, Téléglobe, Cascades et plusieurs autres, [38] non seulement en Amérique du Nord mais aussi en Europe et ailleurs dans le monde, les nationalistes québécois sont désormais persuadés qu'un statut plus autonome du Québec (à l'intérieur ou en dehors de la Confédération canadienne) doit être accompagné d'une ouverture sur le monde. La dynamique des institutions économiques internationales de même que l'engagement québécois dans la zone nord-américaine de libre-échange (même s'il doit être renégocié par un Québec souverain) rendent l'isolement tout à fait impossible, quelle que soit la tournure des événements et l'orientation du statut constitutionnel du Québec.
Le nationalisme québécois est donc devenu compatible avec l'internationalisme. Il l'est aussi avec le pluralisme de l'intérieur. Déjà le passage d'une conception ethnique de la nation à un nationalisme territorial indiquait une certaine démarcation quant à l'homogénéité traditionnelle de la société canadienne-française. Au moins théoriquement, les anglophones et les immigrants étaient invités à s'intégrer à un Québec francophone moderne. Les nationalistes québécois sont demeurés cependant plutôt maladroits dans leur nouvelle volonté de bâtir une nation territoriale. Plusieurs ont même continué de se définir comme des Canadiens français tout en se disant québécois. Alors que la baisse du taux de natalité rendait absolument nécessaire l'intégration des immigrants au milieu francophone, les structures d'accueil ne se mettaient en place que très lentement. Les nationalistes déploraient le fait que les anglophones et les immigrants ne s'intègrent pas au réseau francophone. Mais, de leur côté, ils ne remettaient guère en question leurs comportements comme majorité.
À mesure que se manifestait une nouvelle génération de Québécois directement façonnée par les grandes législations des années 1970, la Charte des droits de la personne en 1975 et celle de la langue française en 1977, le caractère tout à fait contradictoire et improductif de cette attitude s'est révélé comme une évidence. Les Québécois ont mieux accueilli les immigrants et se sont ouverts davantage à la communauté anglophone. Cette dernière s'est longtemps braquée contre les nouvelles exigences gouvernementales et sociales en matière de langue. Mais on peut dire que, malgré tout, de grands progrès ont été réalisés. La majorité des anglophones québécois et, plus encore, la majorité des immigrants parlent français et fonctionnent dans le réseau francophone. Il se trouvera toujours des nationalistes pour insister sur les différences entre les « vrais » Québécois (les francophones de naissance) et les autres. Mais, dans l'ensemble, le nationalisme québécois évolue vers une conception de l'identité qui intègre les diverses composantes du Québec moderne.
Quoi qu'il en soit, ce nationalisme n'a aucun sens ni aucun avenir s'il doit être défini en termes ethniques. Sans doute il ne sera pas aisé pour les Québécois d'adopter résolument la conception pluraliste de la nation dite « citoyenne », selon les traditions française et américaine. Cette voie est difficile pour un petit peuple dont la langue est très minoritaire en Amérique du Nord, bien que le français soit toujours une des grandes langues universelles de notre monde. Cela est d'autant plus difficile que les modèles français et américain donnent des signes d'essoufflement. La France n'est plus la terre d'asile qu'elle était encore récemment, et les États-Unis ne parviennent plus à intégrer aussi allégrement. Il faudra trouver, au Québec comme dans ces pays, la façon de concilier le respect des cultures d'origine et l'intégration toujours souhaitable à une culture publique commune.
[39]
Les populations autochtones ne sont pas incluses dans ce processus. Car elles se refusent à l'intégration et, tout comme les Québécois, elles revendiquent une plus large autonomie. Les nationalistes québécois ne peuvent s'opposer à ces revendications des Premières Nations. Le Parti québécois, pour sa part, produisait en 1991 un programme plutôt ouvert au dialogue et au partenariat, à l'occasion de son congrès national. Le Parti libéral du Québec a souscrit au droit des autochtones à l'autodétermination tel qu'il est enchâssé dans l'accord constitutionnel de Charlottetown. Notons que cet aspect n'a pas suscité d'opposition dans la population, qui rejetait par ailleurs la proposition globale au référendum de 1992.
La crise d'Oka de 1990 a pu être perçue, surtout dans la presse anglophone en Amérique du Nord, comme un affrontement entre autochtones et nationalistes québécois. De même, les vives réactions québécoises à l'endroit de la contrebande qui se pratique à travers les réserves des Indiens mohawks à la frontière canado-américaine ont pu aussi apparaître comme des manifestations de racisme. Il est bien vrai que certains comportements ont renforcé ces impressions. Mais la situation est beaucoup plus complexe qu'elle ne paraît. Des membres de la nation mohawk déplorent eux-mêmes l'arrogance du groupe des guerriers qui ont souvent, semble-t-il, fait la loi dans la réserve. Mais une longue tradition d'accommodement (nonobstant le paternalisme colonial toujours présent) entre Canadiens français et Indiens, qui remonte aux premiers jours du régime français et qui a donné lieu à la formation d'une nombreuse population de métis, est toujours vivante au Québec. Louis Riel était acclamé et appuyé comme un frère en 1885. Il semble bien que la population du Québec, encore aujourd'hui, demeure, dans l'ensemble, plus près des autochtones que ne le sont les autres Canadiens, bien que le racisme et l'injustice menacent toujours (Philpot, 1992).
CONCLUSION
Le nationalisme québécois est devenu très fort dans l'opinion publique en 1990. Au lendemain du rejet de l'accord du lac Meech, en juin 1990, la souveraineté était favorisée par une proportion de la population jamais atteinte auparavant. Ce nationalisme était cependant apparu sous un nouveau visage. Il s'était adouci grâce à l'influence d'une vive conscßience internationale et d'une reconnaissance croissante du pluralisme interne. Même si les Québécois en viennent à réaliser la souveraineté, cette souveraineté serait inévitablement limitée par les nécessités de notre monde contemporain et les perceptions qu'en entretiennent les Québécois.
Un nationalisme défini comme une manifestation de chauvinisme correspond de moins en moins au nationalisme québécois. Comme on l'a vu plus haut, le passage d'une conscience nationale canadienne-française et traditionaliste à la conception nouvelle d'une allégeance québécoise a impliqué une redéfinition graduelle de l'identité québécoise. La territorialité a succédé à l'« ethnicité ». Tel qu'il était conçu par une majorité de Québécois, le nationalisme s'est contenté d'une reconnaissance politique à l'intérieur du Canada. Le nationalisme qui a pris forme au cours des années 1980 est [40] apparu comme encore plus modéré, bien qu'il puisse conduire à la souveraineté, faute d'accommodement dans un Canada chartiste et uniformisé.
BIBLIOGRAPHIE
BALTHAZAR, Louis, 1986, Bilan du nationalisme au Québec, Montréal, L'Hexagone. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
COMMISSION DE L'UNITÉ CANADIENNE, 1979, Rapport : se retrouver, Ottawa, Approvisionnements et Services.
COMMISSION SUR L'AVENIR POLITIQUE ET CONSTITUTIONNEL DU QUÉBEC, 1991, Rapport, Québec, Assemblée nationale.
COMMISSION ROYALE D'ENQUÊTE SUR LE BILINGUISME ET LE BICULTURALISME, 1965, Rapport préliminaire, Ottawa, Imprimeur de la Reine.
COMMISSION ROYALE D'ENQUÊTE SUR LES PROBLÈMES CONSTITUTIONNELS, 1956, Rapport, Québec, Imprimeur de la Reine.
DEUTSCH, Karl, 1966, Nationalism and Social Communication, Cambridge, Mass., M.I.T. Press.
DEUTSCH, Karl, 1979, Tides Among Nations, New York, The Free Press.
DION, Léon, 1975, Nationalisme et politique au Québec, Montréal, Hurtubise HMH. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
DUFOUR, Christian, 1989, Le Défi québécois, Montréal, L'Hexagone.
GELLNER, Ernest, 1989, Nations et nationalisme, Paris, Payot. KÖHN, Hans, 1956, The Idea of Nationalism, New York, Macmillan.
MORIN, Claude, 1973, Le Combat québécois, Montréal, Boréal Express.
PHILPOT, Robin, 1991, Oka : dernier alibi du Canada anglais, Montréal, VLB.
SMITH, Anthony D. (dir.), 1976, Nationalist Movements, London, Duckworth.
SMITH, Anthony D., 1983, Theories of Nationalism, London, Duckworth.
[1] Je reprends ici plusieurs thèmes déjà élaborés dans Bilan du nationalisme au Québec, Montréal, L'Hexagone, 1986.
[2] Cette traduction est la mienne, de même que celles qui suivent.
[3] « À mon sens, nous resterons français et catholiques dans nos conceptions culturelles, ou nous disparaîtrons. » François-Albert Angers, conférence à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, 24 janvier 1962, cité par Georges Robitaille, S.J. « Une conférence historique », Relations, mars 1962, p. 81-82.
|

