Jean Benoist
“Médecine, psychiatrie et ethnologie:
les relations entre approche clinique et approche ethnographique.
L’écoute, le regard, le langage: affrontement
ou convergence de deux pratiques?”
Un chapitre publié dans le livre Tohu-bohu de l’inconscient:
paroles de psychiatres, regards d’anthropologues. Actes de colloque,
pp. 17-27. Lyon : La Ferme du Vinatier, 2001, 80 p.
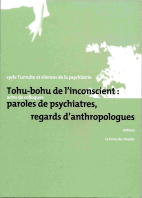 Le titre qu’on m’a proposé pour cet exposé est presque celui d’une dissertation, un titre qui pourrait servir à un concours. Aussi me suis-je dit : “ Vais-je parler en universitaire qui disserte ? ”, ce que je n’aime pas trop. Il m’a semblé plus intéressant de partir de quelques expériences personnelles. D’autant que, ce rapport entre anthropologie et psychiatrie est nécessairement une expérience vécue de part et d’autre, une rencontre souvent inattendue, qui survient lors de toute relation avec des malades. Car on ne s’adresse jamais à des corps malades, mais avant tout à des personnes qui portent un bien plus lourd fardeau que celui d’une maladie. Ce qu’essaie de connaître l’anthropologue, c’est l’expérience de vie que représente ce fardeau, la façon dont cette expérience se construit au croisement de ce qui est le plus individuel en eux et de ce qui est modelé par la société. Venu d’un autre horizon, le psychiatre pénètre nécessairement dans le même territoire, même si sa préoccupation est de comprendre, par delà sa culture et son histoire, l’individu, tandis que celle de l’anthropologue est de découvrir, à travers l’expérience de l’individu, sa culture. Le titre qu’on m’a proposé pour cet exposé est presque celui d’une dissertation, un titre qui pourrait servir à un concours. Aussi me suis-je dit : “ Vais-je parler en universitaire qui disserte ? ”, ce que je n’aime pas trop. Il m’a semblé plus intéressant de partir de quelques expériences personnelles. D’autant que, ce rapport entre anthropologie et psychiatrie est nécessairement une expérience vécue de part et d’autre, une rencontre souvent inattendue, qui survient lors de toute relation avec des malades. Car on ne s’adresse jamais à des corps malades, mais avant tout à des personnes qui portent un bien plus lourd fardeau que celui d’une maladie. Ce qu’essaie de connaître l’anthropologue, c’est l’expérience de vie que représente ce fardeau, la façon dont cette expérience se construit au croisement de ce qui est le plus individuel en eux et de ce qui est modelé par la société. Venu d’un autre horizon, le psychiatre pénètre nécessairement dans le même territoire, même si sa préoccupation est de comprendre, par delà sa culture et son histoire, l’individu, tandis que celle de l’anthropologue est de découvrir, à travers l’expérience de l’individu, sa culture.
Aujourd’hui, je vous propose donc, un peu comme les chineurs du dimanche qui reviennent du marché aux puces, de vous parler de ce que j’ai pu ramasser en route, à travers une double démarche d’anthropologue et de médecin. Cela peut nous aider à clarifier, et nous devons sans cesse le faire, le débat sur les rapports entre anthropologie et psychiatrie, vieux couple pas toujours heureux, mais parfois créateur.
Un premier élément de comparaison est très important. Depuis longtemps maintenant, je fais de l’ethnologie sur des terrains divers : je sais qu’on s’y investit, qu’on y a des rapports personnels avec des gens, et cela jusqu’à des niveaux d’amitié souvent extrêmement forts, des amitiés à la fois transculturelles et “ trans-sociales ”dans des rencontres imprévisibles ailleurs ou dans d’autres circonstances. Mais en même temps, les ethnologues restent totalement irresponsables. Nos actes, nos écrits, nos présences sont gratuites. J’entendais rappeler il y a peu une phrase où Sartre disait qu’en face d’un enfant qui meurt de faim, La Nausée ne pèse pas lourd. Et bien face à une consultation et à une demande médicales, tout ce à quoi croit répondre l’anthropologue ne pèse pas lourd. Le médecin a la responsabilité directe d’un acte. Alors que l’anthropologue n’est pas là pour agir ; il est là pour lui, pas pour les autres, même quand il argue de responsabilités (responsabilité sociale et collective, éveil des consciences et des sensibilités, aide au développement) qui n’ont rien à voir avec l’urgence douloureuse qui attend de vous, de votre savoir, une réponse et une action. Il y a là une faille, entre médecins et anthropologues. Laissons là certes de côté, mais enregistrons là, comme un préalable. L’ignorer serait une erreur.
Mais il est aussi des moments de la vie intellectuelle où l’on arrive à ce que j’appelle un carrefour lumineux ; là, une série de voies s’éclairent. Je pense à une phrase de Pascal qui est un de ces carrefours. L’anthropologue et le psychiatre s’y rencontrent. Je l’ai trouvée dans les premières pages du livre Gens de la grande Terre, quand Maurice Leenhart use de cette merveilleuse phrase pour dire sa façon de concevoir l’ethnologie : “ Des yeux, il va jusques au cœur, et par le mouvement du dehors, il connaît ce qui se passe au-dedans. ” Peut-on mieux définir ce qu’est l’idéal de l’ethnologue, et aussi celui du clinicien, celui du psychiatre ?
Car tout ce qui est donné à notre observation, et ce avec quoi nous observons, ce sont les yeux et les voix, alors que notre objectif est d’aller jusqu’au cœur. D’un même mouvement, du dehors nous essayons d’aller au-dedans, et cette phrase est presque paradigmatique de la part d’identique de deux démarches dont les finalités sont autres.
Toutefois, est-ce que les yeux qui regardent sont les mêmes ? Car un regard, c’est la perception à travers une information antérieure : l’information au sens informatique, c’est-à-dire le programme qui construit notre perception, qui trie, qui filtre. Or elle est bien différente l’information des anthropologues de celle qu’ont acquise les psychiatres. Et le propre d’une information préalable est qu’il est très difficile de l’ébranler par l’expérience. Si donc psychiatres et anthropologues vont des yeux jusqu’au cœur, mais pas avec la même information, ils ne récoltent pas la même image de ce qui est au-dedans.
L’information du médecin, et donc le plus souvent du psychiatre, vise à reconnaître ce qu’il y a de plus individuel dans “ la personne ”, quitte à confronter cet individuel aux critères de l’homme universel, en édifiant une nosologie qui se veut elle aussi universelle. La culture construit certes, mais aussi perturbe le message de l’individuel auquel il essaye d’accéder
L’ethnologue, lui, suit un autre fil conducteur, il est guidé par une information différente : entre l’individuel et l’universel, ce qui l’intéresse, c’est ce collectif partagé, ces ensembles aux frontières plus ou moins nettes, plus ou moins floues, qu’on va nommer cultures, sociétés, groupes, réseaux,... À travers l’individuel, il cherche à lire le message qui lui permet d’identifier ce collectif. Car “ culture ” c’est finalement la part de ce collectif partagé qui est en moi, en chacun de nous. Dans nos rapports avec les autres, parler de l’Autre avec majuscule n’est-ce pas une façon de refuser cette part commune à moi et à l’autre, par une dénégation de l’énorme dénominateur commun qui nous construit même au plus intime de nous-même et confondre le “ moi ” avec cette mince pellicule qu’est en réalité le “ moi ” barrésien ? Ce collectif partagé est constitutif de chacun de ceux qui le partagent.
Aussi cette différence fondatrice ne laisse-t-elle une place à la discussion entre le psychiatre et l’anthropologue qu’à condition que l’un et l’autre mettent clairement sur table leurs façons de concevoir, d’exprimer, la réalité qu’ils observent. Sinon, le malentendu s’installe. J’ai eu parfois le sentiment que les psychiatres venaient vers l’ethnologue comme vers un spécialiste de la culture, destiné à arracher le “ masque culturel ” qui les empêchait de percevoir directement leurs malades. En arrachant ce “ masque ”, n’est-ce pas le visage que l’on détruit ?
Dans ce débat s’infiltre alors un autre écart, dans la mesure où se fait aussi une construction culturelle de soi par la profession. Les études sont toujours en même temps des désapprentissages de savoirs antérieurs, de ces savoirs partagés, que nous perdons. Il ne s’agit pas ici de surestimer le contenu des savoirs populaires, mais ils existent au moins comme “ concevoir ”, et nous les perdons. Le rabotage intellectuel de toutes les études, c’est aussi la construction d’un autre collectif partagé, d’une culture qui permet de faire consensus dans une profession, qui nous identifie professionnellement. Et en ce domaine le psychiatre, construit d’abord comme médecin, puis spécialisé, suit une voie bien différente de celle de l’ethnologue. Différences souvent mal mises en évidence, mais qui peuvent si on les néglige, distordre le dialogue.
Il est un autre point de rupture ou de collaboration : tout individu n’est pas construit seulement par sa “ culture ” ; il l’incorpore à travers la position qu’il occupe, dans les jeux et enjeux sociaux où il est inséré. Tous les individus sont des individus en situation, définis par des critères basiques : leur sexe, leur âge, etc., et d’autres beaucoup plus subtils : leur position sociale et les conceptions qu’elle génère L’anthropologue auquel on demande d’approfondir le contenu d’une culture, répond : “ Ce qui est important et signifiant c’est le qui fait quoi, le qui dit quoi ”. Or on ne définit pas le “ qui ” comme individu seulement, on le définit en relations, en réseaux sociaux, en position de pouvoir, en biens, en capacité d’apprentissage, en capacité de se faire entendre, en réseaux de parenté, en mode de contrôle d’un sol, d’un foncier, d’un bien, etc. Tout cela il ne faut pas l’ignorer. Sans doute le médecin généraliste, dans sa campagne ou son quartier le savait-il grâce à cet empirisme du savoir-faire de tous ceux qui sont forcés de manipuler des relations sociales. Mais bien souvent, en situation hospitalo-universitaire, cette contextualisation est effacée : le malade doit tenir son rôle de malade, on l’uniformise, on le décontextualise au maximum.
Je citerai à ce sujet une petite phrase, d’un psychiatre de Montréal, Laurence Kirmayer : “ Décontextualiser l’expérience du patient, bien que nous permettant de mettre l’accent sur les processus psychologiques, peut participer involontairement à une forme d’oppression sociale et politique. Une attention explicite au cadre des problèmes, l’usage d’explications externes à ces problèmes, et une attitude de coopération avec les patients peuvent leur donner des concepts et des outils qui leur permettent d’entreprendre l’action personnelle capable de lutter contre les inégalités qui sont les causes directes et les amplificateurs de leurs souffrances. ” Bien souvent malheureusement ce point de vue n’est pas pris en compte dans la thérapie individuelle, dans l’explication individuelle, dans l’explication culturelle. Ainsi, lorsque l’on parle des “ immigrés ”, ne doit-on pas oublier que cela signifie qu’il s’agit d’individus en trajectoire et non pas d’individus stables, définis seulement par leur origine ou leur mode actuel d’insertion. S’il est un message des anthropologues pas seulement aux psychiatres, mais aux médecins en général, c’est cette contextualisation : le fait que les individus sont tous, qu’ils le sachent ou non, qu’ils le veuillent ou non, des acteurs sociaux en situation, qu’il y a toujours un « qui » derrière le « quoi », et que les relations entre les « qui » sont le lieu privilégié où placer l’action, la poignée qui permet de saisir le « quoi » et de le transformer éventuellement. Donc identifier les insertions sociales de la personne, ses réseaux, ses rôles, c’est une des tâches peut-être dont l’anthropologue attend le plus et qui est peut-être le moins bien faite.
Au cœur de ces questions se retrouve le débat actuel et important concernant l’attitude de la clinique inter-culturelle face à l’accent porté sur la contextualisation. Je fais ici un détour à travers un exemple personnel, bien loin de la clinique psychiatrique, mais qui peut éclairer ce propos. J’ai vécu longtemps au Québec ; même si je rends hommage à ce pays je dois reconnaître combien il est lourd de s’y voir en permanence assigner une identité qui vous définit par vos origines. Vous êtes au Québec depuis vingt ans, et on vous dit toujours : “ Vous qui êtes Français ”, et on vous renvoie à votre culture, à votre origine. On suppose à partir de cela que vous pensez ceci, que vous avez tel objectif, quoi que vous fassiez pour vous intégrer. On ne peut certes pas refuser à quelqu’un son identité d’origine, mais on ne peut pas non plus lui refuser son identité d’aspiration. Et cela implique de grandes précautions dans la manipulation du culturel, dont la surestimation est bien souvent, malheureusement, un alibi, un faire-semblant. Je n’ai pas de conclusions à proposer là-dessus, mais il me semble que c’est un lieu de méditation forte.
***
Un autre thème de rencontre de l’anthropologue et le psychiatre touche à mon sens la perception de la maladie. Qu’elle soit mentale ou qu’elle ne le soit pas - et dans bien des sociétés est-ce là une catégorisation signifiante, je n’en sais rien -, l’anthropologue perçoit la maladie ou apprend à la percevoir comme on la perçoit de l’intérieur de la société. Et pour celui qui on a étudié la médecine c’est une longue ascèse que de rejoindre ce point de vue, d’apprendre à se démédicaliser pour parler de maladie dans une société autre que la sienne : il faut, j’allais dire une psychanalyse, mais plutôt une “ culture-analyse ” , pour récupérer la nécessaire virginité du regard, pour percevoir autrement la frontière entre ce qui est maladie et ce qui ne l’est pas. Et dans le domaine de la maladie mentale ces frontières sont particulièrement mobiles, varient énormément d’un groupe social à un autre, d’une société à une autre. Je vais prendre un exemple qui m’a beaucoup frappé quand je l’ai vécu à l’île de la Réunion, et j’en ai publié le récit voilà quelques années dans « Psychiatrie française ». C’est l’histoire d’un homme qui, une nuit, s’éveille en hurlant, prend une hache, tente de tuer sa femme, laquelle s’enfuit, met le feu à sa maison, puis part nu courir dans la savane, où on le rattrape le lendemain matin. Diagnostic immédiat : il a été possédé dans la nuit par un esprit. Quel esprit ? Que faut-il faire ? On le ligote dans sa case avec du fil de pêche en nylon, on fait venir un prêtre indien qui, entrant lui-même en possession, apprend par son esprit quel est l’esprit en cause, fait les cérémonies nécessaires : découper un coq en arrachant sa tête sur la tête du malade. À l’issue de la cérémonie, l’esprit nourri, part, et tout revient dans l’ordre. La crise a recommencé quelques mois plus tard, et on a refait la même chose. Et puis un jour je demande :
- - Qu’est-ce qu’il est devenu ?
- - Ah, il est devenu fou !
- - Ah bon ? Que s’est-il passé ?
Celui qui m’a raconté cela en était le témoin ; il m’a dit : “ Un matin avec mon compère (c’est-à-dire qu’il était le parrain de sa fille), on faisait le café tous les deux dans la grège (cafetière, en créole), il a pris la cendre du feu, parce que c’était sur un feu de bois, et l’a mise dans la cafetière. J’ai eu peur, j’ai eu peur. Je me suis dit que son cerveau était gâté. On l’a amené à l’hôpital psychiatrique de St-Paul, et ils l’ont gardé : c’est bien la preuve qu’il était fou. ” La seule preuve de folie était qu’il avait fait quelque chose qu’aucun esprit ne pouvait faire, et qu’aucun individu mentalement sain ne pouvait faire non plus : confondre de la cendre et du café. Tenter de tuer sa femme, mettre le feu à sa maison, partir nu rôder dans la savane, était totalement hors du champ de la maladie - je ne parle même pas de la maladie mentale. Le regard des cliniciens a certes été autre, l’interrogatoire sur l’anamnèse a dû aller plus loin ; on a pu sans doute le catégoriser : ce n’est pas pour le café qu’on l’a hospitalisé. Mais si cet individu n’avait pas fait cette confusion, il ne se serait pas rendu suspect ; il aurait pu de temps en temps recommencer son épisode comme tant le font.
Je ne veux pas faire là un éloge de la manière merveilleuse dont les sociétés traditionnelles gèreraient les maladies mentales, parce que ce n’est pas vrai. Allez voir comment cela se passe pour les enfants arriérés dans certains pays du Maghreb… Je me souviens encore des idiots thyroïdiens du Mali, dans des arrière-cases où personne ne s’occupait d’eux, des confréries du type de celle de Bouya Omar au Maroc où les malades sont séquestrés des années durant, des centre traditionnels de psychiatrie en Inde avec leur malades enchaînés... Ne faisons pas de romantisme sur le charme de l’idiot du village. Mais n’oublions pas non plus que certaines structures sociales et certaines formes de croyances tiennent à l’écart de la pathologie des conduites qui ailleurs ne le sont pas. Pour les psychiatres, c’est important, car à la limite, cet individu avec cet équilibre qui avait été trouvé - je ne parle pas de son éventuelle dangerosité -, se trouvait non-psychiatrisé. Il avait l’esprit sur lui, mais il n’avait pas le cerveau gâté, tandis que par son erreur sur café il a révélé que son cerveau était gâté, et un cerveau gâté ne se répare jamais. Quand il est sorti de l’hôpital, il avait pour toujours le cerveau gâté.
Ce point est important, et il y a là tout un champ d’investigation qui a déjà été beaucoup exploré, pas assez dans nos propres sociétés, sur les frontières de ce qui est psychiatrique ou ne l’est pas.
Et puis il y a des frontières que je dirais plus périlleuses. Psychiatre et anthropologue, surtout ethnologue, ont hérité de la philosophie le goût de ce qu’on pourrait appeler les explications globales. On aime mieux se trouver dans un système totalisant, qui explique tout, et qui convainc en séduisant, que dans un système ouvert, qui n’explique qu’en partie et qui convainc en démontrant. Que de références montrent combien les séducteurs, les constructeurs de systèmes, qui expliquent tout à partir d’un code déchiffrable, donnent l’illusion qui répond à notre besoin profond d’intelligibilité et libère l’inquiétude du “ Je ne sais pas ”. Et là psychiatres et anthropologues ont joué un ballet, qui a commencé par le caricatural Totem et tabou de Freud et qui ne s’est pas arrêté depuis. Je dois dire que je suis souvent irrité par des textes psychiatriques irrigués de métaphores anthropologiques ou, pire, par des textes ethnologiques imbibés d’une para-psychiatrie qui devient effectivement parfois de la para-psychologie au sens de base du terme.
Si vous lisez des ouvrages du XIXème siècle, vous y trouverez des choses absolument adorables sur les explications, par l’onanisme notamment, de toute une pathologie mentale par des voies purement biologiques, sans compter toutes les explications héréditaires ou par le milieu, etc. Et ces réductionnismes biologiques, on les a malheureusement combattus par ce qui pourrait sembler un réductionnisme sociologique, dans lequel beaucoup d’ethnologues se sont sentis à l’aise parce qu’ils détenaient les clés de leur accès. On emploie peu en France cette expression si courante en Amérique Latine de bio-psycho-social, qui est un espace beaucoup plus cohérent que la lutte permanente qui anime encore en France y compris dans les milieux psychiatriques, les tenants du biologique, les tenants du social. Je lisais récemment dans Le Monde un texte issu d’une conférence du Professeur Guyotat qui justement montrait très bien l’équilibre de ces deux points de vue. Mais c’est malheureusement encore rare, entre ceux qui ne croient qu’au corps et voient dans toutes nos pensées une fonction du cerveau, comme l’insuline est une fonction du foie, et ceux qui en refusant le corps laissent filtrer leur désir de croire à l’âme. Un certain dualisme corps-âme imbibe encore un certain nombre de pensées. A côté du scientisme simpliste dénoncé par beaucoup de philosophes, existe certainement ce “ littérarisme ” que dénonçaient si bien Sokal et Bricmont dans un livre qu’ont critiqué ceux qui justement confondent le cohérent avec le connu, le discours avec une science.
Dans la rencontre entre l’anthropologue et le psychiatre, si on ne définit pas clairement les termes, si on ne définit pas les lieux d’expertise, si on ne saisit pas ce champ du culturel quelque part entre le moi et l’universel, cette importance du social et du relationnel, on peut se perdre dans une bouillie théorique construite à coup de métaphores, où l’un va emprunter à l’autre, en prenant pour démonstration ce qui est un outil de séduction. Ces discours sont souvent brillants, rendant hommage à l’intelligence de leurs auteurs, mais une intelligence de l’ordre de celle des théologiens médiévaux et non pas celle des savants de notre siècle, qui sont souvent plus modestes parce qu’ils n’aspirent pas aux explications globales. Et quand l’anthropologie elle aussi construit des explications globales, au lieu de donner un outil de plus dans l’accès jamais achevé à des réalités complexes et difficiles, elle devient périlleuse. Quand au mélange des genre, il peut flatter mais il apporte surtout la confusion.
C’est ce que Devereux disait déjà. Je me permets de vous lire un texte issu de son Ethnopsychanalyse complémentariste : « La nécessité de postuler l’interdépendance totale de la donnée sociologique et de la donnée psychologique, parce que chacune de ces données est créée à partir du même fait brut »… « mais aussi la nécessité de postuler en même temps l’autonomie absolue tant du discours sociologique que du discours psychologique, que du discours psychologique »(p.14). Je dirais aussi « que du discours psychiatrique ». En même temps, l’interdépendance totale des données : voilà ce que nous essayerons de résoudre en conclusion.
***
Mais le thème de la dissertation qu’on m’a assigné n’était pas seulement le regard ; il y avait aussi la parole. D’autant que là encore, comme à propos de la phrase de Pascal, anthropologue et psychiatre ont quelque chose en commun. Ils sont ceux qui savent le pouvoir de parole qu’a le silence, non pas le silence passif, mais le silence qui est message, et qui utilise de temps en temps un mot comme Moïse utilisait son bâton pour faire sourdre l’eau.
Et ce pouvoir de parole qu’est le silence, c’est la relation de terrain.
J’ai souvent rêvé d’être cet aveugle africain au pied d’un baobab, autour duquel tourne le village dont il entend les voix sans y intervenir : il sait ce que les gens disent et ce que les gens pensent. Au fond nous procédons un peu comme cela sur le terrain. Ou alors comme Maigret arrivant, dans tel ou tel roman de Simenon, quelque part dans un petit village du Nord au bord d’un canal où il y a eu un crime ; les gens se connaissent tous et lui ne connaît rien ; il est là, il commande un café, il se tait, il est dans un coin. Peu à peu autour de lui des bruits, des sons, des paroles, des confidences. Et il démêle par la vie sociale les rapports, les gens d’où la vérité va sortir. Puis il perçoit un nœud, un endroit où les bruits ne sont pas clairs. On comprend par cette parole qu’est le silence, c’est-à-dire le fait d’être un interlocuteur, mais un interlocuteur qui n’intervient pas. Là, je crois que l’anthropologue et le psychiatre ont quelque chose de très en commun.
Certains thérapeutes traditionnels vous apprennent cela. Mais je ne veux pas idéaliser car y a de tout parmi eux : des charlatans, des malhonnêtes, des escrocs, et Dieu sait si la société française en déborde actuellement, qui font ce métier pour l’argent qu’ils prennent à ceux qui se laissent prendre. Mais s’ils se laissent prendre, c’est tout de même parce qu’il y a une raison à cela... Passons. Je revois quelques guérisseurs notamment de sociétés peu ou pas médicalisées. Je pense notamment à l’un d’eux qui ne parlait pratiquement pas, mais qui avait une autorité par sa stature, par son allure. À son silence accompagné d’un regard, d’un clignement d’œil… Cet homme-là orientait les gens à parler non pas seulement d’eux, mais aussi de ce qui les entourait. On dit beaucoup que les « traditionnels » sont des « empiriques », et par empirique on croit que c’est parce qu’ils ont découvert l’effet de l’alcaloïde des végétaux qu’ils utilisent. En fait ils sont des empiriques du social et du relationnel. J’ai souvent été frappé, par le génie relationnel de certains de ces individus. Je pense à ce guérisseur, qui, en séance publique, interviewait les gens et demandait à un individu qui le consultait : “ Et avec lui, comment tu es ? Et avec lui ? Et avec lui ? Et avec lui ? ”. Ce n’est pas les réponses de l’individu qui comptaient, c’est la manière dont ses réponses lui faisaient déceler les zones de son entourage et les reliefs de ses relations avec lui. Il gérait le contexte par cet empirisme du social que nous avons perdu comme nous avons perdu beaucoup d’empirisme.
Je ne sais pas si ce que je vous ai dit vous paraît clair ou confus. J’essaye de vous montrer qu’il y a une rencontre, qu’elle est nécessaire, mais que c’est souvent une démarche parallèle, dans laquelle on doit être perpétuellement éveillé à ce que l’autre peut apporter et aux risques de confusions. Autrement dit, il ne faut pas que le psychiatre lise l’anthropologue à travers l’information du psychiatre, ni que l’anthropologue lise le psychiatre par l’information de l’anthropologue.
Je vous propose une petite illustration de cette thèse, par la lecture à plusieurs u d’un phénomène, une lecture qui essaye d’être aussi « complémentariste » que possible.
J’ai travaillé un certain temps sur une thématique finalement bien banale: celle de la marche dans le feu. Elle trouble : on voit des gens qui passent sur des feux sans se brûler. Je pense à l’île de la Réunion, où j’ai étudié cette marche. Si je vous dis « la marche dans le feu », « l’île de la Réunion », vous voyez des photos publicitaires, et des annonces destinées aux “ Marche dans le feu, tel jour, endroit ”. À trois heures de l’après-midi, les curieux arrivent, puis la procession des hommes habillés en jaune, portant des vases sur la tête, qui traversent trois fois un lit de braise.
Et le touriste rentre chez lui ; il a fait des photos, tout le monde est content. Le prêtre indien qui a conduit la cérémonie a vu beaucoup de touristes, et il est content lui aussi. Ensuite, tout le monde discute : « Pourquoi ne se sont-ils pas brûlés ? » Alors là vous avez toutes les réponses possibles : « Ils sont dans un état de transe », « La déesse laisse tomber un sari et crache sur le sari », « Ils ont les pieds tannés par leur vie pieds nus dans les champs », « Ils mettent des enduits protecteurs » etc.
Pour l’ethnologue, qu’en est-il de la marche dans le feu ? C’est un fait social. On adore en France l’expression, de « fait social total », et c’en est un : tous les lieux de la société sont concernés. Je vous propose une lecture de ce fait social, qui peut illustrer la façon dont l’anthropologue et le psychiatre peuvent déchiffrer le même cas, interpréter la réalité du même individu.
Je me demande, comme ethnologue : “ Qu’est la marche dans le feu pour le prêtre qui la conduit ? ” : c’est une cérémonie religieuse, qui dure 21 jours, pour laquelle il y a une longue préparation, l’alliance d’un certain nombre de personnes avec une déesse, puis toute une nuit de cérémonie reconstituant des passages de Mahabaratha, et enfin de la marche dans le feu, suivie le lendemain par d’autres cérémonies. La présence du public est celle de témoins qui attestent la maîtrise qu’a le prêtre, sa maîtrise surnaturelle ; elle renforce son prestige, son rôle social. Et comme par ailleurs ce prêtre est aussi un thérapeute, cela vient attester son pouvoir surnaturel de guérir.
Mais il y a d’autres regards. De ceux qui passent dans le feu. Certains sont des croyants ; ils partagent le regard du prêtre. D’autres ne sont pas des croyants, mais des personnes qui ont été malades ou qui ont eu un enfant malade. Ils peuvent être des Indiens, mais aussi des Noirs, des Blancs, des Métropolitains qui dans un moment de désespoir sont allés consulter le prêtre indien, et qui, satisfaits, ont fait la promesse de marcher dans le feu. Pour eux, il y a là le résultat des pratiques étranges d’un guérisseur, qui détient des pouvoirs surnaturels.
Pour le touriste, il y a d’abord l’un des aspects mystiques de l’Inde (ces gens qui lancent des cordes en l’air et y grimpent) et puis l’exploit, un peu comme dans la corrida ou au cirque.
Les biologistes, eux, font des théories. Il y a ceux qui comptent le temps de contact, et qui disent : « Ils passent sur six mètres, ça fait onze pas ou dix, d’un quart de seconde, ça fait donc un contact de tant : la probabilité que ça brûle est faible ». Il y a ceux qui disent : « Ils sont en état de transe, on va mesurer les catécholamines dans leurs urines, pour voir la trace de leur stress».
Est-il sage de chercher qui a tort ou qui a raison dans tout cela ? Le fait social n’est pas objectif comme la plante qu’un botaniste essaye d’identifier avec précision. Il se construit justement par ceux qui le vivent. Il social s’édifie au croisement de leurs regards : finalement c’est un fait virtuel qui naît de la rencontre d’une quantité de regards. Chacun est cohérent vis-à-vis du champ sur lequel il est posé, mais incohérent avec l’autre champ.
Alors osons une hypothèse : dans certains cas, la construction, et même la gestion, de la pathologie mentale dans notre société n’est-elle pas elle aussi virtuelle, entre celle des techniciens, des administrateurs, des cliniciens, des psychanalystes, des psychiatres, des gens qui font de la neurophysiologie, des ethnologues, etc ? Allant au delà ne devons nous pas penser que la spécificité des sciences sociales est qu’elles traitent justement de faits virtuels, qui s’incarnent à travers les regards entrecroisés qui les élaborent, leur donnant une consistance telle qu’ils deviennent source de décision, source de perception ?
Tout cela nous conduit vers une conclusion inspirée d’un texte de Merleau-Ponty, qui commençait en disant à peu près ces choses tout à fait banales que tout le monde aime dire, du genre : “ Regardez cette maison, je la regarde de tel endroit, j’ai une image de la maison ; je vais ailleurs, j’ai une autre image de la maison ”. Nous avons tous pensé cela un jour ou l’autre, ou quelque chose d’analogue. On se dit : “ J’accumule des images, j’accumulerai des images différentes de la maison. Alors comment pourrais-je vraiment voir la maison ? ” On poursuit “ La réalité de la maison est-ce alors la maison vue de nulle part ? ”. Merleau-Ponty répondait : « Ce n’est ni la maison vue de quelque part, ni la maison vue de nulle part, c’est la maison vue de toutes parts ”. Toutes ces images ne s’excluent pas les unes des autres, mais, en se cumulant, et sans jamais sortir de chacune des perceptions partielles, elles construisent le réel au-delà de chaque perception partielle.
N’est-ce pas là que nous conduit ce petit itinéraire entre les éventaires de ce qu’ont à s’offrir psychiatres et anthropologues ? Clarifier nos concepts, nos positions, nos identités. Ne jamais oublier que nous sommes à la fois des primates qui pensent et des primates qui aspirent à ne pas en être, et que cela nous fait construire des mythes, des idées, des erreurs. L’anthropologue analyse cela ; le psychiatre choisit un autre chemin, car il est un homme en responsabilité, ce qui est une différence très importante. Le message sur lequel je voudrais attirer votre attention, c’est de ne jamais dissocier à notre propos que nous sommes des êtres de culture et des êtres sociaux, et que l’un se gère à partir de l’autre. On ne peut pas évacuer les rapports sociaux dans un culturalisme idéaliste.
D’autre part, on peut sans doute éviter les exclusions sans fusionner les idées dans la bouillie de mélanges confus, en essayant de construire son regard de façon feuilletée, à partir des différents points de vue qu’il embrasse à mesure qu’il se déplace, des points de vue qui sachent se cumuler tout en demeurant autonomes.
Références
Benoist Jean Anthropologie médicale en société créole. Paris P.U.F. , 1993. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
Benoist Jean L’esprit sur lui et le cerveau gâté Psychiatrie française, 5, 1983.
Devereux Georges Ethnopsychalalyse complémentariste.
Leenhardt Maurice Gens de la grande terre Paris, Gallimard, 1937.
Sokal Alan et Jean Bricmont Impostures intellectuelles Paris, O. Jacob , 1997.
|

