|
Jean-Louis Benoît
“Réflexions tocquevilliennes
sur un paradoxe démocratique”.
Traduction française du texte d’une communication faite au Symposium de Liberty Fund à Compostelle en septembre 2008 sur l’apport du voyage de Tocqueville aux États-Unis sur la pensée et l’œuvre de Tocqueville. Le texte original, en anglais, de la conférence a été publié dans l’ouvrage sous la direction de Christine Dunn Henderson, Tocqueville's Voyages : The Evolution of His Ideas and Their Journey Beyond His Time. Indianapolis, Indiana : Liberty Fund Inc, février 2015, 560 pp.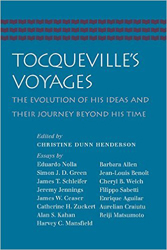
- Introduction
- L’inversion de la perspective et le changement total de point de vue sur le sort réservé aux Indiens
- Les derniers féodaux
- La question du métissage
- Le choc des civilisations et l’esprit des nations
- Témoigner devant le tribunal de l’Histoire : un plaidoyer pour dénoncer le sort fait aux Cherokees
- Respect des traités et promesses fallacieuses
- L’Algérie, les leçons d’une expérience
- En Amérique j’ai vu plus que l’Amérique
Introduction

Le dernier chapitre de la seconde partie de La démocratie en Amérique 1835 possède un statut singulier dans l’ouvrage, et Tocqueville signale à l’attention du lecteur qu’il s’agit d’une sorte d’addendum d’une nature différente du reste du livre [1] dont, curieusement, la nécessité ne s’était pas imposée d’emblée puisque les ultimes épreuves et brouillons du texte, qu’il avait donné à lire et commenter à ses proches [2], s’arrêtaient à la fin du chapitre IX qui s’achevait par cette conclusion :
- Mon but a été de montrer, par l’exemple de l’Amérique, que les lois et surtout les mœurs pouvaient permettre à un peuple démocratique de rester libre [3].
Puis, en rupture avec tout ce qui précède, il livre au lecteur un ultime chapitre, le chapitre X, qui constitue en fait une nouvelle partie à lui tout seul, qualitativement - par son contenu – et quantitativement, parce qu’il représente plus du quart de la première Démocratie. L’avertissement qu’il adresse au lecteur est très net et singulier à la fois :
- La tâche principale que je m’étais imposée est maintenant remplie (…). Je pourrais m’arrêter ici, mais le lecteur trouverait peut-être que je n’ai point satisfait son attente.
-
- [...] On rencontre en Amérique autre chose encore qu’une immense et complète démocratie …
-
- Dans le cours de cet ouvrage, mon sujet m'a souvent amené à parler des Indiens et des Nègres, mais je n'ai jamais eu le temps de m'arrêter pour montrer quelle position occupent ces deux races au milieu du peuple démocratique que j'étais occupé à peindre. (…)
-
- Ces objets, qui touchent à mon sujet, n'y entrent pas; ils sont américains sans être démocratiques, et c'est surtout la démocratie dont j'ai voulu faire le portrait. J'ai donc dû les écarter d'abord; mais je dois y revenir en terminant [4].
Cette dernière remarque peut être considérée comme ambiguë puisque la question de l’esclavage, appuyé sur une question de race, et du racisme, et le sort réservé aux Indiens : spoliation, déportation, extermination et génocide, constituent une véritable antinomie démocratique.
En effet, pour Tocqueville, la république américaine et les démocraties modernes à venir, correspondent à un état social absolument nouveau [5], ces régimes étant totalement différents de ceux d’Athènes et de Rome [6] : Je voudrais bien qu’en cette matière on cessât de nous citer à tout propos l’exemple des républiques démocratiques de Grèce et de l’Italie [7]. Rien de commun non plus avec les Républiques italiennes de la Renaissance.
Comme il le souligne dans l’introduction de La démocratie, Tocqueville considère le continuum historique, comme un mouvement providentiel qui a rendu inéluctable la montée de la démocratie moderne, née de l’esprit des Lumières, cher aux philosophes français comme aux pères fondateurs des États-Unis, Jefferson, par exemple.
Les principes des Lumières constituent pour Tocqueville une reprise laïcisée des valeurs universelles du christianisme originel, comme il l’affirme à Gobineau dont il condamne avec vigueur L’Essai sur l’Inégalité des Races [8]. Pour lui, il n’existe qu’une seule humanité, une seule espèce humaine : L’homme suivant Buffon et Flourens, est donc d’une seule espèce et les variétés humaines sont produites par trois causes secondaires et extérieures : le climat, la nourriture et la manière de vivre [9] . L’égalité des hommes constitue donc un principe cardinal, au fondement de toutes les démocraties modernes [10].
Ce principe cardinal est incompatible avec l’esclavage et le génocide des Indiens qui sévissaient aux États-Unis et dont l’existence constituait pour lui une antinomie démocratique et le problème posé par cette antinomie est, dans sa nature même, démocratique et américain à la fois et c’est bien la démocratie américaine qui est en question comme le note justement Cheryl Welch :
- Il existe un certain paradoxe dans cette exclusion théorique des problèmes qui allaient représenter le défi moral le plus profond pour la démocratie américaine, et, pourrait-on dire, pour toute société démocratique moderne. Tocqueville lui-même s’est rendu compte de certains de ces paradoxes : il n’a pas détourné le regard de la contradiction vécue par un peuple « égalitaire » et « libre » qui pratiquait le despotisme racial et était responsable d’un génocide, mais il y a posé un regard pénétrant avant de se concentrer sur ses propres préoccupations [11].
Qu’est-ce qui justifie ce soudain changement de cap dans l’analyse que Tocqueville fait de la démocratie américaine ; pourquoi cet ajout, au dernier moment, du chapitre X ?
À leur retour des États-Unis, il avait été convenu que Tocqueville rédigerait un ouvrage sur les institutions américaines, Beaumont se réservant de traiter des mœurs, sous une forme romanesque. Les deux ouvrages rédigés au même moment étaient destinés à paraître quasi simultanément ; en outre chacun des deux auteurs annonçait la parution du livre de l’autre. Et c’est dans la mesure où le roman de Beaumont : Marie ou de l’esclavage aux États-Unis, traitait du problème des races et du racisme, de l’esclavage, et de la misère des Indiens et de leur disparition à terme, que Tocqueville avait renoncé à traiter de ces questions.
À la fin de l’introduction de La démocratie, il écrit dans une note : À l'époque où je publiai la première édition de cet ouvrage, M. Gustave de Beaumont, mon compagnon de voyage en Amérique, travaillait encore à son livre intitulé Marie, ou l'Esclavage aux États-Unis, qui a paru depuis [12].
Le statut du chapitre X fait donc problème ; les questions abordées : l’avenir des trois races, l’esclavage des Noirs et le sort des Indiens relèvent plus des mœurs et des questions sociétales et politiques que des institutions proprement dites.
Qu’est-ce qui justifie cette nouvelle approche, cet ajout qui n’a pu être décidé que d’un commun accord entre les deux amis ?
- Le 15 août de cette année [13], son manuscrit sous le bras, Tocqueville arrivait au château de Gallerande, dans la Sarthe, invité par Madame Eugénie de Sarcé, sœur de Gustave de Beaumont. Il resta en compagnie des Beaumont jusqu’à la mi-Septembre…
Beaumont a-t-il convaincu Tocqueville de traiter une question qui, au départ, appartenait à Marie ? La décision de Tocqueville a-t-elle quelque chose à voir avec les problèmes raciaux qui ont éclaté sur la côte est des États-Unis pendant l’été 1834 ? Tocqueville a-t-il revu et corrigé ce chapitre chez les Beaumont à la fin de l’été ? Le manuscrit (…) est là pour attester une composition rapide [14].
L’hypothèse la plus vraisemblable est que ce dernier chapitre fut bien ajouté au texte original au dernier moment, à Gallerande, d’un commun accord, en raison des émeutes qui avaient éclaté à New York le 9 juillet 1834, et que Beaumont intégrait, lui aussi, au chapitre 13 de son roman, « L’émeute » !
Les circonstances historiques et politiques du moment rendaient cet ajout obligatoire pour Tocqueville qui entendait livrer à la classe politique française un ouvrage de première importance sur les institutions des États-Unis. Il ne lui était désormais plus possible de passer sous silence la question de l’esclavage et celle du génocide, les deux problèmes majeurs, politiques, moraux et sociétaux qui se posaient et continueraient de se poser à la démocratie américaine, sans discréditer la valeur scientifique de son ouvrage [15].
L’inversion de la perspective et le changement total
de point de vue sur le sort réservé aux Indiens

Le dernier chapitre de La démocratie est d’autant plus remarquable qu’en ce qui concerne la question des Indiens, Tocqueville inverse la perspective du premier chapitre de l’ouvrage concernant les conditions faites aux Indiens et leur destinée. Là, après avoir souligné les vertus des Indiens, il se plaçait dans une perspective historique admettant que si les Indiens étaient certes les premiers occupants du pays, ils n’en étaient pas pour autant vraiment les propriétaires, se ralliant, en vertu de la force des lois du développement historique, au point de vue des citoyens américains pour lesquels les Indiens n’avaient été jusqu’alors que les usufruitiers temporaires du sol, « en attendant ». La même Providence, qui ne les avait placés là que pour occuper l’espace de façon non prométhéenne, avait inscrit également leur disparition nécessaire et inéluctable. Singulière Providence qui sacrifiait le droit naturel, celui du premier occupant, à la raison du plus fort :
- Quoique le vaste pays qu'on vient de décrire fût habité par de nombreuses tribus d'indigènes, on peut dire avec justice qu'à l'époque de la découverte il ne formait encore qu'un désert. Les Indiens l'occupaient, mais ne le possédaient pas. C'est par l'agriculture que l'homme s'approprie le sol, et les premiers habitants de l'Amérique du Nord vivaient du produit de la chasse. Leurs implacables préjugés, leurs passions indomptées, leurs vices, et plus encore peut-être leurs sauvages vertus, les livraient à une destruction inévitable(…) La Providence, en les plaçant au milieu des richesses du nouveau monde, semblait ne leur en avoir donné qu'un court usufruit ; ils n'étaient là, en quelque sorte, qu'en attendant [16].
Le système pénitentiaire était un prétexte : je l’ai pris comme un passeport qui devait me faire pénétrer partout aux États-Unis, écrivait Tocqueville à son cousin Camille d’Orglandes, en novembre 1834 [17]. Il avait effectivement plusieurs autres raisons d’entreprendre ce voyage, la première étant de s’éloigner du nouveau régime installé en France, mais il avait également un vif désir de voir fonctionner, in situ, la démocratie américaine, à cela s’ajoutait l’intérêt traditionnel, dans le milieu familial de Tocqueville et Beaumont, pour la vie politique des États-Unis et la découverte du pays et de ses habitants, y compris les Indiens qui hantaient l’imaginaire français depuis les voyages de Cartier et l’évangélisation des Jésuites. Ils avaient encore l’esprit plein des textes de Fennimore Cooper et de Chateaubriand et leur déconvenue fut totale [18].
Le spectacle de ces malheureux Indiens choqua profondément les deux voyageurs, émus par la détresse de ceux qui étaient, pour eux, l’incarnation du Bon Sauvage de Rousseau. Singulier contraste entre leurs vertus originelles et leur pauvreté présente, dans la majesté du cadre originel décrit par Tocqueville comme un tableau romantique de Corot ou Delacroix : Une sorte d'ordre méthodique y a présidé à la séparation des terres et des eaux, des montagnes et des vallées. Un arrangement simple et majestueux s'y révèle au milieu même de la confusion des objets et parmi l'extrême variété des tableaux [19]. Livre de la Genèse, monde des origines, peuplé de sauvages possédant encore l’innocence, la douceur mais aussi la férocité et la fierté primitives. Là vit le Bon Sauvage, plein des vertus de noblesse, de courage et de désintéressement ; parfaitement adapté à la vie naturelle et à la mort.
- Les Indiens, en même temps qu'ils sont tous ignorants et pauvres, sont tous égaux et libres…
-
- Doux et hospitalier dans la paix, impitoyable dans la guerre, au-delà même des bornes connues de la férocité humaine, l'Indien s'exposait à mourir de faim pour secourir l'étranger qui frappait le soir à la porte de sa cabane, et il déchirait de ses propres mains les membres palpitants de son prisonnier.(…) L'Indien savait vivre sans besoins, souffrir sans se plaindre, et mourir en chantant [20].
Tocqueville écrivait l’histoire de la rencontre des Indiens avec les Européens dans une perspective rousseauiste : les Indiens étaient naturellement bons faisant preuve de générosité et d’hospitalité à l’égard des Européens ; ses interlocuteurs canadiens lui assuraient que le vol était inconnu chez eux avant leur entrée en contact avec la société moderne et « civilisée » qui les avait corrompus : Je pense qu’ils sont beaucoup meilleurs quand ils n’ont point de contact avec nous et certainement plus heureux [21], lui dit un Bois-Brûlé [22].
Mais lorsque Tocqueville et Beaumont arrivent en Amérique, ces Bons Sauvages ont déjà été décimés, il n’en restait alors que quelques milliers dans les treize colonies initiales ; tous les autres ont disparu, chassés de leurs territoires, exterminés. Au cours de leur périple, les deux Français ne tardent pas à acquérir la certitude qu’ils sont en face d’un processus d’extermination massive qui ira jusqu’à son terme.
Comme beaucoup d’observateurs et d’analystes, Tocqueville établit une distinction entre les relations que les Français, d’une part, les Anglais de l’autre, avaient noué avec les Indiens.
La plus grande partie des opinions élogieuses qu’il relève à l’égard des Indiens, sont le fait soit de Français, soit de Canadiens de souche française et les interlocuteurs de Tocqueville soulignent tous la sympathie réciproque des Indiens, des Canadiens [23] et des Français ; et dès lors, à ce stade de La démocratie, il remplace désormais, quand il évoque les pionniers, le terme « Européens » par « Anglo-Américains » [24].
Fidèle à l’enseignement de Montesquieu dans L’Esprit des Lois, Tocqueville considère qu’il existe bien un esprit des nations ; et, concernant la question de l’avenir des Indiens comme des Noirs, il juge que ce qui se joue aux États-Unis résulte bien du choix politique et idéologique des émigrants de souche majoritairement anglaise. Il n’est pas loin de considérer comme Francis Parkman quelques années plus tard, que : La civilisation espagnole a écrasé l’Indien; la civilisation anglaise l’a méprisé et négligé; la civilisation française l’a étreint et chéri [25] ; et il rappelle que le gouverneur du Canada faisait part à Louis XIV de l’attitude ambivalente des Français, tout à la fois bloqués par leur « esprit de clocher » et capables de partager la vie des sauvages :
- Deux grandes nations de l'Europe ont peuplé cette portion du continent américain : les Français et les Anglais.
- Les premiers n'ont pas tardé à contracter des Unions avec les filles des indigènes mais (…) au lieu de donner aux barbares le goût et les habitudes de la vie civilisée, ce sont eux qui souvent se sont attachés avec passion à la vie sauvage…
L'Anglais, au contraire… n'a donc voulu établir aucun contact avec des sauvages qu'il méprisait, et a évité avec soin de mêler son sang à celui des barbares.
Et Tocqueville ajoute :
- Si nous faisons attention, disent Messieurs Clark et Cass dans leur rapport au Congrès, doc. n° 117, p. 11, à l’influence acquise et exercée par les Français sur les Indiens, influence dont on aperçoit encore les traces visibles après que deux générations se sont écoulées, on sera porté à conclure que les Français se sont servi de leur pouvoir avec honneur et impartialité. [26]
Les derniers féodaux

À partir de son voyage dans la région des Grands Lacs et du séjour Canadien, Tocqueville est d’autant plus attentif au sort des Indiens qu’il les a côtoyés, qu’il a parlé avec eux [27]. Ils ne sont plus tout à fait étrangers, et Tocqueville les considère désormais moins comme les Bons Sauvages que comme un peuple possédant - et tenant à conserver, au péril de sa vie même - ses vertus et ses valeurs : le mépris du travail et des objets matériels, le goût de la liberté, du combat et de la guerre et un sens aigu et viscéral de l’honneur. Ils sont à leur manière les derniers féodaux et de véritables aristocrates :
- Il n'y a point d'Indien si misérable qui, sous sa hutte d'écorce, n'entretienne une superbe idée de sa valeur individuelle ; il considère les soins de l'industrie comme des occupations avilissantes… Il se croit encore supérieur à nous. La chasse et la guerre lui semblent les seuls soins dignes d'un homme. L'Indien, au fond de la misère de ses bois, nourrit donc les mêmes idées, les mêmes opinions que le noble du Moyen Âge dans son château fort, et il ne lui manque, pour achever de lui ressembler, que de devenir conquérant…
-
- Je ne saurais m'empêcher de penser que la même cause a produit, dans les deux hémisphères, les mêmes effets, et qu'au milieu de la diversité apparente des choses humaines, il n'est pas impossible de retrouver un petit nombre de faits générateurs dont tous les autres découlent. Dans tout ce que nous nommons les institutions germaines, je suis donc tenté de ne voir que des habitudes de barbares, et des opinions de sauvages dans ce que nous appelons les idées féodales [28].
Ce point est fondamental ; en écrivant son ouvrage, Tocqueville s’adresse directement aux premiers destinataires de La démocratie en Amérique, les siens, ceux de sa caste, les légitimistes. Il tient à convaincre les élites politiques que la montée de la démocratie dans les États de droit de l’Europe occidentale est inéluctable.
L’aristocratie est à la société française de 1835 ce que les Indiens sont au développement historique et économique des États-Unis : un vestige historique destiné à disparaître. Et lorsqu’il évoque « les institutions politiques de nos pères les Germains [29] », il fait allusion, à la tradition, issue de Boulainvilliers et reprise de Montesquieu à Guizot, à laquelle il s’est lui-même référé, qui faisait remonter la féodalité et l’aristocratie qui en est issue, aux envahisseurs des tribus germaniques qui auraient imposé leur domination aux populations gallo-romaines. Dialectique hégélienne du maître et de l’esclave, au terme de laquelle l’esclave devient le maître du maître, illustration du processus historique qui conduit à la Révolution française.
La théorie de Boulainvilliers avait nourri l’idéologie de la réaction nobiliaire qui accéléra le processus révolutionnaire. Dès 1788, Sieyès écrivait dans Qu’est-ce que le Tiers état ?
- Pourquoi (le Tiers) ne renverrait-il pas dans les forêts de la Franconie toutes ces familles qui conservent la folle prétention d'être issues de la race des conquérants et d'avoir succédé à leurs droits ?
-
- La nation, alors épurée, pourra se consoler, je pense, d'être réduite à ne se plus croire composée que des descendants des Gaulois et des Romains. En vérité, si l'on tient à vouloir distinguer naissance et naissance, ne pourrait-on pas révéler à nos pauvres concitoyens que celle qu'on tire des Gaulois et des Romains vaut au moins autant que celle qui viendrait des Sicambres, des Welches et autres sauvages sortis des bois et des étangs de l'ancienne Germanie ? [30]
Et Tocqueville considère que Sieyès avait raison sur le fond, même s’il eût fallu nuancer le propos dans la forme [31].
Comme Chateaubriand, qui appartient à sa parentèle [32], Tocqueville est vivement convaincu d’être le témoin d’un monde qui s’évanouit, de la disparition de la vieille aristocratie, en tant que telle, dans son rapport à l’Ancien Monde ; elle est donc destinataire, au premier chef, du message par lequel il lui enjoint de s’adapter au monde démocratique qui est en train de naître, afin de lui transférer ses valeurs propres, au premier rang desquelles son goût inextinguible pour la liberté.
Tamara Teale considère que l’empathie de Tocqueville pour les Indiens condamnés à disparaître révèle une sympathie profonde, une communauté de caste avec les nations indiennes qui partageraient une sorte de communauté de destin avec l’aristocratie française : Tocqueville compare l’Indien au noble féodal dans son château, refusant de s’intégrer au nouvel ‘état social’ sauf à y être contraint par la nécessité. Dans le paradoxe de la naissance gémellaire de la liberté et du génocide nous pouvons voir en l'appropriation par Tocqueville de son héritage, le fait d'un aristocrate, membre d’une catégorie en voie de disparition, établissant un parallèle avec la situation des indiens d'Amérique [33].
La question du métissage

Lors de leur périple américain, Tocqueville et Beaumont ont découvert l’importance du métissage dans les sociétés humaines. Métissage des Indiens et des blancs au Canada et dans la région des Grands lacs, métissage des Noirs et des Blancs, si particulier en Louisiane et impossible ailleurs. Ils ont acquis la certitude que si le problème de l’esclavage est insoluble à courte échéance, aux États-Unis, c’est parce qu’il ne porte que sur une seule race, ce qui rend l’abolition possible en droit mais impossible dans les mœurs, les préjugés contre les Noirs résistant à toute tentative abolitionniste ! Le problème ne trouverait sa solution que si les deux populations acceptaient de se côtoyer sur un pied d’égalité, de se mêler et d’admettre vraiment un métissage. Mais Tocqueville sait que ceci n’est pas possible hic et nunc et il ignore si ce métissage pourra jamais se faire [34].
Il évoque à plusieurs reprises la rencontre avec des métis, la première et la plus curieuse a lieu lorsque Beaumont et lui se rendent à Saguinaw Bay :
- Comme je me préparais moi-même à monter (dans le canot) le prétendu Indien s’avança vers moi, me plaça deux doigts sur l’épaule et me dit, avec un accent normand qui me fit tressaillir : « N’allez pas trop vitement, y en a des fois ici qui s’y noient. » Mon cheval m’aurait adressé la parole que je n’aurais pas, je crois, été plus surpris … Le Canadien poussait la nacelle de l’aviron, tout en chantant à demi voix sur un vieil air français le couplet suivant dont je ne saisis que les deux premiers vers :
- Entre Paris et Saint-Denis
- Il était une fille… [35]
Et le lendemain, nouvel étonnement : le métis était absent mais sa jeune femme, une Indienne, psalmodiait sur un air indien Les cantiques de la Providence !
À Saguinaw, nouvelle rencontre avec une Indienne et son fils : Le Français était son mari et il lui avait déjà fait plusieurs enfants. Race extraordinaire, mélange du sauvage et de l’homme civilisé… [36]
Quelques jours plus tard, en arrivant à Sault-Sainte-Marie ils découvrent un village singulier où se mêlent trois populations, française, indienne et métis, ainsi que Beaumont l’écrit à son frère Achille :
- Le 6 août, de bon matin, nous sommes entrés dans le village qui porte le nom de Saut Sainte-Marie… (où) tout le monde (…) parle français ; il y a là autant d'Indiens que de Canadiens. Chaque jour les deux populations se mêlent entre elles : cette population moitié européenne moitié indienne n'est point désagréable…. Les Canadiens appellent métiches (métis) ceux qui sortent de cette double origine. J'ai vu des jeunes filles métiches qui m'ont paru d'une beauté remarquable… [37]
À plusieurs reprises Tocqueville souligne lui aussi l’heureux résultat du métissage tant sur le plan de la beauté que de l’intelligence ; peut-être même pourrait-il constituer la seule voie de salut. Plusieurs de leurs interlocuteurs pensent qu’il rendrait, ou aurait peut-être rendu, possible la survie et une forme d’assimilation réussie des Indiens [38].
Mais dans La démocratie et dans Marie, Tocqueville et Beaumont considèrent que désormais que le métissage ne peut être une voie de salut parce que le sort des Indiens est scellé en raison même de leur confrontation avec la civilisation anglo-américaine, à la fois parce que nombre de tribus refusaient de s’adapter et, pire encore, parce que celles qui avaient entrepris de s’adapter étaient bien plus indésirables encore pour les colons qui entendaient accaparer la totalité du continent, jusqu’au Pacifique.
Le choc des civilisations et l’esprit des nations

À partir de son expérience américaine, Tocqueville met en évidence une loi [39] du développement et de la cohabitation des sociétés qui met la moins avancée en péril quand elle est confrontée à une civilisation plus moderne. La rencontre entre deux sociétés très inégalement développées est fondamentalement différente selon que celle qui l’emporte par la force est la plus ou la moins avancée. Historiquement, dans le second cas, les envahisseurs se sont intégrés au pays, ont assimilé la civilisation ambiante et se sont mis à l’école de ceux qu’ils avaient vaincus. Tocqueville reprend ici l’exemple de l’invasion de l’Empire romain par les Germains, s’appuyant une nouvelle fois sur la théorie de Boulainvilliers :
- Si l'on jette un regard attentif sur l'histoire, on découvre qu'en général les peuples barbares se sont élevés peu à peu d'eux-mêmes, et par leurs propres efforts, jusqu'à la civilisation…
-
- Les barbares finissent par introduire l'homme policé dans leurs palais, et l'homme policé leur ouvre à son tour ses écoles. Mais quand celui qui possède la force matérielle jouit en même temps de la prépondérance intellectuelle, il est rare que le vaincu se civilise; il se retire ou est détruit [40].
Disciple de Montesquieu, Tocqueville met en évidence la loi du développement historique qu’il tire de son expérience américaine et s’appuie, pour établir la justesse de sa thèse, sur trois situations dans lesquelles, sur le continent Nord-Américain, les Français au contact des Anglais, se sont vus dominer par ceux-ci. Dans le premier cas, ils n’ont eu d’autre solution que de quitter la ville de Vincennes au Wabash ; dans le second, au Canada, ils ont subi et continuent à subir la domination politique des Anglais ; dans le troisième leur domination économique, en Louisiane [41].
Au nom des valeurs universelles de l’humanité, des nations chrétiennes et de la démocratie, la civilisation la plus développée et la plus puissante devrait instaurer un modus vivendi garantissant, au moins en partie, la survie de la civilisation première et la moins avancée. Et Tocqueville rappelle que Washington s’était adressé au Congrès en ces termes : Nous sommes plus éclairés et plus puissants que les nations indiennes; il est de notre honneur de les traiter avec bonté et même avec générosité … mais il ajoute : Cette noble et Vertueuse politique n'a point été suivie [42].
Les actes du Congrès et les passages de différents rapports au Congrès [43] établissent clairement que les hommes politiques étaient parfaitement avertis de ce qu’il aurait fallu faire pour assurer la sauvegarde, au moins partielle de la population indienne : garantir aux tribus, par des traités, une part significative de leurs territoires ancestraux et respecter ces traités au lieu de les resserrer sur des espaces de plus en plus restreints. Des traités convenablement rédigés et appliqués auraient dû reconnaître aux indiens un véritable droit de propriété permettant la survie de leurs nations et un accommodement de leur vie et de leur civilisation traditionnelle avec celles des Anglo-Américains, mais : le malheur des Indiens (a été) d'entrer en contact avec le peuple le plus civilisé, et j'ajouterai le plus avide du globe [44].
Témoigner devant le tribunal de l’Histoire :
un plaidoyer pour dénoncer le sort fait aux Cherokees

À mesure de la progression de leur périple américain, Tocqueville et Beaumont acquièrent la certitude que la cause des Indiens est entendue et que le génocide ira jusqu’à son terme. Ils décident de témoigner devant l’Histoire, l’un comme romancier, l’autre comme avocat. Tocqueville rassemble alors les pièces d'un dossier dans lequel il élabore la défense des nations indiennes contre les États de l'Union et l'Union elle-même, ce qui explique le caractère totalement insolite et atypique de ce passage de La démocratie ; le seul dans lequel les notes extraits de rapports, textes officiels, données quantitatives sont trois fois plus importantes que dans l’ensemble du livre [45].
En juillet 1834, Tocqueville et Beaumont ont acquis une connaissance précise de la question indienne, née de leurs rencontres et de leurs discussions avec tous leurs interlocuteurs les plus divers : les Indiens qu’ils ont vus vivre, les Bois-Brûlés, les pionniers. Ils ont également recueilli les témoignages et commentaires de personnages importants comme Joël Roberts Poinsett et John Spencer, et plus encore, ceux de John Tanner et Sam Houston, qui ont vécu des années dans les tribus indiennes. Ils ont également lu une quantité de rapports officiels consacrés à la question indienne depuis deux siècles, avec leur mystérieux talent, qui semblait parfois providentiel, de trouver les hommes les plus importants qui faisaient, ou qui accompliraient, les choses les plus importantes dans l’Amérique de leur génération [46], de Houston à Crokett et Tanner, d’Adams à Jackson.
Tocqueville est désormais capable de dégager de l’ensemble de ces données « une idée mère » ; il est assuré qu’avec la mise en place de L’Indian Removal Act, il est possible d’avoir une vision globale de la question indienne, dans une perspective synchronique, puisqu’il est certain que toutes les tribus connaîtront le même sort, et diachronique, puisqu’il tient désormais la « raison » - au sens fort et quasi mathématique du mot de ce qui s’est passé avec les Indiens depuis l’arrivée des premiers colons en Virginie aux traités de 1790, de ce qui se passe depuis le début de la présidence de Jackson, et de ce qui en découlera inéluctablement.
Tocqueville juge que le destin ultime des tribus indiennes est déjà écrit, d’où le titre du sous-chapitre : État actuel et avenir probable des tribus indiennes qui habitent le territoire possédé par l’Union…
Leur sort est déjà scellé, comme dans la tragédie : « Et voilà. Maintenant, le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul (…) il n'y a plus d'espoir,( …) Et il n'y a plus rien à tenter… [47] »
Pour la majorité des interlocuteurs de Tocqueville, les Indiens doivent disparaître : Je pense que c’est une race qui périra sans se civiliser. (…) Au reste, je pense que l’homme civilisé a le droit de prendre la terre dont (le sauvage) ne sait point tirer parti.... [48]
Les tribus indiennes incapables de se civiliser, ou refusant de le faire, sont donc condamnées à disparaître, mais celles qui ont choisi la voie de la civilisation le sont également, et à plus forte raison ; il faut absolument les arracher au sol qui leur appartient et sur lequel elles entreprennent de se sédentariser, de cultiver comme le font les Cherokees, remarquables d’intelligence et de courage, comme Houston le soulignait en comparant les qualités des diverses tribus :
- À la tête de tous sont les Cherokees. Les Cherokees vivent entièrement de la culture de la terre. Ils sont la seule nation indienne qui ait une langue écrite.
- Après les Cherokees viennent les Creeks. Les Creeks vivent tout à la fois de la chasse et de la culture des terres. Ils ont des lois pénales positives et une forme de gouvernement.
- Je place ensuite les Chikesaws et les Chactaws [49].
Pour la majorité des citoyens, l’affaire est simple : tous doivent mourir, ceux-ci parce qu’ils refusent de se civiliser, ceux-là parce que, au contraire ils choisissent la civilisation et constituent un obstacle bien plus grand encore et qu’ils sont d’autant plus gênants. Tocqueville met en évidence le fond de la pensée de la majorité des Américains :
- Il faut qu’ils meurent [...] Je ne ferai rien contre eux, je me bornerai à leur fournir tout ce qui doit précipiter leur perte... Avec le temps j’aurai leurs terres et je serai innocent de leur mort […]
-
- Satisfait de son raisonnement, l’Américain s’en va dans le temple où il entend un ministre de l’Évangile répéter chaque jour que tous les hommes sont frères et que l’Être éternel qui les a tous faits sur le même modèle leur a donné à tous le devoir de se secourir [50].
Pour souligner l’importance de l’enjeu, Tocqueville recourt aux données chiffrées officielles et à la question de respect des traités signés par le pouvoir fédéral en 1790.
Les tribus qui occupaient les treize colonies initiales ont été décimées ; elles ne comptent plus, selon les chiffres officiels du 20e Congrès, que 6273 individus misérables, mourant de faim et condamnés à mendier, ceux-là même que Beaumont et lui ont rencontrés à Oneida [51].
Concernant la population des Indiens existant encore sur le territoire des États-Unis, il cite trois autres chiffres empruntés aux données officielles : il restait en 1830, 75000 Indiens appartenant aux quatre grandes des nations Choctaws, Chickasaws, Creeks et Cherokees et 313 000 Indiens sur « le territoire occupé ou réclamé par l’Union Anglo-Américaine » [52]. Or ce sont justement ces tribus les plus assimilables dont la déportation est déjà arrêtée par le pouvoir jacksonien comme l’indique une note : Voyez les instructions du secrétaire de la guerre (…), en date du 30 mai 1830. Il y a 75,000 Indiens à transporter [53].
Pour contraindre ces tribus à accepter « volontairement » cette déportation, le pouvoir use des moyens les plus déloyaux ainsi que Tocqueville l’écrit à sa mère, le 25 décembre 1831, dans une lettre pleine de compassion, d’ironie et de colère [54].
Respect des traités et promesses fallacieuses

Houston, qui avait vécu parmi les Creeks, affirmait à Tocqueville, encore choqué du spectacle obscène de l’embarquement des Chactas à Memphis une semaine plus tôt, le jour de Noël 1831, que l’installation des tribus Indiennes à l’Est du Mississipi était pour elles une opportunité à saisir, la possession des terres situées dans l’Arkansas leur étant garantie :
- Les États-Unis se sont engagés par les serments les plus solennels à ne jamais vendre les terres contenues dans les limites et à ne jamais permettre à la population blanche de s’y introduire d’aucune manière, et il ajoute : Il se trouve déjà dans le territoire 10000 Indiens. Je pense qu’avec le temps il y en aura environ 50000 ; le pays est sain et la terre est fertile [55].
Houston croyait-il vraiment ce qu’il disait ? Beaumont et Tocqueville considéraient, eux, que la vérité était tout autre et ils n’ont rien retenu de ces affirmations dans leurs deux ouvrages respectifs, et, dans La démocratie, Alexis rappelle dans trois notes que ces mêmes promesses avaient déjà été faites solennellement aux Creeks et aux Cherokees en 1790 et 1791, et maintenant - en 1829 - le gouvernement central, en promettant à ces infortunés un asile permanent dans l’Ouest, n’ignore pas qu’il ne peut le leur garantir [56]. Promesses fallacieuses, serments éhontés ; Tocqueville et Beaumont partagent l’avis de Tanner, qui lui aussi avait vécu de nombreuses années avec les Indiens et considère que le processus qui est entamé ne cessera qu’avec la disparition des Indiens. Il dit à Beaumont :
- Vous, qui sympathisez avec leurs malheurs… hâtez-vous de les connaître ! car ils auront bientôt disparu de la terre. Les forêts d'Arkansas leur sont livrées à perpétuité ! Ce sont, il est vrai, les termes du traité ! Mais quelle dérision ! Les terres qu'ils occupaient dans la Géorgie leur avaient été, il y a trente ans, concédées aussi à perpétuité. (…) L'Indien qui s'attache (au pas des buffles sauvages) ne fait que suivre ses moyens d'existence, mais à force de s'avancer vers l'Ouest, il rencontrera l’Océan Pacifique. Ce sera le terme de sa courte vie. Combien d’années s’écouleront avant sa ruine ? On ne pourrait le dire [57].
Tous les éléments du dossier étant ainsi posés, il ne reste pour terminer à Tocqueville, qu’à procéder à la plaidoirie, il choisit donc de donner la parole à ceux qui sont condamnés à disparaître, et il rapporte l’émouvant témoignage des Cherokees devant le Congrès :
- Par la volonté de notre Père céleste qui gouverne l'univers, … la race des hommes rouges d'Amérique est devenue petite et la race blanche est devenue grande et renommée…
- Nous voici les derniers de notre race, Nous faut-il aussi mourir ?
- Depuis un temps immémorial, Notre Père commun qui est au ciel, a donné à nos ancêtres la terre que nous occupons [58].
Tocqueville dénonce la dépossession illégale qui prive les Indiens de leurs terres et ajoute : Tel est le langage des Indiens : ce qu'ils disent est vrai; ce qu'ils prévoient me semble inévitable [59].
En 1830 le Congrès des États-Unis adopta l’Indian Removal Act [60]. Le Président Jackson en fit une loi qu’il se hâta de signer. Les Cherokees tentèrent de combattre la loi de déplacement devant la cour Suprême en se faisant reconnaître comme une nation indépendante. En 1832, la Cour Suprême des États-Unis arbitra en faveur des Cherokees et le juge John Marshall décida que la nation Cherokee était souveraine, ce qui invalidait l’acte de déplacement. Les Cherokee devraient donc au préalable donner leur accord dans un traité qui aurait à être ratifié par le Sénat.
En dépit de la décision de la Cour Suprême, le Président Jackson refusa de facto le verdict de la Cour déclarant : « Le juge Marshall a décidé de cette loi, à lui de la faire appliquer…»
Ce Monde est, il faut l’avouer, un triste et ridicule théâtre [61], écrit Tocqueville, avec l’ironie du désespoir à la fin de ce chapitre, et il conclut :
- La conduite des Américains des États-Unis envers les indigènes respire au contraire le plus pur amour des formes et de la légalité…
-
- Les Américains des États-Unis ont atteint ce double résultat avec une merveilleuse facilité, tranquillement, légalement, philanthropiquement, sans répandre de sang, sans violer un seul des grands principes de la morale aux yeux du monde. On ne saurait détruire les hommes en respectant mieux les lois de l'humanité [62].
Quelle iniquité terrible également lorsque Mr. (John) Bell annule d’un trait de plume les droits de propriété des Indiens sur les terres qui leur appartenaient, et « se débarrasse des arguments fondés sur le droit naturel et sur la raison [63] », violant ainsi les droits humains auxquels ces vertueux légistes prétendent être si attachés.
Tocqueville et Beaumont avaient bien pris conscience de la nature exacte du crime contre l’humanité qui se déroulait et la publication du livre de Beaumont et l’inclusion, dans celui de Tocqueville, du chapitre X, répondait au besoin de témoigner, de dénoncer la double atteinte au droit naturel et aux droits des individus et des peuples, véritable déni de démocratie au sein même de la grande démocratie moderne ; et, pour Tocqueville, il était devenu capital d’établir qu’il n’était pas passé à côté de l’existence de cette antinomie démocratique.
L’Algérie, les leçons d’une expérience

Entre 1837 et 1848, Tocqueville fut l’un des principaux intervenants sur la question de la colonisation de l’Algérie. Ses textes : articles dans les journaux, notes, rapports, interventions à la Chambre sont très nombreux et, ici encore, l’expérience américaine est toujours présente, même si c’est en arrière-plan, même si elle joue surtout le rôle de contre-exemple : « Ne recommençons pas, en plein XIXe siècle, l'histoire de la conquête de l'Amérique. N'imitons pas de sanglants exemples que l’opinion du genre humain a flétrie » [64]…
Cette recommandation, qui figure dans son rapport de 1847 sur l’Algérie, constitue l’une de ses préoccupations essentielles concernant les modalités de la colonisation, et ce, depuis ses premières prises de position en 1837. La comparaison du sort des Arabes, avec celui des tribus indiennes, par les Américains était d’autant plus justifiée que parmi les partisans de l’installation dans le pays il existait un courant d’opinion qui estimait qu’il fallait se débarrasser des indigènes, faire place nette pour les colons, assimilant explicitement le cas des Algériens à celui des Indiens et affirmant que « l’extinction de cette race coupable (serait) une harmonie » [65].
Dans ses deux Lettres sur l’Algérie de 1837, Tocqueville estimait que la France aurait dû procéder à la manière des Grecs : établir des comptoirs commerciaux ainsi que deux postes stratégiques sur la côte, à Alger et Mers El Kebir : Coloniser quelques points de la côte et dominer l’intérieur à la manière des Turcs est le seul plan praticable [66]. Il pensait qu’il serait possible que s’opère progressivement un métissage des deux peuples, Européens et Arabes, et que ce métissage qui a bien fonctionné entre Indiens et Canadiens, devrait permettre à ces « deux peuples différents de civilisation (d’) arriver à se fondre dans un seul tout » et qu’à terme, « la fusion (viendrait) plus tard d'elle-même » ; et il va même jusqu’à employer un terme très fort, le verbe amalgamer : Il n’y a donc point de raisons de croire que le temps ne puisse parvenir à amalgamer les deux races. Dieu ne l’empêche point; les fautes seules des hommes pourraient y mettre obstacle .
Mais après son premier voyage, en 1841, il revient sur son jugement et considère désormais que l’obstacle civilisationnel, fondé sur l’antagonisme religieux, exclut toute possibilité d’une société métissée :
- La première objection ne saurait être faite que par des gens qui n'ont pas été en Afrique. (…) La fusion de ces deux populations est une chimère qu'on ne rêve que quand on n'a pas été sur les lieux [67].
Il devient alors partisan de l’emploi de la force pour établir une « domination totale » permettant de réaliser « une colonisation partielle » [68], et s’appuyant une nouvelle fois a contrario sur son expérience américaine, il affirme, par exemple, qu’il ne faut pas entreprendre d’étendre la colonie dans les environs de Bône parce que : pour arriver à coloniser avec quelque étendue, il faudrait nécessairement en venir à des mesures non seulement violentes, mais visiblement iniques. Il faudrait déposséder plusieurs tribus et les transporter ailleurs, où vraisemblablement elles seraient moins bien [69].
Il dénonce en outre la latitude qu’il n’a jamais été ni sage ni même raisonnable dans un siècle civilisé de laisser à une autorité déléguée, surtout à une autorité militaire [70], l’armée étant naturellement inapte à réussir une mission de la colonisation.
À partir de 1846, Tocqueville s’oppose frontalement à Bugeaud parce que, pour lui, l’état de guerre n’est pas fait pour être permanent. Pour lui, l’objectif à atteindre était d’établir une colonie de peuplement avec des surfaces agricoles importantes, acquises par les arrivants, nécessaires à leur installation. La propriété d’une partie significative et suffisante des terres serait garantie aux populations indigènes pour qu’elles puissent vivre convenablement et que les deux populations puissent être utiles l’une à l’autre. Il propose à cet effet une politique globale d’occupation des sols, dans son rapport de 1847 [71].
Pour Tocqueville, le sud du pays doit rester aux mains des indigènes sans modifier la nature de la propriété : la population qui l’habite (…) « nous obéit sans nous connaître ; à vrai dire, elle est notre tributaire et non notre sujette » [72].
La Kabylie doit rester, absolument, aux mains et sous le contrôle des Kabyles, peuple différent des Arabes, possédant une réelle noblesse, avec lequel il serait possible de commercer. Les populations Kabyles avaient une haine naturelle des étrangers mais n’étaient « ni envahissantes, ni hostiles, (même si elles) se défendent vigoureusement quand on va chez elles… [73] » … Tocqueville réaffirme avec force et constance :
- Quant aux Kabyles, il est visible qu'il ne saurait être question de conquérir leur pays ou de le coloniser : leurs montagnes sont, quant à présent, impénétrables à nos armées et l'humeur inhospitalière des habitants ne laisse aucune sécurité à l'Européen isolé qui voudrait aller paisiblement s'y créer un asile. Le pays des Kabyles nous est fermé, mais l'âme des Kabyles nous est ouverte et il ne nous est pas impossible d'y pénétrer. [74]
Tocqueville ne bougea jamais de cette position et condamna sans ambiguïté l’entreprise militaire de Bugeaud en Kabylie en 1847 ; entreprise stupide d’un ambitieux matamore, et il ajoutait de façon prémonitoire : Qu’allons-nous faire en Kabylie ? (…) Nous allons vaincre les Kabyles ; mais comment les gouvernerons-nous après les avoir vaincus [75]…
En ce qui concerne la Mitidja, elle est déjà occupée par les Européens, il convient donc de régulariser la situation de la propriété des terres qui doivent rester aux colons mais au terme d’un processus régulier ou « régularisé ».
Quant au reste du Tell, de l’Algérie utile, c’est dans cette partie surtout qu’il convient d’installer de nouveaux colons et donc d’acquérir des terres, soit en recourant au « droit de la guerre » qui autorise le vainqueur à récupérer les terres des tribus qui se sont soulevées contre lui, soit en achetant des terres aux indigènes. Mais il précise que la vente des terres aux colons par les indigènes doit être interdite afin d’éviter les transactions frauduleuses et les spoliations, bien qu’il ait pu voir aux États-Unis qu’une telle pratique ne garantissait rien.
Et il ajoute :
- En conquérant l'Algérie, nous n'avons pas prétendu, comme les Barbares qui ont envahi l'empire romain, nous mettre en possession de la terre des vaincus.(…) La capitulation d'Alger en 1830 a été rédigée d'après ce principe. On nous livrait la ville, et, en retour, nous assurions à tous ses habitants le maintien de la religion et de la propriété. (…) S'ensuit-il que nous ne puissions nous emparer des terres qui sont nécessaires à la colonisation européenne? Non sans doute (…) Il importe à notre propre sécurité, autant qu'à notre honneur, de montrer un respect véritable pour la propriété indigène, et de bien persuader à nos sujets musulmans que nous n'entendons leur enlever sans indemnité ! aucune partie de leur patrimoine, ou, ce qui serait pis encore, l'obtenir à l'aide de transactions menteuses et dérisoires dans lesquelles la violence se cacherait sous la forme de l'achat, et la peur sous l'apparence de la vente [76].
Tocqueville continuait de penser et d’espérer qu’au contact l’une de l’autre, les deux populations pourraient avoir des intérêts communs à travailler et commercer ensemble :
- Il serait peu sage de croire que nous parviendrons à nous lier aux indigènes par la communauté des idées et des usages, mais nous pouvons espérer le faire par la communauté des intérêts…
-
- L'Européen a besoin de l'Arabe pour faire valoir ses terres ; l'Arabe a besoin de l'Européen pour obtenir un haut salaire. C'est ainsi que l'intérêt rapproche naturellement dans le même champ, et unit forcément dans la même pensée deux hommes que l'éducation et l'origine plaçaient si loin l'un de l'autre [77].
Les textes de 1846-47, concernant l’Algérie, constituent le testament politique de Tocqueville sur cette question. Il souligne comment la colonisation a été engagée avec des grandes maladresses en commettant de graves erreurs. Non seulement l’armée a montré son inaptitude à mener à bien cette entreprise mais encore l’administration civile avait, en Algérie, tous les défauts de l’administration française, en pire : à Alger, le pouvoir le plus oppressif et le plus malfaisant, est le pouvoir civil [78].
Tocqueville considère donc que, concernant la colonisation en Algérie, la France est à la croisée des chemins et se trouve devant une alternative : soit réviser totalement les modalités de la colonisation, y compris, et surtout, dans ses rapports avec les indigènes, soit se condamner à terme à un échec considérable qui condamnerait l’une des deux populations, algérienne ou européenne à disparaître :
- La commission est convaincue que de notre manière de traiter les indigènes dépend surtout l'avenir de notre domination en Afrique. (…) Si (…) nous agissions de manière à montrer qu'à nos yeux les anciens habitants de l'Algérie ne sont qu'un obstacle qu'il faut écarter ou fouler aux pieds ; si nous enveloppions leurs populations, non pour les élever dans nos bras vers le bien-être et la lumière, mais pour les y étreindre et les y étouffer, la question de vie ou de mort se poserait entre les deux races. L'Algérie deviendrait, tôt ou tard, croyez-le, un champ clos, une arène murée, où les deux peuples devraient combattre sans merci, et où l'un des deux devrait mourir. Dieu écarte de nous, Messieurs, une telle destinée ! [79]
La situation est donc ici en partie comparable à ce qui se passe et risque de se passer dans les États du Sud des États-Unis ; et c’est encore à ceux-ci qu’il fait référence, en terminant son rapport de 1847.
En Amérique j’ai vu plus que l’Amérique

- Comme si les mêmes pensées ne formaient pas un autre corps de discours par une disposition différente, aussi bien que les mêmes mots forment d’autres pensées par leur différente disposition.
« Il y a déjà près de dix ans que je pense une partie de ce que je t’exposais tout à l’heure », écrivait Tocqueville à son cousin Camille d’Orglandes en novembre 1834, précisant ainsi qu’avant même son voyage aux États-Unis, il était déjà en possession de son idée mère et de son appareil conceptuel concernant la montée inéluctable et les enjeux de la démocratie. En outre l’essentiel des découvertes et des nouveautés de Tocqueville constituent, comme le savent ceux qui ont lu le corpus tocquevillien avec attention, une reprise et une mise en évidence originale des idées du temps et, concernant la science politique, la philosophie politique et les problématiques du temps, tout ce qu’il dit ou écrit l’a été par d’autres à la même époque, et cependant il existe bien une originalité absolue, un génie propre de Tocqueville. Ainsi, pendant son voyage aux États-Unis, il a su qui interroger, quelles questions poser et qu’en retenir ; de même, dans l’ensemble de La démocratie, le détail des idées a déjà pu être exposé ici ou là, mais la synthèse tocquevillienne est absolument originale.
En outre, le voyage a ouvert la réflexion de Tocqueville sur maintes modalités et problématiques de la réflexion et de l’action politique à propos desquelles son expérience américaine resta constamment présente. Elle joua en particulier un rôle capital dans son combat pour l’abolition de l’esclavage, dans sa lutte pour élaborer et faire voter la réforme du système pénitentiaire français et dans ses interventions à la commission de rédaction de la constitution de 1848.
La présentation du dossier du génocide Indien est particulièrement éclairante à trois niveaux. D’une part elle nous renvoie à l’éthique du politique et au système de valeurs tocquevillien, d’autre part, elle est très instructive en ce qui concerne la méthode de Tocqueville, ce qui permet de mettre en évidence combien l’expression d’un prophétisme tocquevillien est impropre.
Pour Tocqueville, la réflexion et la conduite politique doivent reposer sur une conception éthique du politique, d’où sa critique de Machiavel. Il est profondément attaché aux valeurs des Lumières, dans lesquelles il voit la reprise laïcisée des valeurs du christianisme originel pour lequel il souligne à Gobineau son admiration tout en faisant état de son agnosticisme [80]. Il se situe dans le prolongement immédiat de Montaigne pour lequel : Chaque homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition [81] et pour lequel il n’existe bien qu’une seule humanité, riche de sa diversité ! C’est au nom des valeurs universelles et des droits de l’humanité que Tocqueville dénonce le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs. Les analyses qu’il fait à ce sujet nous permettent de mieux comprendre ce qu'il en est de sa méthode et de ce qu'on appelle de façon impropre son « prophétisme ». Il met en place un processus d’anticipation rationnelle, posant à plat l’ensemble des données disponibles, se référant aux lois du développement historique, et tenant compte des forces en présence et des paramètres qui entrent en jeu, il peut déjà déterminer le terme de la progression. Il est alors certain que le génocide des Indiens n’est ni un accident, ni un processus réversible, mais qu’il ira à son terme. En revanche, concernant la question des Noirs et de l’abolition de l’esclavage, le nombre de paramètres inconnus et imprévisibles, est tel qu’il est impossible, en 1834-35, de savoir à l’avance quelle sera l’issue du problème, alors que, concernant l’avenir de la colonisation française en Algérie, s’il n’est pas possible de poser les termes de l’alternative et de prévoir quel en sera le terme, il est aisé d’en préciser la nature.
En ce sens, le voyage, et l’utilisation qui en est faite, jouent un rôle capital sur la formation de la méthode tocquevillienne et sur la genèse des procédures qu’il mettra en place dans cette science politique nouvelle qui sous-tend son analyse et son action politiques.
[1] Sauf exception, toutes les références au texte de De la démocratie en Amérique (DA), renverront à la double édition d’Eduardo Nolla : édition Vrin (1990) et la version bilingue de cette édition pour Liberty Fund (LF), (2009)
[2] Le manuscrit de Tocqueville a été relu, notamment par Hervé de Tocqueville, son père, ses deux frères, Hippolyte et Edouard, Louis de Kergorlay, son cousin et ami, et Gustave de Beaumont qui ont commenté nombre de passages et proposé maintes modifications, les plus nombreuses étant le fait d’Hervé (une centaine de remarques) et d’Edouard (une cinquantaine). Elles figurent dans les deux éditions d’Eduardo Nolla, Vrin et Liberty Fund, 2009. Voir n.e., Vrin(1), p. 4-5, LF, p. 5.
[4] D.A., Vrin (1), p. 246, LF, p. 515-516.
[5] La notion d’état social démocratique est fondamentale pour comprendre l’analyse tocquevillienne. [Voir l’article Jean-Louis Benoît, “Tocqueville et la presse: presse, opinion publique et démocratie”. Texte d’une conférence faite à l’École de journalisme de l’Université de Marseille le 23 juin 2009.” dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
[6] D.A., Vrin (1), pp. 234-235, LF, p. 490-491.
[7] D.A., Vrin (2), p. 215, LF, p. 1142, n. n.
[8] On se reportera ici aux développements qui figurent dans Tocqueville Moraliste, éd. Champion, Paris, 2004, 88-89, 112-22.
[9] Tocqueville, Œuvres Complètes, (O.C.),vol. IX, Correspondance avec Gobineau, Paris, Gallimard, 1959, p. 197. Lettre de Tocqueville à Gobineau, 15 mai 1852. Cette lettre donne d’emblée la position de Tocqueville qui se réfère aux Travaux de Flourens, suppléant de Cuvier au Collège de France, un an avant la controverse sur l’Essai, qui ne débute qu’en 1853.
[10] L’égalité est mentionnée au second paragraphe de la déclaration d’indépendance des États-Unis : « Nous tenons ces vérités pour évidentes que tous les hommes sont créés égaux, qu’ils sont investis par leur Créateur d’un certain nombre de droits inaliénables, et que ces droits sont la Vie, la Liberté, et le poursuite du Bonheur », comme de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui stipule, dans son article premier : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits… »
[11] Cheryl Welch, De Tocqueville, New-York University Press, p. 61.
[12] E. Nolla, Vrin (1), p. 15, LF, p. 29. Les deux ouvrages de Tocqueville et Beaumont parurent en 1835, mais la première édition de La Démocratie sortit en janvier, avant Marie. De son côté, Beaumont écrit dans l’avant-propos de Marie ou de l’esclavage aux États-Unis : « Deux choses sont principalement à observer chez un peuple : ses institutions et ses mœurs. Je me tairai sur les premières. A l’instant même où mon livre sera publié, un autre paraîtra qui doit répandre la plus vive lumière sur les institutions démocratiques des États-Unis. Je veux parler de l’ouvrage de M. Alexis de Tocqueville, intitulé : De la démocratie en Amérique ». [En ligne dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
[14] D.A., Vrin (1), p. 246, n. a., L.F., p. 515, n.a.
[15] Malgré cet ajout du chapitre X, le 2 février 1835, la Gazette de France, reproche à Tocqueville d’avoir fait l’éloge d’« un pays d’humanité tricolore où des hommes rouges qui en sont les naturels se voient exterminer par des hommes blancs qui en sont les usurpateurs ; où les hommes noirs se vendent pêle-mêle sur la place publique » La Gazette de France, 2 février 1835, cité par Françoise Mélonio, Tocqueville et les Français, Aubier/Histoires, Paris, 1993, p. 58.
[16] D.A., Vrin (1), p. 24, LF, p. 43-44.
[17] Tocqueville, O.C. XIII, 1, Correspondance d’Alexis de Tocqueville et de Louis de Kergorlay, p. 374, Lettres choisies, Quarto, Paris Gallimard/Quarto, 2003, p. 311.
[18] E. Nolla ajoute dans une note : « C’est à Oneida Castle que les voyageurs avaient aperçu des Indiens pour la première fois. Quelques-uns d’entre eux avaient couru derrière leur voiture en demandant l’aumône ; ‘Nous avons rencontré les derniers d’entre eux sur notre chemin, écrit Tocqueville à sa mère à propos des Iroquois ; ils demandaient l’aumône et sont aussi inoffensifs que leurs pères étaient redoutables’. » Vrin (2), p. 291, n. b., LF, p. 1304, n. b.
[19] D.A., Vrin (1) p. 19, LF, p. 33.
[20] D.A., Vrin (1), p. 23, LF, p. 41-42.
[21] Tocqueville, O.C., V, 1, Voyage en Sicile et aux États-Unis, p. 74 ; Georges Wilson Pierson, Tocqueville in America, Baltimore, John Hopkins University Press, 1996, p. 303.
[22] Le fils d’un Canadien français et d’une Indienne.
[23] Dans les textes que Tocqueville consacre à son voyage dans le Bas-Canada, Tocqueville, le mot « Canadiens » renvoie à ceux que nous nommons aujourd’hui les « Canadiens français » ; les autres habitants du pays étant, outre les Indiens et les Bois-brûlés, des « Anglais ».
[24] D.A., Vrin (1) p. 251, LF, p. 526. Dans le chapitre X, « Dans la plupart des cas (le mot Européen) a été barré et substitué par Anglo-Américains… » (E. Nolla).
[25] Comme toutes les considérations générales, celle-ci n’est que partiellement vraie ; elle ne tient pas compte d’actes de cruauté et de barbarie des Français vis-à-vis de certaines tribus indiennes, comme l’extermination des Natchez que Beaumont rappelle dans Marie ou de l’esclavage aux États-Unis : « Les Français de la Louisiane ont entièrement détruit la grande nation des Natchez » (éd. C. Gosselin, Paris, 1835, vol. 2, p. 358).
[26] D.A., Vrin (1), p. 256, n. s., LF, p. 534, n. s. : « Note sur un feuillet indépendant du manuscrit, mais qui, selon les indications de Tocqueville aurait dû être placé ici… » (E. Nolla),
[27] O.C., V, 1, Voyage en Sicile et aux États-Unis, p. 174-175 ; les faits évoqués ici se déroulent le 6 août 1831, d’autres conversations sont mentionnées dans Quinze jours dans le désert.
[28] D.A., Vrin (1), pp. 253-254, LF, pp. 531-532.
[29] D.A., Vrin (1), p. 254, n. r., LF, p. 532, n. r..
[30] Sieyès : Qu’est-ce que le Tiers état ?
[32] Le frère aîné de Chateaubriand, Jean-Baptiste, avait épousé la sœur aînée de Louise de Rosanbo, mère d’Alexis.
[33] Tamara M. Teale, Tocqueville and American Indian Legal Studies, the Paradox of Liberty and Destruction - The Tocqueville Review / La Revue Tocqueville, 1996, vol. XVII n° 2, p. 57-65.
[35] D.A., Vrin (2), p. 311, LF, p. 1344.
[36] O.C., V, 1, Cahier portatif n° 2, p. 171.
[37] Gustave de Beaumont, Lettres d’Amérique (Paris: PUF, Publications de la Sorbonne, 1973), 122-123. À la Nouvelle Orléans aussi, Tocqueville et Beaumont admirent les jeunes métisses, dont la beauté les condamne inéluctablement à la prostitution, raison pour laquelle l’héroïne du roman de Beaumont, Marie, a quitté la ville.
[38] Pierson, Tocqueville in America, p. 652.
[39] Concernant l’emploi du terme “loi”, il convient ici de se référer, aux analyses de Raymond Boudon, dans son livre : Tocqueville aujourd’hui, Paris, Odile Jacob, 2005, notamment au chapitre IV, pp. 83-130: Lois sociologiques. Il montre et démontre avec clarté comment Tocqueville met en évidence une multiplicité de mécanismes d’interaction entre les faits sociaux, mais aussi les événements historiques. Les sociologues et les analystes politiques parlent de “lois”, les historiens présentent des théories du développement du processus historique. Dans l’introduction de La démocratie Tocqueville écrit : « Si de longues observations et des méditations sincères amenaient les hommes de nos jours à reconnaître que le développement graduel et progressif de l'égalité est à la fois le passé et l'avenir de leur histoire… », il n’emploie pas pour autant le terme « loi » ; il écrit également : « le développement graduel et progressif de l'égalité est à la fois le passé et l'avenir de leur histoire, cette seule découverte donnerait à ce développement le caractère sacré de la volonté du souverain maître. Vouloir arrêter la démocratie paraîtrait alors lutter contre Dieu même, et il ne resterait aux nations qu'à s'accommoder à l'état social que leur impose la Providence », et quand il se réfère explicitement à la théorie des climats de Montesquieu, il n’utilise ni le mot ‘théorie’ ni le mot ‘loi’ dont il réserve l’emploi au seul domaine législatif. Ceci par un choix délibéré, pour des raisons d’élégance et de style.
[40] D.A., Vrin (1), p. 255, LF, p. 535.
[41] D.A., Vrin (1), p. 257, n. 19, LF, pp. 539-540, n.19.
[42] D.A., Vrin (1), p. 258-254, LF, pp. 541.
[43] Au premier rang desquels le rapport de Lewis et Clark.
[44] D.A., Vrin (1), p. 25, LF, p . 535-536.
[45] Dans De la démocratie en Amérique, 1835, l’ensemble des notes de Tocqueville, en bas de page et en appendice, représentent 12% du texte, dans le chap.X, 18% et dans la sous-partie concernant les Indiens, 38,5% !
[46] Pierson, Tocqueville in America, p. 609.
[47] Jean Anouilh, Antigone, La table ronde, Paris, 1947.
[48] Tocqueville, O.C., V, 1, et Pierson, Tocqueville in America, p. 652.
[50] Tocqueville, O.C., V, 1, p. 225, Cahier alphabétique a, 20 juillet 1831, D.A., Vrin (2), p. 292, LF, p. 1308.
[51] D.A., Vrin (1), p. 250 n 2, LF, p. 523 n 2. Ce n’est pas un hasard si le premier acte politique de Jackson en la matière est l’éviction des quatre tribus les plus civilisées, donc les plus insupportables parce que ruinant la valeur du discours officiel. Elles aussi doivent disparaître, et même en premier !
[52] D.A., Vrin (1), p. 254 n 14 , LF, p. 533, n. 14. Dans une lettre de Beaumont à son frère Achille, en, date du 11 août 1831, celui-ci précise : “il y a encore trois ou quatre millions de sauvages dans le Nord seul des Etats-Unis”, c’est-à-dire moins du quart du territoire actuel du pays. Les estimations les plus vraisemblables émises aujourd’hui retiennent un chiffre de 8 à 12 millions d’indiens occupant le territoire actuel des États-Unis lors à l’arrivée des premiers colons. Au plus bas de l’étiage, à la fin du XIXe siècle, il n’en restait que 200 000.
[53] D.A., Vrin (1), p. 259 n x, LF, p. 542, n. x.
[54] Tocqueville, O.C., XIV, Correspondance familiale, pp. 159-160, Pierson, Tocqueville in America, 59698.
[55] O.C., V, 1, pp. 264-265, Pierson, Tocqueville in America, 614- 615.
[56] D.A., Vrin (1), p. 260, LF, p. 544.
[57] D.A., Vrin (1), p. 256, LF, p. 537-538, “Cette conversation appartient aux notes et brouillons de Marie (YTC, Beaumont, CIX)”, (note d’Eduardo Nolla).
[58] D.A., Vrin (1), p. 260, LF, p. 545.
[59] D.A., Vrin (1), p. 261, LF, p. 546.
[61] D.A., Vrin (1), p. 261, LF, p. 547.
[62] D.A., Vrin (1), p. 261, LF, p. 547.
[63] D.A., Vrin (1), p. 261, LF, p. 547.
[64] Tocqueville, O.C., III, 1, Paris, 1962, pp. 329-30.
[65] Tocqueville, O.C., III, 1, p. 294.
[66] Tocqueville, O.C., III, 1, p. 173. Notes prises avant le voyage d’Algérie et dans le courant 1840.
[67] Tocqueville, O.C., III, 1, p. 275.
[68] Tocqueville, O.C., III, 1, p. 218. Sur la question de l’Algérie, voir Comprendre Tocqueville, Paris, Armand Colin 2004, 123-144 et Tocqueville, Paris, Perrin, 2013, pp. 422-446.
[69] Tocqueville, O.C., III, 1, p. 242.
[70] Tocqueville, O.C., III, 1, p. 196.
[71] Tocqueville, O.C., III, 1, p. 326-328. Il revient plusieurs fois, à divers moments sur cette question dans les textes figurant dans ce volume, mais les principes demeurent ceux que j’ai exposés ici.
[72] Tocqueville, O.C., III, 1, p. 312.
[73] Tocqueville, O.C., III, 1, p. 360.
[76] Tocqueville, O.C., III, 1, p. 326-327.
[77] Tocqueville, O.C., III, 1, p. 329.
[78] Tocqueville, O.C., III, 1, p. 261.
[79] Tocqueville, O.C., III, 1, p.329.
[80] Tocqueville, O.C., IX, Correspondance d’Alexis de Tocqueville et d’Arthur Gobineau, pp. 57-59.
[81] Montaigne, Essais, vol. 3.
|

