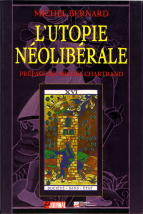 Introduction Introduction
Le mot utopie, créé par Thomas More (1478-1535) par la juxtaposition des mots grecs topos (lieu, pays) et ou (pas, négation), désigne la cité sans lieu ou le projet imaginaire qui reste chimérique, mais qui nous appelle à un dépassement, à un idéal, à un universel [1]. Pour les néolibéraux, cette utopie, ce lieu idéal, c'est la société de marché autorégulée accompagnée d'un État minimal du type agence de protection. L'utopie néolibérale nous convie à l'extinction du politique en faveur d'une automaticité à base économique, d'une coordination spontanée des actions individuelles par le marché.
En abordant les thèmes centraux de la doctrine néolibérale comme la négation du droit social, l'État minimal du type agence de protection, la propriété privée intégrale et illimitée et l'ordre spontané du marché, nous n'avons pas exagéré les thèses du néolibéralisme pour en donner une image odieuse ou pour mieux les réfuter. Nous exposons ses propositions telles qu'elles sont présentées par les chefs de cette école, les prix Nobel, les grands instituts, les auteurs célèbres, les commentateurs érudits : notre bibliographie en témoigne. Qu'il suffise, pour l'instant, de mentionner le titre d'un livre d'un grand penseur du néolibéralisme, Friedrich Hayek, le saint de l'École. Ce livre s'intitule Le mirage de la justice sociale : on s'aperçoit alors que la radicalité de l'idéologie néolibérale n'a pas à être inventée [2]. Selon ce « prix Nobel néolibéral », le désir de la planification étatique serait une relique du stade tribal de l'humanité. Pour cet idéologue en chef, « la revendication de justice sociale est en fait une expression de révolte, un reliquat d'esprit tribal contre les exigences abstraites de la logique de la Grande Société sans objectif commun qui se puisse voir [3]». Cette sublime idée, qui pourrait susciter un éclat de rire, est pourtant le résultat d'un long raisonnement sur les ordres spontanés. Nous, qui croyons encore à un idéal social, confessons notre ignorance alimentée par nos gènes tribaux.
Les zélateurs de la cabale néolibérale nous présentent leur utopie comme un sympathique ordre de liberté : ils prônent la déréglementation, le remplacement du droit social par la charité « proverbiale » des bien nantis, la quasi-élimination des impôts et de la planification sociale, la privatisation de l'éducation, des services de santé, de l'eau, des routes, des prisons et de pratiquement tous les biens publics. Il faut ajouter le thème de la suprématie des intérêts privés sur les États favorisée par la mondialisation des marchés. l'État minimal ne demeure que comme mal nécessaire a la protection du droit de propriété privée. Un beau monde naturel et libérateur surgirait de la désimplication étatique. L'idéologie de la classe possédante élude complètement le côté sombre de cette pseudo-liberté : nous allons l'exposer et réaffirmer les principes de justice de l'État‑assuranciel.
Au premier chapitre, nous allons décortiquer le néolibéralisme en tant qu'idéologie dissimulant un pouvoir sous le couvert de la liberté [4]. Une classe sociale propose une idéologie qu'elle voudrait voir dominer. Elle le fait en finançant les théories qui valorisent son action. Le but est de convaincre et d'en faire un projet d'orientation de la société. En réalité, ceux qui bénéficient du laisser-faire veulent le substituer à tout projet étatique et à tout idéal social exprimé politiquement. Le pouvoir politique est le seul à s'opposer au pouvoir économique. C'est la dernière arme des moins nantis. On propage donc l'idée que le laisser‑faire est la liberté pour tous. Les théories qui nous présentent l'ordre social comme un ordre spontané qui s'élabore de lui‑même sans planification sont donc portées au pinacle. Une idéologie peut devenir dominante même si elle privilégie une minorité, à la condition d'être présentée comme bénéficiant à tous. Aussi, beaucoup d'énergies sont dépensées pour nous persuader que l'économie fonctionne toute seule pour le bonheur général, que le capitalisme est un jeu à somme positive qui permet à une minorité de s'enrichir, mais à l'intérieur duquel la majorité est mieux que sous n'importe quel autre système. Celui qui travaille pour un salaire de subsistance en enrichissant une minorité doit s'estimer chanceux car, sous n'importe quel autre système possible, il obtiendrait moins. On présente le capitalisme idyllique comme un mode de « coopération » indépassable, comme la fin de l'histoire. C'est cet appareil idéologique qu'il faut d'abord exposer et démonter.
L'utopie du passage de l'« économie» de marché à la « société » de marché autosuffisante est une autre bonne vieille marchandise intellectuelle qui voit sa cote remonter. Le deuxième chapitre exposera cette utopie qui se fonde sur le retrait du politique en faveur de l'économique. Nous montrerons donc la continuité idéologique à partir des philosophes du dix-septième siècle qui fondent l'ordre social sur un agencement des passions, en passant par la théorie de l'harmonie naturelle des intérêts d'Adam Smith pour aboutir à sa forme moderne, la théorie de l'ordre spontané des néolibéraux. La passion de s'enrichir doit recevoir une caution à la fois morale et épistémologique. Les humains ont formé historiquement un ordre spontané, encadré « négativement » par des lois pour réprimer les comportements délictueux et « positivement » par le système des prix pour orienter leurs actions. Dans cette foire à l'individualisme possessif, l'épine dorsale du fonctionnement social sont les prix. Ce sont eux qui nous informeraient de la valeur de nos actions. La grande société moderne est hypercomplexe, nous disent les penseurs néolibéraux, les connaissances y sont divisées à l'extrême et ne sont pas synthétisables par de quelconques organismes de planification; il vaut mieux laisser agir les individus via l'unique instrument de coordination possible, le marché. L'ordre social est-il véritablement le résultat non recherché de l'action individuelle? Pourtant, l'action individuelle produit des effets globaux pervers qui demandent l'intervention de l'État, comme l'illustre le cas des embouteillages automobiles générés par la concentration urbaine : les néolibéraux ne bronchent pas, l'État ne doit pas intervenir.
La réfutation du néolibéralisme doit être à la fois épistémologique et éthique. On doit mesurer la valeur de vérité de ses énoncés et vérifier s'ils violent les impératifs moraux généralement reconnus. Par exemple, les néolibéraux qui s'autorisent de Hayek nous disent que la société est un ordre spontané constitue progressivement par les interactions des individus comme le sont le langage ou l'expression de la coutume en loi. Il n'a pas été pensé, planifié puis appliqué; il est né progressivement comme un reliquat de l'action individuelle. Il est absurde de penser que la justice sociale n'ait pas émergé pour se charger des effets non anticipés des actions des individus. On ne peut interroger la société, mais on peut questionner les individus sur la représentation mentale qu'ils se font de leur société. Quand on le fait, on repère l'existence de la justice sociale, un recours consenti à l'individu contre l'ensemble. Sur quelle base peut‑on nier l'institution de la justice sociale comme une erreur constructiviste et accepter pleinement celle du marché comme un ordre spontané? Quelle est la valeur de vérité d'énoncés qui décrivent la justice sociale comme une « absurdité ontologique », qui nous présentent l'activité économique comme répondant à des lois aussi inéluctables que les lois de la physique? Quelle est la crédibilité de propositions affirmant que l'immense force de persuasion commerciale ne crée pas de besoins, n'oriente pas la civilisation, d'énoncés soutenant que le marché réalise par lui‑même un usage optimal des ressources, etc.? Le marché serait de la civilisation spontanée et la justice sociale du tribalisme constructiviste, un abus de la raison organisatrice qui a la prétention d'affirmer une existence possible hors du marché...
La doctrine de la secte néolibérale apparaît comme une métaphysique peuplée d'êtres imaginaires comme l'homo œconomicus, la main invisible, les lois du marché, l'harmonie naturelle, la concurrence pure, l'ordre spontané social, la théorie de la croissance économique par l'offre des riches, l'usage optimal des ressources par le marché, la justesse a priori du prix du marché, la supériorité présumée du secteur privé sur le secteur public, l'autodiscipline du marché dans les questions environnementales, l'impossibilité pour la publicité de créer des besoins, etc. Parfois, ce sont des postulats que l'on considère aussitôt comme des vérités. Nous ne sommes pas sans remarquer que le recours à l'ordre spontané du marché est commode pour contrer le désir de planification étatique, pour éliminer les impôts, la répartition, la réglementation et toutes autres instances construites par le rationalisme constructiviste du « tribalisme ». Le discours économique est aussi parfois formulé de façon tautologique. Il nous dit rien sur la réalité, on ne peut imaginer d'expériences pouvant le réfuter. Le prix du marché est toujours le bon prix car c'est le prix du marché; un peu comme l'opium qui endort à cause de sa vertu dormitive. On nous dira par exemple que les Haïtiens et les Asiatiques, qui fabriquent des chaussures pour Nike au salaire de subsistance de 50 cents de l'heure, bénéficient du capitalisme de marché et reçoivent le juste salaire. On ne parle pas du déséquilibre du rapport de force présent dans la négociation de leur salaire; on ne dit rien d'un système logiquement possible qui leur accorderait une plus grande part du prix de vente de 120 $ la paire obtenu en Amérique pour ces chaussures. Les besoins sont toujours déjà là. Ainsi, la publicité des compagnies de tabac n'aurait jamais incité qui que ce soit à fumer : elle ne fait qu'informer de l'existence d'une marque. Les jeunes décident spontanément de fumer et la publicité ne leur fait fumer que des marques particulières. Le financement des compagnies de tabac a transformé les organisateurs d'événements sportifs et les artistes en courtisans.
Par son paradigme de la société de marché post‑étatique, le néolibéralisme ne confie‑t‑il pas plutôt l'avenir de la civilisation à ceux qui dominent le marché? La société de marché est‑elle vraiment une démocratie de consommateurs? Si l'on admet que l'homme est un être essentiellement social qui doit bâtir une civilisation fondée sur la coopération, on n'hésitera pas à reconnaître une fonction d'intervention à l'État par l'intermédiaire du droit social. Sommes‑nous libres uniquement quand nous n'allons nulle part et quand nous renonçons à nous définir un universel ou une finalité collective? L'individu s'enrichira en suivant la route de la liberté naturelle que lui montrera son intérêt. Proposer une société sans fins, n'est‑ce pas renoncer d'avance à critiquer les moyens? Toute anticipation devient alors impossible. Les néolibéraux ont‑ils raison de dénoncer toute action politique volontariste, toute planification comme conduisant au totalitarisme? N'y a‑t‑il pas un bonheur possible dans la poursuite d'un idéal social qui transcende l'individu et guide le projet personnel? Doit‑on se contenter de poursuivre l'efficacité économique dans un capitalisme idyllique proposé comme terme de l'histoire? Il faut faire ressortir le coût qui ne figure pas dans les bilans des néolibéraux : celui que représenterait l'absence de l'État. Pour le néolibéralisme, le droit à une rémunération décente, l'assurance-maladie obligatoire, l'assurance-chômage obligatoire, la fixation des prix agricoles, le contrôle des loyers, la protection du territoire agricole ou de la nature sont des atteintes intolérables à la liberté de contracter.
Le troisième et le quatrième chapitres introduisent des éléments de l'éthique néolibérale. La négation du droit social conduit-elle à la négation des droits de la personne? On nous dit, en effet, que la justice sociale est un imaginaire naïf, une fausse totalité, que seule l'action individuelle peut être juste ou injuste. Le néolibéralisme accorde une préséance au droit de propriété sur les droits à la vie, à l'égalité des chances. Il sort l'éthique des structures sociales pour s'en remettre aux libéralités de la morale personnelle. On exige l'abolition des réglementations du commerce et de l'environnement pour laisser agir le libre marché qui résoudra tous les problèmes. Nous produirons des données empiriques démontrant que le néolibéralisme produit une extrême concentration des richesses. Il est source d'une grande inégalité réelle combinée à un refus de l'égalité des chances; il est donc une vaste source d'instabilité sociale qu'il compense par un État minimal disciplinaire de type agence de protection de la propriété privée. L'État minimal, c'est aussi l'abolition de tout contrat social s'exprimant politiquement; c'est donc aussi la ruine de la démocratie, car seuls les bien nantis peuvent faire valoir leurs projets via le marché.
Il faut voir comment les néolibéraux, ces intégristes du droit de propriété privée, en font un absolu. Le libéralisme s'est prêté à un rapport instrumental avec le capitalisme du dix‑neuvième siècle, notamment par son soutien au droit inconditionnel de la propriété privée et sa croyance en la capacité autorégulatrice du marché. Aujourd'hui, les néolibéraux, enhardis par le repli du socialisme et la crise budgétaire de l'État‑providence, reprennent, avec un certain radicalisme, les thèses principales de l'utopie libérale classique. Cet appel à l'État minimal, au caractère absolu de la propriété privée, à l'ordre spontané du marché comme instrument de la régulation sociale, cette préséance de l'individu sur le social, ce recours exclusif à la rationalité économique sont difficiles à comprendre sans un retour aux énoncés philosophiques essentiels du libéralisme, qui étaient déjà posés au dix‑huitième siècle. C'est pourquoi ce livre déterre les principales racines du libéralisme et éclaire son soubassement philosophique.
Le thème majeur de l'idéologie néolibérale et sa conséquence la plus dangereuse est la négation de la justice sociale et son corollaire, la justification de l'inégalité. On dit que les programmes sociaux coûtent cher : combien de fonds publics sont dépensés pour faire respecter le droit de propriété et de contracter des puissants? Le libéralisme a détruit, au nom de l'égalité, l'ancienne société à ordre fondée sur la domination des clercs et des nobles, mais il a créé une société inégalitaire à partir du statut économique. Il a remplacé le caractère de la domination qui s'infiltre, dorénavant, dans l'espace créé par la séparation de la production et de la consommation. L'égalité et la liberté libérales ne sont que formelles. Ces formes peuvent être inhabitées : notamment, le droit de propriété et de contracter est une coquille vide pour les uns, mais il est tout pour un spéculateur ou un banquier. La liberté, c'est le pouvoir positif d'agir. Or, dans la société de marché néolibérale, le pouvoir d'agir est proportionné au pouvoir d'acheter. La liberté et le pouvoir sont réservés aux bien nantis, aux gagnants du jeu du marché.
Il faut remarquer aussi comment les catégories axiologiques du néolibéralisme conduisent à l'homme unidimensionnel. Le citoyen de la société de marché ne serait-il pas réduit à sa dimension de consommateur? Le gouvernement étant vidé de son essence, le seul droit de vote résiduaire serait‑il celui qu'il enregistre par ses choix de consommation? Nous le verrons dans le cinquième chapitre, le consommateur est loin d'être l'homo oeconomicus parfaitement informé choisissant librement et rationnellement devant l'immense force de persuasion des grandes entreprises modernes. Cette image cache un rapport de force. La connaissance et la science qui devraient faire partie du patrimoine humain seront de plus en plus mises au service de la demande solvable [5]. Lorsque la technique règne sur une société, le moyen devient la fin, aucun sens, aucune valeur ne retiennent son développement. À quoi sert d'augmenter nos moyens sans fin s'ils nous asservissent ? Le capitalisme technologique s'est emparé de la science et nous catapulte dans une course effrénée à l'accélération de l'innovation sans autolimite. La société de marché, en s'emparant de la science, nous plonge dans une barbarie à visage technique, elle liquide les métiers, métamorphose les compétences, provoque la désuétude accélérée des produits, recompose constamment les coordonnées de la vie sociale. On laissera le marché définir l'avenir de l'homme et le néolibéralisme pliera toutes les volontés à cette machine qui ne se comprend plus elle-même et interdira qu'un droit social vienne secourir les victimes du changement accéléré, de la course aveugle en avant devenue fin en soi. Dans le paradigme dominant de la croissance sans fin, l'homme est un simple ustensile économique et la nature un stock de marchandises potentiel à exploiter au plus sacrant, à convertir en cash au plus vite. Quand tous les habitants de la Terre voudront adopter notre mode de vie, la planète n'en aura plus pour longtemps. Évidemment, le néolibéralisme continuera de nier la nécessité de la planification étatique.
Le sixième chapitre montrera que le néolibéralisme n'est pas un système public de coopération acceptable; il est une atteinte à la démocratie sous le couvert d'une demande de liberté. Il n'exprime aucunement les termes équitables de coopération entre citoyens libres et égaux. À quoi servirait la liberté politique dans un État où la vie publique aurait été vidée de son contenu, où le rôle du gouvernement se limiterait au maintien d'une police, d'une armée et d'un système judiciaire voués prioritairement au respect de la propriété privée? Dans une société néolibérale, il n'y a plus de matière politique, le fatalisme et la docilité devant le marché conduisent à une dépolitisation et à un ordre spontané.
Le néolibéralisme reconduit le principe de l'inviolabilité de la propriété privée en tant que contenu de la liberté. Or le travail, moyen d'accès à cette aire de liberté-propriété, demeure hors de la portée d'une partie de la population, le chômage étant devenu structurel, endémique au système. Le pouvoir réel sur la destinée des individus se réfugie dans les conseils d'administration et de direction des entreprises. La doctrine de l'harmonie naturelle des intérêts s'appuie sur un libre rapport de force commercial, sur un état permanent de concurrence qui est contredit par une inéluctable tendance à la concentration du pouvoir économique, nécessitant l'arbitrage de l'État. L'insuffisance intrinsèque du libéralisme est démontrée par son impossibilité à résoudre, par le marché libre, le problème des externalités, notamment celui de la prise en compte de l'accaparement hors marché et de la destruction des ressources de l'environnement qui affectent largement les « non‑échangistes ».
On montrera, au septième chapitre, comment la stratification sociale néolibérale place les affairistes au sommet de l'échelle au Québec; comment le gouvernement même les consulte comme des nouveaux sages, alors qu'ils poursuivent des intérêts strictement personnels. La classe sociale, qui aspire à dominer, doit présenter ses intérêts comme l'intérêt collectif de tous les membres de la société. Elle doit donner à ses pensées la forme de l'universalité, les présenter comme les seules rationnelles, les seules universellement valables. Quand nous aurons compris comment l'économie a toujours dissimulé le pouvoir des possédants derrière des pseudo-faits objectifs, nous comprendrons comment les vraies causes de la crise des finances publiques ont été dissimulées par cette pseudo-science. Il y a donc aussi dans ce livre une interrogation sur la recevabilité des connaissances qui gouvernent nos vies. Nous aurons fait le tour des instruments historiques de persuasion (surnature, nature, ordre spontané, fin en soi de la technique) pour mieux comprendre comment les nouveaux théologiens-économistes modernes, les évangélistes-affairistes et les grands prêtres des temples de la finance nous imposent leur doctrine par l'intermédiaire d'une vaste machine de persuasion.
La façon de s'approprier le pouvoir en Occident consiste à contrôler, non pas l'armée ou la police, mais les institutions à l'intérieur desquelles s'élaborent les idéologies. Une bonne façon de commencer à établir le système à pensée unique est d'acheter les médias et les éditorialistes inclus dans le package comme le font Conrad Black et Paul Desmarais. Au Québec, la classe possédante l'a compris et la propriété des médias est de plus en plus concentrée entre leurs mains, à la fois comme machines à argent et appareil d'orientation de l'opinion. Au Québec, les élus ont fait l'erreur de déléguer à des comités de « sages », formés majoritairement d'hommes d'affaires, la réflexion sur l'avenir de la société alors que, depuis deux siècles, le libéralisme considère comme normal que la bourgeoisie des affaires poursuive son intérêt personnel. Les affairistes nouveaux sages en sont venus à la conclusion qu'il fallait réduire les impôts des sociétés, déréglementer et privatiser tout ce qui est rentable, des parcomètres à l'hydroélectricité en passant par l'eau potable, les ponts, les routes, les écoles, les hôpitaux et jusqu'aux prisons. Ceux qui ne pourront se payer ces services privés seront reconduits à la porte de la Cité via la désinsertion sociale. Le gros argent arrogant, les affairistes sages, eux‑mêmes surpris d'être questionnés sur le bien public par un gouvernement qui refuse de gouverner, ont demandé la réduction de la protection de la langue française et le renoncement à l'indépendance du Québec stigmatisés comme une nuisance aux « affaires » érigées en finalité ultime de l'homme. Un million de dollars, ça ne parle pas anglais ou français, dit le premier ministre Chrétien; une raison de plus pour que nous organisions notre défense collective contre le capital qui ne comprendra plus bientôt que l'anglais.
Les références à la surnature et à la nature doivent faire place au réalisme de l'organisation sociale, à la mutualisation des risques sociaux. La seule transcendance de l'individu est la solidarité humaine. La seule métaphysique digne de l'homme, c'est la métaphysique sociale. À l'absurdité ontologique néolibérale de l'individu isolé, il faut opposer une ontologie solidariste, celle qui désigne l'homme comme un être social qui ne peut rien accomplir seul [6]. C'est en admettant de façon réaliste sa condition d'humain et sa finitude immanente que l'homme accédera à l'humanité véritable. Le chômeur ne reçoit pas de prestations en vertu de la charité chrétienne ou d'une vague morale laissée à la discrétion des possédants ni en vertu d'un droit naturel puisque la nature est silencieuse sur nos droits et étrangère aux constructions humaines; il reçoit sa prestation en vertu de son droit à la production sociale qui n'est pas éteint par son chômage. Il la reçoit du fait que tous reconnaissent que le chômage est le côté pervers de la division du travail, qui est inévitable par ailleurs, et du progrès technologique dont tout le monde devrait profiter [7]. Tous s'unissent pour pallier ce mal social qui peut frapper n'importe qui.
Les références à la morale, à la surnature et à la nature ne sont plus nécessaires. La couverture du risque rattaché à mon existence m'oblige à couvrir celui des autres. Le solidarisme ne me demande pas de renoncer à moi‑même, mais à reconnaître que je ne peux rien seul contre le mal social. La quête de ma protection m'oblige à vouloir celle des autres. La solidarité est la seule forme authentique de l'harmonie des intérêts. La solidarité sociale est la seule « main invisible » amicale, non pas la main invisible néolibérale qui voudrait qualifier les intérêts personnels les plus grossiers de source du bien général, mais celle qui organise notre défense contre les risques et les contingences de la vie. Au lieu d'objectiver le chômage comme un mal social, les néolibéraux en font une responsabilité individuelle. Leur individualisme leur cache que la nécessaire division du travail est une organisation essentiellement sociale dont tout le monde bénéficie. Si un individu s'en trouve affecté, la société qui tire profit de cette division du travail ne peut nier sa responsabilité. Les néolibéraux veulent éliminer le droit social au profit du droit civil qui ne reconnaît que les droits et les obligations créés par des contrats privés.
Ce n'est qu'après avoir démasqué le pouvoir dissimulé par la machine néolibérale et après avoir prononcé la faillite du néolibéralisme que nous démontrerons au huitième chapitre, la nécessité de l'État‑assuranciel. L'apologie d'une égalité formelle devant la loi conduit à une justification des inégalités réelles. L’État minimal libéral cautionne l'exercice de l'inégalité en protégeant un droit de propriété absolu. Un argument néolibéral veut que la complexité, maintenant atteinte dans les grandes sociétés, rende impossible la justice sociale ou l'identification d'une responsabilité quelconque dans le sort des démunis.
L'hypercomplexité d'une machine sociale moderne, qui ne se comprend plus elle‑même et qui brouille les réseaux de causalité, discrédite justement la catégorie de responsabilité en faveur de celle de solidarité. Le droit civil, assisté de la charité privée, ne suffit plus et la société doit devenir elle‑même assurancielle. Un risque social naît de la participation à une Grande Société, de la division poussée du travail, de l'acceptation collective a priori du progrès et de l'internationalisation des marchés qui recomposent continuellement les coordonnées de cette forme de vie sociale. Le risque social conduit à l'intériorisation de la nécessité de la justice sociale, c'est‑à‑dire à la nécessité d'un recours consenti à l'individu contre l'ensemble [8]. Un impératif moral nous commande de ne pas traiter autrui comme un simple moyen. Dans la société de marché, le projet individuel ne rejoignant le projet collectif que par le marché, tout universel autre qu'économique se trouve invalidé.
Le néolibéralisme pose le défi de la légitimité du droit social et de l'existence de la justice distributive. Un droit libéral traditionnel, protégeant l'individu contre l'intervention de l'État, doit être équilibré par un nouveau droit social protégeant l'individu par l'intervention de l'État. Quant à la propriété privée, le néolibéralisme perd de vue que c'est le droit fondamental à l'appropriation des biens nécessaires à la vie et au projet de vie qui a reçu une détermination dans la propriété privée. Le droit de propriété privée est donc subordonné. Les imperfections de la propriété privée et du marché autorisent l'intervention de l'État et son rôle de redistribution.
La société pourrait être un système équitable de coopération entre des personnes libres et égales [9]. Nous ne sommes pas prédéterminés à vivre dans un système qui enrichit une minorité et où l'on se contente de regarder le cortège de démunis s'allonger en jasant de chômage naturel. En même temps, il s'agit de créer une référence qui nous permettra d'examiner le degré de justice de nos institutions politiques et sociales et les critères d'un système publie de coopération sociale acceptable. À quelles conclusions sur l'intensité du rôle de l'État en viendraient des personnes réfléchissant sur la structure de base de la société, en faisant abstraction de leur position personnelle, tout en connaissant les risques de la coopération sociale moderne ? Nous tenterons de répondre à cette question en consultant John Rawls, un des contemporains les plus respectés en la matière.
Les philosophes existentialistes nous disent que l'homme se fait par son existence : jeté dans le monde, il est mis en demeure de trouver un sens a ce monde; il n'est pas prédéterminé par une essence; il est radicalement libre. L'homme est la résultante de ses choix, de ses actes libres. Mais celui à qui la naissance arrive se découvre dans un monde tourné vers l'efficace, le prix du temps et l'explication économique du comportement humain. Il lui est difficile d'imaginer que le monde pourrait être autre. L'homme ne peut éviter de choisir. Ne rien faire, c'est choisir le néolibéralisme. L'homme peut choisir de construire la justice sociale comme concept et l'appliquer concrètement via un droit social. Si nous laissons cette doctrine triompher, nous n'aurons plus le droit de nous plaindre. Un joueur qui perd son argent aux courses n'a pas le droit de se lamenter, car il a d'abord accepté les règles de ce pari. Nous n'aurons pas le droit de dire que l'immense cortège des perdants du néolibéralisme sont des victimes à compenser si, collectivement, nous contribuons à le laisser s'implanter et vider le droit social de son contenu.
[1] FOULQUIÉ, Paul, Dictionnaire de la langue philosophique, Paris, PUF, pp. 746‑747.
[2] HAYEK, Friedrich, « Le mirage de la justice sociale », Droit législation et liberté, tome 2, collection Libre‑échange, Paris, PUF, 1982.
[4] Idéologie : « Système plus ou moins cohérent d'idées, d'opinions ou de dogmes qu'un groupe social ou un parti présentent comme une exigence de la raison, mais dont le ressort effectif se trouve dans le besoin de justifier des entreprises destinées à satisfaire des aspirations intéressées et qui est surtout exploité pour la propagande ». Paul Foulquié, op. cit.
[5] LESGARDS, Roger, « L'empire des techniques », Manière de voir, no 28, novembre 1995.
[6] Ontologie (ontos, être et logos, discours, science) : connaissance de ce qui est. Les néolibéraux, prix Nobel de la Banque de Suède, nous disent que la justice sociale ne peut exister, car seuls des individus peuvent avoir des droits et des obligations. Si on ne peut toucher et voir la société, elle est bien là comme une instance qui résulte de nos actions et qui guide aussi nos actions. L'individu isolé des néolibéraux n'a pas l'existence autonome qu'on lui prête : il ne peut exister sans la société. Il s'affirme comme étant autonome pour cacher sa dette envers la société. La justice sociale et le droit social peuvent exister si on choisit de leur prêter l'existence, et les individus auront des recours contre la société qui se reconnaîtra des obligations. Après tout, on a fait naître des droits et des obligations à des compagnies qui sont des êtres bien plus « volatils » que la société et qui ont accumulé un pouvoir énorme.
[7] Nous parlons ici de chômage, mais notre raisonnement est valable pour toute autre contingence comme la maladie, l'accident de travail, de la route ou les catastrophes naturelles comme les inondations, etc. Les systèmes de défense contre l'inéquité dans les rapports de force ou les lois de protection des consommateurs sont aussi une manifestation de la solidarité devant un risque; elles empêchent le marché de devenir une arnaque perpétuelle.
[8] EWALD, François, L’État‑providence, Livre Ill, « Du risque professionnel au risque social. Le contrat de solidarité », pp. 223 et suivantes, Paris, Grasset, 1986.
[9] Nous empruntons à la démarche de John Rawls, un des contemporains les plus respectés en la matière. Sa démarche a été exposée principalement dans Théorie de la Justice, Seuil, 1987 et Libéralisme politique, PUF, 1995.
|

