Avant-propos
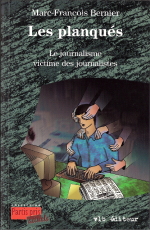
Dans le terrifiant et glacial goulag que nous a révélé Soljenitsyne, les planqués sont ceux qui profitent de leur situation privilégiée pour servir leur intérêt personnel au détriment de l’intérêt commun des détenus du stalinisme, les zeks. Ils engraissent «leur propre personne» et ont recours à «des moyens pas très propres», ils sont «les maillons de l’administration du camp et du travail de camp», maillons dont l’absence «aurait fait se démantibuler toute la chaîne de l’exploitation, tout le système des camps [1] !»
Il n’est pas question de mettre sur le même pied les planqués du goulag et les planqués du journalisme québécois dont je vais parler. Pour la bonne raison que les planqués de Soljenitsyne ont d’abord et avant tout adopté une stratégie de survie au sein des camps d’extermination, alors que la motivation des planqués québécois relève simplement de la cupidité parfois, de l’ignorance souvent, mais presque toujours du désir de mouler arbitrairement les contraintes déontologiques en fonction de leurs intérêts immédiats. J’y trouve cependant une irrésistible analogie qui évoque comment certains savent à la perfection tirer le maximum de bénéfices personnels sans trop se préoccuper ni des autres ni des torts causés au journalisme qu’ils dégradent de leur simple présence.
Disons-le d’entrée de jeu, les planqués du journalisme québécois constituent un groupe minoritaire, mais ce fait n’atténue pas la portée négative de leur présence, car certains planqués sont des vedettes de la profession. De toute façon, chacun est de trop s’il refuse de s’amender, et tous les planqués nuisent aussi bien à l’intérêt général qu’à l’ensemble de la profession.
Tous les journalistes ont accompli un jour ou l’autre des actions contraires à l’éthique et à la déontologie professionnelles, actions que la majorité d’entre eux ne répéteraient pas aujourd’hui parce qu’ils reconnaissent avoir dérapé. Les planqués, eux, s’entêtent. Voilà la différence entre l’erreur de jugement pouvant être commise en toute bonne foi et la faute professionnelle.
Ni méprisant ni glorifiant, mon plaidoyer se veut à la mesure de l’importance de fournir une information journalistique de qualité, intègre, honnête et impartiale, au service de l’intérêt public avant tout. Je ne fais que dégager les conséquences éthiques et déontologiques de la rhétorique journalistique qui pose cette fonction sociale comme un pilier de la démocratie. Raison de plus pour être exigeant à l’égard de ceux qui pratiquent le journalisme, comme eux-mêmes doivent l’être à l’endroit des autres acteurs sociaux. Les planqués admettent ces principes du bout des lèvres, parfois même ils les défendent rudement. Mais ils refusent néanmoins d’adapter leurs comportements professionnels en conséquence. Ils sont en dernière instance les seuls à décider de leurs comportements, lesquels, lorsqu’ils sont douteux ou franchement condamnables, font l’objet d’une censure qui relève uniquement de la pudeur corporatiste. Il n’y a pas de conspiration du silence, c’est-à-dire pas d’entente formelle chez les journalistes, ni complot. Simplement un silence complaisant, une stratégie qui sauve l’honneur de la profession en lui épargnant les affres du jugement lapidaire et souvent injuste de l’opinion publique qu’alimentent les médias d’information.
Les planqués du journalisme peuvent aussi bien être des syndiqués peinards que des pigistes à revenus précaires, quand ce ne sont pas les grands patrons de l’information. Ce qui les caractérise, c’est leur aptitude à profiter de leur statut pour en retirer des avantages personnels divers grâce au vide déontologique et éthique de leur métier. La plupart des journalistes québécois n’adhèrent à aucun code de déontologie explicite et ceux qui sont soumis à un tel code, bien souvent, parviennent facilement à y échapper parce que personne ne le fait respecter.
La politique du laisser-aller est généreuse pour les planqués de tout acabit qu’elle génère dans tous les champs sociaux où elle règne. Mais le champ social est structuré de façon telle que ceux qui y occupent les positions dominantes s’accommodent beaucoup mieux que les autres des règles du laisser-aller, simplement parce qu’elles les confortent et consolident leur pouvoir. La principale règle implicite est bien entendu l’interdiction de refaire la donne sociale, voire d’y songer, ce qui suffit à tenir à l’écart la plupart des importuns et dicte les règles de servilité aux opportunistes. C’est en vérité la moindre des choses que de gratifier ceux qui travaillent à la pérennité du système!
La divulgation de faits ne perd rien à être associée à la prescription déontologique si on évite toute contamination de l’une par l’autre. La connaissance ainsi acquise d’événements réels peut susciter et justifier des dénonciations sur les plans éthique et déontologique si, et seulement si, on admet comme postulat que le fait social ne devient pas une norme par sa seule existence empirique. Il y a effectivement des pratiques condamnables, qui ne devraient pas exister si on s’en remet aux fondements de la légitimité du journalisme. Il faut reconnaître cette possibilité, sinon on se limite à des constats et des analyses sans mettre en relief le fait que les pratiques s’opposent aux discours vertueux, alors que ces discours mêmes servent d’écran protecteur aux planqués.
Le plus difficile reste à faire, c’est-à-dire démontrer en quoi ces pratiques sont condamnables et contraires aux attentes du public comme à ses intérêts légitimes. Mais aussi mettre en évidence comment les planqués menacent à terme ce qui permet l’existence même du journalisme: le consentement social que l’on nomme la légitimité professionnelle.
[1] Alexandre Soljenitsyne, L’archipel du goulag, Paris, Seuil, t. 2, p. 190-220.
|

