|
Jean-Luc Bonnniol
Université d’Aix-Marseilles III, France.
“De la construction d’une mémoire historique aux figuration
de la traite et de l’esclavage dans l’espace public antillais”.
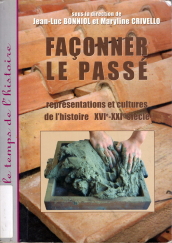 Un article publié dans l’ouvrage sous la direction de Jean-Luc Bonniol et Maryline Crivello, Façonner le passé. Représentations et cultures de l’histoire (XVIe-XXIe siècle), p. 263-284. Aix-en-Provence, Presses de l’Université de Provence, 2004. 304 pp. Un article publié dans l’ouvrage sous la direction de Jean-Luc Bonniol et Maryline Crivello, Façonner le passé. Représentations et cultures de l’histoire (XVIe-XXIe siècle), p. 263-284. Aix-en-Provence, Presses de l’Université de Provence, 2004. 304 pp.
 La convocation du passé dans le présent s’inscrit dans différents registres, qu’il est possible d’ordonner entre deux pôles, le « léger » et le « lourd », ou, pour employer une terminologie anglo-saxonne aujourd’hui largement répandue, le soft et le hard… Aux Antilles, nous sommes manifestement du côté du hard. Le passé y est en effet marqué par une tragédie singulière, dont l’empreinte reste encore particulièrement forte, même si son inscription mémorielle mérite d’être interrogée, celle de l’esclavage et de la Traite atlantique. Jacques Petitjean-Roget, conscient de cette charge si pesante que l’évocation du passé charrie en ces lieux, avait justement placé, en exergue à sa thèse sur les débuts de la société d’habitation à la Martinique (rédigée à la fin des années 70), un tableau de Magritte aux multiples replis signifiants. On y voit la Mémoire, figurée par le buste sculpté d’une femme blanche très belle, dont la tempe droite est souillée par une éclaboussure de sang qui obture à moitié son regard. Ce buste est placé sur le rebord d’une baie à demi-ouverte sur une mer bleu-gris sans fin, à demi-fermée par un rideau rouge opaque. Même si une telle représentation déborde certainement toutes les tentatives d’interprétation, ne peut-on penser que le fond du tableau installe une alternative : faut-il tout occulter en tirant le rideau, ou bien doit-on accéder obligatoirement à l’existence par l’appropriation du passé ? Mais dans ce cas n’y a-t-il pas le risque, par le rappel lancinant de celui-ci sur la scène présente, de s’enfermer dans le carcan de l’histoire et de se faire le prisonnier perpétuel des morts, selon la formule de Karl Marx ? La convocation du passé dans le présent s’inscrit dans différents registres, qu’il est possible d’ordonner entre deux pôles, le « léger » et le « lourd », ou, pour employer une terminologie anglo-saxonne aujourd’hui largement répandue, le soft et le hard… Aux Antilles, nous sommes manifestement du côté du hard. Le passé y est en effet marqué par une tragédie singulière, dont l’empreinte reste encore particulièrement forte, même si son inscription mémorielle mérite d’être interrogée, celle de l’esclavage et de la Traite atlantique. Jacques Petitjean-Roget, conscient de cette charge si pesante que l’évocation du passé charrie en ces lieux, avait justement placé, en exergue à sa thèse sur les débuts de la société d’habitation à la Martinique (rédigée à la fin des années 70), un tableau de Magritte aux multiples replis signifiants. On y voit la Mémoire, figurée par le buste sculpté d’une femme blanche très belle, dont la tempe droite est souillée par une éclaboussure de sang qui obture à moitié son regard. Ce buste est placé sur le rebord d’une baie à demi-ouverte sur une mer bleu-gris sans fin, à demi-fermée par un rideau rouge opaque. Même si une telle représentation déborde certainement toutes les tentatives d’interprétation, ne peut-on penser que le fond du tableau installe une alternative : faut-il tout occulter en tirant le rideau, ou bien doit-on accéder obligatoirement à l’existence par l’appropriation du passé ? Mais dans ce cas n’y a-t-il pas le risque, par le rappel lancinant de celui-ci sur la scène présente, de s’enfermer dans le carcan de l’histoire et de se faire le prisonnier perpétuel des morts, selon la formule de Karl Marx ?
Au-delà de cette interrogation générale, le tableau réfère étrangement au passé singulier des sociétés antillaises et de toutes les sociétés du Nouveau Monde qui leur sont apparentées. On peut le rapprocher d’un poème de Derek Walcott, Prix Nobel de littérature, originaire de l’île de Sainte-Lucie :
- « Where are your monuments, your battles, martyrs
- Where is your tribal memory ? Sirs,
- in that grey vault. The sea. The sea
- has locked them up. The sea is History [1]»
On retrouve ce thème de la mer-histoire, qui s’articule à celui de l’absence de traces historiques classiques témoignant de la tragédie (et du destin de la lignée qui l’a au premier chef subie) dans deux œuvres majeures : celle de l’écrivain martiniquais Edouard Glissant, qui fait de la cale du bateau négrier la matrice d’une humanité nouvelle [2], et celle du sociologue Paul Gilroy qui, dans son ouvrage Black Atlantic [3], considère la figure du bateau comme le chronotope majeur de l’Afro Amérique.
I
Que faire du passé, dans une terre ayant connu une antique oppression, dont le point de départ est marqué par une rupture qui semble irréparable, une douleur qui paraît sans remède [4] ? Comment prendre acte de l’histoire mise en marche à partir de la plantation esclavagiste, qui vous a fait, et simultanément lui résister, « jouer en quelque sorte un côté de soi-même contre l’autre [5] » ? Dilemme central pour des sociétés marquées par un génocide fondateur, celui de l’élimination des populations indigènes amérindiennes, puis par l’oppression fondamentale de l’esclavage, et la segmentation interminable générée par le préjugé de couleur, mais où tous les hommes sont venus d’ailleurs, et où aucun repli vers une quelconque autochtonie n’est possible… Sociétés entièrement modelées par la prépondérance d’une économie de plantation « à moteur externe », car vouée à la satisfaction de besoins extérieurs, mais nées dans le mouvement même de colonisation : comment produire un récit historique émanant du lieu, et prenant en compte le destin de ceux qui y ont été réifiés, alors que l’hétéronomie du projet colonial ne fait qu’établir les fondements de l’histoire du colonisateur ?
L’une des premières attitudes qui pu se déployer suite à la libération des esclaves fut de tourner le dos au passé d’oppression et de violence subies pour recomposer une société meurtrie. On peut en la matière rappeler la phrase inaugurale de Rostoland, gouverneur provisoire de la Martinique : « je recommande à chacun l’oubli du passé… ». L’Abolition, qui signifia en même temps pour les nouveaux libres, du moins pour les colonies françaises, l’accession à la citoyenneté, débouchait tout naturellement sur la voie, à la fois culturelle et politique, de l’assimilation, qui impliquait l’adhésion à la culture importée de métropole et l’agrégation à un ensemble national, donnant par ailleurs la possibilité d’une mobilité sociale prévue par les lois républicaines. Le passé servile devait être, dans ces conditions, oublié au nom de l’idéal républicain d’égalité et dans le rêve rédempteur de la fraternité française. Du côté de l’Etat, l’oubli du passé était nécessaire à la constitution du récit de la Nation unie et glorieuse, dont l’ethos collectif prenait justement naissance à l’Abolition, en 1848… Du côté antillais, cette vision républicaine était largement diffusée, comme en témoigne cet extrait d’une Histoire de la Martinique écrite à destination des écoles primaires (1932), dont la vision irénique de la diversité raciale occultait soigneusement l’origine et les tensions qui continuaient à parcourir cette diversité :
- « Colonisée peu après la découverte de l’Amérique par des Normands, des Bretons et des Africains, (la Martinique) forme à l’heure actuelle par le mélange des races qui ont foulé son sol étroit un petit peuple de coloration épidermique variant du noir d’ébène au blanc d’albâtre, mais ayant la même langue, les mêmes intérêts, les mêmes croyances religieuses, les mêmes mœurs et les mêmes traditions que la France. Par son passé historique qui depuis trois siècles se confond avec celui de la France, par les épreuves subies en commun mais surtout par sa volonté et par son cœur, elle aspire, par une assimilation complète, à faire partie intégrante de la grande et généreuse nation française [6] ».
Une telle aspiration fut, rappelons-le, satisfaite par la loi de départementalisation de 1946, qui, transformant les vieilles colonies en département d’outre-mer, représenta la traduction politique du mouvement au long cours de l’assimilation. La volonté d’oubli s’articulait d’autre part à l’absence d’un récit collectif qui aurait verbalisé son souvenir, absence en rapport avec l’impossibilité, propre aux sociétés créoles, de se constituer un corpus mémoriel unifié [7].
En face se faisait jour cependant une tendance opposée, que l’on peut placer sous la bannière générale de l’auto-affirmation. Initiée à Paris dans les années 30 par le mouvement de la négritude, sous l’impulsion d’Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor, cette tendance a d’abord été caractérisée par une volonté de regrouper, sur la base d’une identité chromatique rapportée à une origine africaine, immédiate ou lointaine, l’ensemble des ressortissants d’une diaspora « noire » dispersée de l’Ancien au Nouveau Monde. Une des positions liée à cette auto-affirmation a amené à faire un tri dans le passé, certaines lignées culturelles étant considérées plus « authentiques » et porteuses d’identités que les autres : sur le fondement d’une fierté raciale retrouvée, elle a abouti à une revalorisation des « racines » africaines, censées nourrir, de manière souterraine, par-delà l’esclavage, la civilisation antillaise (avec l'idée implicite, qui avait pu être soutenue par certains ethnologues spécialistes de l’Afro-Amérique comme M.J. Herskovits, d'un primat des formes originelles…). L’attitude d’auto-affirmation a pu également s’articuler, en aval de l’héritage africain, à une prise en compte du traumatisme même de la traite et de l’esclavage, insistant sur les effets dévastateurs d’un système d’oppression et d’aliénation mais glorifiant dans le même temps la résistance à l’esclavage (à travers la figure emblématique de l’esclave fugitif, le Marron…), posture en phase avec la montée des mouvements nationalistes, à la fin des années 60 et dans les années 70. Elle a pu enfin correspondre à une posture idéologique quelque peu différente, chronologiquement postérieure, qui met quant à elle l’accent sur ce qui s’est construit aux îles mêmes, sur ces phénomènes de création culturelle locale, d’innovation, qui, à partir de l’assemblage d’héritages divers (amérindien, européen, africain, asiatique…), ont abouti à quelque chose de neuf, écartant le Nouveau Monde de l’Ancien dans un lent mouvement de dérive. L’idée d’antillanité (lancée par E. Glissant), puis le mouvement de la créolité ont ainsi développé un nationalisme de sol, de territoire, de langue, refusant de sectionner l’une quelconque des racines dont l’identité antillaise peut se revendiquer (ainsi peut se lire la métaphore de l’identité-rhizome, telle qu’elle a pu être proposée par E. Glissant à la suite de Deleuze et Guattari) et assumant le caractère à la fois nouveau et composite des cultures antillaises.
Influencés par cette nouvelle donne idéologique et mus dès lors par une quête identitaire les portant au devant de tous ceux dont la dignité d’hommes avait été déniée, un bon nombre d’écrivains locaux contemporains ont développé le thème de l’amnésie collective, sous le signe de l’absence de traces et de l’impuissance de la mémoire. Aimé Césaire évoque ainsi ces « pays sans stèles, ces chemins sans mémoire [8] », et parle, sous le signe du silence et de l’obscurité, d’une « blessure sacrée » et d’une « soif irrémédiable » :
- « J’habite une blessure sacrée
- j’habite des ancêtres imaginaires
- j’habite un vouloir obscur
- j’habite un long silence
- j’habite une soif irrémédiable
- j’habite un voyage de mille ans
- j’habite une guerre de trois cents ans [9] »
Glissant parle quant à lui de « non-histoire » ( « ce discontinu dans le continu, et l’impossibilité pour la conscience collective d’en faire le tour, caractérisent ce que j’appelle une non-histoire [10] »), du « raturage soigneux du passé » et de « l’obscur de cette mémoire impossible ». Du côté anglophone, Derek Walcott estime qu’ « avec le temps, l’esclave capitula devant l’amnésie », et que « c’est cette amnésie qui constitue la véritable histoire du nouveau monde [11] ». Pour le sociologue d’origine jamaïcaine Orlando Patterson, « l’héritage le plus important de l’esclavage est la rupture totale, moins avec le passé qu’avec une conscience du passé [12] ». Le texte-manifeste qu’est l’Eloge de la créolité, paru en 1989, dresse, dans la ligne déjà tracée par Glissant, le même bilan : « cela s'est fait sans témoignages, nous laissant un peu dans la situation de la fleur qui ne verrait pas sa tige, qui ne la sentirait pas [13]... » :
- « Notre histoire (ou plus exactement nos histoires) est naufragée dans l’Histoire coloniale… Ce que nous croyons être l’histoire antillaise n’est que l’histoire de la colonisation des Antilles. Dessous les ondes de choc de l’histoire de France, dessous les grandes dates d’arrivée et de départ des gouverneurs, dessous les aléas des luttes coloniales, dessous les belles pages blanches de la Chronique (ou des flambées de nos révoltes n’apparaissent qu’en petites taches), il y eut le cheminement obstiné de nous-mêmes. L’opaque résistance des nègres marrons bandés dans leur refus. L’héroïsme neuf de ceux qui affrontèrent l’enfer esclavagiste, déployant d’obscurs codes de survie, d’indéchiffrables qualités de résistance, la variété illisible des compromis, les synthèses inattendues de vie [14]… ».
Ces écrivains prennent dans le même temps acte de l’impuissance des historiens à se confronter à cette « histoire du silence », du fait même de l’absence de leur matériau classique, les traces écrites, et de la rareté des vestiges matériels. Un texte d’Edward Baugh, poète jamaïcain, porte le titre révélateur « The West Indian Writer and his Quarrel with history [15] ». Une telle ligne de pensée, fortement inspirée par Derek Walcott, pour qui « History is irrelevant in the Caribbean », a été largement développée par E. Glissant :
- “Dans un tel contexte, l’histoire en tant qu’elle est discipline et qu’elle prétend éclairer la réalité que vit ce peuple souffrira d’une carence épistémologique grave : elle ne saura pas par quel bout s’attraper. Le trouble de la conscience collective rend en effet nécessaire une exploration créatrice, pour laquelle les rigueurs indispensables à la mise en schémas historicienne (sic) peuvent constituer, si elles ne sont pas dominées, un handicap paralysant… »
Aussi font-ils appels, face à ce manque, aux arts de l’imagination. Derek Walcott est d’avis que, « pour le monde caribéen, l’histoire reste le territoire de l’imagination et de la mémoire [16] ». Une mémoire pour laquelle la littérature peut servir d’instrument de transmission, voire même de reconstitution. Ce qu’E. Glissant exprime avec force :
- « Le passé, notre passé subi, qui n’est pas encore histoire pour nous, est pourtant là (ici) qui nous lancine. La tâche de l’écrivain est d’explorer ce lancinement, de le « révéler » de manière continue dans le présent et l’actuel… C’est ce que j’appelle une vision prophétique du passé… Parce que le temps antillais fut stabilisé dans le néant d’une non-histoire imposée, l’écrivain doit contribuer à rétablir sa chronologie tourmentée… En ce qui nous concerne, l’histoire en tant que conscience à l’œuvre et l’histoire en tant que vécu ne sont donc pas l’affaire des seuls historiens ».
L’Éloge de la créolité va dans le même sens :
- « Si bien que notre histoire (ou nos histoires) n’est pas totalement accessible aux historiens… Ce n’est pas un hasard si, pour l’histoire antillaise, tant d’historiens utilisent des citations littéraires pour surprendre des principes qu’ils ne peuvent qu’effleurer du fait même de leur méthodologie… Seule la connaissance poétique, la connaissance romanesque, la connaissance littéraire, bref la connaissance artistique, pourra nous déceler, nous percevoir, nous ramener évanescents aux réanimations de la conscience ».
Toute l’œuvre littéraire de Glissant est ainsi une tentative, dans une série de romans enchâssés, de retracer le destin de lignées martiniquaises au fil des siècles, afin de sortir, par une Relation des histoires, de l’infra-histoire et d’accéder au temps vrai d’une identité reconquise [17]. L’un des grands romans de l’un des auteurs de l’Eloge, Texaco, se présente comme une restitution de vastes pans de l’histoire martiniquaise, de l’univers de la plantation esclavagiste aux quartiers contemporains d’habitat spontané, en passant par cette épopée intérieure que fut la conquête agraire des mornes par les esclaves qui venaient d’être libérés [18]. La littérature semble jouer là un rôle essentiel dans une prise de conscience collective, assumant une fonction de transmission mémorielle, cherchant des traces là où on ne s’attend pas normalement à les trouver [19]… En particulier dans le paysage, expression visible de la structure agraire, qui garde encore une empreinte forte de l’ordre géométrique de la plantation et des espaces gagnés dans les interstices du système par les petits cultivateurs. Ce qu’a exprimé E. Glissant à sa manière : « notre paysage est son propre monument : la trace qu’il signifie est repérable par dessous. C’est tout histoire [20] ».
Les efforts des écrivains ne se sont pas révélés vains… Ils ont en effet grandement contribué à la construction d’une nouvelle mémoire historique qui s’est progressivement constituée au XXe siècle, avec une accélération notable à partir des années 70 et une considérable enflure dans les années 90, avec l’ouverture d’une décennie de commémorations en série (bi-centenaire de la première abolition de 1794, cent-cinquantenaire de l’abolition de 1848, bi-centenaire du rétablissement de l’esclavage par Bonaparte en 1802 et du sacrifice de l’insurgé Delgrès à la Guadeloupe…). Il faut noter la place essentielle tenue, à côté des écrivains, par les médiateurs culturels et les intellectuels locaux. Une place particulière doit être réservée aux historiens : contrairement aux préventions qui avaient pu être exprimées à leur encontre, la connaissance historique de ces sociétés a largement progressé, menée selon tous les critères de scientificité de la discipline, surtout à partir de la fin des années 60 avec la mise en place progressive d’un milieu professionnel et avec l’application locale des principes de la nouvelle histoire… Cette progression s’est faite dans deux grands domaines : une histoire internationale de la traite atlantique (dominée par les historiens américains) ; une histoire régionale, où se rencontrent les travaux d’historiens originaires et non-originaires, qui s’est concentrée sur la plantation esclavagiste et ses séquelles après l’Abolition. Ces productions de divers ordres ont été mobilisées dans une quête idéologisée de l’identité : la matière historique a été retravaillée, malaxée, interprétée, finissant, dans le labeur même de construction d’une mémoire historique nantie des attributs de toute mémoire (adhérence avec le présent, pénétration des affects, fidélité mais non forcément véracité, inféodation aux groupes qui la portent et aux idéologies qui l’impulsent …), par acquérir la consistance du mythe, en tant que récit qui, par la répétition même d’une figure générale, est censé fonder le présent…
On peut ainsi mentionner deux discours récurrents sur le passé qui trouvent leur matériau dans cette mémoire : l’accent mis sur la résistance à l’esclavage a d’abord permis une extraordinaire promotion de la figure du Marron, celui qui a choisi d’échapper à l’univers servile pour vivre libre dans les profondeurs des bois. Les historiens s’accordent pour minimiser le phénomène aux Petites Antilles, où l’exiguïté de l’espace se prêtait mal à de telles échappées, du moins collectives. Mais la figure est devenue un leitmotiv presque obligé durant ces dernières années, dans lequel se mêlent les références à l’Afrique originelle (le Marron ayant été celui qui a pu conserver et transmettre des éléments culturels africains) et celles relatives à la résistance face à l’esclavage.
La reconnaissance du caractère mêlé de la population antillaise est d’autre part loin de s’opérer dans le rêve irénique du métissage (même si le mouvement de la créolité a pu récupérer en partie l’engouement que le terme rencontre sous d’autres cieux…) : elle est surtout représentée sur le mode de la déchirure existentielle ou névrotique… Il est vrai que dans l’optique coloniale l’image du métissage s’est traditionnellement composée à partir de l’union de la femme de couleur et de l’homme blanc sous le sceau de l’illégitimité, alors que l’union de l’homme noir et de la femme blanche est restée jusqu’à une date assez récente largement impensable, selon un schéma où se conjuguent la domination masculine et l’oppression raciale… Aussi a été généralisé et stéréotypé, à partir de faits singuliers - dont la réalité ne peut au demeurant être mise en doute - le viol de la femme esclave par le maître, qui serait à la source d’un certain nombre de névroses collectives antillaises : conscience malheureuse qui entoure traditionnellement la figure du métis, qui ne peut que porter la souffrance en son sein, révélant une dysharmonie sociale et exprimant un sentiment tragique d’aliénation ; marginalité de l’homme noir à qui a été dénié le rôle de géniteur et qui ne peut assumer son rôle de père…
Une telle représentation est, on le voit, tout entière racialisée. Il est en effet une trace immédiatement visible de l’esclavage, dans l'apparence même des descendants de ceux qui en ont été victimes, qui continue, à travers ce lien généalogique inscrit sur l'enveloppe des corps, à segmenter interminablement la société. Les individus apparaissent ainsi surdéterminés par la visibilisation d’une ascendance qui fixe leur place dans les affrontements sociaux et idéologiques. On est en présence d’une histoire qui, pour employer une métaphore un peu lourde, s’est véritablement imprimée sur l’épiderme des individus qui se sont succédés au long des générations [21]… Contrairement à ce qui se passe par exemple en France métropolitaine, où le souvenir des clivages de la société d'ordres (nobles et roturiers…) n'est plus opérant dans les luttes politiques contemporaines, le débat politico-culturel antillais, tel qu'il s'est profilé durant les années récentes, a pu être caractérisé par cette constante référence à l'esclavage dont la race contribue, selon l’expression lumineuse de Tocqueville, à perpétuer le souvenir.
La nouvelle mémoire de l’esclavage s’offre ainsi comme une catégorie de discours dotée d’efficacité, comme un embrayeur remarquable de l’action. On retrouve là, selon une formule de P. Nora, la capacité « régissante » de la mémoire…
- « Aujourd’hui pourtant nous entendons le fracas de Matouba. Pour retrouver le temps de leur histoire, il a fallu que les pays antillais brisent la gangue que le lacis colonial avait tissée au long de leurs côtes [22] ».
Ainsi s’exprime E. Glissant, afin d’illustrer à partir d’un exemple héroïque, celui du lieutenant Delgrès qui préféra se faire sauter avec ses hommes dans la redoute de Matouba plutôt que de se rendre aux troupes du général Richepance venu rétablir l’esclavage, la constitution de cette mémoire historique qui, pénétrée d’imaginaire, nourrit elle-même une nouvelle floraison d’images…
II
Pour qui débarque aujourd’hui dans un département français d’Amérique, en l’occurrence la Guadeloupe ou la Martinique, on ne peut être que frappé par l’irruption d’images du passé qui, depuis quelques années, s’étalent sur les murs de la ville. Il s’agit de simples tags, ou de fresques plus élaborées, comme celles qui ornent le mur d’enceinte du Lycée Baimbridge, à Pointe-à-Pitre, ou celles, ce qui relève d’une singulière ironie, qui s’étalent sur le mur de la prison de Basse-Terre. La quasi-majorité de ces figurations fait référence à la traite atlantique et à l’esclavage.
Le mur de l’entrée du Lycée Baimbridge, Pointe-à-Pitre
Le lycée Baimbridge, situé dans l’extension urbaine récente de l’agglomération de Pointe-à-Pitre, est le plus important lycée de la Guadeloupe, rassemblant plusieurs milliers d’élèves. Une vaste fresque orne son mur d’enceinte, à l’entrée de l’établissement, le long du Boulevard des héros. Cette fresque est le résultat de ce qui peut être considéré comme une commande officielle, destinée à valoriser dans l’espace public le travail des élèves dans le cadre de cours d’arts plastiques, en collaboration avec des artistes guadeloupéens.
 C’est d’abord la traite qui s’impose au regard. La forte mémoire historique qui s’est constituée à son propos a pu se nourrir de nombreuses images : gravures de l’époque, souvent utilisées dans les manuels récents ou dans les revues de vulgarisation ; films, qui reconstituent les horreurs de la traversée, comme Tamango [23], tiré de la nouvelle de Prosper Mérimée, dans les années 50 ou, plus récemment (1997), Amistad [24], de S. Spielberg. Une chaîne de captifs, directement inspirée de gravures de l’époque aujourd’hui mises en circulation par les historiens, progresse dans un paysage figuré par un ciel et des hautes herbes : des femmes, dont deux portent de lourdes charges sur les épaules, la première avec un enfant sur le dos, sont au premier plan, simplement vêtues de pagne ; un captif, au sexe indéterminé, s’est effondré sur le côté… La chaîne métallique, s’affranchissant de la scène, s’autonomise en gros-plan, reliant des visages au faciès africain, yeux largement ouvert reflétant la détermination et la résistance, alors que des silhouettes semblent s’échapper d’un magma rouge, brasier ou fleuve de sang… C’est d’abord la traite qui s’impose au regard. La forte mémoire historique qui s’est constituée à son propos a pu se nourrir de nombreuses images : gravures de l’époque, souvent utilisées dans les manuels récents ou dans les revues de vulgarisation ; films, qui reconstituent les horreurs de la traversée, comme Tamango [23], tiré de la nouvelle de Prosper Mérimée, dans les années 50 ou, plus récemment (1997), Amistad [24], de S. Spielberg. Une chaîne de captifs, directement inspirée de gravures de l’époque aujourd’hui mises en circulation par les historiens, progresse dans un paysage figuré par un ciel et des hautes herbes : des femmes, dont deux portent de lourdes charges sur les épaules, la première avec un enfant sur le dos, sont au premier plan, simplement vêtues de pagne ; un captif, au sexe indéterminé, s’est effondré sur le côté… La chaîne métallique, s’affranchissant de la scène, s’autonomise en gros-plan, reliant des visages au faciès africain, yeux largement ouvert reflétant la détermination et la résistance, alors que des silhouettes semblent s’échapper d’un magma rouge, brasier ou fleuve de sang…
Non loin l’Afrique, avec ses contours, est représentée dans une veine allégorique : personnifiée par des visages dont l’un surgit d’un espace craquelé ; elle apparaît véritablement saignée, avec des coulées de sang qui dégoulinent tout au long de ses côtes…
 Un bateau négrier, toutes voiles dehors, lutte contre une mer déchaînée : sa figuration est assez fantaisiste, alors même qu’est reproduite la coupe horizontale de ce type de navire, avec les corps des captifs allongés serrés les uns contre les autres sur toute la surface de la cale, document très souvent reproduit dans les ouvrages spécialisés (voir plus bas, détail de la photo 5)… Un bateau négrier, toutes voiles dehors, lutte contre une mer déchaînée : sa figuration est assez fantaisiste, alors même qu’est reproduite la coupe horizontale de ce type de navire, avec les corps des captifs allongés serrés les uns contre les autres sur toute la surface de la cale, document très souvent reproduit dans les ouvrages spécialisés (voir plus bas, détail de la photo 5)…
La deuxième grande thématique de la fresque correspond à la geste de Delgrès et Ignace. Rappelons brièvement les faits, qui remontent aux troubles que la Guadeloupe a connus lors de la période révolutionnaire. Tout comme la Martinique, l’île, sous l’impulsion de la classe dominante des planteurs, soucieuse de ne pas perdre ses privilèges, s’était donnée aux Anglais. Mais l’énergique envoyé de la Convention, Victor Hugues, devait reconquérir l’île, promulguant sur place la première Abolition de l’esclavage (1794). En 1802 Bonaparte, revenant sur les décisions révolutionnaires, envoyait un corps expéditionnaire afin d’assurer le rétablissement de l’esclavage, suscitant la résistance des troupes de couleur, menées par un officier d’origine martiniquaise, Delgrès, et l’insurrection des ex-esclaves, sous le commandement de l’ancien esclave Ignace. Après des combats acharnés et l’abandon du Fort Saint-Charles assiégé par le Général Richepance, Delgrès préféra, suite à la mort d’Ignace et au massacre de ses combattants sur le Morne Baimbridge près de Pointe-à-Pitre, ayant rédigé une déclaration qu’il livra à la postérité, se faire sauter avec ses derniers hommes dans la redoute de Matouba, sur les hauteurs de Basse-Terre…
 Alors que dans l’historiographie traditionnelle de la Guadeloupe, ces deux personnages étaient représentés comme des insurgés, ils ont connu une héroïsation progressive, qui s’est développée tout au long du XXe siècle. Déjà, au début de ce siècle, avec la montée du mouvement négriste en Guadeloupe et ses succès électoraux, une rue Delgrès apparaît à Pointe-à-Pitre. Aimé Césaire publie en 1958 le « Mémorial à Louis Delgrès », intégré ensuite dans le recueil intitulé Ferrements, en référence au passé esclavagiste [25]. Delgrès - et Ignace - deviennent ensuite des figures majeures de référence pour le mouvement nationaliste guadeloupéen. Cette fortune est institutionnalisée avec les transferts de pouvoir consécutifs à la décentralisation : le Fort Saint-Charles à Basse-Terre (qui porta un temps le nom de Fort Richepance !) est désormais dénommé le Fort Delgrès [26] ; une plaque où est retranscrite sa célèbre déclaration, rédigée juste avant sa mort, a été apposée à l’entrée de l’enceinte intérieure du Fort. Alors que dans l’historiographie traditionnelle de la Guadeloupe, ces deux personnages étaient représentés comme des insurgés, ils ont connu une héroïsation progressive, qui s’est développée tout au long du XXe siècle. Déjà, au début de ce siècle, avec la montée du mouvement négriste en Guadeloupe et ses succès électoraux, une rue Delgrès apparaît à Pointe-à-Pitre. Aimé Césaire publie en 1958 le « Mémorial à Louis Delgrès », intégré ensuite dans le recueil intitulé Ferrements, en référence au passé esclavagiste [25]. Delgrès - et Ignace - deviennent ensuite des figures majeures de référence pour le mouvement nationaliste guadeloupéen. Cette fortune est institutionnalisée avec les transferts de pouvoir consécutifs à la décentralisation : le Fort Saint-Charles à Basse-Terre (qui porta un temps le nom de Fort Richepance !) est désormais dénommé le Fort Delgrès [26] ; une plaque où est retranscrite sa célèbre déclaration, rédigée juste avant sa mort, a été apposée à l’entrée de l’enceinte intérieure du Fort.
 Cette geste héroïque avait déjà touché les élèves du Lycée Baimbridge (ainsi nommé du fait de son voisinage avec le morne où succomba Ignace) quelques années auparavant. Les élèves de seconde AB, d’octobre 76 à mai 77, avaient rédigé, sous la houlette de leur professeur de français, un roman historique, publié sous le titre Les Arbres de la liberté, en référence à ces arbres plantés à l’époque de V. Hugues pour célébrer la liberté récemment acquise. « En racontant la liberté d’Ignace, c’est un peu la nôtre que nous faisions venir à la lumière », était-il écrit dans l’avant-propos de l’ouvrage, dans une « conscience historique ») qui affleurait au fil du texte, repérable aussi bien au niveau du dit que du non-dit, au travers de représentations largement stéréotypées : un esclave arrivé d’Afrique se révélait en fait être Ignace, permettant de mettre en avant un certain type de rapport à l’Afrique, alors que dans le même temps était cultivée l’idée de l’émergence, à cette période, d’une nation guadeloupéenne… Le drame a continué à inspirer les activités pédagogiques des enseignants du Lycée, cette fois dans le domaine des arts figuratifs. Les deux personnages, le Mulâtre Delgrès et l’Africain Ignace sont représentés en portrait, près d’une scène figurant la première abolition, avec des esclaves qui clament leur allégresse d’être délivrés de leurs chaînes, alors que juste à côté, dans une autre vignette, le mot « libre » est figuré par des chaînons rompus et dissociés, et que la Guadeloupe, avec son contour caractéristique, apparaît comme le germe d’une nouvelle pousse (ailleurs dans la fresque apparaît le drapeau rouge, vert et jaune flanqué d’une étoile que se sont donnés les nationalistes guadeloupéens…). Cette geste héroïque avait déjà touché les élèves du Lycée Baimbridge (ainsi nommé du fait de son voisinage avec le morne où succomba Ignace) quelques années auparavant. Les élèves de seconde AB, d’octobre 76 à mai 77, avaient rédigé, sous la houlette de leur professeur de français, un roman historique, publié sous le titre Les Arbres de la liberté, en référence à ces arbres plantés à l’époque de V. Hugues pour célébrer la liberté récemment acquise. « En racontant la liberté d’Ignace, c’est un peu la nôtre que nous faisions venir à la lumière », était-il écrit dans l’avant-propos de l’ouvrage, dans une « conscience historique ») qui affleurait au fil du texte, repérable aussi bien au niveau du dit que du non-dit, au travers de représentations largement stéréotypées : un esclave arrivé d’Afrique se révélait en fait être Ignace, permettant de mettre en avant un certain type de rapport à l’Afrique, alors que dans le même temps était cultivée l’idée de l’émergence, à cette période, d’une nation guadeloupéenne… Le drame a continué à inspirer les activités pédagogiques des enseignants du Lycée, cette fois dans le domaine des arts figuratifs. Les deux personnages, le Mulâtre Delgrès et l’Africain Ignace sont représentés en portrait, près d’une scène figurant la première abolition, avec des esclaves qui clament leur allégresse d’être délivrés de leurs chaînes, alors que juste à côté, dans une autre vignette, le mot « libre » est figuré par des chaînons rompus et dissociés, et que la Guadeloupe, avec son contour caractéristique, apparaît comme le germe d’une nouvelle pousse (ailleurs dans la fresque apparaît le drapeau rouge, vert et jaune flanqué d’une étoile que se sont donnés les nationalistes guadeloupéens…).
 Un texte, soigneusement calligraphié, s’intercale entre les deux héros, message adressé à la postérité : « Et nous lèguerons nos exemples à suivre à ceux qui viendront après nous et qui, plus heureux, conquerront, eux, cette liberté que nous n’avons fait qu’entrevoir ». Une plaque, apposée tout près, rédigée en petits caractères, s’adresse à un lecteur plus attentif. Y figure un poème, composé par une élève de Terminale du Lycée Gerville-Réache à Basse-Terre : Un texte, soigneusement calligraphié, s’intercale entre les deux héros, message adressé à la postérité : « Et nous lèguerons nos exemples à suivre à ceux qui viendront après nous et qui, plus heureux, conquerront, eux, cette liberté que nous n’avons fait qu’entrevoir ». Une plaque, apposée tout près, rédigée en petits caractères, s’adresse à un lecteur plus attentif. Y figure un poème, composé par une élève de Terminale du Lycée Gerville-Réache à Basse-Terre :
- Né du sang versé par nos pères asservis
- Aujourd'hui tu existes
- Je te veux et je te vis
- Je te crie
- Liberté
 La fresque est censée illustrer la pensé exprimée par ce poème. Sur la plaque est également mentionnée la date de l’inauguration de l’œuvre, soit le 27 mai 1998, ce qui correspond au cent-cinquantenaire de la libération des esclaves en 1848. L’anniversaire est positionné dans l’année en référence au soulèvement des esclaves de la Guadeloupe qui, juste après ceux de Martinique, surent arracher leur liberté aux autorités de la colonie, avant même l’arrivée du décret émancipateur… La fresque est censée illustrer la pensé exprimée par ce poème. Sur la plaque est également mentionnée la date de l’inauguration de l’œuvre, soit le 27 mai 1998, ce qui correspond au cent-cinquantenaire de la libération des esclaves en 1848. L’anniversaire est positionné dans l’année en référence au soulèvement des esclaves de la Guadeloupe qui, juste après ceux de Martinique, surent arracher leur liberté aux autorités de la colonie, avant même l’arrivée du décret émancipateur…
 On trouve dans la fresque d’autres éléments, comme une évocation de l’univers de l’habitation esclavagiste, avec son moulin à vent et sa « rue cases-nègres ». On trouve dans la fresque d’autres éléments, comme une évocation de l’univers de l’habitation esclavagiste, avec son moulin à vent et sa « rue cases-nègres ».
 Certains détails, suite à des ajouts postérieurs, apparaissent particulièrement signifiants. On trouve ainsi le portrait d’une mulâtresse, richement parée, avec sa coiffe caractéristique et un lourd collier autour du cou. Juste au-dessus de ce portrait, un graffiti vengeur, griffonné après coup dans une orthographe approximative, a servi à l’expression d’un jugement sans appel sur ce personnage, assimilé à la figure de la mulâtresse-courtisane : « APRE 150 ANS ABOLISSION D’ESCLAVAGE JE RESTE TOUJOURS LA PUTE DU BLANC »… Certains détails, suite à des ajouts postérieurs, apparaissent particulièrement signifiants. On trouve ainsi le portrait d’une mulâtresse, richement parée, avec sa coiffe caractéristique et un lourd collier autour du cou. Juste au-dessus de ce portrait, un graffiti vengeur, griffonné après coup dans une orthographe approximative, a servi à l’expression d’un jugement sans appel sur ce personnage, assimilé à la figure de la mulâtresse-courtisane : « APRE 150 ANS ABOLISSION D’ESCLAVAGE JE RESTE TOUJOURS LA PUTE DU BLANC »…
 Une autre partie de la fresque cherche à évoquer le destin du « peuple noir » : flambeau illuminant la nuit, visage songeur alors qu’un lien désormais inutile pend le long du bras, corps harmonieux dans l’effort, paysage apaisé devant la mer, au soleil couchant, alors qu’un texte vibre à l’unisson : « De douleur son âme a crié/A plat son sang a coulé/Mais le peuple noir a montré/Qu’il resterait maître de sa destinée »… Une autre partie de la fresque cherche à évoquer le destin du « peuple noir » : flambeau illuminant la nuit, visage songeur alors qu’un lien désormais inutile pend le long du bras, corps harmonieux dans l’effort, paysage apaisé devant la mer, au soleil couchant, alors qu’un texte vibre à l’unisson : « De douleur son âme a crié/A plat son sang a coulé/Mais le peuple noir a montré/Qu’il resterait maître de sa destinée »…
Statuaire municipale
Lorsqu’on remonte le boulevard des Héros, on arrive à un rond-point où a été érigé un monument dédié au sacrifice de Delgrès à Matouba, qui représente le héros déchiqueté. Il est d’autre part une autre figure de mulâtresse qui habite la mémoire historique guadeloupéenne. Non loin du boulevard des Héros, se dresse, au milieu du terre-plein central d’un autre rond-point, la statue de la Mulâtresse Solitude. Celle-ci était l’une des femmes qui avait rejoint la colonne des insurgés de 1802, et qui fut exécutée lors de la répression qui suivit. Les traces de son existence réelle sont minces : elle est mentionnée par un historien du XIXe siècle, A. Lacour, qui ne se prive pas d’exprimer à son encontre sa réprobation, conforme à l’esprit de l’élite assimilationniste de l’époque :
- Elle laissait éclater, dans toutes les occasions, sa haine et sa fureur… Et cette malheureuse allait devenir mère ! Solitude n’abandonna pas les rebelles et resta près d’eux, comme leur mauvais génie, pour les exciter aux plus grands forfaits [27]… »
Changement d’époque et nouvelle fabrique des héros… Le destin de Solitude a inspiré le beau roman La Mulâtresse Solitude, d’André Schwarz-Bart (1972) [28], qui venait d’accoster par son mariage aux rivages de la Guadeloupe, encore tout auréolé de l’aura acquise avec Le dernier des justes (œuvre consacrée au destin millénaire d’une famille juive, de l’an mille aux camps d’extermination, Prix Goncourt 1959). Sous la statue qui représente Solitude fièrement campée, les mains sur les hanches, manifestement enceinte, un foulard soutenant son ventre, une stèle rappelle au passant son histoire et se termine par ces phrases :
- EN DÉPIT DE SA GROSSESSE SOLITUDE POURSUIVIT LA LUTTE DE RÉSISTANCE APRÈS LES ÉPREUVES TRAGIQUES DE BAIMBRIDGE ET DE MATOUBA. MAIS AU COURS D’UNE BATTUE DANS LES BOIS DE LA BASSE TERRE ELLE FUT CAPTURÉE ET CONDAMNÉE À LA PENDAISON, SES TORTIONNAIRES NE LUI ACCORDANT QUE LE TEMPS DES COUCHES. LE 29 NOVEMBRE 1802, AGÉE SEULEMENT DE 30 ANS, SOLITUDE FUT PENDUE AU GRAND MAT DES SUPPLICIES AU CRI DE « VIVRE LIBRE OU MOURIR ».
- LE PEUPLE GUADELOUPEEN RECONNAISSANT TEMOIGNE HONNEUR ET RESPECT À SA MEMOIRE.
-
- 27 MAI 1999.
 Cette fabrique des héros, qui s’articule dans ce cas à un personnage quelque peu légendaire dont la stature est rehaussée par la littérature, peut aussi à l’occasion puiser dans l’imaginaire d’une figure collective, comme le Nègre marron… Changeons d’île, et passons à la Martinique, dans la commune du Diamant. Comme ailleurs aux Antilles, les collectivités locales, qui ont vu leur pouvoir s’accroître depuis la décentralisation, ont participé à la promotion de la nouvelle mémoire historique en célébrant la mémoire de ses héros. La statuaire publique dédiée au Marron n’est pas chose nouvelle : déjà une statue monumentale avait été érigée sur une place de Port-au-Prince en Haïti. Au Diamant comme à Port-au-Prince, c’est ici la figuration d’un mythe : le personnage, adossé à une structure courbe dont la signification demeure mystérieuse, tient à la main une corne de lambi (comme c’est le cas pour la statue de Port-au-Prince…), emblème de la lutte collective, instrument de ralliement des révoltés… Cette fabrique des héros, qui s’articule dans ce cas à un personnage quelque peu légendaire dont la stature est rehaussée par la littérature, peut aussi à l’occasion puiser dans l’imaginaire d’une figure collective, comme le Nègre marron… Changeons d’île, et passons à la Martinique, dans la commune du Diamant. Comme ailleurs aux Antilles, les collectivités locales, qui ont vu leur pouvoir s’accroître depuis la décentralisation, ont participé à la promotion de la nouvelle mémoire historique en célébrant la mémoire de ses héros. La statuaire publique dédiée au Marron n’est pas chose nouvelle : déjà une statue monumentale avait été érigée sur une place de Port-au-Prince en Haïti. Au Diamant comme à Port-au-Prince, c’est ici la figuration d’un mythe : le personnage, adossé à une structure courbe dont la signification demeure mystérieuse, tient à la main une corne de lambi (comme c’est le cas pour la statue de Port-au-Prince…), emblème de la lutte collective, instrument de ralliement des révoltés…
 Le Mémorial de l’Anse Caffard Le Mémorial de l’Anse Caffard
Toujours sur la commune du Diamant, à l’extérieur du bourg, une œuvre remarquable, dans tous les sens du terme, a été installée sur le littoral, juste en face du célèbre rocher du Diamant, manifestant une intention nettement monumentale et clairement commémorative. Intitulée Cap 110, Mémoire et fraternité, elle relève plus de l’évocation que de la reconstitution du passé en tant que telle. Elle est flanquée de ces nouveaux panneaux explicatifs, qui satisfont aux normes de la mise en tourisme d’aujourd’hui (avec traduction anglaise…). En 1830, lors s’une violente tempête, un navire négrier (qui pratiquait à cette époque une traite clandestine) se fracassa contre le rocher, entraînant vers le fond sa cargaison humaine : les quelques rescapés qui purent gagner la côte provoquèrent un dilemme juridique quant à la fixation de leur statut, comme lors du célèbre épisode de l’Amistad… L’œuvre consiste en un ensemble de bustes formant un vaste triangle disposé sur un morne dominant la mer : ils sortent de terre, les bras tendus le long du corps, touchant le sol, la tête légèrement inclinée, regardant la mer, dans la direction, au loin, du Golfe de Guinée… Œuvre au fort symbolisme, qui ne manque pas de puissance, provoquant le surgissement dans la conscience du visiteur de l’innombrable foule des victimes de la traite…
 Le buste de la Mémoire éclaboussée de sang, que nous avons évoqué au début de cette réflexion, renvoie de manière singulière à une série de déprédations à forte charge mémorielle, survenues à la Martinique. Depuis le Second Empire s’élevait, au centre de la Place de la Savane à Fort-de-France, la statue de Joséphine, « créole » native de la Martinique, projection locale d’une histoire officielle du pouvoir national, alors même que l’Impératrice, en bonne représentante des intérêts de sa caste, avait pu être accusée par certains analystes d’avoir conseillé à son époux de rétablir l’esclavage… Dans les années 70 cette statue fut transférée par la municipalité, qui profita d’un réaménagement paysager de la place, dans une allée latérale, astreinte à une existence plus discrète. Mais, quelques années plus tard, un matin la vit privée de tête, son voile de pierre maculé de peinture rouge… A la même époque, sa maison natale de la Pagerie, fleuron du patrimoine architectural de la Martinique et attraction touristique notable de la commune des Trois-Ilets, fut détruite par une explosion. Signe du surgissement d’une mémoire lourde de ressentiment, de la fin définitive de l’amnésie en son temps dénoncée par les écrivains ? Illustration en tout cas de la manipulation physique du passé à laquelle se livrent les sociétés humaines : l’effacement des traces, la destruction des images, tout comme leur fabrication, témoignent de ce façonnage permanent, en fonction des exigences mémorielles qui sont celles du présent. Et preuve qu’aux Antilles comme ailleurs coexistent aujourd’hui des représentations du passé contradictoires. Peut-être même plus qu’ailleurs, la mémoire de l’oppression voisinant avec le sentiment de nostalgie porté par les pratiques d’un nouveau régime d’historicité propre aux sociétés avancées (patrimonialisation, mises en scène du passé à destination des touristes…). Comment rendre compte de la douleur du passé, ce sang de l’histoire qui souille à la Martinique la statue de Joséphine ? Le buste de la Mémoire éclaboussée de sang, que nous avons évoqué au début de cette réflexion, renvoie de manière singulière à une série de déprédations à forte charge mémorielle, survenues à la Martinique. Depuis le Second Empire s’élevait, au centre de la Place de la Savane à Fort-de-France, la statue de Joséphine, « créole » native de la Martinique, projection locale d’une histoire officielle du pouvoir national, alors même que l’Impératrice, en bonne représentante des intérêts de sa caste, avait pu être accusée par certains analystes d’avoir conseillé à son époux de rétablir l’esclavage… Dans les années 70 cette statue fut transférée par la municipalité, qui profita d’un réaménagement paysager de la place, dans une allée latérale, astreinte à une existence plus discrète. Mais, quelques années plus tard, un matin la vit privée de tête, son voile de pierre maculé de peinture rouge… A la même époque, sa maison natale de la Pagerie, fleuron du patrimoine architectural de la Martinique et attraction touristique notable de la commune des Trois-Ilets, fut détruite par une explosion. Signe du surgissement d’une mémoire lourde de ressentiment, de la fin définitive de l’amnésie en son temps dénoncée par les écrivains ? Illustration en tout cas de la manipulation physique du passé à laquelle se livrent les sociétés humaines : l’effacement des traces, la destruction des images, tout comme leur fabrication, témoignent de ce façonnage permanent, en fonction des exigences mémorielles qui sont celles du présent. Et preuve qu’aux Antilles comme ailleurs coexistent aujourd’hui des représentations du passé contradictoires. Peut-être même plus qu’ailleurs, la mémoire de l’oppression voisinant avec le sentiment de nostalgie porté par les pratiques d’un nouveau régime d’historicité propre aux sociétés avancées (patrimonialisation, mises en scène du passé à destination des touristes…). Comment rendre compte de la douleur du passé, ce sang de l’histoire qui souille à la Martinique la statue de Joséphine ?

Bibliographie
Bernabé, Jean, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, Eloge de la créolité, Paris, Gallimard, 1989.
Bonniol, Jean-Luc, La couleur comme maléfice. Une illustration créole de la généalogie des « Blancs » et des « Noirs », Paris, Albin Michel, Bibliothèque de synthèse, 1992.
Césaire, Aimé, Cahier d’un retour au pays natal, Paris, Présence africaine, 1939/1983.
Césaire, Aimé, Moi laminaire, Paris, Editions du Seuil, 1981.
Chivallon, Christine, « Mémoires antillaises de l’esclavage », Ethnologie française, 32, 2002 : 601-612.
Cottias, Myriam, « Société sans mémoire, société sans histoire : le patrimoine désincarné », Encyclopedia Universalis, 1992 : 263-265.
Gilroy, Paul, The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness, Londres, Verso, 1993.
Glissant, Edouard, Le discours antillais, Paris, Editions du Seuil, 1981.
Glissant, Edouard, Poétique de la Relation, Paris, Editions du Seuil, 1990.
Jolivet, Marie-José, “La construction d’une mémoire historique à la Martinique : du schoelchérisme au marronisme, Cahier d’études africaines, 107-108, XVII, 3-4 : 287-309.
Mulot, Stéphanie, « La trace des Masques. Identité guadeloupéenne entre pratiques et discours », Ethnologie française, 33, 1, 2003: 111-122.
Patterson, Orlando, « Recent Studies on Caribbean Slavery and the Atlantic Slave Trade”, Latin American Research Review, 17, 1982 : 251-275, cité et traduit par R. Price, op. cit.
Price, Richard, Le bagnard et le colonel, Paris, PUF, 2000.
Ricoeur, Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Editions du Seuil, 2000.
Trouillot, Michel-Rolph, Silencing the Past. Power and the Production of History, Boston, Beacon Press, 1995.
Walcott, Derek, « History » in E.K. Braithwaite & Derek Walcott, Panel Discussion, The Common Wealth of Letters Newsletters, Yale University, 1 (1), 1989 : 3-14.
Walcott, Derek, « The Muse of History », in Is Massa Day Dead, Orde Coombs (réd), New-York, Anchor, 1974 : 1-27.
Walcott, Derek, « The Sea is History », Collected Poems, 1948-1984, New-York, Farzar, Straus & Giroux, 1979/1986 : 364-367.
[1] Où sont vos monuments, vos batailles, vos martyrs ? /Où est votre mémoire tribale ? Messieurs/Dans ce coffre gris. La mer, la mer/ Les a fermés à clef. La mer est l’histoire, D. Walcott, « The Sea is History », Collected Poems, 1948-1984, New-York, Farzar, Straus & Giroux, 1979/1986, cité et traduit par Richard Price, Le bagnard et le colonel, Paris, PUF, 2000.
[2] Edouard Glissant, Le discours antillais, Paris, Editions du Seuil, 1981.
[3] Paul Gilroy, The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness, Londres, Verso, 1993.
[4] Richard Price, op. cit.
[6] J. Lucrèce (directeur d’école), Histoire de la Martinique. Cours supérieur et complémentaire des écoles primaires, Paris, PUF, 1932, cité dans Richard Price, op. cit.
[7] Christine Chivallon, « Mémoires antillaises de l’esclavage », Ethnologie française, 32, 2002 : 601-612.
[8] Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Paris, Présence africaine, 1939/1983.
[9] Aimé Césaire, Moi laminaire, Paris, Editions du Seuil, 1981.
[10] E. Glissant, op. cit.
[11] Derek Walcott, « The Muse of History », in Is Massa Day Dead, Orde Coombs (réd), New-York, Anchor, 1974 : 1-27, cité et traduit par R. Price, op. cit.
[12] Orlando Patterson, « Recent Studies on Caribbean Slavery and the Atlantic Slave Trade”, Latin American Research Review, 17, 1982 : 251-275, cité et traduit par R. Price, op. cit.
[13] Jean Bernabé, P. Chamoiseau et R. Confiant, Eloge de la créolité, Paris, Gallimard, 1989.
[14] Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, op. cit.
[15] Communication au colloque de la Carifesta, Kingston, Jamaïque, 1976.
[16] Derek Walcott, « History » in E.K. Braithwaite & Derek Walcott, Panel Discussion, The Common Wealth of Letters Newsletters, Yale University, 1 (1), 1989 : 3-14, cité et traduit par R. Price, op. cit.
[17] Edouard Glissant, La Lézarde, 1958 ; Le Quatrième siècle, 1965, Malemort, 1975, La Case du Commandeur, tous parus aux Editions du Seuil.
[18] Patrick Chamoiseau, Texaco, Paris, Gallimard, 1992. Le chapitre sur la conquête des mornes est intitulé, dans la langue métissée de créole de Chamoiseau, le « noutèka des mornes », signifiant par là un « nous collectif » et une action au passé…
[20] E. Glissant, op. cit.
[21] Sur ce point, on pourra se reporter à Jean-Luc Bonniol, La couleur comme maléfice. Une illustration créole de la généalogie des « Blancs » et des « Noirs », Paris, Albin Michel, Bibliothèque de synthèse, 1992.
[22] Edouard Glissant, op. cit.
[23] Oeuvre de J. Berry, l’un des auteurs-réalisateurs figurant sur la liste noire d’Hollywood… Une nouvelle adaptation, française, a été réalisée en 2002. Un documentaire-fiction sur la traite, du réalisateur martiniquais Guy Deslauriers, intitulé Le passage du milieu, est également sorti en 2001.
[24] Film inspiré du récit de Barbara Chase-Riboud, Le Nègre de l’Amistad, Paris, Albin Michel, 1989. Une histoire identique est relatée par Françoise Thésée dans son ouvrage Les Ibos de l’Amélie, Paris, Editions caribéennes, 1986.
[25] Première parution dans Présence africaine, n° 23, décembre 1958-janvier 1959 ; Ferrements, Editions du Seuil, 1960.
[26] A Paris, la plaque de la rue Richepance a été décrochée en 2002, pour le bicentenaire des événements de 1802, et remplacée par une nouvelle, qui porte le nom du Chevalier de Saint-Georges, compositeur du XVIIIe siècle - et duelliste célèbre - originaire de la Guadeloupe. Mais la rue Delgrès n’est pas encore à l’ordre du jour…
[27] A. Lacour, Histoire de la Guadeloupe, 1858.
[28] André Schwarz-Bart, La Mulâtresse Solitude, Editions du Seuil, 1972.
|

