[299]
Gérard Bouchard
Sociologue - historien, Université du Québec à Chicoutimi
“L'événement, l'individu, le récit :
une nouvelle frontière pour l'histoire sociale ?”.
Un texte publié dans l’ouvrage sous la direction de Simon Langlois et Yves Martin, L’horizon de la culture. Hommage à Fernand Dumont, pp. 299-319. Quatrième partie : La culture comme mémoire. Québec : Les Presses de l’Université Laval, 1995, 556 pp.
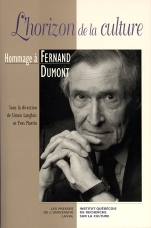
- Introduction
-
- Il y a un demi-siècle : l'histoire sociale. En quoi ? Pourquoi ?
-
- L'héritage de l'histoire sociale
-
- Un programme inachevé
Des questions ouvertes, des obstacles, des défis en attente
- Des chemins pour l'avenir ?
-
- Quatre figures de la nouvelle histoire
Une nouvelle histoire sociale
- La nouvelle histoire sociale comme anthropologie historique
Introduction

Ce texte propose une réflexion sur l'évolution et l'état de l'histoire sociale, telle qu'elle s'est constituée et déployée en France depuis maintenant un demi-siècle environ [1]. Un autre repère encadre cet exercice. L'histoire sociale a en effet été pratiquée au Québec depuis une trentaine d'années grâce aux initiatives de pionniers de la première heure comme Fernand Ouellet, Jean Hamelin, Alfred Dubuc et quelques autres [2]. Avec quelques décennies de recul, il a paru utile de faire le point sur un paysage scientifique qui n'a cessé de bouger malgré la continuité des efforts entrepris à partir des idées fondatrices.
Fort de cette mise en perspective qui dégage des figures à la fois plus nettes et différenciées, nous rappellerons d'abord ce que l'histoire sociale a voulu être à ses débuts et ce qu'elle a été effectivement. Nous essaierons de souligner ensuite ce qu'elle n'a pas été (en dépit de ses ambitions) et de montrer là où, selon nous, elle a échoué. Nous nous interrogerons enfin sur sa situation présente et les nouvelles directions qui se proposent à elle. Essentiellement, ce texte voudrait mettre en forme l'idée que a) l'histoire sociale triomphante a elle-même construit sa mémoire en [300] forme d'unité, de continuité et de cohérence sur un fond d'hétérogénéité, sinon d'éclatement, b) la fragmentation dont elle souffrirait présentement, imputée à sa maturité sinon à son déclin, était en réalité présente dès sa naissance, c) recentrée sur ses prémisses, et tout en étant fidèle à ses acquis, elle est présentement confrontée au défi d'intégrer dans sa pratique méthodologique et analytique des composantes essentielles de la plus vieille tradition historiographique auxquelles elle a paru un moment tourner le dos, à savoir l'individu, l'événement, le récit [3].
L'occasion offerte par ce collectif, préparé en hommage au sociologue Fernand Dumont, ne pouvait mieux convenir à ce genre de réflexion. Nul ne s'est montré en effet plus sensible à la place du sujet – ou des acteurs –dans les modes d'interprétation de l'objet social, à la dimension diachronique dans lequel il baigne, au statut ambigu des constructions scientifiques érigées en culture savante, sorte de substituts de l'autre culture, celle qui lui est préalable et fournit les premiers matériaux du savoir et de l'identité. On sait l'importance que ce dernier clivage a pris dans l'élaboration de la pensée scientifique de Fernand Dumont, faisant écho à une expérience personnelle sur laquelle il s'est ouvert à quelques reprises : comme si l'intensité de la vie intellectuelle et la géométrie un peu froide de son architecture conceptuelle avaient été vécues comme une rupture – sinon comme une sorte de trahison ? – par rapport à la sociabilité chaude de la vie ouvrière à Montmorency [4]. Ce thème, précisément, est au coeur des ambiguïtés qui pèsent actuellement sur l'histoire sociale, sollicitée par l'individuel et le collectif, l'événement et la structure, la durée (c'est-à-dire l'imprévisible) et la nécessité [5].
IL Y A UN DEMI-SIÈCLE :
L'HISTOIRE SOCIALE. EN QUOI ?
POURQUOI ?

L'essor spectaculaire et la très grande popularité de l'histoire sociale en ont peut-être fait un objet faussement familier et, avec le temps, des représentations diversifiées, un peu réductrices aussi, ont pu s'accréditer [6]. C'est que la pratique scientifique a très inégalement reproduit les idées maîtresses des pionniers et que ces idées elles-mêmes sont aujourd'hui perçues comme ayant constitué un programme bien intégré, ce qui n'est pas le cas. Il est donc utile de rappeler d'abord brièvement ce que l'histoire sociale a voulu être, à ses débuts. En schématisant, on pourrait ramener aux énoncés suivants les orientations et propositions qui ont été mises de l'avant par ceux qu'on reconnaît aujourd'hui comme les principaux pionniers de l'histoire sociale – à savoir Lucien Febvre et Marc Bloch, bien sûr, mais aussi Ernest Labrousse (bien que par des voies différentes) et Fernand Braudel, qui a fait le lien entre la première et la deuxième génération. Notons-le tout de suite, cette mémoire historienne a pris certaines libertés avec d'autres acteurs importants comme Henri Pirenne, Henri Hauser, Henri Berr, Paul Lacombe, Georges Lefebvre, Jean Meuvret et quelques autres. Elle a aussi, et avec raison, élevé des monuments à d'autres pionniers justement célébrés, certes, mais qui ont cependant construit [301] leur chemin en parallèle, sinon en marge de l'histoire sociale ; c'est le cas notamment de Philippe Ariès [7].
- — L'histoire sociale fut d'abord associée à un souci d'étendre l'observation à l'ensemble des acteurs, au lieu de la restreindre aux plus célèbres d'entre eux, d'où une attention aux groupes, aux métiers, aux conditions de vie, aux inégalités, aux comportements différenciés, aux classes et rapports sociaux, aux actions collectives. Il s'y rattachait une sorte de refus des « abstractions toutes faites », une volonté de rapporter les réalités ou phénomènes historiques à leurs coordonnées concrètes, leur environnement, leur substrat social : pas la finance, disait-on, mais les financiers ; non l'enrichissement mais les propriétaires ; non pas la guerre mais les militaires, les soldats. De même, les mouvements du revenu et de la production devaient montrer comment ils se répartissaient entre les groupes ; l'évolution de la technologie agricole devait faire voir comment elle modifiait la condition du paysan ; l'analyse des formes esthétiques ou littéraires devait livrer la vision du monde, les projections, les angoisses, la psychologie d'une classe ou d'un groupe social.
- — Au-delà des acteurs, le social, c'était aussi le collectif, avec ses articulations parfois invisibles mais omniprésentes. Derrière l'événement, il y avait une structure ; à l'origine ou à l'appui de telle idéologie ou vision du monde, il y avait des positions de classes, des stratégies de pouvoir politique ou économique ; sous telle mode vestimentaire ou architecturale, dans tel rituel festif ou funéraire, il y avait un sens, une représentation, un modèle. Il n'existait plus guère de faits autonomes ou innocents ; on pouvait certes travailler sur le minuscule, le singulier, mais à condition de l'inscrire dans ses références collectives, en dégager les articulations. Dès lors, on ne se surprend pas de l'ouverture enthousiaste faite aux sciences sociales, en particulier à Simiand et à Durkheim. L'intérêt pour Saussure et la linguistique, pour Vidal de la Blache et la nouvelle géographie humaine, pour Henri Bergson et la philosophie, tenait d'un glissement analogue. Dans cette direction, la nouvelle science historique s'ouvrait à un postulat de la sociologie durkheimienne en vertu duquel les faits sociaux sont reliés les uns aux autres dans des rapports d'interaction à déchiffrer (idée qui, un peu paradoxalement, était déjà présente chez Charles Seignobos, l'un des plus célèbres représentants de l'« ancienne » histoire).
- — Histoire sociale/histoire globale, disait-on comme en corollaire, ou encore : histoire totale, science de synthèse, qui va du particulier au général. La difficulté de l'entreprise est vite apparue : comment rendre compte de l'objet historique en sa totalité, qu'il s'agisse d'une collectivité, d'une période, d'une institution (par exemple la Renaissance, la Révolution française, l'essor du capitalisme, la christianisation) ? D'où l'euphémisme qui annonçait une position de repli : l'histoire devait être tout au moins totalisante, s'efforcer de situer son objet dans ses référents collectifs [8].
- — Ouverte aux acteurs sociaux, au collectif, aux perspectives globales, l'histoire devait toutefois éviter la réduction aux structures et relever en même temps le défi de l'individuel, de la spontanéité, de liberté dans l'action et dans le [302] changement. Rien ne paraissait aussi contraire à l'esprit de la nouvelle histoire que le mimétisme des sciences naturelles, fortifiées par les découvertes spectaculaires de la physique et de la chimie. On s'en souviendra, parmi les têtes de Turc préférées de Lucien Febvre se trouvaient justement ces géographes de la fin du XIXe siècle qui se plaisaient à découvrir des lois. À cette même préoccupation se rattachait l'attention portée à la sensibilité, aux sentiments et aux émotions, ces matériaux d'une future histoire des psychologies collectives et des mentalités, dont Alphonse Dupront puis Robert Mandrou allaient ouvrir la voie. Science du collectif, l'histoire était aussi la science des possibles.
- — En même temps, on rappelait avec force que l'histoire était la science du changement (« étude des hommes dans le temps »). Non pas seulement la répétition des événements qui sont la source des « leçons de l'histoire », mais aussi, mais surtout l'étude du changement qui survient au croisement de l'individuel et du collectif, et d'un changement non programmé, inscrit dans la durée, dans la dispersion et la succession créatrice des événements, dans les conjonctures de l'économique et du social, dans les structures et les mouvements longs des cadres spatiaux, des représentations, des catégories mentales. Ici, un autre postulat affleurait : celui de la continuité de l'histoire qui a horreur des sauts dans le vide, qui ne se réinvente pas subitement mais se transforme dans son élan, dans son inertie, à des rythmes variables selon ses couches, ses « durées ». Toujours identique mais mouvante, en train de devenir autre.
- — La même règle invitait aux analyses différentielles, au respect de la diversité, du détail, de la richesse foisonnante de la réalité historique. Ici, c'est l'historien-ethnographe qui prenait le pas pour inventorier, trier, ordonner, mettre en perspective, rapprocher et distinguer.
- Mais le respect du réel n'allait pas jusqu'à postuler qu'il s'imposait de lui-même à la connaissance du savant attentif et passif. On ne croyait pas non plus que le fait historique était inscrit dans la réalité du temps comme le fossile dans le roc, ou « comme la statue d'Hercule dans les veines du marbre » (Leibniz, Essai sur l'entendement humain). L'histoire-problème était née, se substituant à l'histoire positiviste : désormais, on tenait que le savant construit et déconstruit son objet au gré des interrogations, des débats, des préoccupations du temps présent.
- — La complexité des matières à traiter et de leurs prolongements dans la géographie, la démographie, l'économie, la psychologie, etc., exigerait désormais un travail d'équipe, à caractère interdisciplinaire.
- — On réalisait pleinement aussi – mais Lucien Febvre plus que d'autres peut-être – la nécessité de l'enquête comparative qui, seule, permettrait de mettre en relief les caractères distinctifs et toutes les facettes de l'objet à l'étude. En fait, l'exigence de la comparaison découlait directement de l'esprit de l'histoire totalisante. On doit comprendre en outre qu'après deux guerres qui avaient chambardé l'Europe et le monde, cet appel à l'ouverture procédait aussi d'un esprit de prudence et de rapprochement.
[303]
- — L'histoire se voulait également novatrice sur le plan des sources ; il fallait aller au-delà du texte et de l'archivistique traditionnelle [9] et tirer un parti original de tous les témoins du passé : les parlers, les formes architecturales, les paysages, les cartes, les objets. On invitait aussi à compter, à quantifier et, à cette fin, construire des séries qui prendraient place dans la pluralité des données et des éclairages. Finalement, c'est toute une méthodologie qui allait devoir être élaborée.
En rapport avec ce « programme », deux questions se posent. D'abord, on peut s'interroger sur les causes de ces réorientations en profondeur. À cet égard, il faut évidemment faire valoir les bouleversements et les catastrophes qui avaient secoué l'Europe depuis le tournant du siècle. On soupçonne facilement que les transformations économiques et sociales associées à l'essor de l'industrie et de la ville avaient mis en relief les phénomènes de masse, les réalités collectives, les mouvements sociaux. Sur un autre plan, on ne peut guère s'étonner de ce que les horreurs des deux guerres mondiales aient créé le sentiment que les élites ne maîtrisaient pas le destin des sociétés, qu'il fallait réviser bon nombre de prémisses, de définitions, de normes, à commencer par celles qui commandaient la connaissance de la réalité humaine. Il y avait donc un travail à faire non seulement dans la politique mais aussi dans la culture, et en particulier dans la science dont l'objet est précisément de comprendre l'évolution des sociétés. De tout cela, on peut faire découler la plupart des éléments énoncés plus haut : l'attention portée au social et aux structures, c'est-à-dire aux forces impersonnelles, anonymes ; le rejet des dogmatismes, de l'assurance tranquille de l'esprit positiviste ; la perte de confiance dans les grandes institutions ; le besoin de renouveler les fondements du savoir, les grilles d'analyse, et de reconstituer l'esprit de synthèse garant d'une connaissance intégrale.
Qu'est-ce qui unifiait tous ces points du « programme » de l'histoire sociale ? Il faut d'abord souligner que le vocable lui-même était réducteur. Le nouveau courant recouvrait bien plus que l'investissement du social. On pourrait dire qu'il s'est alimenté à deux sources essentiellement : d'importants changements qui ont attiré l'attention sur les structures ; et des désordres sociaux, des échecs institutionnels qui ont jeté une génération d'intellectuels dans le désarroi, dans le doute, et l'ont poussée à la recherche d'une autre vérité et plus précisément d'une autre connaissance, d'un autre équilibre entre la science et le réel. D'ailleurs, s'agit-il véritablement d'un courant ? ou, bien davantage, d'une simultanéité de glissements, d'adaptations, de choix et d'orientations diversifiées que la seconde génération et celle qui l'a suivie ont réunis sous une commune étiquette [10] ? N'est-il pas remarquable du reste qu'on parle tantôt de l'histoire sociale et tantôt de la nouvelle histoire ? Et comment s'en surprendre dès lors que ses oeuvres fondatrices vont des Rois thaumaturges de Marc Bloch à la Méditerranée de Fernand Braudel et au Beauvaisis de Pierre Goubert [11] ?
[304]
L'HÉRITAGE DE L'HISTOIRE SOCIALE

Il y a plus. On a souligné avec raison les grandes réalisations de la science historique française au cours des dernières décennies, dans la foulée des initiatives et des projets lancés en particulier par Lucien Febvre, Marc Bloch et Ernest Labrousse. Mais les travaux les plus représentatifs, ceux qui ont mis en place les méthodes, les modèles et le style de ce qui est devenu avec les années l'École des Annales, sont presque tous parus avant 1970. En fait, il s'est heureusement trouvé une seconde génération, très talentueuse, qui a su faire fructifier l'héritage et l'a fait connaître à travers le monde. Ici, les noms les plus importants sont F. Braudel, R. Mandrou, G. Duby, P. Goubert, P. de Saint-Jacob, P. Chaunu, J. Le Goff, E. Le Roy Ladurie, P. Vilar, A. Soboul, P. Ariès, F. Furet, J. Dupâquier, A. Daumard, R. Mousnier et d'autres. Du point de vue de l'histoire sociale, il faut signaler tout particulièrement les brillantes monographies d'histoire régionale parues surtout durant la décennie 1960 et dont le Beauvais et le Beauvaisis de P. Goubert demeure peut-être la plus belle réussite. Par ailleurs, la plupart des voies ouvertes par les fondateurs ont été explorées, ce qui a donné lieu à d'importants travaux, novateurs et justement célébrés, dans de nombreuses directions : histoire quantitative et sérielle, histoire de la population, histoire culturelle, histoire ethnologique, histoire environnementale, etc. En cours de route, de vieux clichés ont été mis en pièce, de nouvelles questions ont été posées et de véritables découvertes ont été effectuées : sur les rapports entre l'industrialisation et les structures sociales, notamment familiales ; sur les comportements démographiques, en particulier le rythme des naissances, les niveaux de fécondité, la mobilité géographique ; sur les structures de la parenté et la diversité des modes de reproduction familiale ; sur certaines modalités du changement culturel, qu'il s'agisse de l'alphabétisation ou de l'imaginaire social. L'histoire-problème a beaucoup été pratiquée aussi, tout comme la recherche collective et pluridisciplinaire ou la mise en oeuvre de nouvelles sources et méthodologies. Tout cela a été justement souligné à plusieurs reprises. À ce point-ci, il peut être utile d'explorer l'autre versant du dossier pour faire voir cette fois des lacunes, des abandons, des déviations, des difficultés non surmontées, voire des échecs, et suggérer quelques directions utiles peut-être.
- Un programme inachevé

Il est remarquable, par exemple, que sur divers points, la pratique scientifique des années 1970 et 1980 s'est beaucoup éloignée, mine de rien, des directions fondatrices. À commencer par l'histoire sociale au sens le plus strict qui, après 1970, n'a plus manifesté le même intérêt pour la problématique des inégalités, des classes et des rapports sociaux. En outre, sauf chez Michelle Perrot, Rolande Trempé et quelques autres, l'histoire ouvrière et des mouvements sociaux a été assez négligée [12], tout comme, en général, la recherche sur la période contemporaine (XIXe-XXe siècles). À cet égard, il faut toutefois faire exception pour l'historiographie [305] marxiste, avec laquelle l'École des Annales n'a pas toujours entretenu des rapports très harmonieux [13] (évitant en fait de se l'incorporer), mais qui a néanmoins maintenu son cap durant la décennie 1970, tout comme il convient de souligner l'initiative récente de J. Dupâquier [14] et de ses collaborateurs dans le champ de la mobilité sociale. Dans l'ensemble, et surtout si on pense à l'essor qu'elle a connu dans le monde anglophone, on peut dire que l'histoire urbaine est restée un peu en retrait également, et ce malgré quelques brillantes synthèses qui peuvent encore servir de modèles (M. Garden sur Lyon, J.-C. Perrot sur Caen, P. Deyon sur Amiens, J.-P. Bardet sur Rouen...).
Sur un autre plan, la réflexion théorique sur les pratiques interdisciplinaires – à la manière de F. Braudel [15], par exemple – n'a finalement pas beaucoup avancé, même si concrètement la recherche a donné lieu à de fréquentes interactions entre diverses disciplines [16]. La modélisation reliée à l'étude du changement social n'a pas beaucoup progressé non plus, dans un contexte de vacuum créé par le déclin récent du marxisme. Si l'on excepte quelques entreprises comme celle du collectif d'histoire rurale comparée entre la France et le Québec (a-t-elle du reste son équivalent ?), l'histoire comparative est un autre champ de l'histoire sociale qui est resté à peu près en friche [17]. Quant à l'histoire totale, telle qu'elle a pris forme dans des monographies de régions ou de paroisses, elle n'a cessé de perdre du terrain, si bien que les grandes synthèses qui auraient pu résulter de cet effort n'ont pas vraiment vu le jour. Il s'est produit la même chose au Québec après la parution des ouvrages repères de F. Ouellet et de L. Dechêne [18]. Enfin, la longue durée, elle non plus, n'a pas beaucoup fait recette, sauf peut-être chez certains médiévistes. Les entreprises d'envergure sur le modèle d'A. Chastel et de P. Ariès [19] demeurent rares.
Dans la même veine, mais sur le plan méthodologique cette fois, on doit souligner la lenteur avec laquelle l'histoire sociale s'est donné les outils, les moyens techniques de ses ambitions. La volonté d'étudier les comportements collectifs dans une perspective diachronique suppose la capacité de prendre en compte des effectifs importants d'individus, de familles ou de ménages, de croiser les informations les concernant, de faire ressortir les itinéraires, les interactions, les corrélations. Tout cela fait appel à des procédés de collecte, de conservation et de traitement de données prenant la forme de véritables infrastructures de recherche, en sorte qu'une fois telle enquête complétée, la base empirique reste disponible pour d'autres utilisations et s'enrichit avec le temps. Un exemple – parmi plusieurs autres possibles – de ces infrastructures consiste dans les fichiers de population ; mais la science historique française n'y est venue que tardivement, et encore, avec le secours, sinon l'impulsion d'autres disciplines (le fichier TRA de l'équipe Dupâquier, le fichier de la Valserine de l'équipe Bideau à Lyon). Le fait est d'autant plus remarquable que, chez les historiens, Pierre Goubert avait indiqué cette voie dès 1960, en ouvrant la reconstitution des familles à des données d'histoire sociale. Un autre exemple est fourni par les tentatives, demeurées sans suite, pour doter la communauté scientifique de grilles de classement socioprofessionnel et d'échelles [306] socio-économiques. Encore là, le problème avait été très clairement posé dès le début des années 1960 et des initiatives très prometteuses étaient en cours, notamment sous la responsabilité d'Ernest Labrousse et d'Adeline Daumard [20].
Par-dessus tout peut-être, ces remarques font voir toute la difficulté de l'histoire sociale comme genre scientifique, à cause de l'ampleur de ses ambitions. On réalise mieux aujourd'hui sans doute à quel point les objectifs et orientations qu'elle s'est donnés au départ sont exigeants sur les plans à la fois de la réflexion théorique, de la méthodologie et des techniques d'élaboration des données.
- Des questions ouvertes,
des obstacles, des défis en attente

Plus remarquable encore, le fait de travaux devenus justement des classiques du (second) XXe siècle et accueillis comme des fruits de l'héritage, alors même qu'ils rompaient avec certaines de ses orientations les plus fondamentales. C'est le cas, par exemple, des Paysans du Languedoc d'E. Le Roy Ladurie et de L'homme devant la mort de Philippe Ariès [21]. On se souviendra que le premier, voulant rendre compte de l'évolution multiséculaire des structures de la paysannerie languedocienne, enfermait le gros de l'explication dans le jeu malthusien des rapports entre, d'un côté, l'écoumène et ses capacités de production (exprimées dans la fluctuation des prix) et de l'autre, le nombre des habitants. L'auteur, on le sait, y ajoutait la conviction que la nouvelle histoire ne pourrait se prétendre scientifique que si elle était quantitative [22]. Qui pourrait affirmer que Lucien Febvre ou Marc Bloch se serait reconnu dans ce programme ?
Quant au grand ouvrage de P. Ariès, il pose d'une manière très vive la question des articulations entre le social – au sens large – et le culturel. En effet, observant une évolution dans les représentations (et les pratiques) de la mort dans la longue durée, Ariès n'éprouvait pas vraiment le besoin de l'insérer d'une manière ou d'une autre dans la trame générale du social. Il professait même que ces essais de mise en relation entre des attitudes et des structures sociales, économiques ou politiques étaient un peu « puérils [23] ». Dans le champ de l'histoire des mentalités et de la psychologie collective, il suffit de comparer cette démarche avec celles de Marc Bloch ou de Robert Mandrou, par exemple, pour mesurer l'écart qui s'est creusé. Évitons tout malentendu : ce commentaire ne se veut pas une critique de l'histoire culturelle ainsi délestée du social ; celle-ci correspond à un choix théorique parfaitement défendable qui s'est avéré du reste fécond. Il est toutefois utile de souligner cette rupture qui est ordinairement dissimulée sous le parapluie de la nouvelle histoire ou de l'École des Annales. Le postulat qui fondait l'histoire totale ou l'histoire totalisante est ici clairement remis en question.
Ce ne sont pas là les seuls cas de décrochage. On pourrait dans le même esprit évoquer tout ce courant de l'histoire sociale qui vise à en faire une science « dure », nourrie de quantitatif et largement axée sur la recherche de causalités, de déterminismes. [307] Mais il est vrai que ce parti a été assez peu représenté en France, trouvant ses principaux adeptes aux États-Unis où ils demeurent, là aussi, minoritaires (et doivent du reste assez peu aux Annales elles-mêmes). Ce dernier type de recherche a généralement pour effet de fragmenter l'objet social dans le but de détecter des interactions à micro-échelle. Mais il s'avère ensuite très difficile de faire le chemin inverse : rassembler toutes les parties pour reconstituer la vie des ensembles ; d'où un émiettement du champ de l'histoire en de multiples spécialisations.
En ce qui concerne maintenant la recherche elle-même et les interrogations qu'elle a poursuivies, il peut être utile de signaler un certain nombre de questions qui ont sollicité l'attention et où l'on ne voit toujours pas très clair. Par exemple :
- - Les causes, les modalités et le calendrier de la transition démographique, en particulier du déclin de la fécondité et des origines de la contraception.
- - La mesure, l'interprétation et les conséquences de la mobilité géographique, tantôt source d'instabilité culturelle et sociale, tantôt instrument de reproduction et de continuité familiale.
- - La « transition » du féodalisme au capitalisme, le poids et la signification des « survivances », les modes d'articulation au marché, les causes, les formes et les étapes de l'industrialisation.
- - La permanence de la petite exploitation paysanne et du groupe familial.
- - L'origine et la surprenante stabilité des très anciens modes de reproduction familiale en milieu paysan.
- - La mesure, la signification et les facteurs de la mobilité sociale.
- - La nature, le poids, l'évolution de la structure de classes.
- - Les causes et les retombées de la Révolution française.
- - La naissance et la diffusion de l'individualisme.
- - La fin des bûchers de sorcellerie et l'essor des Lumières.
- - Le poids des facteurs culturels dans le changement social ; le problème des articulations culture/société.
- - Le paradoxe de l'État-Nation, berceau à la fois des droits universels et des nationalismes ethniques, de la rationalité moderne et de nouvelles pratiques identitaires.
Cette énumération ne prétend pas à l'exhaustivité et chacun pourra l'allonger dans une direction ou une autre [24]. Elle vise encore moins à discréditer ou à condamner l'histoire ou la nouvelle histoire comme discipline scientifique ; il n'y a certes rien d'anormal à ce que des questions demeurent ouvertes et que des sujets soient sans cesse sollicités sous des angles divers, à partir d'inquiétudes nouvelles. Ce rappel peut servir toutefois à mettre en perspective les « progrès » de l'histoire sociale.
[308]
Plus profondément encore, ces lacunes, ces dossiers en attente trahissent parfois d'importantes difficultés épistémologiques. Par exemple, les rapprochements entre histoire et ethnologie sur le terrain des structures de la parenté font entrevoir un véritable hiatus qui n'est pas sans rappeler la fameuse relation d'incertitude de la physique nucléaire. Pour détecter des règles de l'alliance dans des sociétés dites complexes, on peut choisir de travailler sur de toutes petites communautés, à l'aide de données qualitatives. Si l'on arrive de cette façon à identifier des « régularités » dans les pratiques matrimoniales, elles demeurent suspectes d'être le fruit du hasard tant qu'elles n'ont pas subi l'épreuve de la statistique. Mais pour les plier à ce genre de traitement, il faut travailler à une plus grande échelle et grossir les effectifs, ce qui risque justement de dissoudre le phénomène et enlève à coup sûr les moyens de le resituer dans le contexte particulier où il s'est manifesté, avec toutes ses coordonnées très fines de temps, de lieu, de sens.
Autre exemple de difficulté : le social n'est plus guère considéré aujourd'hui comme un champ unifié offert à la rationalité du savant et susceptible de théories générales [25] ; il est au contraire traversé de clivages, éclaté en paliers irréductibles, et on ne sait plus guère en désigner sûrement ni les acteurs ni les mouvements. Le concept de société globale connaît un peu le même sort ; on ne se risque plus aujourd'hui à en désigner précisément les contours et il paraîtrait gratuit de lui assigner d'emblée, comme on le faisait souvent naguère, les frontières de la nation. Il en est ainsi du concept d'intégration collective, sur lequel plus personne n'oserait miser. À un bout, le social s'est fragmenté, replié sur les sociabilités proches et les individus ; en même temps, à l'autre extrémité, il s'est fondu dans de très grands ensembles dont la théorie reste à faire.
Une troisième difficulté est illustrée par l'enquête comparative, lorsqu'elle porte sur une variable en particulier (comme : l'évolution de l'alphabétisation, les modes de reproduction familiale, les rituels du mariage, l'évolution de la pratique religieuse, la fréquence des naissances illégitimes ou des conceptions prénuptiales, le déclin de la fécondité, etc.). Dans la mesure où chacune de ces variables est définie par l'ensemble des relations et des interactions qu'elle entretient avec une dynamique collective inscrite dans une conjoncture singulière, est-il légitime de les en détacher pour les confronter ? de traiter chacune d'elles comme une pièce d'une mosaïque alors qu'elle est définie par un jeu de relations complexes qui s'enracinent et se ramifient dans le social ? La solution serait évidemment de faire entrer entièrement dans la comparaison ces environnements collectifs eux-mêmes. Est-ce possible ?
Des impasses naissent aussi de l'impossibilité apparente d'articuler le social et le culturel [26], le quantitatif et le qualitatif, les comportements et les significations, le changement et la continuité. Sur ce dernier point, l'histoire-problème consacre le constructivisme de la connaissance historique. Elle établit aussi la primauté de l'actuel en fonction duquel se fixent les priorités de la recherche, et aussi ses [309] directions, ses éclairages. Ainsi la discontinuité s'installe, non du côté de l'objet mais du sujet. Tout cela va évidemment dans le sens des thèses de M. Foucault [27]. Mais quelle conclusion pratique faut-il en tirer pour ce qui est du métier de l'historien dont le discours baigne dans la durée et s'en nourrit, et qui se donne comme un spécialiste des enchaînements ?
DES CHEMINS POUR L'AVENIR ?

Jusqu'ici, notre texte a délibérément entretenu une certaine confusion en mettant en équation histoire sociale, nouvelle histoire, École des Annales. Cette confusion est un peu inévitable dans la mesure où elle a été largement entretenue par les acteurs les plus immédiatement concernés. Mais au-delà des étiquettes, quelques glissements peuvent être identifiés assez nettement. Ils nous serviront de point de départ pour une réflexion sur l'avenir immédiat de la pratique historienne.
- Quatre figures de la nouvelle histoire

Le premier phénomène à mettre en relief consiste dans l'ambiguïté qui entoure, aujourd'hui plus que jamais, la notion d'histoire sociale. Celle-ci désigne parfois l'ensemble de la science historique ; on postule alors que l'objet de l'histoire est social par définition et que cet énoncé fait l'unanimité dans la communauté scientifique. Un peu en retrait, le vocable peut désigner également une manière, parmi d'autres, de pratiquer l'histoire générale. Enfin, il renvoie souvent aussi à une spécialité de l'histoire générale, celle qui traite des groupes et des classes, des inégalités et des hiérarchies, des mouvements et des rapports sociaux.
Un deuxième trait consiste dans ce que plusieurs appellent maintenant l'éclatement de l'histoire sociale [28]. Cet éclatement est double : d'abord sur le plan des spécialisations (l'émergence de la démographie historique en est un exemple, mais aussi l'histoire rurale, l'histoire économique, l'histoire des femmes), ensuite sur le plan des méthodes et des terrains de recherche. Il est vrai que ce qu'on pourrait appeler la troisième génération de l'École des Annales (les Roche, Chartier, Vovelle, Castan, Revel, Goy, Farge, Velay-Vallantin et autres) a bien assuré le relais dans des directions très diverses, ce qui a contribué à étendre et à diversifier le « territoire » de l'historien. Mais à tout prendre, cette hétérogénéité existait dès le départ et ne s'est jamais démentie (on le voit en feuilletant les Annales des années 1950 ou en retournant aux ouvrages principaux de la génération des fondateurs). Ce qui ressort plus clairement aujourd'hui, encore une fois, c'est le sentiment du fractionnement de l'objet historique et du caractère irréductible des itinéraires pluridisciplinaires auxquels il donne lieu, ces derniers se structurant autour ou à partir de matrices relativement autonomes comme l'espace, la population, la production, le pouvoir, le symbolique. Ce pluralisme – à bien distinguer du relativisme inhérent à l'histoire-problème, comme à toute démarche constructiviste [310] – fait désormais obstacle à l'ambition première de l'histoire sociale et c'est en ce sens qu'il y a peut-être lieu de parler d'une crise. Le fait n'est pas étranger sans doute au glissement qui s'est opéré dans les termes, l'« histoire sociale » cédant souvent le pas à la « nouvelle histoire » et à l'« anthropologie historique ». N'est-il pas significatif qu'en 1978 déjà, dans un dictionnaire encyclopédique consacré à la nouvelle histoire [29] qui divisait la matière en dix chapitres, aucun ne portait spécifiquement sur l'histoire sociale. Un article lui était toutefois réservé dans lequel R. Chartier et D. Roche constataient que l'histoire sociale des années 1950-1960 avait vécu, ayant laissé la place, entre autres, à l'histoire socioculturelle.
En troisième lieu, il est manifeste qu'un large courant de la nouvelle histoire s'est concentré dans des enquêtes à micro-échelle (la famille, le ménage, la sociabilité, la rue, la foule, le costume, le livre...). Faut-il n'y voir que l'effet naturel de la spécialisation ? ou plutôt une sorte de repli, une prise de distance par rapport à la fois aux grands enjeux du temps et aux ambitions fondatrices ? Certes, il faut se hâter de souligner que cette histoire qu'on pourrait croire myope est loin d'être muette ; elle a produit des ouvrages brillants, magnifiquement construits, pleins d'inventions. Mais il est clair que l'histoire-synthèse n'y trouve pas son compte, sauf à l'échelle du microcosme pris à témoin. Peut-on croire que l'addition, la fédération de ces apports y ramènera ? Rien n'est moins sûr. Il semble plutôt que la micro-histoire découpe ses univers dans des lieux du social ou du culturel qui communiquent mal parce qu'ils sont souvent traités en eux-mêmes comme des totalités – on serait tenté de dire : comme des systèmes relativement clos.
En ce sens, et comme toujours, l'histoire est fille de son temps. Le dernier quart du siècle et la perspective du prochain millénaire ne sont guère porteurs de grands projets sociaux ni de grandes espérances. Les contemporains n'y voient plus très clair et l'histoire non plus. Les grandes tribunes sont donc pour l'instant un peu désertées, faute de programmes. Même le 200e anniversaire de la Révolution française, qui a suscité d'innombrables publications, n'a pas rallumé de véritables débats de fond. D'où peut-être – c'est la quatrième figure – la réflexion qui paraît s'amorcer depuis quelque temps (le collectif dirigé par Christophe Charle [30] en est un exemple) sur la science historique elle-même, ses orientations, ses enjeux, ses responsabilités.
- Une nouvelle histoire sociale

Sur cet arrière-plan de doute, de fractionnement, de renouvellement et de diversité, il est important que l'histoire sociale survive, non plus comme une matrice qui voudrait commander l'ensemble de la science historique mais comme une spécialité parmi d'autres : une spécialité qui reprendrait à son compte les principales idées fondatrices (attention prioritaire aux acteurs sociaux, au collectif, aux structures, aux interactions, au changement), qui se garderait des visées totalitaires du scientisme et qui, sans céder à la séduction du fragment, saurait [311] intégrer à ses analyses l'individu, l'événement et le récit. En réalité, cette nouvelle histoire sociale, fidèle à ses acquis mais aussi à des éléments essentiels de la plus vieille tradition historiographique, est déjà en voie de se constituer. L'analyse de survie [31] qui soumet l'étude des itinéraires biographiques à un traitement statistique intégré de même que les fichiers de population [32] ont ouvert de nouvelles avenues méthodologiques à l'analyse des destins individuels ; en un sens, du reste, les études de prosopographie avaient déjà préparé la voie [33]. L'événement a amorcé son retour lui aussi –Pierre Nora l'annonçait déjà il y a vingt ans [34]. Quant au récit, il ne s'est jamais véritablement éclipsé mais la durée n'a pas toujours constitué la trame principale de l'histoire sociale ; au lieu de raconter une histoire, celle-ci s'est souvent employée à détecter et à explorer des relations et des systèmes.
Il n'y a rien d'incompatible entre les rôles que s'est assignés l'histoire sociale à sa naissance et ces éléments d'ouverture. On pourrait même dire qu'il ne s'y trouve rien de vraiment neuf. L. Febvre n'a-t-il pas lui-même pratiqué la biographie, précisément à la manière de l'histoire sociale [35]. De même, l'ouvrage de Georges Duby sur Bouvines et le Carnaval de Romans de Le Roy Ladurie sont structurés autour d'un événement [36]. Les individus dont il s'agit ici ne sont évidemment pas ceux qui fournissaient leur matière aux biographies traditionnelles ; plutôt, ils incarnent et résument un espace-temps social et culturel, et ils ne concurrencent pas les modèles ou les séries mais ils les animent, les concrétisent, leur donnent un visage et illustrent la diversité des situations et des destins. De même, l'événement n'est pas cet atome qui, combiné à d'autres, va constituer le tissu de l'histoire ; c'est plutôt ce qui révèle et parfois fait basculer la structure, ce qui actualise une croyance, un rapport de force, ou à l'inverse donne forme à une légende, précipite les mouvements de l'imaginaire [37].
Il n'y a pas de raison pour que l'histoire sociale se prive du pouvoir évocateur de l'événement et de l'efficacité du récit pour promouvoir une vérité qui lui est propre, où l'émotion, le sentiment doivent tenir leur place. Quant à la durée, c'est le lit du drame humain et le matériau qui fait de l'histoire une science des possibles oeuvrant dans la narrativité [38]. La nouvelle histoire sociale doit poser son chevalet au carrefour du social et de l'individuel, du général et du singulier, du quantitatif et du qualitatif, de l'analyse et du récit. L'histoire sociale : science des interstices, des brisures, des béances. Et elle n'a pas à fournir au départ les codes de ses raccordements : à chacun de les inventer dans des équilibres et selon des sensibilités qui font de l'histoire une discipline spécifique. Certes, il faut aller le plus loin possible dans la reconnaissance des régularités et des corrélations, des causalités et des déterminismes, des pesanteurs collectives, en s'inspirant de la méthodologie et des modèles des sciences sociales, mais en sachant aussi que l'objet historique ne s'y réduit pas entièrement, que les faits sociaux existent pour et par les acteurs, par la conscience qu'ils en ont, par les réactions et expressions qu'elle détermine – lesquelles sont aussi du reste des faits sociaux [39]. C'est pourquoi l'intuition et la sensibilité seront toujours des qualités essentielles à l'historien.
[312]
Pour opérer cette réorientation, pour réinsérer le singulier et le récit, l'histoire sociale n'a pas à renoncer à ce qu'elle a été. Bien au contraire, il lui faut revenir à ses idées fondatrices et faire valoir ses acquis en les enrichissant. Sur ce point, nous nous éloignons de la position assez radicale de Laurence Stone [40], pour qui l'histoire narrative doit remplacer l'histoire sociale, en quelque sorte condamnée par ses échecs. En réalité, l'histoire sociale est une discipline qui montre mieux qu'elle ne démontre et, finalement, cette conception installe l'historien devant le défi le plus ancien et le plus fondamental qui soit : jeter des ponts entre, d'une part, les raideurs de la connaissance scientifique pratiquée selon le modèle des sciences naturelles et, d'autre part, les spontanéités plus ou moins organisées de la vie collective.
D'une manière un peu analogue, l'histoire sociale doit poursuivre l'étude du changement, des continuités et des ruptures, mais en sachant que le problème posé par les discontinuités de la connaissance elle-même est insurmontable. Le savoir historique se construit sur des fondements provisoires, sur des postulats qui créent un lieu restreint de cohérence à partir duquel il est possible d'élaborer des représentations qui ont un sens pour les hommes et les femmes d'une époque. Au-delà, l'historien n'a pas à résoudre la contradiction ; il lui suffit de la dire. Si l'on doit récuser ce compromis et la position instable qu'il consacre, ne se condamne-t-on pas au mutisme ? Science des interstices, l'histoire sociale est elle-même faite de ruptures, de brisures, comme il sied à un savoir qui n'est jamais achevé, qui se construit toujours en forme de question.
LA NOUVELLE HISTOIRE SOCIALE
COMME ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE

L'histoire est non seulement une science humaine, c'est aussi une science qui prend le parti de l'humanisme, c'est-à-dire d'une conception et d'une promotion de la condition humaine en tant que caractérisée par la conscience et la liberté, en tant que continuellement confrontée aussi au tragique –celui des destins collectifs aussi bien qu'individuels. C'est sur cet arrière-plan que s'édifie le commentaire de l'historien et c'est ce qui l'autorise, parvenu à un certain point de sa démarche, à s'affranchir du chiffre et de la preuve. Toute société comporte a) des éléments d'organisation matérielle axée sur la production, la survie, le fonctionnement, b) des dispositions relatives à la reproduction démographique, familiale, sociale, c) des conventions, des coutumes et des structures présidant à la sociabilité et aux rapports collectifs, d) des valeurs, des représentations, des sentiments qui imprègnent tout ce qui précède, qui lui donnent un sens, un ordre, et qui en procèdent également. Le parcours de l'histoire sociale doit recouvrir toutes ces réalités, dans leurs interactions complexes, jamais prévisibles, et en produire un compte rendu qui prenne la forme d'une histoire « vraie ». C'est de cette manière qu'elle peut devenir une véritable anthropologie.
[313]
On peut craindre que la « science » n'y trouve pas son compte et que la connaissance historique verse ici non seulement dans le relativisme mais dans l'arbitraire. Ce n'est pas le cas. On se rappelle que dans l'univers philosophique d'Aristote et saint Thomas, mais aussi de Descartes et Newton, le réel préexistait au sujet qui était habilité à l'observer, à le mesurer, à l'appréhender. Puis l'idéalisme – kantien en particulier – a fait ressortir la contribution déterminante du sujet, son activité créatrice dans l'élaboration de l'objet. On doit surtout à R. Aron, H.-I. Marrou et P. Ricoeur [41] d'avoir fait sous cet éclairage le procès de l'histoire traditionnelle, dite positiviste [42]. L'opinion dominante tient maintenant que la connaissance scientifique est le résultat d'un arrangement ou d'un compromis en vertu duquel chaque discipline construit sa vérité selon des procédés, des règles, une méthodologie adaptés à son objet. Or, nous l'avons indiqué, l'objet de l'historien présente une géométrie inégale ; dans certaines de ses parties (par exemple, la production économique ou les comportements démographiques), on peut prétendre le traiter quasi expérimentalement. Dans d'autres (les croyances religieuses, les sentiments, les relations personnelles), il relève en grande partie de l'indéterminé, de l'imprévisible. Dans la perspective d'une histoire sociale soucieuse des totalités, il est par conséquent nécessaire de mettre en oeuvre un appareil assez disparate, approprié à la nature composite de l'objet. Ainsi, le déchiffrage des réalités singulières relève également de l'intuition et de la sensibilité, et il ne peut se priver des ressources du récit, du langage, de son pouvoir évocateur. La narration recrée chez le lecteur des images et des émotions qui reproduisent ce réel aussi exactement que possible et mettent en forme sa vérité spécifique.
En ce sens, on peut dire que le problème épistémologique de la relation entre le sujet et l'objet, l'historien le résout un peu à la manière du peintre, par la recherche incessante d'une vérité disciplinée par les règles du genre, par une méthodologie, mais arbitrée par des critères qui relèvent aussi bien de l'esthétique et de l'humanisme que de la scientificité entendue au sens le plus restrictif [43]. On voit par là que la maison de l'histoire sociale est par définition ouverte à la diversité et à l'exploration, et qu'elle s'accommode d'un certain désordre, l'état et les tendances de la recherche reflétant simplement les curiosités, les besoins du temps et l'inventivité des contemporains.
Cela dit, quelques distinctions importantes s'imposent. Ainsi, tous les vecteurs de la connaissance du passé (l'histoire n'en est qu'un parmi d'autres) sont utiles et tous les usages qu'on peut vouloir en faire sont légitimes, dans les limites de la méthodologie propre à chaque genre. En ce qui concerne la science historique, elle a servi jusqu'ici – et sert sans doute encore – à formuler des leçons de morale, à proposer des figures édifiantes, à restaurer certains symboles par la célébration d'événements remarquables. Mais elle tient assurément d'autres rôles, par exemple lorsque le passé sert de laboratoire à ce qui se voudrait une science du changement social. Dans cet ordre d'idées, deux grandes fonctions en particulier doivent retenir l'attention. Selon la première, l'histoire a pour effet de créer une distance entre le [314] passé et le présent, pour les opposer ; selon la deuxième, elle contribue au contraire à les rapprocher en les fondant dans une même filiation.
Dans certaines de ses démarches en effet, l'historien construit dans le passé une représentation de soi en tant qu'autre, en tant que différent. Dans cette perspective, la pertinence des données d'archives est déterminée par leur capacité de dépaysement. Ainsi, relisant des dépositions de témoins dans des procès du XIXe siècle ou parcourant simplement des chroniques de vieux journaux, le chercheur sera sollicité par ce qui sort de son ordinaire, du familier de son temps, par ce qui n'a pas survécu jusqu'à lui. Son attention se portera sur tel trait inusité, l'absence d'une coutume qui semble aller de soi, la célébration d'un culte tombé depuis longtemps dans l'oubli, etc. L'intérêt de se construire et de se projeter ainsi comme étranger, c'est un peu celui que chacun trouve à regarder de vieilles photos de soi ou des siens, ou celui qu'une population éprouve à découvrir ses lointains vestiges archéologiques. Mais cette fascination de l'altérité ambiguë, dans ce rapport avec soi en tant qu'autre, rappelle aussi la démarche de l'ethnologue à l'endroit des sociétés exotiques et elle participe de la même feinte : au fond, c'est soi-même que l'on découvre dans le miroir de l'altérité, mais sous une figure renouvelée et créatrice, selon des reliefs insoupçonnés. À la manière d'un procédé d'objectivation, la reconnaissance des différences provoque une nouvelle prise de conscience de sa propre identité, une mise en perspective et une révision de soi. C'est la fonction de distanciation, où s'enracine aussi la fonction critique de l'historien, selon un autre thème cher à Fernand Dumont.
À l'inverse, l'enquête historique peut aussi se vouer directement à l'établissement de filiations et de raccordements, à la restauration d'une proximité brisée par des changements trop rapides, par une succession de ruptures, de décrochages. Ici, l'historien vise à réaménager la représentation du passé de manière à l'ajuster à la lumière du jour, afin de l'harmoniser avec une nouvelle vision du monde, avec les nouvelles priorités de la culture, ou avec les nouvelles images de soi. Dans cette perspective, de larges avenues de recherche, jusque-là pratiquées intensément, sont régulièrement abandonnées pour d'autres et des interrogations tenues pour fondamentales deviennent bientôt secondaires, presque sans intérêt – ou mieux : sans pertinence. Les enjeux se sont déplacés. Cette fonction de l'histoire amène, on le voit, à trouver des précédents, des ancêtres aux événements et situations actuels pour montrer qu'ils ne sont pas gratuits ou aléatoires, qu'ils s'inscrivent au contraire dans des tendances, dans des évolutions convergentes qui n'avaient pas été perçues et où viennent se dissoudre les ruptures du temps. En semant post facto des empreintes derrière l'actuel, elle ordonne la marche de l'histoire et montre que, finalement, la durée a un sens, une direction. Mai 1968 remet à l'ordre du jour le Front populaire et la Commune de Paris ; la Révolution française fait voir à Michelet la longue marche du peuple français vers la liberté ; l'instabilité de la Troisième République évoque chez Fustel de Coulanges les problèmes et les structures de la Cité antique. Au Québec, la Révolution tranquille suscite un intérêt pour les [315] changements qui l'ont précédée de près ou de loin ; la révolution contraceptive des années 1960 fait rechercher des comportements précurseurs au XIXe siècle ; la laïcisation d'après-guerre fait entrevoir de la libre-pensée dès le XVIIIe siècle ; les luttes présentes pour l'émancipation féminine font découvrir dans le passé des héroïnes, des évolutions annonciatrices, etc. Car il répugne aux contemporains d'être privés de repères, de se sentir en marge de la trame qui jusque-là emportait leur société et encadrait leur devenir : il faut récuser l'événement orphelin, l'inscrire dans une filiation. On se souviendra que c'est le rôle principal que Lucien Febvre assignait à l'histoire : réduire l'angoisse, l'insécurité qui accompagne les déséquilibres, les déplacements produits par le changement, la durée ; dédramatiser le présent. Cette tâche relève non plus de la distanciation mais de son contraire, c'est-à-dire de l'intégration, selon une dimension verticale correspondant à la durée.
En définitive, l'une et l'autre fonctions entretiennent un rapport étroit avec l'identité : dans le premier cas pour la remettre en question, la soumettre à une réflexion, sinon à une critique ; dans le second pour la légitimer, pour la conforter par un recours au passé qui, pour être tout aussi scientifique (car il possède ses procédés d'objectivation), fait de l'historien une sorte de mercenaire de l'actuel. La première fonction, plus que l'autre, semble relever pleinement de ce que nous appelons ici l'anthropologie historique. C'est dans cette direction, croyons-nous, que la pensée humaniste et la sensibilité créatrice de l'historien ont le plus de chances de s'épanouir sur le modèle d'une philosophie appliquée, et c'est à cette fin que devrait tendre surtout la nouvelle histoire sociale.
En résumé, il nous semble que cette discipline devrait poursuivre le même genre d'objectifs que H. Broch [44] assignait à la littérature : se constituer en commentaire original de la condition humaine dans le temps et, de cette manière, contribuer à une connaissance générale qui tire du singulier la plus grande partie de son matériau.
[1] On sait que ses origines sont plus lointaines – d'une ou deux décennies peut-être. Nous nous concentrons ici sur ce qu'on pourrait appeler sa période triomphante.
[2] Parmi lesquels on voudra bien compter, à cause de sa pratique historienne, Stanley Ryerson, même s'il ne s'est jamais réclamé de l'École des Annales.
[3] Il y aurait beaucoup plus à dire, assurément, sur ce sujet et bien des signes annoncent des réorientations majeures peut-être dans la pratique du métier d'historien. C'est ce que paraît suggérer, entre autres, la vigueur toute nouvelle du débat critique sur ses fondements et ses méthodes : voir par exemple : Christophe Charle (sous la direction de), Histoire sociale/Histoire globale ?, Paris, Fondation de la Maison des sciences de l'homme, 1993, 222 p. ; Lynn Hunt et Aletta Biersack (sous la direction de), The New Cultural History, Berkeley, University of California Press, 1989, 244 p. ; Philippe Carrard, Poetics of the New History : French Historical Discourse from Braudel to Chartier, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1992, 255 p. ; Nadia Fahmy-Eid, « Histoire, objectivité et scientificité. Jalons pour une reprise du débat épistémologique », Histoire sociale/Social History, XXIV, 47, p. 9-34 ; un numéro spécial des Annales E.S.C., novembre-décembre 1989, et un autre, cette fois de l'American Historical Review, 96, 3, 1991.
[4] Celle-là même qu'il évoque dans la première page de son récent ouvrage : Fernand Dumont, Genèse de la société québécoise, Montréal, Boréal, 1993, 393 p.
[5] En fait, on pourrait dire que notre texte se situe directement dans le prolongement d'un réflexion amorcée il y a un quart de siècle par Fernand Dumont : « La fonction sociale de l'histoire », Histoire sociale/Social History, 4, novembre-décembre 1969, p. 5-16.
[6] Jean-Paul Bernard a formulé des commentaires éclairants sur ce sujet : « La notion d'histoire sociale : le concept et la bannière », communication à l'Université de Paris-VII, 1989 (texte non publié).
[7] Notre récapitulation s'appuie sur tous ces auteurs, mais en faisant un sort particulier à Lucien Febvre (Le problème de l'incroyance au XVIe siècle : la religion de Rabelais [1942], Paris, Albin Michel, 1962, 547 p. ; Combats pour l'histoire, Paris, Armand Colin, 1965, 458 p.) et à Marc Bloch (Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, Paris, Armand Colin, 6e édition, 1967, 110 p.).
[8] On reconnaît en tout ceci l'influence lointaine – déterminante chez Lucien Febvre – de Michelet : « La science est une : les langues, la littérature et l'histoire, la physique, les mathématiques et la philosophie, les connaissances les plus éloignées en apparence se touchent réellement, ou plutôt elles forment toutes un système » (discours à l'occasion d'une distribution de prix au Lycée Sainte-Barbe, le 17 août 1824).
[9] En l'occurrence symbolisée par la célèbre École des Chartes de la Sorbonne, cible de bien des quolibets.
[10] Alfred Dubuc a insisté avec raison sur la grande diversité des apports à l'origine de ce qui est devenu l'histoire sociale (« L'influence de l'École des Annales au Québec », Revue d'histoire de l'Amérique française, XXXIII, 3, décembre 1979, p. 357-386).
[11] Marc Bloch, Les rois thaumaturges : étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre, Paris, Armand Colin, 1961, 542 p. ; Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, Armand Colin, 1160 p. ; Pierre Goubert, Beauvais et le Beauvaisis : de 1600 à 1760. Contribution à l'histoire sociale de la France du XVIIe siècle, thèse de doctorat, Paris, SEVPEN, 2 volumes, 1960.
[12] Contrairement à ce qui s'est passé, par exemple, en Angleterre, aux États-Unis et au Canada où elle a été l'un des principaux vecteurs de l'histoire sociale.
[13] Pensons aux controverses sur la Révolution française qui ont opposé d'un côté F. Furet et D. Richet, de l'autre A. Soboul et C. Mazauric. La nature de ces rapports, au demeurant assez compliquée, ne laisse pas de surprendre dans la mesure où l'historiographie marxiste aurait dû être comptée dès le début comme étant au coeur même du nouveau courant à cause de l'attention qu'elle portait aux dynamismes fondamentaux, aux structures sociales ; on sait que ce ne fut pas vraiment le cas.
[14] Jacques Dupâquier, Denis Wessler, Didier Blanchet (sous la direction de), La société française au XIXe siècle : tradition, transition, transformations, Paris, Fayard, 1992, 529 p.
[15] Fernand Braudel, Écrits sur l'histoire, Paris, Flammarion, 1969, p. 41-235.
[16] Cette remarque n'ignore évidemment pas les emprunts, nombreux, que la science historique a faits au cours des trente dernières années et dont L'histoire du climat d'E. Le Roy Ladurie constitue un bel exemple. Signalons par ailleurs une initiative assez récente des Annales E.S.C. qui, dans leur livraison de mars-avril 1988 (p. 291-293), lançaient un débat sur les rapports entre l'histoire et les sciences sociales. Le numéro spécial de novembre-décembre 1989 s'inscrivait dans ce même débat.
[17] Rappelons que le collectif d'historiens franco-québécois a commencé ses travaux en 1976 et a donné lieu jusqu'ici à la publication de cinq ouvrages. Le dernier en date : Rolande Bonnain, Gérard Bouchard et Joseph Goy (sous la direction de), Transmettre, hériter, succéder. La reproduction familiale en milieu rural : France-Québec, XVIIIe- XXe siècles, Lyon/Paris/Villeurbanne, Presses universitaires de Lyon/L'École des hautes études en sciences sociales/Programme pluriannuel en sciences humaines Rhônes-Alpes, 1992, 433 p.
[18] Fernand Ouellet, Histoire économique et sociale du Québec, 1760-1850 : structures et conjoncture, Montréal, Fides, 1966, 639 p. ; Louise Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle, Paris, Plon, 1974, 588 p. À signaler toutefois deux très heureuses exceptions, récentes : John Irvine Little, Crofters and Habitants : Settler Society, Economy and Culture in a Québec Township : 1848-1881, Montréal, McGill-Queen's University Press, 1991, 368 p. ; Louis Lavallée, La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760 : étude d'histoire sociale, Montréal, McGill-Queen's University Press, 1992, 301 p. Pour tout ce qui concerne par ailleurs l'essor de l'histoire sociale au Québec et son évolution à partir de la décennie 1950, voir l'utile survol proposé par Alfred Dubuc, loc. cit.
[19] André Chastel, L'art français. Pré-Moyen Âge. Moyen Âge, Paris, Flammarion, 1993, 367 p. ; Philippe Ariès, L'homme devant la mort, Paris, Seuil, 1977, 641 p.
[20] Voir à ce propos l'exposé de Jacques Dupâquier au colloque de Saint-Cloud en 1965 et la discussion qui l'a suivi : « Problèmes de la codification socio-professionnelle », dans : L'histoire sociale. Sources et méthodes, Paris, Presses universitaires de France, 1967, p. 157-167.
[21] Emmanuel Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, Paris, SEVPEN, 2 volumes, 1966, 1035 p. ; Philippe Ariès, op. cit.
[22] « ... il n'est d'histoire scientifique que quantifiable » (Emmanuel Le Roy Ladurie, Le territoire de l'historien, Paris, Gallimard [collection Bibliothèque des Histoires], 1973, p. 22).
[23] Entrevue à l'émission radiophonique « Rencontres », France-Culture, 19 février 1978.
[24] Voir, par exemple : Laurence Stone, « The revival of narrative : reflections on a new old history », Past & Present, 85, novembre 1979, p. 3-24. En référence au contexte québécois, on pourrait citer : la mesure de l'emprise du clergé et de la religion sur la population, la problématique de la crise agricole dans le Bas-Canada, l'impact de la défaite de 1760 et de l'échec de 1837-1838, le dossier du « retard » du Canada français, le poids du régime seigneurial...
[25] Même si l'idée survit : Alain Testart, Essai d'épistémologie, Paris, Christian Bourgeois, 1991, 174 p. Mais en ce cas, il est révélateur que toute tentative de théorie doive désormais comporter la théorie de sa propre production.
[26] À noter que l'ethnologie fait face au même problème (voir : Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books Inc., 1973, chapitre 6). Par ailleurs, nous disons culturel, mais de quoi s'agit-il ? Des construits de l'idéologie, de la science, de l'art ? Des valeurs, des croyances, du sacré ? Des peurs, des appartenances, de l'identité, de tout ce qui relève du psychisme collectif et des mentalités ? De l'outillage mental comme le langage, l'écriture, l'arithmétique ? Des produits de l'imaginaire social comme les contes, les légendes, les rites ? Ou des produits du travail comme le costume, le mobilier, les maisons, les paysages ?...
[27] Voir, par exemple, (Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard [collection Bibliothèque des sciences humaines], 1966, p. 229-230) les commentaires sur « la dérive des positivités », les ouvertures « dans la nappe des continuités », etc.
[28] Par exemple : F. Dosse, L'histoire en miettes. Des « Annales » à la « nouvelle histoire », Paris, La Découverte, 1987, 268 p. ; Daniel Roche, « Les historiens aujourd'hui. Remarques pour un débat », Vingtième siècle. Revue d'histoire, 12, octobre 1986, p. 3-20.
[29] Jacques Le Goff, Roger Chartier et Jacques Revel (sous la direction de), La nouvelle histoire, Paris, CEPL (collection Les encyclopédies du monde moderne), 1978, 574 p.
[30] Christophe Charle (sous la direction de), op. cit.
[31] Par exemple : Daniel Courgeau et Éva Lelièvre, Analyse démographique des biographies, Paris, CEPL, Éditions de l'Institut national d'études démographiques, 1989, 268 p. ; Jean-Claude Passeron, Le raisonnement sociologique. L'espace non poppérien du raisonnement naturel, Paris, 1991, p. 185-206.
[32] Gérard Bouchard, « Les fichiers-réseaux de population. Un retour à l'individualité », Histoire sociale/Social History, XXI, 42, novembre-décembre 1988, p. 287-294.
[33] Laurence Stone, « Prosopography », Daedalus, 100, hiver 1971, p. 46-79.
[34] Pierre Nora, « Le retour de l'événement », dans : Jacques Le Goff et Pierre Nora (sous la direction de), Faire de l'histoire, tome I : Nouveaux problèmes, Paris, Gallimard (collection Bibliothèque des histoires), 1974, p. 210-228. Faut-il rappeler l'initiative, encore plus ancienne et demeurée sans effet, de Maurice Crubellier (« L'événement en histoire sociale », L'histoire sociale. Sources et méthodes, Paris, Presses universitaires de France, 1967, p. 35-43) qui plaidait pour une insertion de l'événement dans le programme de l'histoire sociale ? À peu près à la même époque, Fernand Dumont (« La fonction sociale de l'histoire », loc. cit.) s'étonnait, de son côté, de la désinvolture avec laquelle la nouvelle génération d'historiens congédiait l'événement au nom même de la science, s'éloignant ainsi de ce qui, pour L. Febvre, était au coeur de l'analyse historique (à savoir les rapports entre le « Contingent » et l'« Institutionnel »).
[35] Voir : Lucien Febvre, Le problème de l'incroyance au XVIe siècle : la religion de Rabelais, op. cit. et Un destin. Martin Luther (1928), Paris, Presses universitaires de France, 1968, 210 p. Plus près de nous, on en retrouve un peu le modèle chez Norbert Elias (Mozart. Sociologie d'un génie, Paris, Seuil, 1991, 250 p.), qui a voulu comprendre Mozart en reconstituant le tissu social dans lequel sa vie s'est déroulée. Comme genre scientifique pratiqué dans l'esprit de l'histoire sociale, la biographie devient un mode de lecture d'une collectivité jusque dans ses prolongements les plus fins. Elle exige un va-et-vient entre l'individu et le social qui est évidemment semé d'embûches, au gré de ce que Yvan Lamonde (Louis-Antoine Dessaules [1818-1895], seigneur libéral et anticlérical, Montréal, Fides, 1994, conclusion) appelle une « spirale de la sociabilité ».
[36] Georges Duby, Le dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214, Paris, Gallimard, 302 p. ; Emmanuel Le Roy Ladurie, Le carnaval de Romans : de la chandeleur au mercredi des cendres, 1579-1580, Paris, Gallimard, 1979, 426 p.
[37] À ce sujet, voir, par exemple : Claire Dolan (sous la direction de), Événement, identité et histoire, Sillery, Les Éditions du Septentrion, 1991, 277 p.
[38] Pourquoi faudrait-il se gêner de promouvoir l'événement et la durée alors même qu'une partie des sciences naturelles, derrière I. Prigogine et I. Stengers, commencent à les revendiquer pour elles-mêmes ? Voir : Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, La nouvelle alliance : métamorphose de la science, Paris, Gallimard, 1979, 302 p. et Entre le temps et l'éternité ?, Paris, Fayard, 1988, 222 p.
[39] Cet énoncé nous rapproche de certaines positions déjà exprimées par Arthur L. Stinchcombe, Theoretical Methods in Social History (Studies in Social Discontinuity), New York, Academic Press, 1978, 130 p.
[40] Laurence Stone, « The revival of narrative... », loc. cit.
[41] Raymond Aron, Introduction à la philosophie de l'histoire : essai sur les limites de l'objectivité historique, Paris, Gallimard, 1948, 353 p. ; Henri-Irénée Marrou, De la connaissance historique, Paris, Seuil, 1954, 298 p. ; Paul Ricoeur, Histoire et vérité, Paris, Seuil, 1955, 266 p.
[42] Soulignons que ce procès visait aussi bien l'histoire sociale mais que, celle-ci, pour l'essentiel, s'est généralement dérobée, feignant une sorte d'immunité.
[43] Ce rapprochement avec la peinture (ou avec la sculpture) relève peut-être plus que de la simple allégorie. Pensons à Monet, réfugié à Giverny durant les vingt dernières années de sa vie qu'il consacra à des recherches sur la lumière, n'en finissant plus de repeindre son jardin aquatique (voir toute la série des Nymphéas), en quête d'une « vérité » picturale. Pour remarquable qu'il soit, ce fait n'est pas isolé, loin de là. L'histoire de la peinture offre un éventail de figures très diverses illustrant les manières dont l'artiste a construit son objet. Sur cet éventail, certaines options ne sont pas sans rappeler le réalisme positiviste. C'est un peu le cas de l'automatisme mécanique du peintre québécois Paul-Émile Borduas, qui postulait une homologie entre la structure physique de la matière et les qualités plastiques – selon lui universelles – obtenues par des procédés strictement techniques comme le plissage, les frottements, les dépôts, etc. (« Commentaires sur des mots courants », dans : André-G. Bourassa et al., Paul-Émile Borduas : écrits, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1987, 700 p.). On peut voir quelque chose d'analogue aussi chez Matisse vieillissant, alors que, ne pouvant plus guère tenir ses pinceaux, le maître s'adonnait à la technique des papiers découpés et du collage, procédé grâce auquel, selon Jean Leymarie (Matisse, Paris, Hachette, 1967), « [au] lieu de tracer dans un espace imaginaire des formes reçues de l'extérieur, la main tranche dans un bloc de couleurs [...] des formes venues de l'intérieur et consubstantielles à la matière dans laquelle elles s'inscrivent » ; grâce à quoi l'artiste aboutirait à une sorte de « plénitude »... Dans la même veine, on pense encore aux frottages de Max Ernst ou au process art américain des années 1970.
[44] Hermann Broch, Lettres (1929-1951), Paris, Gallimard, 1961, 525 p.
|

