[xiii]
L’ACTION POLITIQUE DES OUVRIERS QUÉBÉCOIS
(fin du XIXe siècle). Recueil de documents.
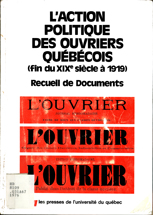 Introduction Introduction
- 1. Les débuts de l'action politique ouvrière
- 2. Le mouvement ouvrier dans le contexte politique canadien
- 3. Quelques éléments de la conjoncture politique et économique
- 4. Organisations et idéologies socialistes
- 5. Le mouvement syndical et l'action politique ouvrière
- 6. Le Parti ouvrier de Montréal et le Parti ouvrier du Canada
- 7. Quelques orientations de recherche

Le Groupe de chercheurs de l'Université du Québec à Montréal sur l'histoire des travailleurs québécois s'est constitué au printemps 1972. Il a participé à la fondation, vers ce même moment, d'un groupe de liaison interdisciplinaire unissant des chercheurs travaillant à Rimouski, Trois-Rivières, Chicoutimi, Québec, Montréal et Ottawa : le Regroupement de chercheurs en histoire des travailleurs québécois (RCHTQ). L’une des premières initiatives de ce Regroupement fut de lancer la Collection « Histoire des travailleurs québécois » des Presses de l'Université du Québec, dont le présent volume est le quatrième à paraitre.
Notre Groupe de chercheurs s'est fixé comme tâche une première étude des mouvements ouvriers politiques au Québec (d'où le sobriquet, le « MOP »). On a commencé par un travail de repérage et de dépouillement des sources , la constitution d'une bibliographie et d'une chronologie pour la période, ainsi que la sélection d'un certain nombre de textes illustrant les premiers pas des travailleurs du Québec vers une action politique ouvrière autonome. La chronologie est publiée sous la forme d'un Cahier du RCHTQ. Le présent ouvrage comprend le Recueil des documents, des Annexes statistiques et explicatives, la Bibliographie, celle-ci précédée par une note où sont détaillés le principe de sélection et quelques-uns des problèmes confrontant les chercheurs dans le domaine des sources. Une introduction tente de situer à grands traits dans son contexte historique l'objet de nos recherches : le mouvement ouvrier québécois à l'heure de la mise en place des premiers éléments d'une organisation politique indépendante par rapport aux « vieux partis » bourgeois et petits-bourgeois. La période allant des années 1890 jusqu'à 1919 nous a semblé correspondre à cette étape plus ou moins précise. En amont, on peut déceler bien [xiv] des signes avant-coureurs épars tout au long d'un demi-siècle qui conduit au présent. (Nous abordons actuellement le travail de déblaiement des années 1920 à 1940.)
Privilégiant nécessairement le mouvement syndical et les velléités d'expression politique autonome (Parti ouvrier, groupements socialistes), il nous a fallu, pour l'instant du moins, laisser de côté les organisations de cultivateurs aussi bien que les mutuelles et les coopératives. Elles ont pourtant leur place non négligeable dans l'histoire de l'ensemble des travailleurs.
Pour ce qui est de la présence de lacunes, d'imprécisions ou d'erreurs du présent travail, nous en sommes pleinement conscients : nous remercions d'avance les lecteurs qui nous aideront à les identifier.
Ce que nous avons surtout voulu faire est de mettre entre les mains de militants et de chercheurs des instruments de travail qui leur seront utiles.
[1]
1. Les débuts de l'action politique ouvrière

Le matériel que nous présentons dans les pages qui suivent comprend quelques-unes des données initiales d'un projet de recherche visant à cerner dans leurs grandes lignes les origines et le cheminement de l'action politique ouvrière au Québec depuis les années 1890 jusqu'au présent. Dans cette première étude nous abordons quelques-uns des éléments historiques qui nous permettent de repérer des pratiques politiques de la classe ouvrière, à partir desquelles il nous sera possible de cerner les questions clés que pose l'émergence d'une conscience et d'une expression organisée de la classe ouvrière au Québec. Depuis la fin de la « révolution tranquille », la question de l'organisation politique autonome des travailleurs a été au centre des débats dans les milieux syndicaux et dans les autres regroupements de travailleurs. L'existence actuelle d’un mouvement ouvrier numériquement fort, quoique profondément divisé, revêt d'une signification particulière cette question. L'interrogation que s'est posée notre groupe de chercheurs est celle-ci : est-ce que l’examen des débuts difficiles de la constitution au Québec d'un mouvement politique ouvrier peut éclaircir quelques-uns des problèmes contemporains ? Le rapport dialectique présent-passé peut-il jeter quelque lumière sur les processus d'une lente élaboration d'objectifs et de stratégies, sur le développement d'une conscience de classe politique des travailleurs ?
La période choisie ici (de la fin du XIXe siècle à 1919) n'est pas celle des prodromes historiques de la présence ouvrière, mais plutôt l'étape marquée déjà par la mise sur pied des premiers partis ouvriers et par la diffusion initiale des idées socialistes au Québec. Certes, la « question ouvrière » s'était posée dès la phase initiale [2] d'industrialisation ferroviaire du milieu du XIXe siècle. La conférence d'Étienne Parent, « Considérations sur le sort des classes ouvrières » (1852), le « Discours sur l'ouvrier » de M. Colin, supérieur des sulpiciens (1869), en témoignent. Si les élites commencent à prendre connaissance du fait ouvrier, c'est surtout à cause des premières luttes revendicatives qui ont été la réplique ouvrière à l'offensive coalisée des patrons.
Le mouvement ouvrier, né de l'industrialisation, ne peut guère être saisi dans toute son évolution lente et difficile qu'à la lumière du caractère et des étapes du développement d'un rapport social fondamental qui est celui du capital/travail. Supposons que par « mouvement ouvrier » on entende la présence plus ou moins généralisée de luttes revendicatives de la part d'ouvriers à gages, ainsi que l'existence d'organisations (même éphémères ou de faible influence) qui expriment les aspirations des travailleurs en tant que groupe social [1].
On a constaté l'existence de ce phénomène embryonnaire dans les années 1830 et 1840 à Montréal et à Québec. Il y a ouvriers, il y a patrons. Ensemble ils sont une minorité infime au sein d'une société coloniale à prédominance agricole, société « traditionnelle » de petits producteurs individuels maniant des outils qui y correspondent. Mais dès le boom des premiers chemins de fer dans les années 1850 une impulsion est donnée aux entreprises que caractérise le rapport capital/travail, fondé sur les techniques de l'industrie mécanique. Le poids spécifique du capitalisme industriel à l’intérieur de la société globale va en augmentant, D'après le Report of the Trade and Commerce of the City of Montreal for 1863, préparé pour le Board of Trade par W.S. Patterson :
- The industrial enterprise of Montrial is perhaps as strikingly manifest in the Iron Works of various kinds in the city and vicinity, as in any other department of business. The short space of 8 or 10 years has afforded opportunity for large increase... There are now within the City limits 12 Founderies, and with each of these fitting and finishing shops are connected. There are also three Rolling Mills ; while since 1859 five Nail Factories have been established. The cotton factories at Hochelaga and Cornwall have greatly increased their facilities during the year [2].
Il ne s'agit pas là d'une « industrialisation hâtive ». Il s'agit de l'émergence d'un mode de production, d'un processus qui, ne s'épanouissant qu'après 1870, n'en débute pas moins par une lente implantation, inégale, éparpillée, dans certains secteurs (transports, bois, biens de consommation), et dont les étapes engendrent le rapport, éventuellement dominant, qui est celui du capital/travail.
La phase initiale du développement du capitalisme industriel est marquée par la formation de coalitions de travailleurs qui revendiquent le droit d'association, [3] la réduction de la longueur de la journée de travail, la hausse de salaire et souvent même son maintien. En l’absence d'un mouvement syndical organisé, ces premières formes de résistance spontanée risquaient de se solder par des échecs.
Dès la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, dans l'Amérique britannique mercantile, on retrace des témoignages qui rendent compte du caractère antagonique du rapport patron/ouvrier : la brève mutinerie de « voyageurs » de la Compagnie du Nord-Ouest au Lac de la pluie (l794) constitue à nos yeux un signe avant-coureur significatif [3].
De son côté, la classe dominante n'a pas hésité à recourir à l'État pour briser ces premières coalitions ouvrières : à preuve, la loi décrétée à Halifax dès 1816 dans le but de mettre fin à l’insubordination des ouvriers des chantiers maritimes regroupés en vue de revendiquer de meilleures conditions de travail.
Avec l'intervention de la troupe pour le « maintien de Pordre » sur les lieux de travail du Canal Rideau dans les années 1820 et du Canal Welland un peu plus tard, le rôle de l'État comme appareil répressif au service des « contracteurs » se dessine assez nettement. L'affrontement de coalitions patronales et ouvrières dans le port de Québec dont fit état dès 1840 le journaliste démocrate Napoléon Aubin, répète en quelque sorte et sous une forme plus poussée, le conflit au cours duquel, un siècle plus tôt, sous le régime français, des constructeurs de navires sortirent en grève. Le correspondant au journal le Canadien qui le 30 juin 1848 pose timidement la question d'une représentation possible à l’Assemblée législative des « classes industrielles », signe « Un ouvrier ». Il est du quartier Saint-Roch où sera tenté en 1852 le lancement d’un journal portant comme titre l’Ouvrier. La tentative échoue, mais ne faut-il pas y voir déjà l'affirmation d'une présence ouvrière qui laisse présager un éventuel mouvement organisé ? Ce sera à la suite des actions des travailleurs des chantiers maritimes à Québec (dès 1840), des grèves des terrassiers des canaux Lachine et Beauharnois (1843-1844), celles des charretiers du Grand-Tronc (1864) et des débardeurs de Québec (1865-1866), qu'on assistera à la formation, sous la direction de Médéric Lanctôt, de la Grande Association de protection des ouvriers du Canada [4]. Dans son ébauche de programme, cette association réunit des revendications socioéconomiques et politiques. Dans son journal, l'Unité nationale, antifédéraliste, on décèle ce même souci d'en arriver à une synthèse du social et du national. Bien sûr, l'« association du capital et du travail » que préconisait Lanctôt supposait une égalité de classe fort illusoire : mais dans la mesure où elle semblait rejeter la subordination du travail au capital, son programme remettait en cause, quoique confusément, le [4] principe même de l'industrie capitaliste. Au cours des débats sur la question de la durée de la journée de travail, c'est la polarité des intérêts patron/ouvrier qui est mise au premier plan, et la montée des mouvements revendicatifs pour la journée de neuf heures et de huit heures sous-tend la formation de centrales syndicales, de ligues, de clubs ouvriers à Montréal aussi bien qu'en Ontario.
La politisation du mouvement ouvrier s'amorce dans les années 1870, marquées par la formation ici et là de syndicats et par la lutte pour l'acquisition des libertés d'association. Celles-ci sont accordées en 1872 par le gouvernement fédéral à la suite de la grève des typographes ontariens, de l'arrestation de leurs dirigeants et de la manifestation d'appui de 10 000 travailleurs à Toronto. C'est aussi l'époque où des leaders syndicaux commencent à se présenter en politique sous la bannière d'un des deux partis traditionnels tout en présentant des projets de loi préparés par les centrales syndicales.
L'enquête de la Commission royale sur les relations du capital et du travail (1886-1888) est une première réponse aux mouvements de protestation que soulèvent les conditions de travail et d'existence des masses ouvrières lors de la nouvelle poussée d'industrialisation qui démarre vers 1880 [5]. Les années 1880-1900 sont celles de l'essor des Chevaliers du travail [6] et des premières interventions parlementaires de la part de groupes ouvriers au Québec. Les candidatures ouvrières en 1883, les succès, en 1888 de Lépine au fédéral, en 1890 de Béland au provincial, sont les précurseurs de la formation à Montréal d'un parti ouvrier [7].
Cette période, dite « lib-lab » ou « tory-lab », est marquée par les candidatures « ouvrières » : H. B. Whitton, typographe conservateur élu au fédéral dès 1872, D. J. Donoghue, candidat conservateur, puis libéral, élu au provincial en Ontario, en 1874, A. Gravel défait en 1883, A.T. Lépine, typographe, député conservateur au fédéral. L'initiative politique ouvrière sera partiellement récupérée par l'un ou l'autre des partis bourgeois. La tentative patronale d'intégrer les travailleurs au système électoral bipartite va à l'encontre des efforts répétés du militantisme ouvrier pour se dépêtrer de l'emprise socio-politique étouffante du « système » en place. L'assimilation de leaders syndicaux aux partis traditionnels, à leur « machine » politique, est souvent suivie de récompenses pour services rendus, sous la forme de postes dans l'administration gouvernementale. Les visées « subversives » de ceux qui voulaient remettre en cause l'ordre établi ont été neutralisées très souvent par les [5] pratiques réformistes bourgeoises ou petites-bourgeoises dans les années qui ont suivi la Confédération canadienne.
Ce type de liens, d'accommodement entre leaders ouvriers et partis traditionnels, se trouvera pendant longtemps à la base des divisions internes au sein du mouvement ouvrier. C'est l'expression d'un opportunisme qui retardera l'éclosion d'une conscience de classe ouvrière.
2. Le mouvement ouvrier
dans le contexte politique canadien

Au Québec, le mouvement ouvrier naissant s'insère dans un cadre étatique particulier. La formation socio-économique de la « société industrielle » (capitaliste) s'étant implantée au XIXe siècle à l'échelle canadienne, il y a recoupement plutôt que coïncidence des frontières ethno-linguistiques, culturelles-nationales avec celles de l'aire de l'industrialisation concentrée. La communauté nationale des Québécois francophones « partage » (de façon assez particulière) avec le Canada anglais une structure sociale capitaliste. Avec dominance du grand capital aux mains des milieux d'affaires anglophones, il y a entrelacement incessant, complexe, mouvant, du national et du social. À l'intérieur de cette formation socio-économique se développent, de façon inégale, à des rythmes différents, un capitalisme anglo-canadien qui domine l'ensemble de l'économie québécoise, et un secteur minoritaire où règnent quelques capitalistes « canadiens-français ». La coalition des grands patrons, tel un Victor Hudon, magnat du textile à Hochelaga, un Andrew Gault, homologue du premier à Valleyfield, traduit une communauté d'intérêts de classe [8]. Face au grand capital, les ouvriers à gages, les petits salariés, recherchent en tâtonnant des formes de coalition à eux, leur permettant de tenir tête à la bourgeoisie. C'est ce qui inspire le vœu d'union, de solidarité, chez un nombre croissant de travailleurs.
Dès les premiers conflits industriels, on constate que le clivage ethnique se confond souvent avec le clivage socio-économique (patrons/ouvriers). Par ailleurs, la classe ouvrière elle-même se caractérise par une diversité interne : d'une part, un prolétariat immigré, irlandais d'origine surtout, ainsi que des ouvriers qualifiés anglo-écossais (mécaniciens et autres) ; d'autre part, une population de travailleurs francophones tirés de la campagne, de la petite production artisanale, se constituant lentement, dans les industries du textile, de la chaussure, du tabac. Cette double présence se retrouvera dans l'industrie forestière, à la « drave », ainsi que parmi les débardeurs et les ouvriers des chantiers navals. Le mouvement des neuf heures, les [6] premiers syndicats et groupements politiques ouvriers, porteront tous l'empreinte de ce caractère ethnique diversifié, que l'immigration subséquente d'Europe contribuera à accentuer. De plus, le mouvement ouvrier ne saurait faire abstraction de la charpente étatique fédérale-provinciale.
Pour évaluer la complexité du contexte politique Canada/Québec, il faut tenir compte de deux autres réseaux économico-politiques : l'un, ancien, est celui de l'Empire britannique, dont les guerres en 1899-1901 et 1914-1918 impliqueront pour le Canada des crises successives ; l'autre est celui où s’inscrivent les rapports impérialistes entre les États-Unis, le Canada et le Québec. C'est sur cette toile de fond que se déroulent les développements saillants, tant socio-économiques que politiques, du mouvement ouvrier au Québec au XXe siècle.
3. Quelques éléments de la conjoncture
politique et économique

L'émergence de mouvements politiques ouvriers vers la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle est à signaler à l’échelle canadienne aussi bien que québécoise. De la Nouvelle-Écosse à la Colombie britannique certains facteurs communs sous-tendent des diversités régionales fort prononcées. Parmi ceux-ci on peut citer :
- - Un nouvel essor d'industrialisation dans les années 1880 et 1890 fait suite aux premiers débuts qui accompagnèrent le boom ferroviaire, et qu'avait interrompus la crise économique de 1873 et la dépression subséquente.
- - L'immigration massive à partir de 1896 élargit le marché du travail tout en peuplant les prairies de l’Ouest canadien.
- - La formation de trusts et de cartels prélude à une phase de concentration monopoliste (1910-1912 en particulier), dont l'une des conséquences est l'exacerbation des rapports entre le grand capital et les travailleurs. (Ce processus amorcé avec les grandes agglomérations ferroviaires s'accompagna de mouvements grévistes de la part des cheminots, des mineurs et des travailleurs du vêtement, et des premières interventions législatives d'Ottawa, comme la loi Lemieux de 1906.)
- - L'extension de l'organisation syndicale à l'échelle canadienne dont les caractéristiques sont : la mainmise des unions internationales (américaines) sur le Congrès des métiers et du travail du Canada au début du siècle aux dépens des syndicats canadiens, l'expulsion des Chevaliers du travail du CMTC (1902), le faible développement de la Fédération canadienne du travail, et au Québec, en réaction également contre le syndicalisme international, la mise sur pied, surtout en dehors de Montréal, d'un mouvement syndical catholique.
- - L'imbrication du Dominion aux appareils tant militaires que commerciaux de l'Empire fait que le tournant du siècle est marqué par la participation à la guerre contre les Boers, alors que la première décennie du XXe siècle est celle des débats autour du « bill naval » et de la course aux armements, prélude à la guerre mondiale impérialiste de 1914-1918.
[7]
- - Dans l'opposition à la guerre et à la conscription se dessinent des éléments de convergence du mouvement ouvrier canadien et du mouvement nationaliste québécois.
- - Mais dans l’opposition à la guerre se dessine également une profonde division à l'intérieur du mouvement ouvrier canadien : les éléments plus radicaux, majoritairement socialistes et concentrés dans les provinces de l'Ouest, qui n'auront pas réussi à faire endosser par le CMTC leurs moyens de lutte à la conscription, se manifesteront avec la fin de la guerre, à la suite de la révolution russe en créant la « One Big Union », et par l’organisation de la grève générale de Winnipeg qui aura des répercussions dans tout le Canada.
- - Le contexte ambiant ainsi que l'influence directe du mouvement ouvrier international joue un rôle de catalyseur dans la formation de groupements politiques ouvriers au Canada et au Québec. La fondation de l'Internationale ouvrière et socialiste en 1889, l'influence croissante de partis socialistes de masse (France, Allemagne), l'impact des manifestations du 1er mai, expression de l'esprit internationaliste des classes ouvrières de maints pays, et enfin le contact direct avec les porte-parole et militants socialistes, surtout britanniques (visite de Keir Hardie) et américains (visites et rapports plus ou moins soutenus avec Eugène Debs, De Leon, Haywood), la tournée au Canada d'Emma Goldman (anarchiste), sont autant d'indications de la perméabilité des groupements d'ici aux influences internationalistes.
- - À Montréal la fondation d'un parti ouvrier en 1899 en prolongement de l'action syndicale et la constitution des premiers groupements socialistes en contact avec les organisations socialistes canadiennes et américaines.
- - Enfin les prises de position de plus en plus fréquentes de ces groupements sur des questions socio-politiques telles que l'instruction publique, le statut de la femme, les affaires municipales, provinciales et fédérales.
Le processus d’industrialisation au Canada et au Québec avait été amorcé dans les années 1850 avec le premier boom de la construction des chemins de fer et s'était poursuivi de façon continue, quoique au ralenti, à cause de la contraction du marché des capitaux consécutive à la grande dépression des années 1873-1878. Cette crise amorça un long mouvement de baisse des prix dans l'ensemble des pays du monde occidental jusqu'en 1896. Cependant, la révolution des transports et les modifications structurelles de l'agriculture québécoise (spécialisation dans l'industrie laitière, commercialisation, accroissement des revenus des agriculteurs) ont stimulé la croissance économique, malgré les fluctuations économiques, en particulier la crise de 1894-1896 qui a eu un impact important dans l'émergence du mouvement politique ouvrier québécois. Entre 1897 et 1920 l'économie canadienne connaît un rythme de croissance d'une intensité sans précédent dans son histoire.
Certains économistes, tel André Raynauld, décrivent cette phase de l'économie canadienne en termes de « décollage », d'autres, tels W.F. Ryan, W.T. Easterbrook, A. Faucher et M. Lamontagne, la décriront comme celle d'une simple accélération du rythme d'expansion économique. Cependant, tous admettent que le Québec a [8] participé à cette croissance soutenue qui s'est poursuivie jusqu'en 1929, alors que le marché québécois s'est intégré davantage à celui des États-Unis et de l'Ouest canadien.
Entre 1897 et 1914 le Canada connaît une vague massive d'immigration qui permet l'ouverture de l'Ouest et l'exportation de denrées agricoles et de viande en Angleterre. Ce boom de l'Ouest contribue largement au développement des industries manufacturières au Québec et en Ontario.
Parmi les statistiques qui illustrent de façon éloquente l'intensité de la croissance économique du Québec, retenons celles de la valeur de la production brute des industries manufacturières qui passe de 158 millions à 730 millions (en dollars courants) entre 1901 et 1921. Évaluée à $1 435 per capita de la population active en 1900, cette production atteint $5 830 en 1920. Pour les industries minières, la valeur de la production brute (en dollars courants), passe de $2 987 731 à $15 522 988 entre 1901 et 1921.
Si le Québec continue à développer une industrie légère à forte intensité de main-d'œuvre (textiles, tabac, etc.), apparaissent depuis la fin du XIXe siècle de nouvelles industries basées sur l'exploitation des richesses naturelles : hydro-électricité, pâtes et papier, électro-métallurgie et mines. La production d'électricité sur une grande échelle n'est apparue qu'à la fin du XIXe siècle. Le Québec entre dans l'ère de l'électricité à peu près en même temps que les États-Unis : le premier grand barrage est construit à Shawinigan en 1898. C'est le capital et la technologie américaine qui vont mettre en valeur le potentiel énergétique du Québec. Les industries du secteur de l'électricité tendront au monopole, au moins régional. Des géants se partageront les diverses régions : la Shawinigan Water & Power, de loin le plus grand producteur, contrôlera la Mauricie et une partie de la rive sud du Saint-Laurent. Elle fournit aussi à la Montreal Light, Heat and Power, compagnie de distribution qui s'accapare le marché de Montréal ; la Gatineau Power s'étend dans la vallée de l'Outaouais et une partie des Laurentides, la Southern Canada Power dans l'Estrie. Certaines de ces entreprises joueront un rôle important dans l'industrialisation du Québec ; en recherchant des débouchés pour leur surplus d'électricité, elles attireront ici les entreprises qui en feront un grand usage comme l'aluminium et l'industrie chimique.
Le secteur des pâtes et papier deviendra le pôle de croissance le plus dynamique au début du XXe siècle. Le développement de cette industrie est lié au développement de la demande américaine de papier journal qui connaît une très forte hausse au début du XXe siècle avec l'augmentation du volume des journaux, du tirage. Suite aux très forts investissements orientés dans ce secteur entre 1915 et 1925, cette industrie devra subir une crise de surproduction qui entraînera la disparition de plusieurs moulins et la formation de deux grands empires : la Canadian [9] International Paper domine le secteur des intérêts américains et la Consolidated Bathurst, celui des intérêts canadiens-anglais.
Dans le secteur de l'électro-métallurgie, l'aluminium vient au premier rang. Les premières installations sont ouvertes dès le début du siècle. Une nouvelle étape sera franchie vers 1925 avec l'installation de l'Aluminum Company of Canada au Saguenay. La première guerre mondiale assurera, par ailleurs, une expansion considérable à l'industrie chimique.
L'industrie minière se développe assez tardivement au Québec. En 1911 elle n'emploie encore que 6 000 hommes soit moins de 1% de la force ouvrière. Au début du XXe siècle, les activités dans ce secteur se résument à l'extraction de matériaux de construction (carrières de pierre, sable) et de l'amiante, industrie encore très instable pendant les premières décennies du siècle.
Ces nouvelles industries, qui viennent s'implanter à proximité des sources de matières premières et d'énergie électrique, contrairement aux entreprises manufacturières légères qui recherchaient d'abord la proximité de la main-d'œuvre et des marchés, transforment le réseau urbain existant. Par ailleurs les industries manufacturières au XXe siècle seront de plus en plus localisées dans la région de Montréal qui assure en 1900, 45% de la production manufacturière québécoise, et, en 1929, plus de 63%.
Les industries liées aux richesses naturelles vont exiger la construction d'unités de production de dimensions plus vastes et des investissements considérables. Les capitaux et la technologie proviendront de l'extérieur.
De 1900 à 1910 les investissements étrangers au Canada doublent pour atteindre environ $2 500 000 000, puis ils doublent de nouveau de 1910 à 1920. D'origine britannique à 85% et américaine à 14% en 1900, ces capitaux viendront de plus en plus massivement des États-Unis après la première guerre. Ils domineront plusieurs secteurs, en particulier les pâtes et papier, les textiles, l'amiante et l'industrie chimique.
En 1920, au Canada les capitaux proviennent encore dans une proportion de 53% de l'Angleterre et 44% des États-Unis. Au Québec, dès 1915 les investissements américains représentent plus du tiers de tous les investissements étrangers alors que pour l'ensemble du Canada ils en représentent moins du quart.
En termes d'investissements directs, la vitesse de pénétration du capital américain au Canada est impressionnante : la moyenne annuelle de l'accroissement des compagnies canadiennes contrôlées par les Américains qui était de 4% avant 1900, passe à 11% de 1900 à 1909, et ce pourcentage double pour la période de 1910 à 1919.
Sur le plan des échanges extérieurs, la domination de l'économie américaine sur l'économie canadienne apparaît aussi clairement : dès 1901 les États-Unis fournissent environ 60% de toutes les importations canadiennes et en 1921 cette proportion est passée à 70%. Exportateur de produits alimentaires (blé, farine, viande) [10] qui occasionnent le « boom de l'Ouest », de produits faiblement transformés (pâtes et papier) et de matières premières (produits miniers non ferreux, et non métalliques surtout), le Canada est durant toute cette période un gros importateur de biens d'équipement et de produits finis.
Durant cette période d'intégration de la structure industrielle du Canada à celle des États-Unis, intégration qui deviendra déterminante entre autres pour l'économie québécoise, le nombre de travailleurs salariés urbains canadiens augmente dans des proportions considérables en suivant d'assez près le taux de la population urbaine, qui, pour la période 1900-1920, passe de 38% à 50%. Au Québec, entre 1901 et 1921 la population totale passe de 1 648 898 à 2 360 510 à cause d'un taux de naissance très élevé jusqu'au début de la guerre et du ralentissement de l'émigration aux États-Unis. La population active québécoise passe de 512 026 à 777 445 pendant cette même période. La croissance économique se traduit par une urbanisation accélérée du Québec : d'environ 40% en 1901, le taux d'urbanisation atteint 56% en 1921. La population de Montréal croit pour sa part de 20% :elle passe de 267 730 à 618 506.
La population active du secteur primaire continue d'augmenter malgré la modernisation de l'agriculture, à cause de l'augmentation des travailleurs forestiers et miniers et le maintien des zones de colonisation. Ses effectifs passent de 247 000 à 328 000 en 1921. Ce secteur demeure le plus important durant toute la période, représentant 48% en 1901 et 42% en 1921.
Le secteur secondaire voit son importance relative baisser légèrement de 25.2% en 1901 à 21.8 % en 1921, malgré une augmentation considérable de la production et une augmentation de ses effectifs en chiffres absolus de 129 000 (en 1901) à 170 000 (en 1921). Le secteur tertiaire voit ses effectifs passer de 135 000 à 280 000 durant la même période, représentant respectivement 26.5% et 35.8% de la main-d’œuvre active.
4. Organisations et idéologies socialistes

Sous sa forme « utopique », l'idée socialiste fait son apparition à une échelle minuscule avec la tentative de fonder en 1828 sur les rives du lac Huron une petite colonie d'adhérents de Robert Owen. Ce geste communautaire n'eut pas de suite. Une quinzaine d'années plus tard le chartiste écossais Thomas MacQueen, immigré au Canada-Ouest (l'ancien Haut-Canada, futur sud de l'Ontario), rédacteur de journal dans la vallée de l'Outaouais d'abord, ensuite à Goderich sur le lac Huron, se fera le porte-parole d'un démocratisme radical, pacifiste, défenseur de revendications populaires. Ces précurseurs préparent un terrain propice à la diffusion des idées socialistes qui suivront l'apparition de la machine à vapeur, du chemin de fer, de l'usine. Le machinisme du XXe siècle traduit non seulement la mise en place d'une nouvelle technologie, mais également l'émergence d'un nouveau rapport social. L'industrie capitaliste implantée dans les colonies de peuplement britannique finit par provoquer la résistance spontanée des exploités. Une réflexion critique sur les nouveaux rapports [11] de travail, de production sociale, de propriété, et sur la distribution combien inégale des biens matériels, prépare le terrain à l'apparition des premiers éléments d'une conscience politique prolétarienne.
Faisant suite aux premiers essais d'action politique parlementaire des années 1870 à 1880, ainsi qu'aux mouvements revendicatifs autour de la journée de travail, on assiste vers 1890 aux débuts de l'organisation socialiste. En Ontario s'organise dès 1894 une section torontoise du Socialist Labor Party fondé aux États-Unis en 1877, et dont le dirigeant est Daniel De Leon [9]. Très rapidement ce parti établit d'autres sections à Hamilton, London, Brantford, Ottawa, Halifax, Winnipeg, Vancouver ; à Montréal il publie à l'occasion du 1er mai 1895, le texte français d'un manifeste-programme [10]. Le SLP édite trois journaux : à Halifax, Cause of Labor ; à Brantford, Ontario, Better Times ; à Montréal, Commonwealth. Se consacrant essentiellement au travail de propagande, méfiant sinon hostile à l'égard des syndicats, le parti ne compte plus en 1901 que quatre sections au Canada et qu'un journal, Cause of Labor.
Vers la fin du XIXe siècle on fonde des « ligues socialistes » : issues de groupes réformistes fort actifs, elles prônent un socialisme d'inspiration chrétienne. Collaborant avec les syndicats, poussant leurs membres à se syndiquer, les ligues recrutent aussi quelques éléments radicaux du clergé protestant anglo-canadien. Elles font surtout un travail d'éducation. En 1899, une cinquantaine de ces ligues se regroupent sous le nom de Canadian Socialist League. En Colombie britannique les sections de la ligue se fusionnent avec les militants SLP pour former le Socialist Party of British Columbia. Deux ans plus tard, en 1903, pour la première fois au Canada, les travailleurs de la Colombie britannique font élire deux députés socialistes au Parlement provincial. Cette victoire entraîne le passage du leadership du mouvement socialiste canadien de Toronto à Vancouver. Lors de son quatrième Congrès le SP of B.C., à la demande de socialistes du Manitoba, devient le Parti socialiste du Canada (1904). Son journal, le Western Clarion, sera diffusé à la grandeur du pays. Très vite, le parti compte des sections en Ontario, au Québec, au Manitoba, tout en maintenant à Vancouver sa direction centrale. Dès lors il existe à l'échelle canadienne une organisation politique à caractère socialiste.
La critique « radicale » à l'égard du syndicalisme et du parlementarisme que développe le PSC aboutit à un abstentionnisme sectaire : absence de tout soutien aux mouvements de grève, refus de participation aux élections municipales, considérées comme une diversion, condamnation de formations socialistes anglaises et américaines, jugées réformistes, refus de s'affilier à la 2e Internationale. À partir de [12] 1907-1911, les oppositions se cristallisent au sein du parti. À partir de Vancouver, de Winnipeg et de Toronto se forment des éléments d'un nouveau groupement politique : le Parti social-démocrate. Ils reprochent au PSC son anti-syndicalisme, son boycottage des élections municipales et autres, son rejet de l'affiliation à l'Internationale socialiste. C'est en décembre 1911, à Port Arthur, Ontario, que les délégués de locaux exclus du PSC fondent le Parti social-démocrate du Canada. Son programme marque un retour aux revendications immédiates, à l'appui de l'action syndicale et l’affiliation au mouvement ouvrier international. Dès 1913, avec 3 500 membres, le PSD dépasse les effectifs du PSC ; l'année suivante il compte 82 locaux en Ontario, 46 en Colombie britannique, 45 en Alberta, 20 en Saskatchewan, 28 au Manitoba, et 8 au Québec.
La plupart des membres du PSD sont des ouvriers immigrés d'Europe, influencés soit par le succès de la social-démocratie, soit par les expériences vécues de luttes militantes et de répression gouvernementale, surtout dans les pays de l'Europe centrale et orientale. C'est le cas aussi, dans les formations analogues, aux États-Unis. Le PSC cependant, est composé en bonne partie d'anglophones. Alors même que se forme le PSD, un autre groupe plus nettement de gauche se détache du PSC à Toronto pour fonder le Revolutionary Socialist Party of North America. Opposé à la « collaboration de classes » jugée opportuniste, le groupement se donne pour tâche de diffuser le marxisme : ses membres doivent maîtriser et propager les concepts fondamentaux du matérialisme historique. Plusieurs de ses membres dont Tim Buck, se retrouveront parmi les fondateurs du Parti communiste en 1919-1921.
La conjoncture de la guerre de 1914-1918 aura pour effet de transformer les données de la situation du mouvement ouvrier canadien. D'une part, les autorités gouvernementales effectuent une intégration des dirigeants syndicaux de droite à l'appareil de « l'effort de guerre » : y concourent le chauvinisme britannique, les exigences de la production de munitions, les pressions coercitives. D'autre part, un certain nombre de socialistes s'opposent à toute participation à la guerre « pour l'Empire » : ils seront la cible de la loi des mesures de guerre.
Le débat autour de la conscription, à partir de 1916, engendre pour la première fois au Canada une velléité de convergence politique de trois forces oppositionnistes d'envergure : le mouvement des fermiers de l'Ouest, la mobilisation d’une masse importante de travailleurs syndiqués et non syndiqués, et la résistance nationale, anti-impérialiste, du Québec francophone [11].
[13]
Le Congrès des métiers et du travail du Canada, malgré ses réserves antérieures, cède à la pression anti-conscriptionniste : son congrès annuel tenu en septembre 1917 vote la mise sur pied d'un parti ouvrier à l'échelle canadienne destiné à combattre de façon légale la loi de conscription [12]. Dans la mesure où le souci des dirigeants était de « contenir » les mouvements de masse au profit du réformisme, la tactique a porté fruits. La dissension règne parmi les quatre cents délégués qui participent au congrès de fondation de la section ontarienne du POC (mars 1918). La gauche n'accepte pas de s’affilier à un parti de type « travailliste ». Les tenants de l'orientation vers la lutte de classe viennent d'ailleurs de recevoir une impulsion nouvelle et puissante : la révolution d'octobre de 1917. Ainsi, le Parti social-démocrate du Manitoba vote une résolution félicitant les sociaux-démocrates russes du renversement de la classe capitaliste dans leur pays. Il fait appel en faveur d'une fusion, au Canada, des partis socialistes et sociaux-démocrates sur la base d'un programme marxiste. À Toronto, les sociaux-démocrates discutent un projet de formation d'un nouveau parti révolutionnaire, communiste. Lors d'une réunion initiale en février 1919, la police fait irruption et arrête les participants. Le 1er mai 1919, un premier tract signé par « Le Comité exécutif central du Parti communiste du Canada » est diffusé à Montréal ainsi que dans plusieurs autres villes canadiennes [13].
La création à Moscou en mars 1919, de la IIIe Internationale (communiste) stimule les efforts des militants de gauche des trois partis socialistes au Canada (PSC, PSD, RSPNA) en vue d’une fusion éventuelle. Ces efforts se poursuivront jusqu'à la fondation dans la clandestinité, d'un parti communiste canadien (juin 1921).
L'émergence d'un courant de gauche s'affirme pendant les années de fin de guerre et de retour à la paix, au sein du mouvement syndical. Les efforts maintes fois entrepris en vue de faire accepter par le CMTC l'affiliation de groupements socialistes s'étaient soldés chaque fois par un échec. Mais la montée du militantisme ouvrier, renforcée par les expériences de la lutte anti-conscriptionniste et intensifiée par les conditions économiques de la démobilisation militaire, se traduit en 1919 par la Western Labor Conference et ensuite par une vague d'actions grévistes dont la grève générale de Winnipeg. Les structures traditionnelles, l'immobilisme bureaucratique des chefs réformistes s’en trouvent rudement ébranlés.
La tendance anarcho-syndicaliste était née des durs conflits de mineurs de l'Ouest nord-américain. La Western Federation of Miners, précurseur de la Mine Mill & Smelter Workers' Union avec son programme anti-capitaliste, l'Industrial Workers of the World, qui avait percé en Colombie britannique dès 1906, prônaient le remplacement des syndicats de métiers (craft unions) par des syndicats à l'échelle des industries, l'abandon de la collaboration de classe, la démocratisation et l'unification des organisations de travailleurs. Les syndicalistes de gauche, adhérents de l'un ou [14] l'autre des groupes socialistes en viennent à convoquer à Calgary en mars 1919, une « Western Labor Conférence » [14] : rassemblement ayant pour but de préparer une action commune des syndicats de l'Ouest lors du prochain congrès du CMTC en faveur d'un syndicalisme industriel. La conférence de Calgary (mars 1919) adopte une résolution en faveur de l'abolition du système de production capitaliste, basé sur le profit, et son remplacement par un système fondé sur les besoins des masses. Condamnant les syndicats de métiers, ainsi que la politique parlementaire et électoraliste, les délégués réclament le groupement industriel et unitaire (« One Big Union »), ainsi que le recours à l'action directe, allant jusqu'à la grève générale comme moyen de renverser le système au pouvoir. On exprime une salutation fraternelle à l'adresse du nouveau gouvernement soviétique - et l'on fait campagne pour faire cesser l'envoi de munitions aux troupes stationnées en Russie, allant jusqu'à exiger le retrait des forces interventionnistes qui s'y trouvaient.
La grève générale de Winnipeg (mai 1919) marqua le point culminant de la vague de militantisme ouvrier qui suivit la guerre. Son impact se fit sentir chez les travailleurs à travers le pays, suscitant parmi les gouvernants canadiens un sentiment de panique. L'article 98 du code criminel, particulièrement répressif, adopté sur l'initiative de J. P. Morgan et les intérêts de Wall Street, donna le signal à une vague d'arrestations et de déportations de militants, une fois la grève brisée.
La tentative de lancement de la « One Big Union », qui a eu des échos jusqu'à Montréal [15] où Michael Buhay s'en fit le propagateur, tourna court. La plupart de ses dirigeants réintégraient les syndicats de métiers afin d'y poursuivre la propagande en faveur du syndicalisme industriel et unitaire. Dès lors, la tendance anarcho-syndicaliste s'efface au sein du mouvement ouvrier canadien.
5. Le mouvement syndical
et l'action politique ouvrière

Au Canada, comme aux États-Unis et en Europe occidentale, on constate une croissance remarquable des effectifs syndicaux. Au Canada de 1900 à 1920, le nombre de syndiqués est multiplié par six, passant de 50 000 à 300 000. Au Québec la progression est encore plus rapide : pour la même période le nombre de syndiqués passe d'environ 8 000 à 80 000. En 1920, les 80 000 syndiqués québécois se répartissent à peu près comme suit : 55 000 pour les unions internationales, 5 000 pour les unions nationales et indépendantes et 20 000 pour les unions nationales catholiques. Mis à part les cinq dernières années pendant lesquelles le syndicalisme catholique connaît une certaine expansion, c'est le syndicalisme international qui profite le plus de ces progrès. Jusqu'en 1890, les syndicats internationaux, établis au Canada depuis 1860, ont suivi, quant à leur nombre et à leur dimension, une évolution semblable à celle des syndicats nationaux canadiens.
[15]
Regroupés aux États-Unis depuis 1881 sous le nom de Federation of Organized Trades and Labor Unions of the United States and Canada, puis à partir de décembre 1886 sous celui de American Federation of Labor, les syndicats internationaux avaient respecté jusqu'à cette date l'autonomie du mouvement syndical canadien.
De son côté le mouvement syndical canadien, qui avait donné naissance en septembre 1886 au Congrès des métiers et du travail du Canada, admettait dans ses rangs aussi bien les locaux canadiens des syndicats internationaux que les syndicats proprement canadiens et les assemblées des Chevaliers du travail. À partir de 1894, cependant, les syndicats internationaux s'implantent beaucoup plus rapidement et pourront ainsi s'assurer le contrôle du CMTC. Ils combattent alors les tentatives répétées depuis 1894 par les Chevaliers du travail du Canada de faire du congrès une véritable centrale canadienne.
Lorsque les Chevaliers du travail ont voulu réunir dans un même conseil tous les ouvriers organisés de Montréal et ont créé à cet effet en février 1886 le Conseil central des métiers et du travail (CCMT) ils se sont alliés les syndicats internationaux.
Ce Conseil central groupa jusqu'en 1897 la très grande majorité des unions de métier et des assemblées de Chevaliers du travail de Montréal. Cette alliance fut toujours assez précaire.
Les deux mouvements, ne partageant pas la même idéologie et divergeant quant aux méthodes d'action, en particulier quant au type d'action politique que devait défendre le conseil, se sont souvent affrontés. Le CMTC, selon l'historien Logan, aurait longtemps joué un rôle de modérateur entre les représentants des Chevaliers du travail et ceux des unions internationales. Pour le CMTC, ces deux formules d'action syndicale n'étaient pas incompatibles.
Les Chevaliers du travail [16], implantés à Montréal plus tôt que les unions internationales, ont dominé le CCMT. La constitution du conseil privilégiait la représentation des Chevaliers. Ce n'est que vers 1894 lorsque le syndicalisme international s'implante définitivement dans la métropole, et dans l'ensemble du pays, que la lutte entre les deux mouvements prend toute son ampleur.
Entre 1894 et 1902, la vieille guerre entre ces deux factions, commencée dix ans plus tôt aux États-Unis, s'intensifie au Canada.
À Montréal, quatre syndicats internationaux rompent avec le Conseil central des métiers et du travail, et créent leur propre organisation en avril 1897, le Conseil des métiers fédérés (CME). Ce nouveau conseil, qui signifie la fin de l'alliance entre l'Ordre et les Unions des métiers, est dû en grande partie à la difficulté de ces dernières à imposer leur orientation syndicale aux Chevaliers du travail. Donc, à partir de 1897, deux organisations syndicales affiliées au Congrès des métiers et du travail du Canada existent à Montréal : le CMF et le CCMT.
[16]
Regroupant les travailleurs sur la base de leurs métiers, le CMF accuse le CCMT, composé majoritairement de Chevaliers du travail, de semer la zizanie au sein des unions de métier en voulant syndiquer les ouvriers sur une base géographique.
La lutte acharnée entre les deux groupes se poursuit jusqu'à l'assemblée du Congrès des métiers et du travail du Canada. À la session annuelle de septembre 1900 du CMTC, le Conseil des métiers fédérés se sent déjà assez fort pour s'opposer à l'admission des représentants du Conseil central et de deux assemblées des Chevaliers du travail de Montréal, qui, selon lui, ne représentent qu'eux-mêmes.
L'affrontement final ne survint que deux ans plus tard, en novembre 1902, au Congrès de Berlin (aujourd'hui Kitchener). À la suite de la répétition du même scénario, le CMTC vote une résolution bannissant de la centrale toutes les unions nationales œuvrant dans des secteurs où étaient déjà implantées les unions internationales [17].
Des vingt-trois organisations expulsées par cette mesure, douze sont de Montréal - il s'agit du Conseil central des métiers, de cinq assemblées de Chevaliers et de six syndicats nationaux.
À ce moment, les unions internationales qui avaient réussi à doubler le nombre de leurs locaux au Canada en quatre ans contrôlaient le CMTC et J.A. Flett, organisateur de la Fédération américaine du travail (FAT) au Canada, est alors président du Congrès. C'est ce qui explique la facilité avec laquelle elles ont pu faire adopter cette résolution amendant leur constitution.
Les organisations exclues du CMTC en 1902 fondèrent aussitôt à Berlin (Ontario) une nouvelle centrale syndicale avec les objectifs déclarés suivants : réunir toutes les organisations ouvrières existantes au Canada et fonder des syndicats nationaux à travers tout le Canada. Cette nouvelle centrale prit le nom de Congrès national des métiers et, du travail du Canada (CNMTC) avant d'adopter en 1908 celui de Fédération canadienne du travail (1908-1927).
Dès 1903, cependant, au premier congrès officiel tenu à Québec, les délégués de la nouvelle centrale rejettent le droit d'affiliation pour les locaux canadiens des syndicats internationaux. Cette décision qui faisait le jeu des syndicats internationaux sera un obstacle majeur au développement de cette centrale pendant les vingt-cinq années de son existence. Des 7 000 ouvriers qu'elle réunit en 1903, dont plus de 90% venant du Québec, il n'en reste plus en 1920 que 6 000, dont moins de 10% venant du Québec. Pour la même période le membership du CMTC passe de 15 000 à 175 000.
[17]
Avec l'influence croissante des syndicats internationaux sur le Congrès des métiers et du travail du Canada à la fin du XIXe siècle, et surtout avec leur mainmise quasi complète sur le congrès à partir de 1902, le mouvement ouvrier canadien sera soumis désormais aux orientations des dirigeants de la FAT à Washington [18]. Les seules prises de positions du CMTC en faveur du syndicalisme de métiers et son rejet du syndicalisme industriel jugé trop révolutionnaire et du socialisme sous toutes ses formes sont suffisamment éloquentes à cet égard.
Dès le début du siècle, le CMTC adoptera une nouvelle forme d'action politique ouvrière : il préconisera une représentation politique ouvrière indépendante des partis bourgeois traditionnels, mais organisée et contrôlée par le mouvement syndical. Cette position en faveur du « travaillisme » s'exprimera en opposition à l'action politique partisane et au socialisme. D'ailleurs, à la session de 1899 du Congrès et à celles qui suivirent jusqu'en 1906, on ne propose jamais la création comme tel d'un parti canadien indépendant de la centrale.
C'est en septembre 1899 que le CMTC décide de se lancer dans l'action politique, à la suite de l'élection au Parlement de la Colombie britannique de Ralph Smith et Robert MacPherson [19], candidats ouvriers dits indépendants mais effectivement appuyés par le Parti nationaliste (Chevaliers du travail) et le Parti libéral. La nomination de A.W. Puttee par le Conseil des Métiers et le Parti Ouvrier indépendant de Winnipeg comme candidat ouvrier dans une élection fédérale partielle amena J.A. Flett, organisateur de la FAT au Canada et vice-président du Congrès, à définir une ligne politique. Il fait adopter une résolution recommandant aux divers conseils des métiers de prendre des mesures nécessaires pour se former en partis ouvriers locaux et nommer des candidats aux différents niveaux de gouvernement. La résolution de Flett déclare qu'à l'avenir les unionistes qui défendront les programmes des vieux partis seront considérés comme des escrocs et des ennemis du mouvement ouvrier.
Suite au Congrès de 1899 du CMTC, apparaîtront les partis ouvriers indépendants de Montréal (octobre 1899), de Vancouver (juillet 1900) et de Toronto (août 1900). Ils ont tous eu une existence très brève. Le Parti ouvrier indépendant de Winnipeg avait été formé dès 1895 ; il est la première organisation de ce nom au Canada.
Dès l'année suivante, l'exécutif du CMTC dominé par des partisans libéraux remet en cause cette première orientation. Enfin, la décision du CMTC de 1901 de nommer un officier syndical au Parlement à temps plein pour préparer des projets de loi conformes aux intérêts des syndiqués et faire rapport sur l'attitude des députés en Chambre, signifiait l'adoption par le CMTC des méthodes de lobbying de la [18] direction américaine des syndicats internationaux. En 1903 et en 1904 le Congrès se contente d'endosser le principe de l'action politique indépendante, c'est-à-dire l'appui à des candidatures ouvrières individuelles. En 1905 il recommande aux ouvriers de London d'appuyer le candidat conservateur aux élections provinciales.
Au fond, le CMTC a adopté sensiblement la même position que celle que défendait la FAT dès son Congrès de 1891. Cette année-là, Gompers et son exécutif l'ayant emporté sur les membres du Socialist Labor Party qui s'étaient vu refuser le droit d'affiliation pour leur parti à la FAT [20], avaient définitivement tracé une « politique non partisane » pour les syndicats internationaux.
Il faut bien interpréter les appels officiels de la part de la direction des unions américaines en faveur de l'action politique. Concrètement cela signifiait appuyer indifféremment les candidats des diverses formations politiques reconnus pour être particulièrement favorables au programme législatif du mouvement syndical.
À fortiori, les dirigeants des syndicats internationaux n'étaient pas opposés aux candidatures ouvrières issues des syndicats mais ils insistaient pour qu'elles se fassent sous une étiquette strictement ouvrière (« straight labor ticket ») ; ils les craignaient dans la mesure où elles pouvaient donner naissance à une organisation politique permanente échappant au contrôle des syndicats.
Au Canada comme aux États-Unis, la position hésitante et timorée de la direction des syndicats internationaux devait bientôt rencontrer chez les syndiqués de la base une opposition à cette ligne politique et le désir de créer une organisation politique autonome et permanente des travailleurs.
Au début du XXe siècle, dans plusieurs dizaines de villes nord-américaines des syndiqués fondent des partis ouvriers, tant sur la scène municipale qu'au niveau de leur État ou de leur province. C'est ainsi que réapparait à Montréal le Parti ouvrier en décembre 1904 [21].
Jusqu'à maintenant les dirigeants de la FAT, comme ceux du CMTC, s'étaient toujours opposés à la création d'un parti ouvrier national. Au début de 1906, les ouvriers américains qui réclamaient un tel parti, mettent de l'avant l'important succès électoral de British Labor Party. Gompers répond à leur demande en mettant sur pied un Labor Representation Committee pour faire la lutte aux Républicains et insiste fortement auprès des syndiqués pour qu'ils élisent quelques-uns des leurs.
De leur côté, en septembre 1906, les ouvriers canadiens profitent à la fois de la conjoncture politique ouvrière anglaise, américaine et canadienne. En février 1906, Alphonse Verville, président du CMTC, avait été élu dans Montréal-Maisonneuve [19] sous la bannière du Parti ouvrier de Montréal. Depuis quelques années, l'exécutif du CMTC déployait de multiples efforts pour reconquérir la confiance des ouvriers de l'Ouest canadien car, depuis 1901, plusieurs ouvriers, en particulier de Colombie britannique, avaient brisé leurs liens avec le CMTC et grossissaient les rangs de l'American Labor Union, centrale industrielle américaine fondée par le leader socialiste E. V. Debs.
Au Congrès du CMTC, qui se tient en 1906 à Victoria, dans le but de se rapprocher des « Westerners », les délégués de Victoria proposent qu'un « Canadian Labor Party » soit formé. Les délégués de Vancouver vont jusqu'à proposer que ce nouveau parti adopte le programme du Parti socialiste du Canada.
P.M. Draper, secrétaire du congrès, fait voter une résolution qui demande aux exécutifs provinciaux du congrès de convoquer des assemblées pour fonder les différentes sections d'un parti ouvrier canadien, mais sur la base du programme politique du CMTC.
Le texte de la constitution du Parti ouvrier canadien qu'adoptent les délégués, prévoit que le comité exécutif des sections locales sera composé de quinze délégués du Conseil des métiers et de cinq délégués pour chacun des clubs ouvriers de quartier. Aucune structure nationale permanente n'est prévue pour coordonner ultérieurement l'action des sections locales.
C'est ainsi qu'au mois d'octobre 1906 la section manitobaine (Winnipeg) est créée ; la section ontarienne, en avril 1907. Les sections de Colombie britannique et d'Alberta quant à elles ne voient pas le jour, les militants locaux du Parti socialiste du Canada ayant saboté leur assemblée de fondation et fait adopter le programme du PSC. Au Québec, le Parti ouvrier de Montréal, qui était réapparu depuis deux ans, forme désormais la section québécoise du Parti ouvrier du Canada. Les chroniqueurs ouvriers des quotidiens montréalais continueront à parler du « Parti socialiste » la section québécoise du PSC.
Le Parti ouvrier canadien ne devait cependant pas connaître une longue carrière car après la session de 1909 du CMTC, les exécutifs provinciaux ne se réunissent plus pour traiter des affaires du parti ; seules les sections du Québec, à Montréal, et d'Ontario, à Hamilton, connaissent une certaine constance dans leurs activités jusqu'en 1917, année où le parti sera de nouveau relancé à l'échelle canadienne [22].
En plus des carences organisationnelles et financières, on attribue généralement l'« échec du parti » au fait qu'au congrès de 1907, on refusa de reconnaître le principe de l'autonomie des sections provinciales en matière d'orientation politique c'est-à-dire concrètement de reconnaître le Parti socialiste dans les deux provinces de Colombie britannique et d'Alberta. Le POC, dans l'esprit des représentants des syndicats internationaux, n'avait nullement l'ambition de prendre le pouvoir mais seulement d'y [20] participer. Fondamentalement la direction des syndicats internationaux pratiquait une politique de collaboration avec les patrons et leurs gouvernements. Elle ne manquait pas les occasions de mettre les travailleurs en garde contre les socialistes, « éléments extrémistes, destructeurs de la civilisation ». Défendant principalement les intérêts sectoriels des ouvriers les plus qualifiés, la direction des unions internationales voyait d'un très mauvais œil la volonté des différents groupements socialistes d'organiser tous les ouvriers sans distinction de métier.
Le syndicalisme industriel prôné par les socialistes consistant à regrouper tous les ouvriers d'une même industrie dans un même syndicat devait permettre d'organiser les non-spécialisés et surtout d'accroître la solidarité ouvrière en temps de grève. Les défenseurs des syndicats internationaux qui inclinaient vers un syndicalisme d'affaires et de négociation craignaient cette forme d'organisation facilitant les grandes actions de grève.
C'est ainsi que les socialistes qui militaient dans le mouvement syndical n'obtiendront jamais que le Congrès organise les ouvriers sur la base de leur industrie de préférence à celle de leur métier. Une exception : au congrès du CMTC tenu à Calgary en 1911, une représentation exceptionnellement forte des syndicats de l'Ouest réussissait à faire endosser le principe du syndicalisme industriel. Dès l'année suivante, l'exécutif du Congrès obtenait que la résolution de 1911 soit interprétée comme une déclaration de nature strictement « permissive et éducative ». Le rejet de cette forme d'organisation par le CMTC encourage le doublage syndical (« dual unionism »). C'est ainsi que dans plusieurs métiers, des syndicats canadiens s'affilient à des centrales industrielles américaines, (American Labor Unions, Western Federation of Miners, Amalgamated Clothing Workers, Industrial Workers of the World, etc.), ce qui entraîne une division permanente dans les rangs des ouvriers canadiens.
6. Le Parti ouvrier de Montréal
et le Parti ouvrier du Canada

Au Québec, pendant les vingt ans qui ont précédé la première guerre mondiale le mouvement ouvrier politique est traversé notamment par l'idéologie travailliste. Contrairement aux provinces de l'Ouest mais parallèlement à l'Ontario, le syndicalisme de métiers y est dominant et contrôle presque dans son ensemble l'organisation politique ouvrière.
Né en 1899, d'une réunion de clubs ouvriers formés dans les années 1890, le Parti ouvrier de Montréal représente la principale organisation politique ouvrière du Québec. Dès 1898, des ouvriers de Montréal réunis dans deux clubs ouvriers, le Club central et le Club indépendant, s'interrogent sur l'action politique indépendante de l'action syndicale et des partis traditionnels. La plupart avaient misé sur l'accession des libéraux au pouvoir à Québec et à Ottawa, pour voir se réaliser les [21] réformes jugées nécessaires. Entre autres, les ouvriers croyaient que les libéraux provinciaux de Lomer Gouin lèveraient l'exigence de la propriété foncière pour participer à la gestion municipale [23].
À Montréal, les ouvriers syndiqués comptent maintenant deux conseils centraux et le nombre de syndiqués grossit chaque semaine. Un ex-typographe, J.A. Rodier, devenu représentant de l'Union typographique Jacques-Cartier au CMTM et chroniqueur ouvrier au journal la Presse, est l'instigateur de la création du Parti ouvrier de Montréal sur la base des clubs ouvriers existants et du CMTC. J.A. Rodier a été formé à l'école des Chevaliers du travail. Ni la section montréalaise du Socialist Labor Party, ni les ligues affiliées à la Canadian Socialist League ne sont impliquées dans le projet. La création du PO s'inscrit dans le programme d'action politique adopté par le congrès du CMTC en 1899.
Le programme du PO comporte une série de revendications précises et abandonne la poursuite de valeurs morales qui caractérisait la Déclaration de principes des Chevaliers du travail présentée par A.T. Lépine en 1888 [24]. La Déclaration commençait par l'article suivant : « Faire de la valeur morale et industrielle - non de la richesse - la vraie mesure de grandeur des individus et des nations ». Le programme du PO reprend cependant la majeure partie des demandes immédiates contenues dans la déclaration des Chevaliers du travail et dans les programmes politiques du CMTC et du CMTM [25].
Le Parti ouvrier en tant que parti réformiste ne condamne pas le système capitaliste et ne reconnaît pas la lutte entre les représentants du Capital et les ouvriers comme fondement de ce système. Cependant, ses objectifs politiques se situent en opposition avec les intérêts de la bourgeoisie libérale et du clergé de cette époque.
Les principales revendications du parti peuvent se formuler comme suit : dès 1899, le parti inscrit à son programme l'éducation gratuite et obligatoire et l'abolition, du travail pour les enfants de moins de seize ans ; en 1904, il exige la mise sur pied d'un département de l'Instruction publique pour l'ensemble de la province de Québec, un programme d'assurance-maladie, de pensions de vieillesse et d'assurance-chômage. Pour protéger les ouvriers, le PO exige la suppression des intérêts usuraires, la création d'un tribunal pour les petites causes où il serait possible de se défendre sans avocat, l'abolition du système des baux pour la location des maisons, l'interdiction de saisir les salaires et les meubles de ménage, l'impôt progressif sur le revenu, une loi établissant la responsabilité du patron dans les d'accidents de travail et la [22] journée de huit heures. Pour limiter la concentration du capital, le parti réclame la suppression des banques privées et leur remplacement par une banque d'État, l'interdiction aux municipalités d'accorder des subventions pour l'établissement d'entreprises privées et la nationalisation et la municipalisation de tous les services publics. Il propose l'instauration du suffrage universel, l'organisation de référendums, l'élection des juges par le peuple, l'abolition du Sénat et du Conseil législatif et la liberté absolue de la parole et de la presse.
Bien que le PO ait été formé dès le départ par des syndicalistes, ses organisateurs sont conscients des débats que soulèvent, parmi les ouvriers syndiqués attachés aux formations politiques traditionnelles, l'apparition d'un parti proprement ouvrier. Cherchant d'autre part à rejoindre la masse des travailleurs non syndiqués, il s'attache à conserver ses distances par rapport au CMTM et s'établit sur une base de quartier.
Réunis au sein d'un club ouvrier, les travailleurs élisent un comité exécutif et se dotent d'un local pour leurs activités. Cinq de leurs membres sont élus pour siéger à un comité général, instance dirigeante du Parti ouvrier. Parmi les membres de ce comité sont choisis ceux qui siégeront à l'exécutif du parti. Le Comité général a la responsabilité de décider du choix des candidats qui se présenteront aux élections et d'établir le programme du parti dont le financement est assuré par les cotisations des membres.
Malgré les objectifs du parti de se tenir à l'écart des structures syndicales, il ne parvient à peu près jamais à assurer son recrutement à l'extérieur des syndicats. De plus, créé par des membres des unions internationales, il s'aliène les membres du Conseil national des métiers et du travail en rivalité croissante avec le Conseil des métiers et du travail de Montréal.
À partir de 1906, le Parti ouvrier se rapproche du CMTM qui délègue des représentants au Comité général de telle sorte que s'établit une alternance entre les leaders du PO et ceux du CMTM : nommons à titre d'exemple Gustave Francq, Joseph Ainey, Alphonse Verville, G.R. Brunet et David Giroux. Par ailleurs, les syndicats peuvent être représentés directement au Comité général sans passer par le CMTM ou les clubs ouvriers. En 1914, quelques clubs de salariés agricoles sont admis dans le PO. Plusieurs non-syndiqués adhèrent au parti à la condition d'en signer la déclaration de principes, d'obéir à la constitution et d'être admis sur un vote des deux tiers des membres. C'est ce qui permet à des avocats, médecins, échevins sortants d'obtenir l'appui officiel du parti à des élections municipales, provinciales ou fédérales.
Plusieurs des fondateurs et dirigeants du PO sont passés par le Parti libéral avant de militer dans la formation ouvrière. Ils conservent avec lui des rapports de bon voisinage. Le PO bénéficie même d'un certain appui de la part des libéraux. On peut mentionner à cet effet le bon accueil réservé par la Presse et la Patrie à la formation du PO en 1899 et en 1904 et la part très importante prise dans sa création [23] par J.A. Rodier qui fut chroniqueur aux deux journaux. Alphonse Verville, président du CMTC, élu député fédéral pour le PO le 23 février 1906, prend en Chambre des positions très proches du Parti libéral et reçoit par la suite l'appui plus ou moins direct de celui-ci. Le 17 décembre 1917, il est réélu sous la bannière libérale. Joseph Ainey, du PO, est élu membre du Bureau de contrôle de la ville de Montréal en 1910 alors qu'il fait partie de l'équipe de l'Association des citoyens de Montréal, composée de notables mécontents de l'administration municipale et liée au Parti libéral. En décembre 1916, Alphonse Verville est nommé par le gouvernement provincial de Lomer Gouin à la Commission du tramway chargée de régler le problème de la franchise du tramway à Montréal puis en 1918, devient membre de la seconde commission de contrôle de Montréal. Joseph Ainey, pour sa part, après sa défaite dans l'élection à la mairie de Montréal en 1918, est nommé par Gouin surintendant des bureaux de placement provinciaux puis représentant du gouvernement provincial à la Commission fédérale de placement.
Les rapports entre le PO et le clergé québécois sont moins harmonieux. Le clergé voit d'un mauvais œil la création du PO, issu des unions internationales et a-religieux, et cherche pendant cette période à jeter les bases d'un syndicalisme national et catholique. Pourtant à l'exception d'Albert Saint-Martin et de Gustave Francq le PO s'abstient de soulever toute polémique avec le clergé, conscient du danger qui en résulterait pour l'unité de ses militants.
Cette unité au sein du PO est pourtant rompue à quelques reprises. En 1906 et 1907, le parti expulse de ses rangs des militants socialistes dirigés par le secrétaire du PO, Albert Saint-Martin. Il suit en cela la politique établie par le CMTC. À partir de 1907, le PO refuse de répondre aux invitations des socialistes qui lui demandent de collaborer à l'organisation de la manifestation du 1er mai.
En 1912, un groupe de militants du PO dirigé par J.A. Guérin critique la direction du parti qui, malgré de très maigres résultats, s'obstine à maintenir la participation du PO aux élections provinciales et fédérales. Les dissidents considèrent qu'en laissant l'entière liberté aux membres dans les élections provinciales et fédérales, le parti recevrait un appui plus important au niveau municipal. Le parti exige de ses membres qu'il rompe toute attache avec les partis traditionnels. Devant le refus des dirigeants du PO de modifier la constitution, les dissidents quittent le parti et organisent des clubs ouvriers municipaux qu'ils regroupent dans la Fédération des clubs ouvriers municipaux qui ne s'occupe au départ que de politique municipale. Très rapidement, la FCOM dépasse le PO en nombre de membres.
La lutte contre la conscription fournit à la FCOM une autre occasion d'accroître ses effectifs. Dès que le gouvernement fédéral montre son intention de participer à la première guerre mondiale, la fédération prend clairement position contre toute forme de conscription. Avec les nationalistes et les socialistes, elle organise des assemblées monstres. Le PO, lui, dépend du CMTM qui à son tour attend que le CMTC prenne une position au niveau national. Les dirigeants du PO sont eux-mêmes [24] divisés : Verville est opposé à la conscription et Gustave Francq la défend. Pendant ce temps, la FCOM, les nationalistes, disciples d'Henri Bourassa et les socialistes multiplient les assemblées populaires. Toutefois, ce sont les libéraux qui profiteront du mécontentement populaire au Québec. Ni la FCOM, ni le Parti social-démocrate et ni le nouveau Parti ouvrier du Canada, formé à la veille des élections fédérales par le CMTC [26] dans le but de combattre « légalement » la conscription, ne parviennent à faire élire leurs candidats lors du scrutin fédéral du 17 décembre 1917.
La section de la province de Québec du Parti ouvrier du Canada est formée le 3 novembre 1917. Deux cent huit délégués de cent quatre organisations ouvrières participent à son congrès de fondation. Alors que le PO n'a jamais eu d'organisation à l'échelle de l'ensemble du Québec, n'ayant eu que des contacts épisodiques avec Québec, Saint-Hyacinthe et Buckingham, le nouveau Parti ouvrier du Canada compte au départ des représentants de Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Hull, Sorel, Chicoutimi, Rivière-du-Loup, Thetford Mines, Valleyfield. La section du Québec du POC est dirigée par un exécutif comprenant neuf vice-présidents afin d'assurer une représentation de toutes les régions. Les délégués, qui procèdent à sa fondation, viennent de syndicats, de clubs ouvriers, de la FCOM, de sociétés coopératives, du PSD et du PSC. Les cercles agricoles invités à participer au POC délèguent deux représentants.
Le nouveau parti reprend intégralement le programme du PO de Montréal en y ajoutant un préambule nettement plus à gauche. Le but du parti est défini comme étant « d'organiser, instruire et consolider le vote ouvrier dans la province de Québec afin de coopérer avec les autres provinces pour en arriver à une unité d'action politique dans tout le Canada et de procurer à ceux qui peinent le fruit de leur labeur ainsi que la reconnaissance de la lutte de classe pour défendre l'organisation sur le terrain politique et industriel à la seule fin de remettre à la classe ouvrière les ressources naturelles et les moyens de production ». Joseph Ainey est élu président de la section québécoise du POC et Joseph Schubert, du Parti social-démocrate du Canada, trésorier.
Le 12 mai 1918, une assemblée de Montréal du POC est formée. Joseph Métivier en est élu président et une socialiste, Bella Hall, deuxième vice-présidente [27]. Les autres formations ouvrières du Québec prennent position devant la création du POC. Le PO de Montréal, dès le 2 décembre 1917, vote son affiliation au nouveau parti et avec la formation en mai 1918, de l'Assemblée de Montréal, il se saborde. Le PSD, section du Québec, s'affilie à la nouvelle organisation dans le même mois. Enfin, le 22 avril 1918, la Fédération des clubs ouvriers municipaux vote elle aussi son affiliation.
7. Quelques orientations de recherche

Nous aimerions signaler quelques-unes des questions clés qui orientent notre étude des débuts du mouvement politique ouvrier. Il ne s'agit point de tenter de trancher d'entrée de jeu, mais simplement de souligner que nous entendons les aborder au fur et à mesure que progressera la recherche. En voici donc quelques-unes : quel rapport y a-t-il eu entre l'émergence de la classe ouvrière et l'apparition du mouvement ouvrier ? Quels sont les traits les plus saillants de l'évolution de la composition de la classe ouvrière au Québec ? Quels ont été ses rapports avec les petits producteurs agricoles et urbains ? De quelle manière l’inégalité de développement socio-politique de différentes catégories de travailleurs s’est-elle exprimée à différentes époques ? Quelles ont été les conditions et les facteurs d’émergence d’une conscience de classe politique et d'une idéologie socialiste à l'intérieur du système capitaliste dans sa phase de transition depuis le capitalisme concurrentiel jusqu'au capitalisme monopoliste ? Quel a été l'impact des mouvements socialistes américains, anglais, français et anglo-canadiens dans la formation au Québec de cette conscience de classe politique ? Comment le catholicisme social, avec ses origines européennes, a-t-il canalisé idéologiquement la conscience ouvrière ? De quelle façon, avec quelle envergure, le rapport dialectique entre la question nationale et les questions sociales a-t-il traversé le mouvement ouvrier québécois ? Quelles sont les conditions objectives de travail et de vie des travailleurs québécois qui interviennent de façon significative pour expliquer l'évolution des rapports capital/travail ?
Les éléments rassemblés dans les documents devront permettre aux chercheurs d'aborder l'analyse de la conscience de classe des leaders ouvriers et d'identifier la pratique politique des responsables syndicaux. À partir de l’examen du contenu des interventions des leaders et des prises de position de quelques organisations du mouvement ouvrier il serait important d'essayer d'évaluer l'impact réel de ces interventions sur le milieu socio-économique québécois ; de pondérer le degré de mobilisation des masses ouvrières du secteur industriel dont l'idéologie et la pratique demeurent difficiles à cerner.
[1] Jean Bruhat, « Science historique et action militante », dans la Pensée, no 160, p. 38.
[2] Report of the Trade and Commerce of the City of Montreal for 1863, p. 60, 99.
[3] The Journal of Duncan McGillivray of the North West Company at Fort George on the Saskatchewan, 1794-1795. With introduction, notes and appendix by Arthur S. Morton, Toronto, 1929, p. 6.
[4] Jean Hamelin, « Lanctôt, Médéric » dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. x (de 1871 à 1880), Québec, PUL, 1972, p. 461-466. Richard Desrosiers et Denis Héroux, le Travailleur québécois et le syndicalisme, Montréal, PUQ, 1973.
[5] Fernand Harvey, la Commission royale d'enquête sur les relations du capital et du travail - 1886-1889, thèse de doctorat, Université Laval.
[6] Id., « les Chevaliers du travail, les États-Unis et la société québécoise (1882-1902) » dans F. Harvey, éd., Aspects historiques du mouvement ouvrier au Québec, Montréal, Editions du Boréal Express, 1973, p. 33-188. Voir le document n° 1.
[7] Jacques Rouillard, « l'Action politique ouvrière 1899-1915 », dans Idéologies au Canada français 1900-1929, Québec, PUL, 1974, p. 267-312. [Texte disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
[8] Que fait-on avec les profits accumulés, ceux qu'on ne réinvestit pas ? M. Andrew Gault a légué aux gradués de l'Université McGill sa « possession la plus précieuse » : le Mont Saint-Hilaire. On peut le lire (en anglais, bien sûr !) sur une plaque commémorative située au bord du petit lac (privé) qui se trouve au milieu du boisé au sommet de la montagne. Les conditions de famine de ses travailleurs du moulin de coton à Valleyfield expliquent en bonne partie le geste olympien qu'a pu se permettre leur patron.
[9] Martin Robin, Radical politics and Canadian Labour. 1880-1930, Kingston, Queen's University Industrial Relations Centre, 1968, chap. VII, p. 92-103.
[10] Voir le document n° 2.
[11] Elizabeth Armstrong, dans The Crisis of Quebec 1914-1918 (Toronto, McClelland and Stewart, « Carleton Library » n° 74, 1974) fait allusion à « the very vehement opposition to conscription... prevalent among farmers, not only in Quebec, but also in Ontario »; et constate : « It is not without significance... that active opposition to the war began and was most notable... among the young industrial population of Montreal.» p. 133, 239.
[12] Voir les documents n° 25 et 26.
[13] Voir le document n° 34.
[14] Voir Martin Robin, op. cit., chap. XI : « The Western Revolt : 1919 », p. 160, 177.
[15] Alain Sylverman, « The Quebec Working Class Movement and the Winnipeg General Strike », texte ronéotypé, avril 1974 (à paraître).
[16] Jacques Martin, les Chevaliers du travail et le syndicalisme international à Montréal, thèse de M. A. (relations industrielles), Université de Montréal, 1965.
[17] Voir le document n° 5 et Jacques Rouillard, « le Québec et le Congrès de Berlin (Ontario) - Étude du rôle des Québécois dans la scission en 1902, du mouvement syndical canadien en deux tendances, l'une nationale, l'autre internationale », communication présentée au Congrès de l'Institut d'histoire de l’Amérique française, en octobre 1975.
[18] Voir R. H. Babcock, Gompers in Canada, a Study in American Continentalism before the First World War, Toronto, University of Toronto Press, 1974, 292 pages.
[19] Martin Robin, op. cit, chap. V, p. 62-78.
[20] Les partisans du Socialist Labor Party étaient d'autant plus embarrassants pour les dirigeants de la FAI qu'en plus de combattre le principe de « no politics in the unions and no union in politics », ils condamnaient aussi au nom de la base le syndicalisme de métier et réclamaient une restructuration de la centrale sur la base du syndicalisme industriel.
[21] Voir le document n° 6.
[22] Voir le document n° 25.
[23] Sur la fondation du PO, voir Jacques Rouillard, op. cit. Pour l'ensemble des activités du PO, voir aussi J.-M. Montagne, le Parti ouvrier, Montréal, 1899-1919, Montréal, UQAM, texte dactylographié, hiver 1973, 26 pages.
[24] A.T. Lépine est élu député fédéral en 1888 et crée le Trait d'union, journal officieux des Chevaliers du travail qui publie la Déclaration des Chevaliers.
[25] Voir le document n° 1.
[26] Voir Martin Robin, op. cit, chap. IX : « The Canadian Labor Party :1916-1917 », p. 119-137.
[27] Voir C. Vance, Not by gods but by people, Toronto, Progress Publishers, 1970 : une biographie de Bella Hall-Gould.
|

