Maurice Cusson
[professeur à l’École de Criminologie, chercheur au Centre international
de Criminologie comparée de l’Université de Montréal]
“Peines intermédiaires,
surveillance électronique
et abolitionnisme”.
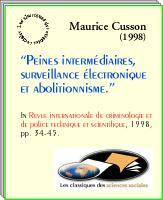 Un article publié dans Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 1998, no 1, 34-45. Un article publié dans Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 1998, no 1, 34-45.
- Résumé / Summary
-
- Introduction
-
- 1- Conservatisme populaire et conservatisme abolitionniste
-
- 2- Mise au point sur les peines intermédiaires et la surveillance électronique.
-
- Références
RÉSUMÉ

Les peines intermédiaires (réparation à la victime, supervision intensive, assignation à domicile...) qui se situent entre la prison et la probation peuvent mieux exprimer que d'autres peines la gravité de la moyenne délinquance. Elles participent d'un idéal de justice et de modération. Et pourtant elles sont sous-utilisées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont coincées entre un conservatisme populaire poussant à la sévérité et un conservatisme abolitionniste qui les discréditent en faisant mine de s'attaquer à la surveillance électronique et en s'appuyant sur la métaphore de l'élargissement du filet pénal. Cette thèse prête flanc à une réfutation en quatre points. 1- Elle ignore la possibilité que l'augmentation des peines soit due à l'augmentation de la criminalité. 2- Elle ne tient pas compte de la raison d'être des sanctions intermédiaires : punir plus justement et plus modérément. 3- Elle est contredite par l'observation empirique. 4- Elle repose en dernière analyse sur l'espérance utopique d'un monde meilleur où les notions mêmes de crime et de peine seraient nulles et non avenues.
SUMMARY

Intermediate punishments (restitution, intensive supervision or home confinement) falling between prison and probation are well suited for offenses of intermediate severity. Their contribution to modération and just désert is obvious. But they are under-developped and under-used. Why ? Because they are caught between a populist conservatism pressing for severity and a abolitionist conservatism which, under the guise of attacking electronic supervision, attacks every intermediate sanctions, arguing that they hâve a net-widening impact. This argument is open to four rebuttals. 1- It does not consider the possibility that the increasing number of punishments are the simple resuit of increasing crime rates. 2- It forgets that the main justification of intermediate punishment is just désert and modération. 3- It does not fit to empirical évidence. 4- It rests on the utopian hope of a world where the very concepts of crime and punishment would be banned.
INTRODUCTION

Face à la moyenne délinquance, nos systèmes pénaux sont mal adaptés parce que trop polarisés. L'individu trouvé coupable d'un délit modérément grave risque d'être puni soit par la prison ferme, soit - plus probablement - par une peine symbolique comme un sursis, une probation ou une faible amende. [1] Rarement sera-t-il sanctionné par une mesure qui se situerait entre le presque tout de l'incarcération et le presque rien des mesures trop douces ou trop mal exécutées pour être prises au sérieux par les délinquants, les victimes et le public. Oscillant entre un excès de sévérité et un excès de clémence, les juges semblent impuissants à graduer la sévérité de la peine à la gravité du délit et au risque que représente le délinquant intermédiaire. Et pourtant cela fait des années que, de propositions en expérimentations, se développe et s'affine une théorie des peines intermédiaires (ou moyennes). Les criminologues entendent par là les mesures pénales plus sévères que la probation et moins que la prison : surveillance intensive, réparation du préjudice causé à la victime, amendes substantielles, assignation à domicile, travaux d'intérêt général (communautaires), maison de transition... (Morris et Tonry, 1990 ; Byrne, Lurigio et Petersilia, réd., 1992). Une volonté de rigueur inspire les partisans de ces mesures : la surveillance est systématique et continue ; si les conditions de la probation ne sont pas respectées, le risque d'incarcération est bien réel ; on vérifie que les dédommagements soient bien versés à la victime ; les amendes sont effectivement perçues et l'on s'en donne les moyens. Ces peines nouvelles supposent l'accord minimal du délinquant parce qu'elles ne peuvent généralement pas fonctionner sans sa collaboration (Pradel, 1995 :585). Autre particularité, sous une seule étiquette, une sanction intermédiaire est souvent faite d'une mixture de plusieurs ingrédients. C'est ainsi qu'une mesure de probation intensive peut comporter : 1- l'obligation de réparer le dommage causé, 2- une ordonnance de traitement, 3- l'obligation de rester à la maison durant certaines heures de la soirée et de la nuit, 4- une prestation de travail communautaire.
Bien que sous-utilisée, la réparation du dommage causé à la victime est la mesure qui apparaît la plus évidemment juste et la moins contestable. Le condamné est astreint à l'obligation de restituer, de verser des dommages-intérêts, de s'excuser ou d'indemniser sa victime. L'origine de l'idée se perd dans la nuit des temps. Les philosophes de l'antiquité parlaient à ce propos de justice corrective : il est juste que le délinquant corrige le tort qu'il a fait subir à sa victime, il perd ainsi le profit mal acquis et il peut difficilement nier le caractère juste et équitable de l'obligation. Plus important encore, la victime est rétablie dans son bon droit : le préjudice qu'elle a subi est annulé ou du moins compensé. Selon Neys et Peters (1996), la réparation devrait être une « valeur fondamentale de l'administration de la justice pénale qui peut ainsi accomplir l'oeuvre de paix que la société attend d'elle. » (p. 23). (Voir aussi Peters et Aertsen, 1995). Ils insistent aussi sur le fait que la réparation garde le criminel en contact avec son crime et l'interpelle sur sa responsabilité vis-à-vis de sa victime.
La surveillance intensive s'exerce dans le cadre de la probation ou de la libération conditionnelle. Elle consiste à imposer au condamné des conditions contraignantes et des vérifications systématiques. La mesure repose sur l'idée que la faiblesse humaine étant plus manifeste chez certains délinquants que chez d'autres, ceux-ci seront portés à se mieux conduire s'ils se savent suivis de près. La surveillance s'exerce par des moyens divers : appels téléphoniques fréquents, visites impromptues à domicile, tests divers (alcootest, analyse d'urine...), rencontre avec la famille ou l'employeur du contrevenant, surveillance électronique, etc. Le principal effet recherché est une neutralisation en souplesse. La mesure permet aussi d'infliger une punition qui consiste à limiter la liberté d'aller et venir du condamné. Elle peut exprimer avec justesse la gravité de son acte sans pour autant le faire souffrir atrocement.
L'assignation à domicile est une mesure très proche de la surveillance intensive et souvent les deux vont de pair. L'obligation de rester à la maison, non pas tout le temps, mais durant les heures prescrites comme le soir, la nuit et les fins de semaines est d'ailleurs une condition commune des ordonnances de probation ou de libération conditionnelle. Dans certains cas, elle devient une peine en elle-même. La notoriété récente des arrêts domiciliaires tient au fait qu'ils ont été associés à la surveillance électronique. Pour vérifier que le contrevenant est bien à la maison quand il devrait l'être, on fixe à sa cheville un émetteur miniaturisé (« le bracelet ») qui transmet des signaux à un ordinateur central par l'intermédiaire de la ligne téléphonique. La surveillance électronique ne devrait pas être considérée comme une sanction pénale à elle seule : elle est plutôt un moyen parmi d'autres de faire respecter les conditions des peines non carcérales ; elle fournit un support technique à la surveillance et aiguise la vigilance de l'agent ayant la responsabilité de suivre le condamné.
Les peines intermédiaires ont été « vendues » comme des moyens de contenir la surpopulation carcérale et de réaliser des économies. En réalité, leur raison d'être repose sur des considérations plus fondamentales, et d'abord la simple justice : elles sanctionnent plus équitablement les délinquants intermédiaires que la prison ou la probation. La justice qui, dans son principe, est équilibre, mesure et proportionnalité, sera mieux servie par un éventail complet de peines que par une gamme étriquée et polarisée d'options. Étoffer la zone médiane de l'éventail des mesures pénales donnera au juge le moyen de mesurer plus finement la sévérité de la peine à la gravité de l'acte : ni trop ni trop peu. Une peine modérément sévère sanctionnant un délit modérément grave paraîtra plus juste aux yeux des intéressés et du public que les sentences ayant cours actuellement. Ainsi la justice et l'utilité seront-ils mieux servis. Car il est juste qu'il y ait commune mesure entre le délit et la peine ; et il est utile que les tribunaux criminels redisent sans cesse à tous ce qui est grave et ce qui l'est moins. Des sentences finement graduées font oeuvre pédagogique ; elles disent la vérité du crime jugé en parlant le langage de la sévérité, gravant ainsi dans les esprits l'obligation de se retenir du crime avec d'autant plus d'applications qu'il est plus grave. Sans peines moyennes, comment exprimer la gravité de la moyenne délinquance qui est le pain quotidien de nos tribunaux ?
Ces sanctions aideront aussi la justice pénale à retrouver la crédibilité qui lui fait cruellement défaut. Les sondages démontrent à satiété que les simples citoyens trouvent que les juges ne sont pas assez sévères. Des sanctions qui afficheraient une sévérité réelle sans être excessive rétabliraient une apparence de justice qui ne soit pas de pure apparence. (C'est ce que les criminologues américains ont fort bien vu : voir Lurigio et Petersilia, 1992 ; Tonry et Lynch, 1996).
Même si ces sanctions sont de vraies peines, elles ne risquent cependant pas, comme l'incarcération, de briser la vie du coupable. Obligé de réparer, soumis à des contrôles stricts, forcé de rester à la maison le soir, ce dernier encours de véritables désagréments tout en échappant à l'univers carcéral. Les peines moyennes donnent le moyen de punir sans détruire.
Finalement, ces sanctions réalisent une neutralisation non-carcérale dont les doses peuvent être graduées selon l'état du délinquant. S'il s'améliore, la surveillance peut être relâchée, s'il se détériore, elle peut être resserrée. Elle peut aussi être individualisée. Il est raisonnable de penser que maints délinquants céderaient à la tentation si on leur laissait la bride sur le cou alors qu'ils pourraient en être empêchés autrement que par l'artillerie lourde de la prison.
Ces raisons auraient dû emporter la conviction depuis longtemps et les sentences communautaires auraient dû fleurir partout. Il n'en est rien. Les mesures de réparation du tort causé à la victime sont scandaleusement sous-développées. Sauf aux États-Unis, la surveillance intensive est confinée à la confidentialité des tentatives expérimentales. Quand à la surveillance électronique, discréditée par le choeur des belles âmes, elle tarde à se développer dans la francophonie malgré des débuts en France et en Suisse. Il reste le travail d'intérêt général et les maisons de transition pour être relativement bien développés.
En la matière, le Québec se singularise par son refus de l'innovation. Alors qu'aux États-Unis, en Colombie-Britannique, en Ontario et en France le bracelet électronique s'implante peu à peu, nos autorités le bloquent en un combat d'arrière-garde qui nuit à toutes les mesures intermédiaires (voir Pratte - La Presse, mardi 9 avril 1996). Le système correctionnel québécois fait figure de dinosaure fonctionnant selon la logique primitive du tout des longues peines de prison et le quasiment rien d'une probation amorphe.
Pourquoi les peines intermédiaires sont-elles à ce point sous-exploitées ? La réponse qui sera proposée dans cet article est qu'elles sont coincées - comme souvent le sont les positions de juste milieu - entre deux outrances : d'un côté ; les pressions populaires qui poussent les juges à incarcérer de peur de paraître laxistes et, de l'autre, les abolitionnistes qui, sous couvert de lutte contre la surveillance électronique, s'attachent à discréditer l'ensemble des peines intermédiaires. La suite de l'article est divisée en deux parties. La première examine le conservatisme populaire et le conservatisme abolitionniste en montrant comment ils s'unissent en un combat douteux pour bloquer l'avènement des peines moyennes. La deuxième fait l'état des connaissances sur les sanctions intermédiaires et la surveillance électronique en un effort pour dissiper les demi-vérités et les faussetés qui ont été colportées à leur propos.
1- Conservatisme populaire
et conservatisme abolitionniste

Il ne faut pas chercher loin le premier facteur du sous-développement des peines modérément sévères : c'est la demande pénale populaire faisant pression sur les juges et les poussant à trancher en faveur de l'incarcération. Divers sondages ont établi que les simples citoyens trouvent que les juges ne prononcent pas de peines assez sévères et que les sentences qu'ils proposeraient sont plus sévères que celles que prononcent les juges (Tremblay, 1994 ; Tremblay et coll. 1994). À ce facteur s'ajoute le scepticisme partagé par les juges et le public quant à la valeur punitive de la probation telle qu'elle est pratiquée. Ils ont l'impression qu'elle est faite d'une surveillance si douce, si relâchée et si occasionnelle qu'elle ne peut être reconnue comme une vraie punition (Tremblay et coll. 1987). Quand un accusé est trouvé coupable d'un délit moyennement grave et qu'il n'en est pas à ses premières armes, le juge sentira que la victime et les autres spectateurs assis dans la salle d'audience attendront de lui qu'il incarcère. Il s'y sentira en quelque sorte contraint par les faits de la cause qu'il juge et par la demande pénale que le procureur exprime ouvertement et que les spectateurs du procès font sentir silencieusement. Les juges craignent aussi de se faire rudement rappeler à l'ordre sur la place publique quand un criminel insuffisamment puni commet ensuite un viol ou un meurtre. La crainte de subir la tempête médiatique que provoque de telles bavures dissuade sans doute la plupart des juges de confier à des agents de probation surchargés des condamnés qui n'ont pas encore commis de crime grave mais qui pourraient en commettre. Les juges accepteraient plus souvent de prendre un tel risque s'ils avaient l'option d'une mesure communautaire assurant une surveillance rigoureuse des condamnés. Et ils seraient en droit de se demander : pourquoi les systèmes correctionnels traînent tant à la leur offrir ?
La réponse se trouve dans l'habile travail de sape réalisé par les abolitionnistes et leurs alliés. Au Québec, ils ont fait sentir leur influence autant dans les organismes communautaires que dans le Ministère de la Sécurité publique pour mousser une opposition qui a neutralisé la plupart des efforts pour développer des peines intermédiaires. Mais, ne pouvant les attaquer ouvertement, ils ont utilisé la critique de la surveillance électronique comme cheval de Troie. Nous verrons que les arguments utilisés par les abolitionnistes pour discréditer la surveillance électronique valent mutatis mutandis pour la plupart des sentences intermédiaires. Au Québec, c'est Landreville (1987 et 1994) qui a orchestré cette attaque. Lui ont emboîté le pas les épigones et les répétiteurs à l'Association des Services de réhabilitation sociale et à la Direction générale des services correctionnels du Ministère de la Sécurité publique. [2]
La surveillance électronique, soutient Landreville, permet de dispersion et la diffusion du contrôle social. Selon la métaphore courante, elle contribue à l'élargissement du filet pénal. « Le contrôle électronique pourrait s'appliquer à des contrevenants qui n'auraient été soumis à aucun contrôle » (1987 :255). Il ne serait pas utilisé comme solution de rechange à l'incarcération mais viendrait s'y ajouter (p. 258). Conséquence : « le filet du contrôle social s'élargit. Il se diversifie et ses mailles deviennent plus serrées » (p. 255). La technologie donne donc « un nouvel élan au mouvement actuel du contrôle social » (1994 : 55). Elle permet au pouvoir de s'exercer « selon des modalités plus raffinées et plus discrètes mais de plus en plus systématiques, intensives et extensives » (p. 55). « Ne sommes-nous pas, demande-t-il, devant une technologie qui permettra la réalisation du panoptique de Bentham ? » (p. 56). Et encore si ces contrôles étaient moins coûteux que les anciens ! Mais comme la fréquence des incarcérations se maintient et que la surveillance électronique est plus coûteuse et plus punitive que la probation ou l'amende, elle ajoute des coûts supplémentaires au système. « La surveillance électronique serait une restriction supplémentaire de la liberté plus coûteuse et moins humaine que la mesure qui aurait été imposée autrement » (1987 : 256).
Ce n'est pas un hasard si ces critiques ne valent pas seulement pour la surveillance électronique mais aussi pour l'ensemble des sentences intermédiaires. L'élargissement du filet pénal et la surpénalisation ? La surveillance intensive, les mesures réparatrices, les travaux communautaires, les maisons de transition sont des mesures plus rigoureuses, plus sévères et plus contrôlantes que la probation traditionnelle et elles s'appliqueraient à des individus qui jouissent actuellement d'un sursis ou d'une sentence de probation. Les coûts supplémentaires ? Il est évident que la gestion de ces mesures exigera plus de personnels et de ressources que la probation ou, a fortiori, l'amende.
Finalement, prophétise Landreville (1994), cette technologie est la porte ouverte à la « société de surveillance généralisée » (p. 58). En effet, « elle permet une intrusion considérable et continue dans la vie sociale et personnelle de l'individu » (p. 56). Elle pourrait être combinée à des « implants qui permettraient de détecter automatiquement la présence d'alcool ou de drogue » (p. 57). Elle permettrait de suivre le délinquant « à la trace partout où il ira » (p. 55), d'écouter et d'enregistrer les conversations, de surveiller par caméra vidéo et de contrôler tous les déplacements des gens (p. 59).
L'agenda qui est derrière cette charge contre la technologie n'est absolument pas caché : c'est l'abolitionnisme. Landreville (1986 : 25-26) est révolté par ce qui est dans la nature même du système pénal : distribuer des peines et produire délibérément de la souffrance pour sanctionner ce que d'aucuns appellent « crimes ». « Il faut renoncer à imposer de la souffrance pour « solutionner » les situations problèmes » (p. 25). Tout l'appareil pénal repose, selon lui, sur des bases contestables : la notion de crime ne renvoie pas à une réalité en soi mais n'est qu'un construit socio-juridique artificiel et les peines sont des souffrances inutiles qui aggravent l'inégalité dans la société. Tout cela devrait disparaître. « L'objectif final à long terme est l'abolition du système pénal, l'abolition de l'utilisation de la peine par l'État, l'abolition de tout système répressif, l'abolition des rapports de domination et d'exploitation. » (p. 26). L'attaque contre la surveillance électronique et, par ricochet, contre les peines moyennes n'est donc qu'une partie d'un plan d'ensemble visant la destruction du système pénal, et, naïveté supplémentaire, de tout rapport de domination dans la société.
Logiques avec eux-mêmes, les abolitionnistes récusent toute vision réformiste du système correctionnel. Logiques avec leur contestation de la notion de crime, ils refusent de s'intéresser au criminel, à la criminalité, aux victimes, à l'insécurité et à la justice pénale. Ils n'écrivent jamais sur ces questions sauf pour en contester la validité. Ils font semblant de vivre dans un monde où la demande de sécurité et de justice de la société civile n'est que le fruit d'une manipulation de la droite. Dans ce monde-là, l'idée que les délinquants intermédiaires subissent les sanctions intermédiaires qu'ils méritent est irrecevable. Aussi est-il curieux qu'en son temps, le Ministère du Solliciteur général du Québec ait demandé à Landreville de présider un comité d'étude sur « les solutions de rechange à l'incarcération » (1986b). C'était comme demander à un marxiste-léniniste de présider un comité sur la dénationalisation des sociétés d'État.
Dans le système correctionnel pour adultes du Québec, les manoeuvres abolitionnistes ont été d'une efficacité dévastatrice. La réparation aux victimes est au point mort ; la surveillance intensive piétine dans des expériences sans lendemain et la surveillance électronique est frappée d'un véritable tabou. Comment une idéologie discréditée par ses propres excès peut-elle se targuer d'un tel succès ? Tout d'abord en infiltrant quelques services de réadaptation et les services correctionnels du Ministère de la Sécurité publique. Ensuite, par un habile jeu d'alliances avec les administrateurs forcés de sabrer dans les dépenses et avec les agents de probation. Aux premiers, le discours sur l'élargissement du filet pénal et l'augmentation consécutive des coûts fournissait des arguments pour bloquer les projets de peines intermédiaires. Aux seconds, il apportait des prétextes pour s'opposer à une évolution qui menaçait leur pouvoir discrétionnaire. En effet, les systèmes de surveillance intensive -électroniques ou non - imposent aux praticiens une rigueur, une vigilance et une obligation d'intervenir plus contraignantes que dans la probation et la libération conditionnelle traditionnelles. Aux États-Unis, les programmes de probation intensive soumettent les agents à des plans écrits de supervision comptabilisant le temps qu'ils devront consacrer pour chacun des sujets dont ils ont la charge (Clear et Braga, 1995). De ce point de vue, la surveillance électronique, c'est l'horreur : les escapades du délinquant laissent des traces sur le disque dur ; si l'agent ne fait rien, cela se saura. L'électronique surveille aussi bien le délinquant que son agent de probation ou de libération conditionnelle. Ce dernier a donc d'excellentes raisons de s'y opposer : sa marge de manoeuvre est en jeu. Et elle n'est pas mince : au Canada 5/6 de la sentence prononcée par le juge échappe au contrôle judiciaire et relève de décisions administratives prises par des agents de libération conditionnelle, d'agents de gestion de cas, de directeurs de prison ou de gardiens-chef. (Il est d'ailleurs étrange que les juges canadiens aient laissé filer entre leurs doigts ce pouvoir qui, ailleurs, relève du judiciaire).
2- Mise au point sur les peines intermédiaires
et la surveillance électronique.

On trouve dans l'argumentation abolitionniste sur les sanctions intermédiaires un mélange de vérités, de demi-vérités et de faussetés qu'il importe de départager.
Il faut d'abord convenir que les peines intermédiaires ne réaliseront pas les promesses faites par des promoteurs trop zélés qui les ont « vendues » en prétendant qu'elles feraient baisser la population carcérale, les dépenses correctionnelles et la récidive. C'était trop beau pour être vrai. « There is no free lunch » (Tonry et Lynch, 1996). Si les sanctions intermédiaires coûtent moins cher que la prison, elles coûtent plus cher que la simple probation et comme elles ne font pas nécessairement baisser la population carcérale, elles ne génèrent pas d'économie à l'échelle de tout le système.
Par principe, les abolitionnistes ne sont pas intéressés à l'impact des peines intermédiaires sur la récidive. Il faut pourtant en parler. L'évaluation la plus convaincante des effets de la surveillance intensive sur la récidive a été réalisée par la Rand Corporation (Petersilia et Turner, 1994). Quatorze programmes de surveillance intensive furent évalués. Les groupes expérimentaux étaient formés de délinquants placés par allocation au hasard en surveillance intensive dans le cadre d'une mesure de probation, de libération conditionnelle ou de déjudiciarisation. Les sujets des groupes contrôle étaient placés dans des mesures traditionnelles de probation, libération conditionnelle ou prison. L'intensité de la surveillance se concrétisait par la fréquence des contacts directs, par téléphone et par des tests de drogue. La surveillance électronique était aussi utilisée dans certains programmes. Après un follow-up d'un an, les sujets placés en surveillance intensive ont un taux d'arrestation pour un nouveau délit de 37% comparé à 33% dans le groupe contrôle ; la différence est non significative. Les délinquants des programmes intensifs ne se distinguent pas de ceux qui sont dans les programmes ordinaires comme la probation par les pourcentages d'arrestations ; ils ne récidivent pas plus tard et ils ne sont pas arrêtés pour des délits moins sérieux. Par ailleurs, la surveillance intensive est associée à beaucoup plus de violations techniques, c'est-à-dire de non-respect des conditions de la probation ou de la libération conditionnelle, l'infraction la plus fréquente étant de consommer de la drogue. Signalons enfin que les sujets en surveillance intensive participaient mieux que les autres aux programmes de traitements. « L'effet zéro » signalé très souvent quand le chercheur compare des mesures pénales s'observe ici comme ailleurs : les différences entre les taux de récidive de groupes de délinquants comparables ayant subi des sanctions différentes se rapprochent de zéro. Un résultat semblable vaut aussi avec les travaux communautaires (Petersilia, Lurigio et Byrne, 1992 ; Tonry et Lynch, 1996).
Si les peines intermédiaires ne font pas baisser significativement la récidive post-pénale, leur capacité de contrôler la délinquance pendant qu'elles s'exercent paraît bien réelle. Quand la surveillance est véritablement intensive, les agents détectent un nombre relativement élevé de bris de condition et ils peuvent alors intervenir précocement (en réincarcérant ou autrement) pour empêcher que la situation ne se détériore jusqu'au point où un acte grave risque d'être posé (Lurigio et Petersilia, 1992). Une surveillance intensive (utilisant ou non l'électronique) a donc probablement une action neutralisante : le délinquant est empêché de se laisser glisser sur la pente qui l'aurait peut-être fait tomber de nouveau dans le crime. C'est dire que l'efficacité des sanctions intermédiaires à forte dose de surveillance tient plus à la neutralisation qu'à la réhabilitation : elles préviennent les crimes pendant qu'elles sont en vigueur et non après. Mais en définitive, la principale raison pour laquelle les peines intermédiaires sont mises de l'avant relève - nous l'avons vu - de la justice : elles permettent de mieux mesurer la sévérité de la peine à la gravité du délit.
La thèse de l'élargissement du filet pénal ignore délibérément l'autre face du problème : la quantité et la gravité des crimes commis dans une juridiction. En effet, comment peut-on traiter la quantité des peines indépendamment de la quantité des crimes qui, après tout, sont les premiers déclencheurs de la décision de punir ? Sauf à prétendre qu'un système pénal distribue des peines aveuglément et au même rythme quelque soit l'état de la criminalité, il faut convenir qu'il s'établit un minimum de rapport entre les crimes et les peines. Si les populations pénales se mettent à augmenter, l'hypothèse la plus raisonnable est que c'est en réponse à une augmentation de la criminalité. Et s'il y a augmentation parallèle et proportionnelle entre le volume des peines et celui de la criminalité, rien n'autorise à prétendre que le système « surpénalise ».
Même en mettant entre parenthèse la criminalité, l'hypothèse selon laquelle le filet pénal ne cesse de s'élargir prête flanc à une critique empirique d'abord, normative ensuite. Derrière la métaphore se profile la théorie selon laquelle le système correctionnel serait un univers en expansion continue ajoutant inexorablement encore plus d'individus sous sa coupe. Une loi naturelle voudrait que, les populations carcérales ne diminuant jamais, toute nouvelle mesure communautaire ne ferait que rendre le système capable de contrôler un nombre plus grand de sujets. Il se pourrait qu'une telle progression se produise mais la question est empirique et historique : est-il vrai, dans tel pays, durant telle période de son histoire, que le nombre total de délinquants soumis à une peine quelconque augmente ? McMahon (1992) a consacré un livre à l'étude de l'évolution des populations pénales en Ontario au cours des années 1950, 1960 et 1970. Au terme d'une analyse fouillée, elle démontre que, dans cette province canadienne, le nombre d'admissions dans les prisons a baissé de 31% et le nombre de détenus incarcérés en un jour donné a baissé de 20% entre 1951 et 1983. Ces diminutions sont attribuables à la chute du nombre des courtes sentences. Or il se trouve que ce recul de l'incarcération n'a pas été compensé par une augmentation de la probation ou d'autres mesures communautaires. Même en additionnant les admissions en prison et en probation, les populations pénales de l'Ontario ont décru, le moment fort de cette décroissance se situant entre 1971 et 1976. Par ailleurs, les sanctions intermédiaires comme les travaux communautaires et les mesures réparatrices étaient exécutées dans le cadre d'une ordonnance de probation : elles ne s'ajoutaient pas au nombre de sujets comptabilisés en probation. Le filet pénal s'est donc rétréci en Ontario au cours de l'après-guerre. Le recul de l'incarcération dans cette province s'explique surtout par une forte diminution des admissions en prison pour non-paiement d'amendes sanctionnant l'ivresse sur la voie publique. En effet, au cours des années 1950, la moitié des admissions en prison étaient liées à l'ivresse sur la voie publique ; cette proportion tombe à 14% au début des années 1980. Bien que la probation servit occasionnellement d'alternative à la prison, c'est surtout le changement dans la gestion de l'ivresse en public qui fit chuter le nombre des incarcérations. McMahon conclut qu'il est possible de faire baisser les populations pénales et que la théorie du filet pénal n'est pas seulement démentie par les faits, elle a pour autre inconvénient d'enfermer les criminologues critiques dans une impasse pratique, les forçant à se dire que, quoi qu'on fasse, l'emprise du pénal sur la société croîtra inexorablement.
Si l'expansion des populations pénales n'a rien d'inéluctable, il n'y a par contre pas de raisons pour lesquelles elle ne se produirait pas ici ou là. Il se pourrait même qu'un éventuel développement des peines intermédiaires ne fasse pas baisser les populations carcérales et fasse augmenter le contrôle global du pénal sur les délinquants. Pourquoi ? Non pas parce que les juges seraient habités par une compulsion à incarcérer mais parce qu'ils ont déjà tendance à n'incarcérer qu'en dernier recours. En France, au Canada, en Angleterre et ailleurs, l'idée selon laquelle la prison « ne doit être appliquée que lorsqu'elle est absolument nécessaire à l'ordre public » est bien ancrée dans les lois et la jurisprudence (Pradel, 1995 :605-7). Dans la recherche sur le jugement pénal réalisée à Montréal, Tremblay et coll. (1987 :87) constatent que les acteurs judiciaires ne prescrivent des peines carcérales que « lorsque la sévérité de la sentence qu'ils désirent infliger est trop élevée pour qu'elle puisse être monnayée légitimement en sentences non-carcérales ».
Dans le même ordre d'idée, Morris et Tonry (1990, p. 224 ss) expliquent que quand les seules options ouvertes au juge sont la prison et une probation nominale, le souci de clémence et de modération le poussent à pencher pour la probation à chaque fois qu'il hésite entre les deux. La création de sanctions intermédiaires le sort de ce dilemme : il n'a plus à prononcer une sentence trop clémente quand la prison lui paraît une punition un peu trop sévère. Et, tout naturellement, ce juge utilisera les sanctions intermédiaires pour les cas qu'il plaçait auparavant en probation. Conséquence : le filet pénal s'élargit. Mais il faut être abolitionniste pour penser qu'il est mauvais de ne plus prononcer des sentences excessivement clémentes.
Sur le plan normatif, c'est le point de départ des abolitionnistes qu'il faut contester. Ils prennent pour acquis le postulat selon lequel le but principal des sanctions intermédiaires serait de lutter contre la « surpopulation » carcérale. Ils ont alors beau jeu de montrer que ces peines ne sont pas toutes utilisées pour des gens qui autrement auraient été en prison. En réalité, les peines intermédiaires n'ont pas pour but de se substituer à la prison, elles valent comme moyen de rendre les sentences plus justes et plus équitables.
Le filet pénal allant s'élargissant est une analogie rhétorique servant à faire passer l'idée selon laquelle nos sociétés surpunissent. Mais qui admettrait cette idée sans examen ? Certainement pas la plupart des citoyens : ils se plaignent plutôt que les juges ne punissent pas assez. Considérant les millions de délits et crimes commis chaque année dans nos pays, le système distribue-t-il trop ou pas assez de peines ? Considérant les taux d'élucidation pour vol de 15%, les sursis et les sentences non exécutées, faut-il parler de surpénalisation ou, au contraire, d'impunité et de laxisme ? Le filet pénal est-il trop large et trop serré ou au contraire trop petit et trop lâche ?
Que penser des prophéties de Landreville qui nous avertit que la surveillance électronique ouvre la porte à la société de surveillance généralisée et à la perte de nos libertés ?
Il faut d'abord savoir qu'aux États-Unis, la légalité du principe de la surveillance électronique n'a pas été contestée devant les tribunaux (Renzema, 1992). Dans ce pays de plaideurs où tout est prétexte à litige, où les droits et libertés sont solidement défendus par la constitution et par une armée d'avocats, cette absence de contestation en dit long. Comment une mesure à laquelle l'intéressé lui-même consent violerait-elle une liberté constitutionnelle ? Quand au droit du judiciaire de punir les délinquants au terme d'un procès en bonne et due forme, comment imaginer qu'il puisse être contesté ? En bon abolitionniste, Landreville refuse par principe de faire la différence entre un criminel avéré et n'importe quel autre citoyen. Il n'accepte pas qu'un individu trouvé coupable d'un délit sérieux a perdu le droit de ne pas être contrôlé et mérite d'être privé, en tout ou en partie, de sa liberté. Son idéologie l'aveugle sur l'évidence qu'il est très différent d'astreindre à la surveillance électronique un contrevenant et un honnête homme.
Dans son article de 1994, Landreville propose au lecteur une anti-utopie, une société imaginaire et cauchemardesque où les simples citoyens sont perpétuellement soumis au regard inquisiteur de "Big Brother" et des agences privées de surveillance : ils doivent porter des implants, ils sont suivis à la trace partout où ils vont, ils doivent se soumettre à des tests d'urine. Il laisse entendre que ce panoptique est à nos portes. Ce faisant, il confond le technologiquement faisable et le politiquement possible. La technologie dont il nous parle est réalisable, mais quel gouvernement démocratique oserait l'imposer au plus grand nombre ? Landreville ne semble pas savoir dans quel régime politique nous vivons. Ces technologies seraient redoutables si nous n'étions pas en démocratie, si nous n'avions ni code civil ni code pénal, ni tribunaux ni partis d'opposition ni chartre des droits et libertés ni contre-pouvoirs ni presse indépendante. Dans nos démocraties telles qu'elles existent, de nombreuses protections nous assurent que les technologies de surveillance seront utilisées - sauf bavures - parcimonieusement et seulement contre les ennemis de l'extérieur et de l'intérieur. Le problème posé par Landreville n'est donc pas technologique mais politique et juridique. L'utopie apocalyptique qu'il nous sert avait déjà été décrite dès 1948 par Orwell dans son roman « 1984 ». Il avait imaginé les maisons équipées de télévisions munies de caméras permettant à "Big Brother" de savoir ce qui se passait dans tous les domiciles. Mais la menace dont Orwell nous mettait en garde n'était pas spécialement de nature technologique ; elle était politique : il visait le totalitarisme de l'U.R.S.S. Et dans la réalité de l'U.R.S.S., les maîtres de Kremlin d'alors ne s'embarrassaient pas de technologie sophistiquée pour asseoir leur pouvoir. Leurs moyens étaient beaucoup plus simples, plus brutaux et probablement plus efficaces : arrestation à trois heures du matin, torture, Goulag et balle de pistolet dans la nuque.
RÉFÉRENCES

Baumer, T.L. ; Mendelsohn, R.I. (1992). Electronically Monitored Home Confinement : Does It Work ? in Byrne, J. ; Lurigio, A. ; Petersilia, J. (réds). Smart Sentencing. Newbury Park : Sage, pp. 54-67.
Byrne, J.M. ; Lurigio, A.J. ; Petersilia, J. (réd.) (1992). Smart Sentencing. Newbury Park : Sage.
Clear, T.R. ; Braga, A.A. (1995). Community Corrections, in Wilson, J.Q. ; Petersilia, J. (eds). Crime. San Francisco : ICS Press, pp. 421-444.
Dallaire, J.C. (1997). La surveillance électronique a-t-elle répondu aux attentes suscitées ? Québec : Direction générale des Services correctionnels. Ministère de la Sécurité publique.
Landreville, P. (1986). Évolution théorique en criminologie : l'histoire d'un cheminement. Criminologie, vol. XIX, no 1, pp. 11-32.
Landreville, P. (1986b). Rapport du Comité d'étude sur les solutions de rechange à l'incarcération. Québec : Ministère du Solliciteur général.
Landreville, P. (1987). Surveiller et prévenir. L'assignation à domicile sous surveillance électronique. Déviance et Société, vol. 11, no 3, pp. 251-269.
Landreville, P. (1994). La surveillance électronique des délinquants. Autrement, no 145, pp. 51-60.
Latulippe, L. (1994). La surveillance électronique. Montréal : Association des Services de réhabilitation sociale du Québec.
Lurigio, A.J. ; Petersilia, J. (1992). The Emergence of Intensive Supervision Programs in the United States, in Byrne, J. ; Lurigio, A.J. ; Petersilia, J. (réd.). Smart Sentencing. Newbury Park : Sage, pp. 3-17.
McMahon, M. (1992). The Persistent Prison. Toronto : University of Toronto Press.
Morris, N. ; Tonry, M. (1990). Between Prison and Probation. Oxford : Oxford University Press.
Neys, A. ; Peters, T. (1996). La peine considérée dans une perspective de réparation. Revue internationale de criminologie et de police technique, vol. XLIX, no 1, pp. 3-29.
Peters, T. ; Aertsen, I. (1995). Restorative justice : in search of new avenues in judicial dealing with crime, in Fijnaut, C. et coll. (réds). Changements de société, crime et justice pénale en Europe, vol. 1, La Haye : Kluwer Law International.
Petersilia, J. ; Lurigio, A.J. ; Byrne, J.M. (1992). Introduction : The Emergence of Intermediate Sanctions, in Byrne, J.M. ; Lurigio, A.J. ; Petersilia, J. (réd.). Smart Sentencing. Newbury Park : Sage.
Petersilia, J. ; Turner, S. ; (1993). Intensive Probation and Parole, in Tonry, M. (éd.) Crime and Justice : A Review of Research, vol. 17. Chicago : University of Chicago Press.
Pradel, J. (1995). Droit pénal comparé. Paris : Dalloz.
Renzema, M. (1992). Home Confinement Programs : Development, Implementation, and Impact, in Byrne, J. ; Lurigio, A. ; Petersilia, J. (réd.). Smart Sentencing. Newbury Park : Sage, pp. 41-53.
Tonry, M. ; Lynch, M. (1996). Intermediate Sanctions, in Tonry, M. (éd.). Crime and Justice. A Review of Research, vol. 20, pp. 99-144. Chicago : University of Chicago Press.
Tremblay, P. (1994). La Justice sondée : tribunaux criminels, décisions sentencielles et opinion publique, in Szabo, D. ; LeBlanc, M. (réd.). Traité de criminologie empirique. Montréal : Presses de l'Université de Montréal.
Tremblay, P. ; Gravel, S. ; Cusson, M. (1987). Équivalences pénales et solutions de rechange à l'emprisonnement : la métrique pénale implicite des tribunaux criminels. Criminologie, vol. XX, pp. 69-88.
Wolfgang, M. ; Figlio, R.M. ; Tracy, P.E. ; Singer, S.I. (1985). The National Survey of Crime Severity. Washington : U.S. Department of Justice. Bureau of Justice Statistics.
[1] Les notions de délinquance moyenne et de délits modérément graves peuvent être définies opérationnellement par leur score sur une échelle de gravité. Dans l'échelle de Wolfgang et coll. (1985), (dont les scores vont de 72,1 à 0,2) nous trouvons dans la zone des scores allant de 7 à 12 des voies de fait, des vols de voiture, des cambriolages, des recels et des fraudes. Un délinquant intermédiaire serait celui qui commet de tels délits et qui n'a pas pour autant un dossier criminel trop chargé.
[2] Voir : « L'Association des Services de réhabilitation sociale du Québec se prononce contre la surveillance électronique » (novembre 1994). Ce document prend appui sur une analyse de Lucy Latulippe (1994) qui, elle, était beaucoup plus nuancée que ne l'était la position officielle de l'A.S.R.S.Q. Voir aussi Dallaire (1997) qui, au Ministère de la Sécurité publique reprend servilement la vulgate landrevillienne.
|

