Maurice Cusson
[professeur à l’École de Criminologie, chercheur au Centre international
de Criminologie comparée de l’Université de Montréal]
“Le phénomène criminel à la lumière
de la psychologie de la peur.”
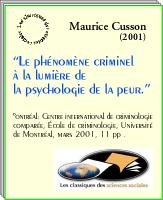
Montréal : Centre international de criminologie comparée, École de criminologie, Université de Montréal, mars 2001, 11 pp.
- Introduction
- I. L'exploitation de la peur
- II. Le délinquant et le danger : vaincre la peur ou la goûter
-
- 1. Dangers mortels
2. Vaincre le danger et la peur
- 3. Jouer avec le danger : la griserie de la victoire sur le danger
- Conclusion
-
- Références
"Tu trembles carcasse"
Introduction

Se trouve-t-il une seule facette du phénomène criminel dans laquelle la question de la peur ne se pose pas ? Le viol terrorise durablement la victime. Les mafias imposent leur loi par l'intimidation. Le sentiment d'insécurité est au cœur des débats sur la politique criminelle, laquelle continue de tabler sur l'effet intimidant de la peine. D'un côté la peur est un effet du crime, de l'autre elle est utilisée par les pouvoirs publics pour dissuader ses auteurs.
La criminologie ne dispose que de fragments d'une théorie des peurs qu'elle rencontre à tous les détours de ses investigations. Et elle n'a pas su tirer profit des travaux des historiens, des psychologues et des philosophes sur cette puissante émotion. Cet article a pour but de contribuer à une théorie de la peur dans le crime. Il introduit le sujet en présentant quelques notions générales sur la peur et son contraire.
La peur commence avec le sentiment qu'une menace plane. Elle est l'émotion qui résulte de la prise de conscience affective et intellectuelle d'un danger ou d'un risque. Elle est un état subjectif (j'ai peur) ; quand elle est intense, elle se manifeste par des réactions psychophysiologiques comme des tremblements, et aussi par l'action ou l'inaction (évitement, fuite, paralysie...). Le terme menace sert ici à désigner tout risque de perdre ce à quoi on tient : sa vie bien sûr, mais aussi ses biens, son honneur, sa liberté, sa santé... La menace peut être réelle et immédiate : j'ai un pistolet braqué sur la tempe. Elle peut aussi être lointaine et incertaine : le braqueur risque la prison. Elle peut enfin être imaginaire : les fantômes, les cadavres, les vampires, les loups-garous ont inspiré des frayeurs très réelles, même si les raisons d'avoir peur paraissent non fondées à qui ne croit pas au surnaturel.
Le riche vocabulaire de la peur en montre la gradation : pressentiment, appréhension, inquiétude, crainte, alarme, frayeur, effroi, épouvante, affolement, terreur, panique.
La fonction de cette émotion est de mobiliser l'organisme pour qu'il pare aux menaces. Elle est utile, nécessaire même, poussant celui qui l'éprouve à prendre ses précautions, à éviter ou neutraliser le danger. Encore faut-il qu'elle ne fasse pas perdre tout contrôle de soi.
Avec Rachman (1990), distinguons dans la peur trois sous-systèmes :
- 1) l'expérience subjective d'appréhension qui survient avec la conscience du danger ;
- 2) les modifications physiologiques qui accompagnent ce sentiment : tremblement, sueurs "froides", pâleur, accélération des battements de cœur, etc. et
- 3) les comportements : fuite, évitement, incapacité d'avancer.
Le fait essentiel, c'est que les corrélations entre ces trois composantes de la peur sont imparfaites. L'expérience subjective de crainte ne s'accompagne pas nécessairement de manifestations physiologiques ; et il n'est pas rare qu'un individu ressentant la peur au point de trembler, se resaississe et affronte le danger comme s'il n'avait pas peur.
Le courage est rendu possible par cette relative indépendance des trois sous-systèmes. Le brave éprouve de la crainte, il lui arrive même de trembler ; malgré tout, il fait face au danger. Ce courage qui, disait Descartes, porte à l'exécution de choses dangereuses est conquête sur soi et sur sa peur. Et ce n'est pas que littérature. Durant la deuxième guerre mondiale, il a été établi que des soldats et des aviateurs allaient au combat malgré la peur qui les tenaillait et dont ils présentaient les symptômes physiques. En cours de traitement, des patients phobiques posent des gestes courageux ; ils sont étreints par la frayeur, leur cœur bat la chamade, ils tremblent, et pourtant ils s'approchent de l'animal qui les terrorise, ils le touchent... (Rachman, 1990). Le courage est la peur maîtrisée. L'individu surmonte la pulsion qui le pousse à fuir ; il fait face au danger et agit selon sa raison et son honneur. Il s'impose la résolution de ne pas céder.
La lutte contre la peur s'accompagne souvent d'une lutte contre le danger. On prend des mesures de sûreté : on se met à l'abri, prend ses précautions, évite les lieux et individus dangereux. Plutôt que d'avoir à surmonter la peur, on se donne de bonnes raisons de ne plus craindre. Ces mesures nous procurent un sentiment de sécurité : croyance d'être à l'abri du danger. Ainsi, la peur est-elle chassée : on est rassuré.
Quand la peur est à son comble, celui qu'elle saisit perd ses moyens ; affolé, terrorisé, paniqué, il fige ou court dans toutes les directions. L'épouvante, écrit Descartes, est un "étonnement de l'âme qui lui ôte le pouvoir de résister aux maux qu'elle pense être proches". "Elle détourne la volonté des actions utiles". La terreur conduit au désespoir : le malheur paraît certain ; on croit qu'il n'y a plus rien à faire ; on se laisse abattre. Frappé d'épouvante, l'individu se désorganise ; il est sans défense ; il ne peut s'empêcher de fuir ou, au contraire, il fige puis reste paralysé.
La puissance dévastatrice de la peur éclate en temps de guerre. Montaigne raconte qu'au siège de Rome, la peur "serra et glaça si fort le cœur d'un gentilhomme qu'il en tomba roide mort par terre à la bresche sans aucune blessure" (p. 98-9). Tantôt, poursuit-il, la peur nous donne des ailes aux talons, tantôt, elle nous cloue les pieds et les entrave. Émotion aux effets opposés en effet : il arrive que, pris de panique, les soldats fuient en tous sens, en désordre ou, qu'au contraire, ils soient paralysés, plongés dans un état de stupeur qui les rend incapables de bouger.
Sur le champ de bataille, c'est souvent la peur plutôt que le rapport des forces qui désigne le camp du vaincu, comme en témoigne l'étude du combat antique qu'en fait Ardant du Picq (1880). Deux armées, en rangs serrés pour que chaque guerrier se sente protégé par ses compagnons, avancent l'une vers l'autre. Plus ils se rapprochent, plus la peur étreint le cœur des combattants. Les projectiles pleuvent ; les cris des blessés se font entendre. Sous la pression du danger qui se rapproche, l'angoisse devient insupportable. "L'homme n'est capable que d'une quantité donnée de terreur" (p.3). La peur est contagieuse si bien que lorsque, dans un camp, quelques soldats commencent à s'affoler, un vent de panique souffle sur tous. Ils jettent leurs armes, se bousculent en voulant fuir, se piétinent et se laissent égorger. Il s'ensuit un affreux carnage. En effet, ce n'est pas quand les armées ennemies se font face en bon ordre qu'elles subissent des pertes, c'est au cours de la déroute. Les soldats en fuite sont tellement affolés qu'ils sont incapables de se défendre. Les vainqueurs peuvent alors en tuer des milliers. "La débandade des armées offre effectivement l'impression qu'une horde de démons parcourt le champ de bataille et chasse devant elle des individus hagards" (Mannoni, 1982, p.3).
La peur apparaît donc comme une émotion puissante dont les effets sont contrastés. Quand elle subjugue l'individu, elle le transforme en pantin gesticulant et courant dans tous les sens ou, au contraire, elle le frappe de stupeur et le paralyse. Quand le sujet reste fort devant le danger et qu'il maîtrise sa frayeur, il suivra les voies de la raison, mais aussi celles de la prudence ; selon les circonstances, il choisira de faire face et de contre-attaquer ou de fuir en bon ordre, ou encore de s'incliner si le combat est perdu d'avance et toute résistance inutile.
Sachant les dangers auxquels sont exposés aussi bien les délinquants que leurs victimes, il y a fort à parier que le problème de la peur se pose pour les uns et les autres. Il faut donc s'attendre à ce que la peur fasse sentir ses effets partout où la question criminelle se pose. Mais ces effets ne seront ni simples, ni prévisibles, justement parce qu'ils vont dans toutes les directions.
Notre enquête sur la place de la peur dans le crime s'attardera à deux problèmes :
- Dans les délits d'intimidation, le braquage par exemple, comment l'agresseur parvient-il à utiliser la peur pour parvenir à ses fins ?
- Comment les délinquants récidivistes affrontent-ils les dangers qui les entourent et comment supportent-ils la peur ?
I. L'exploitation de la peur

Il existe une catégorie de délits, comme le hold-up, le viol, le racket et le terrorisme, qui se caractérise par l'utilisation de la peur. L'agresseur intimide sa victime pour arriver à ses fins. Dans ce qui suit, nous examinerons l'un de ces délits d'intimidation, le braquage, à partir d'un exemple.
En 1974, Willwerth publiait un livre consacré à un braqueur de New York. Cet individu, appelé Jones par l'auteur, se spécialisait dans les attaques de passants dans la rue avec un couteau. Quand il en était à ses débuts, il opérait avec un complice expérimenté ; plus tard, il prit l'habitude d'agir seul.
Un exemple d'un de ses braquages donnera une idée de sa tactique. Ce jour-là, avec un complice, il avait repéré dans la rue un passant dont l'allure inquiète pouvait donner à penser qu'il portait une forte somme d'argent. Ils décident de le suivre. L'homme entre dans un immeuble dont la porte intérieure est verrouillée. Les deux agresseurs s'engouffrent à sa suite avant qu'il n'ait le temps de déverrouiller la seconde porte : il est coincé et il se retrouve avec deux couteaux pointés dans sa direction. Il s'incline immédiatement et leur tend l'argent. "Prenez tout". La victime était un homme d'âge mûr ; il avait eu la bonne idée de ne pas résister pour ne pas énerver ses agresseurs, pour échapper aux coups, à la mort peut-être (Willwerth, 1974 : 33).
Pour ménager l'effet de surprise, Jones s'approche du passant qu'il a choisi comme victime et le coince. Il lui est alors impossible de fuir et "le temps qu'il se reprenne, il est cuit" (p. 54).
Jones dit pourquoi il utilise un couteau. Le revolver, c'est bruyant et la lame fait au moins aussi peur. Tu peux, dit-il, piquer puis enfoncer doucement la lame dans la chair de la victime. "Les gens ont peur de la mort ; si le type a de la jugeote, le fric est à toi" (p. 49).
Jones reconnaît éprouver de la peur, surtout quand il en était à ses premières armes. "J'avais la trouille, ... la trouille de ce type, la trouille de voir s'amener les flics" (p.24). Il s'efforce de n'y point penser pour ne pas perdre ses moyens, pour ne pas se retrouver en position d'infériorité. "Il sait parfaitement, écrit Willwerth, qu'il peut trouver la mort dans la rue. Il doit toujours rester sur ses gardes, ce qui lui fait horreur, bien qu'il sache qu'il le doit à l'existence qu'il a choisie" (p. 29).
Les braqueurs ne font pas de l'ironie quand ils disent qu'ils n'aiment pas la violence. Ils détestent l'idée d'avoir à exécuter leur menace. C'est qu'ils veulent la bourse, non la vie. Et ils obtiennent presque toujours la première sans devoir prendre la seconde. Au Canada, il se commet en une année plus de 28 000 vols qualifiés et seulement 46 meurtres commis au cours d'un vol qualifié (Cusson et Proulx, 1999, p.23). Le braquage est affaire de menace, non de violence actualisée. Le braqueur expérimenté sait doser la peur ; il n'en remet pas car il ne tient pas à ce que sa victime s'affole, qu'elle se mette à hurler ou à gesticuler ou qu'elle s'évanouisse. Il préfère, de loin, qu'elle opte pour la solution prudente de remettre l'argent.
Encore faut-il que la menace soit crédible. L'arme est là pour ça, et le nombre d'agresseurs et leur détermination affichée et tant mieux s'ils semblent prêts à tout.
Les braqueurs capitalisent sur l'effroi provoqué par l'effet de surprise. Le passant va tranquillement son chemin ; soudain, sans crier gare, il voit une arme pointée sur lui : il sursaute, ne sait que faire et se trouve à la merci de l'agresseur. "L'homme surpris a besoin d'un instant pour y voir clair et se mettre en défense ; pendant cet instant, il est mort, s'il ne fuit" (Ardant du Picq, 1888 : 11). Heureusement, le braqueur est disposé à l'épargner, à la condition, bien sûr, qu'il donne sa bourse.
Il ne suffit pas pour le braqueur d'inspirer la peur, encore lui faut-il maîtriser sa propre peur. Il n'est pas sans savoir que certaines victimes auront envie de contre-attaquer, que la rage est quelquefois plus forte que la peur. Il faut donc que l'agresseur se prémunisse contre une éventuelle riposte. Si elle se produit, les risques d'escalade ne sont pas nuls. L'agresseur devient l'agressé. C'est à lui de se défendre. Il se pourra que, craignant d'être tué, il utilise son arme et qu'il tue sa victime ; il arrive aussi - aux États-Unis, ce n'est pas rare - qu'il soit tué par une victime armée (Cusson, 2000). Plus souvent qu'on pense, c'est poussé par la peur qu'on tue son prochain.
II. Le délinquant et le danger :
vaincre la peur ou la goûter
- "Le commun dénominateur le plus apparent des criminels est le fait qu'ils ne ressentent nullement l'inhibition de la menace pénale" (Pinatel, 1960, p. 55)

Les hors-la-loi, à l'évidence, vivent dangereusement, risquant chaque jour de tout perdre : amis, santé, liberté, la vie même. Tout devrait les pousser à fuir ce mode de vie pétri de menaces. De fait, leur carrière criminelle est souvent brève. Pourtant, certains persistent, bravant le danger omniprésent. Comment font-ils ? Domptent-ils la peur ? Parviendront-ils à neutraliser le danger ? Se pourrait-il qu'ils ignorent la peur ? À ces questions, nous trouvons des réponses en combinant les connaissances sur la psychologie de la peur et ce que la criminologie nous apprend
Nul n'échappe à la mort. S'agissant du criminel, cette mort risque d'être violente et prématurée. C'est que nous verrons dans ce qui suit.
- 1. Dangers mortels

Tremblay et Paré (2001) ont consacré un article à la mortalité chez les délinquants et aux raisons pour lesquelles ils risquent de mourir prématurément. Ils signalent que, dans un échantillon étudié par les Glueck au cours des années 1930, les taux de mortalité, à 40 ans, des délinquants persistants était de 8% contre 4% dans le groupe contrôle rigoureusement comparable. Dans un échantillon suédois de 7 757 garçons nés en 1951, 3% des délinquants étaient morts entre 18 et 33 ans contre 1,3% des non-délinquants. Chez les délinquants condamnés quatre fois ou plus, le pourcentage des décès était de 7,2%. Les indications concordent : les individus qui s'engagent dans le crime courent deux fois plus de chances de mourir prématurément que les citoyens respectant la loi, et plus ils sont engagés profondément dans la délinquance, plus ils risquent de mourir jeune. Comparés à leurs camarades qui respectent la loi, les délinquants sont plus souvent assassinés ; ils se suicident plus ; ils meurent plus souvent d'accident et d'overdose.
L'explication de la surmortalité des délinquants proposée par Tremblay et Paré tient en trois points. Ils conviennent d'abord avec Gottfredson et Hirschi (1990) que les carences du contrôle de soi signalées chez les délinquants les poussent à l'imprudence et à la témérité. Mais si une telle explication convient pour les accidents mortels, elle ne suffit à rendre compte ni des meurtres, ni des suicides. La fréquence des assassinats dont sont victimes les criminels doit se concevoir en termes de risques du métier, de risques acceptés. Impossible de vivre du crime sans entrer en conflit non seulement avec ses victimes, mais encore avec ses concurrents et même ses comparses. C'est d'ailleurs du milieu criminel que proviennent les plus grands dangers : tous les ans, les règlements de compte éclaircissent les rangs de la pègre. Les recherches sur la victimisation établissent hors de tout doute que plus un individu commet de crimes violents, plus il risque d'être lui-même victime d'une agression. Au Québec, c'est entre 40 et 44 ans que les risques d'être victime d'un règlement de compte sont les plus élevés, ce qui donne à penser que plus on s'élève dans la hiérarchie du milieu, plus on s'expose à être pris pour cible par des tueurs.
Tremblay et Paré poursuivent en expliquant la fréquence élevée des suicides chez les délinquants. L'incidence de troubles mentaux est plus élevée chez les criminels que dans la population en général. Et une vie dans le crime s'accompagne d'une tension qui finit par être insupportable, au point de vouloir en finir avec la vie.
Sans contredire ce qui précède, la surmortalité menaçant les hors-la-loi peut s'expliquer à l'aide de notions puisées chez des philosophes classiques comme Aristote, Thomas d'Aquin, Hobbes et, aujourd'hui, Novak. Dès lors que le criminel vit en marge de toutes les lois, il ne profite plus de leur protection. Dans ses différends avec ses victimes, ses complices et ses concurrents issus du milieu, il est très mal placé pour faire appel à la loi étatique. Et il est mal protégé par cette loi non écrite fondée sur la notion de réciprocité qui interdit d'attaquer celui qui ne vous a pas agressé. De plus, il est connu pour être intempérant, impulsif, imprévoyant et imprudent, ce qui le conduit à se nuire à lui-même et à nuire à autrui. Au fil des ans, par ses gestes irresponsables ou hostiles, il sème sur son chemin victimes et ennemis. Il fait alors le vide autour de lui et devient l'objet du désir de vengeance d'un nombre croissant de gens. Il risque donc de mal finir : s'il n'est tué, sa situation lui paraîtra à ce point intenable qu'il sera tenté de prendre congé de la vie.
Quoiqu'il en soit des causes de la surmortalité chez les criminels, il subsiste un motif d'étonnement : comment font-ils pour "tenir" en dépit des dangers de mort, bien sûr, mais aussi des risques d'ostracisme et d'incarcération ?
- 2. Vaincre le danger et la peur

Devant le risque, trois attitudes sont possibles. Soit on l'a en aversion et ou l'évite. Soit on l'accepte parce qu'il fait partie intégrante de ce qu'on veut faire, et on le minimise puis le supporte. Soit on aime les sensations fortes qu'il procure, et alors on s'amuse à le frôler en espérant ne pas s'y brûler les ailes. Nous avons vu que l'individu engagé dans le crime ne peut éviter le danger. Il doit donc s'en accommoder. Il peut cependant prendre ses précautions et, autant que faire se peut, réduire son exposition au danger. Il lui faudra malgré tout une bonne dose de courage. Tant qu'il poursuivra dans la dangereuse voie qui est la sienne, il devra trouver les moyens d'éviter de perdre la liberté ou la vie tout en domptant sa peur, les deux allant de pair.
- i. Comment faire face au danger
sans se laisser dominer par la peur ?
- "Contre la peur, il faut courir aux armes" (Alain, 1960, p. 165)
Dans leur lutte contre la peur, les cambrioleurs braqueurs et autres violeurs jouissent d'un avantage sur leurs victimes : ils ont l'initiative ; ils choisissent leur cible, le moment et le lieu de l'attaque. Ce sont eux qui décident de passer à l'action. Or, Alain avait bien vu que l'action dissipe la peur.
Les recherches en histoire et en psychologie se rejoignent sur un fait : la peur recule quand l'individu confronté au danger a le sentiment de dominer la situation (Rachman, 1990, p. 13-15). Durant la 2e guerre mondiale, les pilotes d'avion de chasse souffraient beaucoup moins de la peur que les mitrailleurs des bombardiers ; les premiers, ayant la maîtrise de leur appareil, sentaient que s'ils se concentraient sur le pilotage, ils pouvaient éviter de se faire descendre ; par contre, les deuxièmes se sentaient impuissants. Les individus qui ont confiance en eux-mêmes et en leur compétence à parer au danger ne se laissent pas facilement effrayer. Contrôlant la situation, ils se contrôlent eux-mêmes.
Autre fait établi, l’exposition répétée au danger auquel on parvient à échapper réduit progressivement la peur. Lors de son premier saut en parachute, le sauteur novice a la peur au ventre. Ensuite, d'une fois à l'autre, la frayeur régresse pour disparaître dans certains cas. L'individu se rassure, en réalisant qu'il n'a pas eu raison de craindre. Cette habituation au danger est d'ailleurs utilisée avec un succès remarquable pour traiter les phobies. Le thérapeute encourage le patient à approcher l'objet qui le terrorise dans un contexte rassurant. Lors d'une expérience classique sur un enfant ayant la phobie des lapins, le psychologue commençait par faire jouer l'enfant pour le mettre tout à fait à l'aise. Puis il plaçait un lapin en cage à quatre mètres de l'enfant, puis à deux, puis tout près. Le lapin était ensuite sorti de sa cage. Un autre enfant n'ayant pas peur des animaux était alors invité à flatter l'animal puis, c'était l'enfant phobique qui parvenait à le flatter. De telles thérapies utilisant l'exposition progressive au "danger" et l'exemple de pairs ignorant la peur parviennent rapidement à faire disparaître de nombreuses phobies (Rachman, 1990 : 209-19). Cette technique est d'ailleurs utilisée avec les victimes d'actes criminels devenues phobiques.
Maîtrise de la situation, sentiment de compétence, exposition répétée au danger sans conséquence dommageable : voici comment le braqueur chevronné a appris à dominer sa peur. Il choisit le moment, le lieu et la cible de l'attaque ; il est armé et l'effet de surprise joue en sa faveur. Tout ceci l'assure de dominer la situation. D'autant qu'il sait comment neutraliser les résistances de sa victime. Il sait aussi qu'il a le temps de fuir avec le butin avant qu'elle ne se ressaisisse. Il est sûr de sa compétence. Au cours de braquages réitérés, il a vérifié qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur dès lors qu'il s'est bien préparé et qu'il a judicieusement choisi sa victime.
Pour éviter de se laisser subjuguer par la peur, les délinquants d'expérience ont appris à contrôler la situation par divers stratagèmes : ruses, effets de surprise, vitesse, armes, déguisements... Et leur expérience même leur a appris à ne pas s'affoler.
- ii. L'union contre le danger
La peur est contagieuse, le courage aussi. La solitude effraye, la compagnie rassure. Encore faut-il se sentir épaulé par des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Si, au contraire, on est entouré de poltrons terrorisés, on sera emporté par le vent de panique soufflant sur tous (Rachman, 1990, 59-61). La cohésion du groupe contribue aussi à donner du courage. Quatre braves, écrivait Ardant du Picq (1880, p.93), qui ne se connaissent pas, n'attaqueront pas un lion ; quatre moins braves se connaissant, sûrs de leur solidarité et de leur appui mutuel, iront résolument. La victoire s'obtient en brisant la cohésion de l'armée ennemie. On la coupe en deux ; on isole les bataillons ; on disperse les soldats : l'armée est taillée en pièces et l'adversaire fuit en désordre, affolé.
C'est en de tels termes que s'expliquent la codélinquance, les gangs et la corrélation entre leur cohésion et la fréquence des délits commis par leurs membres. C'est pour se soutenir mutuellement contre la crainte que les jeunes délinquants opèrent à deux ou à plusieurs. Ayant maîtrisé la peur, les délinquants adultes ont plutôt tendance à opérer en solo. Les gangs sont d'abord des groupes de protection mutuelle. Plus un gang est cohésif, plus la productivité délictueuse de ses membres et élevée (Klein, 1995).
- iii. Doser le risque
Tout délinquant peut choisir le degré de risque auquel il s'exposera en choisissant l'infraction qu'il commettra. Le pusillanime s'en tiendra au vol à l'étalage. Si, avec l'expérience, il prend de l'assurance, il osera se risquer au cambriolage. La gravité des délits commis par un individu est fonction de sa tolérance à la peur, car la règle de la proportionnalité entre le délit et la peine annonce des dangers croissants au fur et à mesure qu'augmente la gravité des actes posés. La relative rareté des crimes graves n'est donc pas sans rapport avec la peur. S'ils sont craintifs, les voleurs ne voudront pas se risquer à commettre un seul gros vol, ils choisiront plutôt d'en commettre plusieurs petits. Ils « travailleront » au volume dans l'espoir qu'aucun délit pris individuellement ne sera jugé assez sérieux pour déclencher une réaction pénale. Ils spéculeront sur l'espoir que la police ne fera pas de zèle pour investiguer leurs larcins, que les procureurs ne se donneront pas la peine d'engager des poursuites et qu'au pire, le juge n'ira pas jusqu'à la prison ferme. Ainsi, la menace pénale est-elle désamorcée en jouant aux limites du punissable.
- iv. Dissuader le dissuadeur
Un moyen radical de ne pas avoir peur de l'ennemi est de porter l'effroi dans son camp : il n'osera plus bouger. Des criminels violents dissuadent les victimes de porter plainte, les témoins de témoigner, les policiers de procéder à une arrestation, les jurés de prononcer un verdict de culpabilité ou les directeurs de prison de les garder. Ces actions contre-dissuasives sont surtout le fait d'organisations criminelles, mais celles-ci n'en ont pas le monopole. Ainsi voit-on des batteurs de femme et les violeurs menacer leur victime de représailles si elle porte plainte. Dans les banlieues françaises, des groupes de jeunes lancent des pierres et des cocktails Molotov aux policiers. Ils leur tendent des guet-apens. Ce harcèlement rendra les policiers hésitants, plus lents, moins résolus. Au Québec, des policiers et des fonctionnaires des prisons provinciales sont l'objet de menaces. La règle de l'omerta est une mesure contre-dissuasive. Par l'intimidation, la mafia sicilienne fait avorter les procès. Quand ceci ne suffit pas, elle peut aller jusqu'à faire assassiner des juges.
Mais quoi que fasse le criminel, il ne parviendra jamais à évacuer tout danger de sa vie. Plutôt que s'y résigner, pourquoi ne pas en tirer du plaisir ?
- 3. Jouer avec le danger :
la griserie de la victoire sur le danger

Il est des sports qui n'existeraient pas si personne ne prenait plaisir à frôler le danger et à éprouver la peur : l'alpinisme, le parapente, la plongée sous-marine, le saut en parachute ou à l'élastique, la tauromachie, la course automobile... Le Breton (1995) a bien décrit la passion du risque qui pousse les amateurs de ces sports à rechercher le danger pour lui-même. Se pourrait-il que les dangers qui pèsent sur les habitués du crime soient recherchés pour les émotions fortes qu'ils procurent ? S'agissant de maint jeunes délinquants, la réponse ne fait pas de doute (Cusson, 1981).
Le vandalisme et le "joy riding" ne seraient pas si répandus si le risque n'était goûté pour lui-même. Et il ne manque pas de braqueurs qui reconnaissent éprouver du "thrill" dans le feu de l'action ; jouer avec leur liberté et leur vie est source de puissantes stimulations, de jubilation. Le crime - surtout s'il est grave - est l'occasion de s'éprouver intensément, de mobiliser toutes ses ressources pour échapper au danger, de se sentir pleinement exister. Ni les alpinistes, ni les braqueurs n'ignorent la peur, ils la convertissent plutôt en jouissance et plus leur frayeur est forte, plus la jouissance est intense. Ils provoquent la mort pour en triompher. "L'épreuve procure à l'individu un sentiment puissant d'existence, une vibration de tout son être tendu vers l'effort ou la sensation grisante du danger surmonté" (Le Breton, p. 123).
Toute interdiction fournit l'occasion de goûter au fruit défendu de la transgression. Il arrivera donc que la menace de la peine produise quelquefois exactement le contraire de l'effet désiré : pousser au crime.
Conclusion

Le criminel ne pourra persister dans la vie pétrie de dangers qui est la sienne que s'il apprend soit à lutter contre la peur, soit à la goûter ; à moins qu'il ne l'ignore tout bonnement. Et dès le moment où il se découvre incapable de supporter le danger, il devra songer à prendre sa retraite. Ainsi pourrait s'expliquer la brièveté des carrières criminelles : passée la vingtaine, les dangers qui s'accumulent sur la tête des récidivistes finissent par avoir raison de leur détermination et alors ils abandonnent (Cusson et Pinsonneault, 1986 ; Cusson, 1998). La même logique pourrait rendre compte du fait que les délinquants se recrutent massivement parmi les jeunes célibataires de sexe masculin : il est bien connu que le goût du risque est plus marqué chez les jeunes que chez les gens âgés, chez les hommes que chez les femmes et chez les célibataires que chez les gens mariés.
Références

Alain. (1960). Les Passions et la sagesse. Paris : Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade).
Cusson, M. (1981). Délinquants pourquoi ? Montréal : Hurtubise HMH, Paris : Armand Colin. Réédition : Bibliothèque Québécoise en 1989.
Cusson, M. (1998). Criminologie actuelle. Paris : Presses Universitaires de France.
Cusson, M. (1999). Paradoxes américains : autodéfense et homicides. Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, n° 3, pp. 259-211.
Cusson, M. ; Pinsonneault, P. (1986). The Decision to Give up Crime, in Cornish, D.B. ; Clarke, R.V. (eds). The Reasoning Criminal. New York : Springer-Verlag, pp. 72-82.
Descartes, R. (1649). Des passions de l'âme, in Oeuvres de Descartes. Paris : Charpentier.
Du Picq, A. (1880). Études sur le combat. Paris : Hachette.
Gottfredson, M.R. ; Hirschi, T. (1990). A General Theory of Crime. Stanford, Cal. : Stanford University Press.
Klein, M.W. (1995). The American Street Gang. New York : Oxford University Press.
Le Breton, D. (1995). La Sociologie du risque. Paris : Presses Universitaires de France (Que sais-je ?).
Mannoni, P. (1982) La peur. Paris : Presses Universitaires de France (Que sais-je ?).
Montaigne. (1588). Essais. Paris : Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade).
Pinatel, J. (1960). La criminologie. Paris. Spes.
Rachman, S.J. (1990). Fear and Courage. San Francisco : Freeman Co. (first édition : 1978).
Tremblay, P. Paré, P.P. La vida loca : délinquance et destiné.
Willwerth, J. (1974). L'agresseur à main armée. Paris : Mercure de France. (Traduction française en 1976 de Jones : Portrait of a Mugger, New York : M. Evans and Co.).
|

