[153]
Roch Denis et Serge Denis
Respectivement politologue, UQAM, et Université d’Ottawa.
“L'action politique des syndicats québécois,
de la révolution tranquille à aujourd'hui.” [1]
Un texte publié dans l’ouvrage sous la direction d’Alain-G. Gagnon, Québec : État et société. Tome I, deuxième partie. “L’État, la société et la politique”, chapitre 7, pp. 153-180. Montréal : Les Éditions Québec/Amérique, 1994, 509 pp. Collection : Société : dossiers documents.
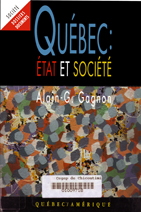
INTRODUCTION
Depuis la fin des années 1950, le visage du syndicalisme québécois s'est radicalement transformé. De mouvement minoritaire qu'il était alors, le syndicalisme est devenu une force d'envergure nationale, capable d'actions très puissantes sur les plans économique et social, doté d'un poids politique que nul parti, nul gouvernement n'est désormais en mesure d'ignorer. Pourtant, les syndicats québécois font face à l'heure actuelle à de nombreux et difficiles défis, qui déstabilisent leur existence. Comptant près d'un million d'adhérents répartis principalement en trois grandes centrales, ils étaient à peine remis de la plus grave crise économique (1982) à s'être produite depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'une profonde récession les frappait de nouveau au début de 1991. Déjà, les difficultés économiques avaient ébranlé leurs assises et secoué leurs traditions ; certains parlent maintenant d'une crise du syndicalisme.
Ce moment a coïncidé, de plus, avec le refroidissement des relations privilégiées nouées depuis la fin des années 1960 entre le Parti québécois et le mouvement syndical. Celui-ci, qui avait pu considérer le PQ comme l'instrument de sa propre représentation, se retrouvait au tournant de la décennie 1990 sans débouché réel sur la scène politique, et cela aussi a servi à nourrir un sentiment d'impasse.
Nous voulons analyser plus précisément comment l'évolution du syndicalisme au Québec s'est transcrite sur le terrain de l'action politique depuis la révolution tranquille, comment s'est manifestée politiquement la force nouvelle des syndicats, puis apprécier les traits marquants de la situation présente. Pour ce faire, nous procéderons tout d'abord à un court rappel analytique.
L'action politique du mouvement ouvrier est partout fonction de facteurs internes et externes à sa propre dynamique. Par exemple, il est généralement reconnu que les époques de profondes difficultés économiques poussent à la reconversion politique (Haupt, 1981) d'une part importante des activités du syndicalisme, même si les lieux et le sens de cette reconversion ne sont pas donnés automatiquement. De même, pour toute la période qui nous intéresse, les développements spécifiques du nationalisme au Québec ont pesé directement sur les formes de l'action politique ouvrière. En ce sens, il nous faut tenir compte des éléments principaux de conjoncture socio-économique et politique qui se sont conjugués à l'intervention propre des syndicats pour définir leur évolution organisationnelle et politique.
[154]
Par ailleurs, soulignons que le rapport du syndicalisme à l'État se déploie selon deux axes fondamentaux. D'abord, sur le plan économique, par les luttes et les mécanismes de contact, plus ou moins élaborés, qui mettent en rapport les appareils privés ou étatiques et les organisations syndicales ; ensuite, sur le plan de ce que l'on pourrait appeler l'action politique et la participation aux débats généraux dans lesquels est engagée la société – notamment lors des campagnes électorales. Sur ce plan, les traditions syndicales nord-américaines définissent deux grandes orientations : la non-partisanerie, qui, assez paradoxalement, peut signifier à la fois l'absence de prise de position ou l'appui actif en faveur d'une formation politique non issue du mouvement ouvrier, et l'orientation dite du « troisième parti » en vertu de laquelle le mouvement ouvrier est appelé à jouer un rôle d'initiateur, ou de force d'appoint dans la création d'un parti politique chargé de représenter ses intérêts.
De sorte que l'action politique peut viser à faire élire des candidats favorables au mouvement ouvrier par l'intermédiaire des partis traditionnels, ou viser la prise du pouvoir comme telle par la formation d'un parti indépendant ; alors que l'engagement dans les mécanismes de participation ne cherche pas d'abord à influencer la composition des gouvernements mais à orienter le fonctionnement de certains appareils d'État dans le sens des intérêts et préoccupations du travail organisé.
LE DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
L'un des premiers enjeux de toute étude sur l'action politique des syndicats consiste à mettre en relation des données qui ne sont pas toujours abordées dans leur interaction : par exemple, l'évolution de la composition professionnelle de la main-d’œuvre salariée et la transformation des rapports généraux du syndicalisme à l'État ; de même, l'influence de la progression organisationnelle sur les pratiques politiques, c'est-à-dire les conséquences de l'expansion comme telle du syndicalisme sur son rôle en politique.
L'ÉVOLUTION DU MONDE DU TRAVAIL
DEPUIS 1945
Si l'on trace un tableau de la composition professionnelle de la main-d'œuvre salariée, le phénomène le plus souvent mis en relief est évidemment celui de la constante progression, dans les années 1960 et 1970, du secteur de la force de travail concentrée dans les services, en particulier les services publics. À la fin de la guerre, les travailleurs et travailleuses du tertiaire (bureau, commerce, transports, fonction publique, etc.) constituaient 40 % des salariés au Québec alors qu'en 1960 leur pourcentage était de 60 %, de près de 66 % en 1970 et qu'il dépassait les deux tiers dans les années 1980 (CSN-CEQ, 1984). De 1945 à 1960, la main-d'œuvre du secteur secondaire s'est maintenue autour de 30 %, tandis que celle du secteur primaire a chuté de 25 % à 10 %. Elle ne sera plus que de 5 % à la fin des années 1970, alors que l'industrie manufacturière et la construction compteront moins de 30 % des salariés. [155] Dans le cadre de ces transformations, la proportion des femmes travailleuses passe à 30 % de la main-d'œuvre en 1960, à quelque 33 % en 1970 et à environ 43 % au début de la décennie 1990.
À la fin des années 1960, c'est notamment l'expansion des réseaux scolaire et hospitalier ainsi que de la fonction publique qui explique que le secteur des services devient si largement prédominant. À titre d'exemple, on peut noter qu'en l'espace de six ans seulement, de 1960 à 1966, le personnel des hôpitaux est passé de quelque 50 000 à 100 000 employés.
Contrairement à ce qui est parfois estimé, le mouvement de concentration de la main-d'œuvre vers les services, et en particulier les services publics, ne signifie pas une diminution du travail manuel au profit de catégories salariées qu'on pourrait regrouper dans le champ du travail intellectuel. Dans une étude où ils abordent précisément cette question, Pierre Drouilly et Dorval Brunelle ont montré que de 1971 à 1981, « c'est encore et toujours l'emploi dans les occupations manuelles qui croît le plus significativement, comptant pour 69 % de l'emploi total créé » (Brunelle et Drouilly, 1985, p. 242). Au début des années 1980, alors que, comme nous venons de le souligner, le secteur dit tertiaire rassemble plus des deux tiers de la main-d'œuvre salariée au Québec, les travailleurs manuels forment pour leur part, tous secteurs confondus, plus des trois quarts de cette main-d'œuvre globale.
Par ailleurs, la croissance des effectifs des services publics durant les années 1960 et 1970 met des dizaines de milliers de nouveaux salariés directement en rapport avec l'État (palier provincial ou municipal, système scolaire, hospitalier, etc.) du point de vue de leurs conditions de travail et de leurs salaires. Cette réalité nouvelle sera lourde de conséquences quant à ce que l'on a appelé la tendance à la politisation grandissante des revendications syndicales. En effet, le rôle de l'État dans les conflits de travail du secteur public ne peut pas revêtir le même caractère d'extériorité que son intervention dans les conflits du secteur privé. Il est en quelque sorte permanent, et souvent immédiat. Le syndicalisme, qui traditionnellement n'était pas placé aussi fréquemment en situation d'antagonisme avec le gouvernement, s'y trouvera dorénavant massivement projeté, ce qui va influer sur son rapport général à l'État et au politique.
- L'apparition d'une nouvelle force sociale
En 1945, il y avait 200 000 syndiqués au Québec, pour un taux de syndicalisation de 20 %. En 1960, le nombre des travailleurs organisés avait presque doublé, pour passer à 375 000 – et le pourcentage des syndiqués par rapport à l'ensemble des salariés s'élevait à 30 %. Dix ans plus tard, en 1970, le nombre des syndiqués a encore une fois presque doublé : il est de plus de 700 000, pour un taux de syndicalisation remarquablement élevé de près de 40 %. En 1977, le Québec compte 900 000 syndiqués ; le taux de syndicalisation, après avoir connu une pointe aux environs de 42 % entre 1971 et 1974, va tendre à fluctuer autour de 35 % au début des années 1980 (Fleury, 1984, p. 4 ; Rouillard, 1989, p. 289), puis à remonter à 40 % à la fin de cette décennie, pour atteindre cette fois le cap du million de travailleurs.
[156]
La baisse relative des effectifs syndicaux au début et au milieu des années 1980 est reliée aux fermetures d'entreprises, à la réduction du nombre d'emplois et à l'augmentation du chômage dans le contexte de la crise qui secoue l'économie. L'emploi moyen au Québec a chuté de 145 000 postes entre 1981 et 1982, dont 73 000 dans le secteur tertiaire (Ingerman, 1983). Entre 1991 et 1994, la profonde récession économique n'a pas entraîné de chute marquée des pourcentages de syndicalisation.
De 1945 à 1960, les unions internationales et les syndicats pancanadiens représentent la majorité des syndiqués au Québec, ce qui continuera d'être le cas pendant toute la période des années 1960 à 1990. Les syndicats catholiques (Confédération des travailleurs catholiques du Canada, devenue la Confédération des syndicats nationaux, CSN, en 1959-1960), de leur côté, regroupent le quart des syndiqués jusqu'au début de la décennie 1960. Ils réussissent, dans les années qui suivent, à canaliser l'énorme vague de syndicalisation qui recouvre la fonction publique et les hôpitaux, et parviennent alors à regrouper jusqu'à 30 % des syndiqués québécois, quelque 200 000 membres en 1970.
De 1960 à 1970, la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) voit ses effectifs passer de 100 000 à 200 000 membres. Elle atteindra près de 300 000 syndiqués à la fin des années 1970, continuant sa progression numérique par la suite, pour rassembler, selon ses chiffres, autour de 350 000 membres au début des années 1980 et plus de 425 000 à la fin de la décennie. À ce moment, elle regroupe environ 95 % des effectifs du Congrès du travail du Canada au Québec (l'adhésion à la FTQ est facultative ; la FTQ est affiliée au CTC en tant que section provinciale), alors qu'elle n'en rassemblait que 41 % en 1961 (Rouillard, 1989, p. 302, 304).
Enfin, il importe de souligner que la Corporation des instituteurs et institutrices catholiques du Québec, qui rassemblait 16 000 membres en 1959, en compte 28 000 dès 1960. En progression constante, par la suite devenue Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) en 1974, elle comptera en 1977 plus de 80 000 adhérents et environ 100 000 dix ans plus tard.
Cette progression marquée de la syndicalisation représente autre chose qu'une simple évolution quantitative. Elle est tellement forte qu'elle permet au mouvement syndical de franchir un seuil qualitatif du point de vue de son existence comme force sociale constituée. Formé d'un ensemble d'organisations numériquement faibles avant 1960, le syndicalisme devient en quelques années un véritable mouvement composé des organisations sociales les plus nombreuses et les plus puissantes au Québec. Son élargissement au secteur public y est pour beaucoup, parce qu'il donne au syndicalisme québécois, pour la première fois, la stature d'un mouvement d'envergure nationale.
LE RAPPORT AU POLITIQUE
Jusqu'au milieu des années 1950, la tendance très largement prédominante au sein du syndicalisme québécois, du point de vue de ses traditions d'action et d'intervention politiques, est celle de la pression sur les gouvernements et partis en place. Il y a, bien sûr, les syndicats industriels du Congress of Industrial Organizations (CIO) américain et de la Fédération des unions industrielles du Québec (FUIQ) [2] qui ont reconnu la [157] vieille Commonwealth Cooperative Federation (CCF) comme représentation politique du travail face aux libéraux et aux conservateurs. Mais la tendance à la constitution d'une force politique indépendante qu'ils incarnent n'a pas un effet énorme compte tenu de la faiblesse numérique et organisationnelle de ces syndicats au Québec.
- Les traditions politiques du syndicalisme
et la révolution tranquille
Mais si la non-partisanerie occupe l'essentiel du champ de l'intervention politique, la deuxième moitié de la décennie 1950 voit surgir un changement important. Lors du congrès de Joliette de la FUIQ en 1955, et surtout avec l'appel pour la fondation d'un « parti des classes laborieuses » lancé par le congrès de la FTQ en 1958, c'est l'orientation en faveur de la constitution d'un troisième parti provincial qui fait sa première entrée significative au sein du mouvement syndical québécois (Denis, 1979, p. 157-179). En témoigne d'ailleurs le fait que la CTCC-CSN, à son propre congrès de septembre 1959, prend la décision d'autoriser ses syndicats à appuyer une formation politique et même à s'affilier à un parti, décision qui constituait une brèche importante dans ses traditions. Quelques mois plus tôt, son exécutif avait même accepté de s'associer aux « pourparlers [...] en vue de la fondation d'un nouveau parti politique » (le futur NPD), tout en réitérant cependant sa préférence pour la non-partisanerie (CSN-CEQ, 1984, p. 161).
Ce sont alors les grèves ouvrières qui nourrissent et condensent l'opposition grandissante du syndicalisme au duplessisme, et lui font rechercher une issue politique en dehors des partis dominants. Là se trouve certainement le facteur principal de l'appel lancé par la FIQ en 1958, alors que la création de la centrale, un an plus tôt, a elle-même favorisé cette évolution, tout comme évidemment la prise de position du congrès du CTC en avril 1958 pour la création d'un nouveau parti à l'échelle pancanadienne.
Pourtant, l'orientation du troisième parti va tendre à refluer dès le début des années 1960, après une première percée sous Duplessis. Pourquoi ?
Il a été souligné que l'avènement au pouvoir du Parti libéral ainsi que l'essor de la question nationale et du nationalisme ont été les facteurs principaux de l'échec de l'orientation tiers-partiste à ce moment. Mais il faut ajouter que des obstacles internes au syndicalisme ont également pesé, comme le fait que des contingents entiers de la force de travail en étaient exclus et ne disposaient pas encore des points d'appui organisationnels nécessaires pour s'engager dans des luttes même strictement économiques. Le poids très réel de la doctrine et du conservatisme catholiques et les traditions de la non-partisanerie elles-mêmes ont aussi joué contre une réorientation aussi radicale de l'action politique syndicale, tout comme les plaidoyers de la presse et des partis dominants qui cherchaient à décourager l'apparition de cette nouvelle force politique.
Mais il faut voir aussi qu'à cette époque, tout comme maintenant, la constitution d'un nouveau parti est la voie qui engagerait le plus la responsabilité des organisations ouvrières. Elle représente un degré d'engagement politique beaucoup plus élevé que la non-partisanerie. Si une solution de rechange à ce type d'initiative parait se dessiner, [158] qui dispenserait le mouvement syndical de prendre lui-même la responsabilité d'offrir une issue, ressurgit la tendance à une action comptant davantage sur la pression.
C'est ce type de rapport que va rapidement nouer le mouvement syndical avec le gouvernement Lesage, de 1960 à 1964. Alors même que se poursuivent officiellement les efforts de la FTQ pour créer un parti des travailleurs, le mouvement syndical cherche à obtenir le maximum d'un gouvernement qui s'est justement constitué comme le principal véhicule politique de l'opposition anti-duplessiste. Cette tendance est même encouragée, contradictoirement, par la force nouvelle dont commencent à disposer les syndicats. Ceux-ci parviennent à déployer une intervention très efficace sur la scène politique et sociale, ce qui a pour effet de réduire, au moins temporairement, la croyance en la nécessité d'un parti autonome. L'action politique syndicale pendant cette période est marquée par une attitude de sympathie à l'endroit du gouvernement. Mais il ne faut pas conclure que cette sympathie ait signifié une soumission des centrales. Il est frappant de constater, par exemple, que pratiquant l'appui politique aux libéraux, les centrales syndicales assurent une action de mobilisation vigoureuse face au gouvernement pour le forcer à concéder le droit d'organisation, de négociation et de grève dans le secteur public.
Leur appui, en d'autres termes, est négocié en échange de concessions réelles. Ce rapport au gouvernement du Parti libéral ne va pourtant durer que peu d'années. Il est remis en cause dès 1965, lorsqu'il apparaît que, face au flot continu des revendications sociales et démocratiques, face au développement rapide du mouvement nationaliste aussi, les syndicats ne trouvent plus dans le gouvernement l'instrument politique de progrès qu'ils continuent d'escompter. Après les années du régime duplessiste, les libéraux étaient parvenus à capter les volontés de changement social et politique. Mais lors des élections de 1966, ni eux ni l'Union nationale ne peuvent prétendre jouer ce rôle.
Le vide politique ainsi manifesté, le mouvement syndical ne cherchera pas, à ce moment, à le combler. Il sort à peine de l'échec du Nouveau Parti démocratique-Parti socialiste du Québec qui pèse sur son comportement politique [3]. Par ailleurs, dès 1967, une scission au Parti libéral laisse croire qu'une recomposition significative des forces politiques est en train de s'opérer (autour de l'ex-ministre René Lévesque), qui pourrait déboucher sur la mise en place d'un nouvel instrument, lequel réaliserait, pour la première fois, la jonction entre les aspirations sociales et les aspirations nationales.
L'action politique syndicale est alors en attente. Mais, fait significatif, entre 1966 et 1968, on n'assiste pas à un simple repli vers une position de pression traditionnelle. Face au gouvernement de l'UN, les centrales syndicales CSN et CEQ vont tenter pour la première fois de se doter d'un moyen d'intervention politique permanent. C'est l'ouverture d'un deuxième front de lutte, c'est-à-dire en dehors des lieux de travail, à la CSN. Et, au lendemain de la défaite des syndicats devant le projet de loi 25 qui touchait les enseignants, on assiste à la création, au début de 1968, de comités d'action politique (CAP) à la CSN et de comités d'action et d'éducation populaires à la CEQ.
Ces initiatives reflètent une conviction accrue en la nécessité d'une action politique organisée. Mais elles ne sont pas conçues par leurs principaux promoteurs comme un pas ou une étape reliés au processus de la mise sur pied d'un troisième parti. Elles cherchent à compléter plutôt qu'à remplacer l'orientation non partisane ; [159] elles visent à élargir et à politiser l'action revendicative au-delà des seuls enjeux des conventions collectives. De sorte que, même si les syndicats se donnent alors les moyens d'une action politique plus autonome, c'est véritablement l'avènement du PQ qui marquera leur orientation électorale à partir de 1968.
- Action politique et nationalisme
Le nationalisme québécois des trente dernières années a beaucoup été étudié. Nous ne voulons cerner brièvement que les traits principaux de son rapport aux mouvements ouvrier et populaire.
L'enthousiasme et l'énergie suscités par les espoirs et réformes de la révolution tranquille, l'effervescence sociale qui accompagne la croissance de l'organisation syndicale entre 1957 et le début des années 1970, etc., tout cela favorise la radicalisation politique de plusieurs secteurs sociaux urbains plus ou moins liés aux classes salariées, à la petite-bourgeoisie et au monde étudiant (artistes, création du Mouvement laïque de langue française en 1961, de l'Union générale des étudiants du Québec en 1965, etc.). Ce contexte est également marqué par le poids objectif de la question nationale [4], qui tend à faire surgir de manière récurrente l'attrait des mouvements nationalistes, et, de façon moins visible, par l'échec du NPD au Québec que l'on a signalé. Cela explique pour une large part qu'une fraction importante de ces secteurs urbains tendra à se regrouper autour d'un projet nationaliste radical, se situant en prolongement et à gauche de la révolution tranquille. Le Rassemblement pour l'indépendance nationale (RIN), formé dès le mois de septembre 1960, apparaîtra bientôt comme l'expression principale de ce courant, qui défendra une position d'indépendance nationale, de laïcité et d'appui à certaines des grandes luttes ouvrières et populaires.
Mais cette conjoncture entraîne rapidement d'autres développements. Seule solution indépendante des vieux partis, le nationalisme va tendre alors à canaliser les volontés de rupture politique, ce qui, en retour, lui donnera un contenu nouveau : de mouvement traditionnel d'élite, il devient un phénomène de masse [5]. Il contribue à façonner la perception populaire des grandes questions politiques et recouvre, peu à peu, la prise en charge de toutes les aspirations, véritable enveloppe politique des revendications sociales et démocratiques. La dynamique de ce nouveau nationalisme va pénétrer l'ensemble des syndicats (de la base au sommet), comme des groupes populaires et communautaires, et articuler bientôt une conscience spécifiquement nationaliste de leurs rapports au politique et à l'État [6]. La rapidité de ces phénomènes confirme, par ailleurs, que des processus sociaux fondamentaux ébranlaient déjà le bipartisme traditionnel et créaient une ouverture pour un nouveau parti.
Le Parti québécois va précisément s'édifier comme le produit et le chaînon de cette évolution, dépositaire et révélateur à la fois des tendances observées. C'est d'abord en s'assurant l'hégémonie sur le mouvement d'aspirations nationales qu'il va réussir à s'ériger comme parti de masse. Mais le développement de l'organisation syndicale au Québec a constitué, comme tel, une condition de cette évolution. Marcel Fournier, dans son livre Communisme et anti-communisme au Québec (1920-1950) *, [160] avait souligné déjà comment la persistance en milieu urbain des réseaux de solidarité issus de la société traditionnelle rurale (famille, paroisse) avait représenté un facteur important de la faible percée des grands mouvements de gauche dans le Québec des années 1930. Pour la décennie 1960, la conjugaison des phénomènes d'urbanisation, d'industrialisation et de syndicalisation a eu raison de cet état de choses. Les nouvelles organisations de solidarité et d'action sociales poussent à l'activité revendicative, face au patronat et au gouvernement, des dizaines puis des centaines de milliers de personnes. Les milieux populaires urbains se regroupent dans des organisations qui échappent au contrôle des élites traditionnelles, politiques, économiques et cléricales. Ils prennent confiance dans leurs propres forces, s'habituent à intervenir dans les grandes questions de société. Le développement du syndicalisme est un facteur de politisation de masse qui contribue directement au processus de démocratisation que connaît alors la société québécoise. Le PQ va apparaître comme le véhicule politique de cette évolution, dans un cadre où le nationalisme populaire est devenu la première idéologie de contestation du bipartisme traditionnel.
Dès 1974-1975, le parti franchit le cap des 100 000 membres, et il en compte un peu plus de 130 000 au moment de la campagne de 1976. La composition de son membership (qui recoupe grosso modo celle de son électorat et se fonde en particulier sur les forces vives populaires et syndiquées) comme le type d'engagement militant qui lui est demandé tranchent avec ceux des vieux partis. La victoire contre Bourassa en 1976 va renforcer ces processus. En 1979, par exemple, le PQ compte quelque 200 000 membres, 238 000 en avril 1980, et près de 300 000 en mars 1981 (Fraser, 1984, p. 391-398 ; Carlos et Latouche, 1976 ; Hamilton et Pinard, 1984).
Dans ce sens, la victoire péquiste de 1976 présente certaines caractéristiques qu'il faut souligner. D'abord, elle n'est pas l'expression d'un simple processus d'alternance électorale et elle ne s'inscrit pas, non plus, dans le cadre du bipartisme traditionnel. Elle va plus loin, par exemple, que le type d'alliance que le CIO a établi dans les années 1930 avec le Parti démocrate aux États-Unis, expérience d'action politique syndicale non partisane qui est demeurée un modèle du genre. Le syndicalisme américain avait alors désigné l'un des deux partis dominants comme le véhicule de son intervention politique. Au Québec, dans les années 1970, l'appui syndical au PQ rompt avec le bipartisme établi, puisque ce parti lui-même se définit comme une alternative aux deux vieux partis. Personne, parmi les responsables du Parti québécois ou des unions ouvrières, ne décrit alors la formation de René Lévesque comme parti des travailleurs. Mais il est évident que le PQ, parce qu'il s'est développé en rupture avec le Parti libéral et l'Union nationale, est perçu comme jouant le rôle du troisième parti. Tout cela non seulement donne une nouvelle impulsion aux attentes envers le Parti québécois, mais renforce aussi la confiance à son égard. L'année 1976 confirme et accentue le monopole de représentation politique qu'exerce dorénavant le Parti québécois sur le mouvement syndical.
LES SYNDICATS ET LE PQ
Les mécanismes du rapport ainsi établi ont entraîné un développement qualitatif dans les modes concrets d'intervention et d'existence politiques du syndicalisme. C'est [161] ce que nous allons maintenant analyser, en retraçant les moments forts de cette évolution.
- La nouvelle alliance
Au tournant de la décennie 1970, le mouvement ouvrier est en rupture ouverte avec les partis qui ont traditionnellement exercé le pouvoir sur la scène provinciale. Les structures et les lieux de concertation au niveau étatique sont largement discrédités. Le gouvernement de l'Union nationale, par exemple, a créé en 1969 un Conseil général de l'industrie chargé de le conseiller sur l'avenir économique de la province et composé uniquement de représentants du monde patronal (Favreau et L'Heureux, 1984, p. 59). Clinton Archibald rappelle, de son côté, que trois jours après la première réunion du Conseil consultatif de la planification et du développement mis en place en décembre 1970, la FTQ s'en est retirée en expliquant que les travailleurs s'y trouvaient sous-représentés (Archibald, 1983, p. 221).
De fait, les élites politiques s'avéraient alors incapables de définir les termes d'un mode efficace de coexistence et de collaboration avec le monde ouvrier. Autre développement important : en 1970, l'imposition de la Loi des mesures de guerre allait susciter la formation d'un large front d'opposition syndical-démocratique qui, quelques mois seulement après la venue au pouvoir de Robert Bourassa, témoignait de l'hostilité envers son gouvernement. À peine engagée, l'expérience Bourassa était rejetée par le syndicalisme.
La dynamique que favorisait le nouveau poids social des syndicats renforçait, par ailleurs, la nécessité et la volonté d'une intervention politique à leur propre compte. Ainsi, l'argument [7] selon lequel des liens trop étroits unissaient l'État et les milieux du grand capital débouchait sur la recherche active d'un accès aux modalités de détermination des politiques macro-économiques pour les classes populaires [8]. Dans sa Déclaration de principes publiée en 1971, la CSN disait considérer « comme une exigence de la justice sociale que les travailleurs puissent participer, par leur organisation syndicale, à l'élaboration des politiques économiques qui façonnent la société dans laquelle ils vivent » (CSN, 1971, p. 38). Un peu dans le même sens, au congrès de la FTQ de 1969, le président Louis Laberge s'était vu durement reprocher de ne pas avoir fait participer la centrale à la bataille contre le Bill 63 sur la liberté de choix de la langue d'enseignement [9] ; et les travailleurs organisés de Saint-Jérôme, de Baie-Comeau et de Hauterive s'engageaient en 1967-1968 dans les campagnes électorales municipales.
Le syndicalisme cherchait alors à définir les moyens qui lui procureraient une influence politique à la mesure de ce qu'il était devenu. La situation donna momentanément lieu à des développements contradictoires, nourris par les tensions qui s'élevèrent sans cesse entre le mouvement ouvrier et les gouvernements de Robert Bourassa, de 1970 à 1976.
On observe ainsi la montée spectaculaire des actions de contestation et d'opposition radicales face au gouvernement et aux institutions. C'est l'époque où Louis Laberge, président de la FTQ, dit que le syndicalisme doit s'interroger sur sa participation aux organismes gouvernementaux de consultation, parce que les conditions [162] qui lui sont offertes sont celles d'une fusion des pouvoirs économique, judiciaire et politique contre nous ; en ce sens, seule compte vraiment, explique-t-il, notre organisation en « force de frappe », le lobby et le travail en commissions parlementaires ne pouvant servir de substituts aux rapports de force que permettent l'action immédiate et les manifestations (Laberge, 1971, p. 7-9, 16-17). Il appelle le congrès de la FTQ en 1971 à « casser le régime » par une action politique directe. Même évolution à la CSN, où le président Marcel Pepin déclare au congrès de 1972 qu'il est nécessaire « d'abattre le régime Bourassa », notamment par la constitution, dans chaque circonscription provinciale, de comités populaires.
Non seulement le dialogue n'est-il pas à l'ordre du jour, mais les points de contact avec l'appareil d'État deviennent presque inexistants. Ce que consacrent les grands manifestes syndicaux du début de la décennie 1970 qui veulent marquer une rupture avec le régime libéral et la rationalité même de l'entreprise privée : L’État, rouage de notre exploitation (FTQ), Il n'y a plus d'avenir pour le Québec dans le système économique actuel et Ne comptons que sur nos propres moyens (CSN), L'école au servi de de la classe dominante (CEQ).
C'est dans ce cadre qu'au printemps 1970 furent réunis 15 grands colloques intersyndicaux qui allaient permettre à quelque 5000 militants des 3 centrales partout au Québec de discuter des conditions de leur action collective hors des lieux de travail. Et c'est dans ce contexte, enfin, qu'a été renforcée à la CSN l'intention de créer des comités d'action politique (CAP) dans les 108 circonscriptions électorales de l'époque, et encouragé le travail d'un comité central d'action politique, avec un secrétariat permanent (Favreau et l'Heureux, 1984, p. 33-34).
Si l'activité des CAP a consisté d'abord à développer l'intervention dans différents enjeux sociaux, les colloques intersyndicaux ont débouché plus directement sur la volonté d'une politique indépendante au palier municipal. Le fleuron le plus connu de l'action municipale (de type troisième parti autonome) fut la création du Front d'action politique (FRAP) [10] à Montréal en mai 1970, produit de la rencontre du colloque intersyndical de la région métropolitaine et d'un regroupement local d'associations populaires (RAP). Son objectif « était d'élire à l'Hôtel de Ville le plus grand nombre de conseillers possible qui seraient responsables à la classe ouvrière [11] », comme le déclara son vice-président Émile Boudreau, du Conseil du travail de Montréal (FTQ). Bien que limitée au palier municipal, l'expérience du FRAP tranchait avec la non-partisanerie traditionnelle. Elle était l'expression d'une politique favorisant la mise sur pied d'une formation émanant comme telle du mouvement ouvrier.
Pourtant, l'expérience du troisième parti n'ira pas au-delà de cette étape. Les grands manifestes syndicaux des années 1971 et 1972 marquent certes une radicalisation idéologique des centrales, elle-même nourrie par les luttes sociales de cette période. Toutes trois prônent l'instauration d'une société socialiste à participation démocratique. Mais le comité des douze, chargé à la CSN de superviser la discussion d'ensemble sur les manifestes de la centrale et d'en consigner les résultats, fait remarquer que si tous les textes et débats posent la question du pouvoir, personne n'en tire une orientation précise quant à l'action politique, ce qui est d'autant plus étonnant qu'on est en présence d'un rejet en bloc des partis traditionnels (Comité des douze, 1973, p. 43-49). Dans ce contexte, l'évolution politique du syndicalisme marque [163] rapidement le pas, et elle va s'éloigner des formes d'action reliées au troisième parti pour revenir progressivement à celle de la non-partisanerie, une non-partisanerie désormais favorable au PQ (quel que soit, par ailleurs, le vocabulaire employé pour la présenter).
Pendant une courte période, le développement de ces formes spécifiques a été concurrent. Les colloques intersyndicaux ont considéré l'action politique municipale comme un « lieu d'apprentissage » des luttes pour le pouvoir. Mais en même temps, pour beaucoup, cette expérience était complémentaire à celle du Parti québécois sur la scène provinciale. Le PQ a été formé l'année même (1968) où on a lancé le deuxième front. En ce qui a trait à l'éclosion d'un nouveau parti, les colloques syndicaux apparaissent donc avec un temps de retard sur le mouvement dirigé par René Lévesque. Le double caractère de l'évolution politique du syndicalisme est alors révélé par le fait que la plupart des militants engagés dans la désignation de candidats municipaux des travailleurs sont par ailleurs membres actifs du PQ. Cela est vrai en province, à Montréal et dans la ville de Québec : près de la moitié des candidats du FRAP, semble-t-il, étaient membres d'exécutifs locaux du Parti québécois ; des syndicalistes s'assuraient que le programme du PQ reprenne des revendications provenant du mouvement syndical; d'autres, se réclamant du socialisme et d'un parti des travailleurs, ne voyaient aucun problème à appuyer des candidats péquistes (Favreau et L'Heureux, 1984, p. 60, 99, 102).
La concurrence momentanée des formes différentes d'action politique se résorba au profit de la non-partisanerie, précisément parce que la création du PQ fut considérée comme la réalisation de leur choix politique par de larges secteurs ouvriers et populaires. En ce sens, si les formes de l'action politique des centrales deviennent assimilables, à partir de ce moment, aux grandes pratiques non partisanes, la conscience qui émane des processus en cours ne leur est pas réductible. D'une certaine manière, les formes réelles de cette action deviennent non partisanes, mais la conscience les perçoit (pour une bonne part) comme s'il s'agissait du troisième parti réalisé, ainsi que nous l'avons déjà mentionné.
En vue des élections provinciales de 1973, la CSN publia un cahier spécial [12] où elle comparait les positions des divers partis avec les siennes. Il en ressortait clairement que les orientations du PQ étaient beaucoup plus proches de ses points de vue. Louis Laberge, quant à lui, tenait à faire remarquer que la plupart des candidats issus des syndicats se présentaient sous la bannière péquiste... Initiatives qui, chacune à leur façon, reprenaient bien sûr des modalités traditionnelles de la non-partisanerie nord-américaine.
Entre 1971 et 1974, l'action politique municipale connut elle-même un changement de cap. À Montréal, à l'approche des élections de 1974 et à la suite d'un appel des derniers éléments du FRAP, les instances régionales des trois centrales décidaient d'œuvrer à nouveau à la formation d'un parti opposé à celui du maire Drapeau. Mais, cette fois, on associa le Parti québécois à ce projet, qui aboutit en avril 1974 à la création du Rassemblement des citoyens de Montréal (RCM). Le RCM s'adressait précisément aux citoyens de Montréal, alors que le FRAP s'était présenté comme l'instrument des salariés [13].
[164]
Et pour les élections de 1976, la non-partisanerie emprunta un autre de ses axes traditionnels, celui qui consiste à propager ses grandes revendications sous forme de programme politique, mais sans parti indépendant pour les défendre. La CEQ avait déjà évoqué la nécessité de diffuser les revendications des travailleurs et de les porter sur la scène publique, alors que Louis Laberge (1975, p. 48) déclara pour sa part :
- Je pense que le temps est venu de réunir nos revendications éparses [...] pour en dégager un véritable programme politique des travailleurs québécois que nous pourrions expliquer à nos membres et [...] mettre de l'avant au moment des grands débats publics que sont les campagnes électorales.
À la CSN, le Conseil confédéral de janvier 1976 adoptait une résolution voulant « que les syndiqués, au plan local, régional et national, sur les lieux de travail et dans les fédérations, travaillent à l'élaboration de l'idéologie politique et d'un programme par et pour les travailleurs » (Pepin, 1976). Quand la campagne fut lancée, les trois centrales appelèrent plus ou moins ouvertement à voter « pour le parti le plus près de nos intérêts » – c'est-à-dire le PQ. À la FTQ, on avait aussi invité les syndiqués à militer au sein du Parti québécois, afin d'influencer son programme : position qui se rapproche du type de lien non partisan que l'AFL-CIO entretient à l'égard du Parti démocrate. Le 26 octobre, en conférence de presse, la FTQ confirmait explicitement cette orientation par un appui officiel au Parti québécois (Lamoureux, 1985, p. 16).
Après la victoire du PQ en 1976, on en viendra à mettre l'accent sur l'idée qu'il n'est pas de la nature du syndicalisme d'intervenir dans la constitution d'un parti. Norbert Rodrigue, président de la CSN, soulignera ainsi au congrès de sa centrale en 1977, que « l'action politique, c'est [pour nous] l'action revendicative à tous les plans, qui [...] développe une ligne alternative embrayée sur des changements fondamentaux » (CSN, 1977, p. 38). Au cœur de ce discours se confirmait le reflux des initiatives reliées à la formation d'un parti des travailleurs. L'action politique allait se manifester dorénavant sous la forme d'une pression revendicative sur le PQ, dans une conjoncture où le parti de René Lévesque était pratiquement reconnu comme la représentation politique du mouvement social. Cette orientation fut plus poussée à la FTQ qu'à la CSN et à la CEQ. Mais en ce qui concerne les formes de l'action politique, la ligne de conduite était semblable d'une centrale à l'autre.
Il est important d'analyser plus précisément la nature de l'alliance politique qui s'est alors réalisée entre le mouvement syndical et le Parti québécois. Aucun des organismes représentatifs du patronat n'appuie en 1976, ni en 1981, le Parti québécois. Sa victoire est ressentie comme une victoire du vote populaire contre les partis et les candidatures que la classe dominante considère comme les siens, même si le PQ n'est officiellement présenté par aucun groupe comme parti ouvrier. En ce sens, sa victoire de 1976 peut être comparée, croyons-nous, aux processus politiques des fronts populaires européens et à ce qu'a représenté historiquement l'élection de gouvernements de ce type.
Le Parti québécois était porté par la dynamique des aspirations populaires et des volontés de changement. Il présentait un programme faisant droit à certaines revendications sociales et ouvrières. De plus, à l'instar des fronts populaires, il mena campagne comme un instrument de rupture avec les formules traditionnelles du bipartisme [165] et de l'alternance gouvernementale. La victoire sur ces formules, c'était la victoire du vote populaire par l'intermédiaire du parti que les militants et membres des syndicats et des organismes revendicatifs, que les gens de gauche, etc., voyaient comme leur parti. Mais il faut aussi souligner le rapport contradictoire qui, comme dans le cas des fronts populaires, s'établit entre les aspirations de l'électorat et le type de gouvernement qui se met en place. Il serait, en ce sens, insuffisant de noter que la victoire péquiste est le produit de ces aspirations, car elle est simultanément l'instrument pour les canaliser et les contenir, et le gouvernement péquiste se dressera bientôt contre leur réalisation.
L'une des caractéristiques premières des fronts populaires est de coaliser des partis qui tirent leur origine de l'évolution propre du mouvement ouvrier (PC, PS, travaillistes, etc.) et des partis dont la nature historique procède du mouvement d'autres forces sociales (par exemple, en France et en Espagne au cours des années 1930, de la bourgeoisie républicaine et laïque). Les gouvernements ainsi formés ne peuvent pas être caractérisés de gouvernements ouvriers, même si la principale force électorale de ces coalitions est majoritairement ouvrière et populaire.
N'étant pas un parti ouvrier, mais comptant sur l'appui du mouvement syndical et cherchant celui de nombreux secteurs en croissance de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie québécoise, le gouvernement péquiste a eu ainsi certains traits de la fonction politique qu'exercent les gouvernements de fronts populaires. L'alliance politique qu'il véhiculait fut à ce titre peut-être informelle, mais elle fut aussi forte que les coalitions formelles vues dans d'autres pays. C'est cela, croyons-nous, qui donne d'abord sa signification à l'élection de 1976.
À ce moment, pour le mouvement syndical, le rapport au nationalisme péquiste apparaissait très rentable et l'alliance avec lui encore plus naturelle et plus facile à justifier.
- Concertation et participation
Le programme du Parti québécois annonçait une volonté de reconnaissance institutionnelle du mouvement ouvrier qui dépassait tout ce qu'on avait connu : promesses d'application universelle de la formule Rand et de l'atelier syndical, accréditation multipatronale, etc. Dans l'idéologie et la pratique gouvernementale du PQ, cette volonté s'avérait inséparable de la préoccupation d'établir une participation structurée des syndicats à la détermination de certaines politiques économiques, voire de leur proposer des schèmes d'incorporation volontaire.
Au moment où le PQ mettait en avant l'idée de la concertation, les centrales québécoises refusaient unanimement le projet de corporatisme tripartite élaboré en 1976 par le Congrès du travail du Canada sur la scène fédérale. Pourtant, dès l'élection du PQ, des positions favorables à la concertation et même à certaines restrictions sur le plan revendicatif étaient apparues au sein des centrales [14]. Et quand le gouvernement Lévesque convoqua son premier sommet économique, le Bureau national de la CEQ parla d'un « geste politique sans précédent au Québec », pouvant servir « à la consolidation du gouvernement à l'intérieur du Québec, ainsi qu'à sa crédibilité sur les marchés financiers extérieurs » (CEQ, 1977).
[166]
Car le mouvement de sympathie était alors présent dans chacune des centrales québécoises et il provenait, à notre avis, de trois facteurs principaux. D'abord, l'ouverture du PQ envers le syndicalisme était réelle, au sens où son programme annonçait un type de reconnaissance de leur existence qui semblait tout à fait acceptable aux syndicats. Ensuite, ses projets de concertation étaient présentés non seulement comme faisant une large part au mouvement ouvrier, mais comme visant à redéfinir la vie économique et sociale selon des principes démocratiques qui apparaissaient similaires aux siens. Enfin, le parti constituait pour l'immense majorité de la base syndicale le nouveau parti qu'elle avait porté au pouvoir, la promesse du changement réalisée ; en ce sens, elle était prête à collaborer avec lui, elle lui faisait confiance, ce qui était totalement différent de ses perceptions du gouvernement de Pierre Elliott Trudeau sur la scène fédérale.
Le plus surprenant, dès lors, est peut-être que les relations de concertation PQ-syndicats ne soient pas allées plus loin et ne se soient pas davantage formalisées dans des mécanismes stables. Au départ, les bonnes dispositions étaient manifestes, tant du côté des syndicats qu'au sein du gouvernement péquiste. Mais plusieurs facteurs devaient concourir à compromettre ce développement. Soulignons les éléments suivants. D'abord, la situation économique marquée par la récession de la mi-décennie 1970 : si le gouvernement promulgue des réformes allant dans le sens des positions syndicales [15], il ne s'engage pas dans le type de concessions [16] qui, à terme, pourraient véritablement approfondir la concertation avec les centrales. Ensuite, le bastion le plus puissant du mouvement ouvrier au Québec, constitué par les salariés de la fonction publique et parapublique, est en rapport de négociation direct avec l'État, ce qui tend à susciter sans cesse des points de friction avec le gouvernement. La décision de la CEQ de ne pas participer en mars 1979 à la deuxième conférence de concertation socioéconomique (Montebello), alors que s'ouvre la nouvelle ronde de négociations du Front commun des syndicats des secteurs public et parapublic, trouve ici ses tenants. Finalement, les mécanismes participationnistes sont aussi enrayés du fait que le mouvement ouvrier perd peu à peu ses illusions sur la nature du programme péquiste. On attendait des mesures économico-sociales [17] et de démocratisation de l'État [18] qui auraient exigé des niveaux de rupture avec l'ancien régime que jamais le gouvernement péquiste ne voulut réaliser.
Les processus d'intégration du mouvement syndical québécois n'iront donc pas très loin, malgré les tentatives dans cette direction. En 1979, le gouvernement de René Lévesque aura recours, à l'instar de son prédécesseur, à des lois spéciales contre certains syndicats (par exemple, le retrait du droit de grève au Front commun). Mais à ce moment, l'effet de ces gestes sur les attitudes politiques du syndicalisme organisé, et sur celles de ses membres, fut moins important qu'il pourrait paraître à première vue. Le statut du Parti québécois ne dépendait pas d'abord d'une exacte correspondance entre son programme social et celui des syndicats, mais du contenu dont étaient chargées les aspirations nationales, et du monopole de représentation politique acquis sur ces aspirations. À l'époque, c'était la marche au référendum de 1980 qui ponctuait fondamentalement la vie politique.
Dans ce cadre, les mécanismes de contact entre le gouvernement provincial et le mouvement ouvrier ne disparurent pas. Ils changèrent plutôt de registre. Il est [167] révélateur que l'accès au cabinet péquiste d'hommes et de femmes liés au syndicalisme semble s'accentuer au moment où les sommets économiques s'avèrent moins prometteurs. C'est un peu comme si on avait voulu établir de nouvelles voies privilégiées de liaison PQ-syndicats, voies plus efficaces dans la mesure où elles seraient directes et permanentes et échapperaient aux aléas de la conjoncture, à la différence des grands sommets [19].
QUESTION NATIONALE
ET QUESTION SOCIALE
Le référendum du 20 mai 1980 au Québec a représenté un moment et une manifestation extrêmement critiques de la crise de l'État canadien. Il en fut de même de tous les débats entourant la mise en œuvre du processus de rapatriement de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (AANB). L'orientation du Parti québécois subit alors deux défaites majeures qui allaient entraîner dans les syndicats les premiers vrais questionnements internes sur le bien-fondé de leur alliance avec le PQ. Nous rappellerons ici quelques éléments-clés de cette période, complétés d'indications sur le moment fort de la distanciation radicale qui s'opéra entre le mouvement ouvrier et le Parti québécois à partir de 1983.
- Une évaluation du péquisme
Une première observation s'impose. En 1980, aucune des centrales syndicales québécoises ne s'est prononcée officiellement en faveur de l'indépendance. Or, la simple reconnaissance du droit à l'autodétermination, qui ralliait la FTQ, la CSN et la CEQ, ne pouvait représenter une position achevée sur la question nationale au Québec. Le débat politique était parvenu à un stade plus élevé, mettant en jeu les formes concrètes d'exercice de ce droit. S'en tenir à affirmer un principe pouvait être identifié à un refus de prendre position, voire à une défection.
À la veille de la période référendaire, les débats amorcés depuis des années à ce sujet donnèrent lieu à un congrès spécial de la CSN, les 1er et 2 juin 1979. Le comité d'orientation de la centrale, appuyé par la majorité de l'exécutif, y recommanda que « pour lutter efficacement contre l'oppression nationale et ses diverses manifestations, la CSN [s'inscrive] dans une démarche d'appropriation par le peuple québécois des pouvoirs et institutions politiques, économiques et culturels » (CSN, 1979). Mais à part cette recommandation, il proposa que la centrale ne se donne pas de position constitutionnelle précise. Cette orientation réussit à s'imposer face à un fort courant qui voulait que la centrale se prononce pour l'indépendance.
La même orientation fut adoptée par la CEQ moins d'une semaine plus tard (les 8 et 9 juin 1979) lors d'un congrès spécial. Après avoir demandé à ses membres et à ses instances de lutter contre toute négation du droit à l'autodétermination et exigé la reconnaissance effective de ce droit par le gouvernement fédéral, le congrès, sur proposition de l'exécutif, décidait que la participation de la CEQ au débat public sur la question nationale ne se ferait pas sur la base d'une option constitutionnelle. Tout [168] autant qu'à la CSN, cette position était défendue non pas contre d'éventuels partisans du fédéralisme mais contre ceux qui voulaient une intervention active en faveur de l'indépendance (Rouillard, 1989, p. 369-370).
Quant à la FTQ, qui tenait un congrès du 26 au 30 novembre suivant, la direction de la centrale, présentant elle-même la question nationale comme l'un des éléments primordiaux à discuter (voir Le Monde ouvrier, journal de la FTQ, édition d'octobre 1979), remit aux délégués ses textes d'orientation à l'ouverture des travaux. Au congrès de 1977, les délégués avaient invité la centrale à défendre les intérêts des travailleurs dans le débat référendaire et à procéder à une large consultation sur le sujet. Pourtant, au congrès de 1979, comme l'ont noté les journaux, les propositions mises de l'avant par Louis Laberge et tous les leaders furent relativement limitées. Le document qu'ils présentèrent (La FTQ et la question nationale) réitérait la position de 1977 et proposait la tenue d'un conseil général ou peut-être d'un congrès spécial « pour prendre position » lorsque la question référendaire du gouvernement Lévesque serait connue. À l'unanimité, les délégués exigèrent la tenue obligatoire d'un tel congrès. Le débat fut houleux. Ainsi que le rapporta Le Devoir, le 30 novembre 1979 : « La FTQ, qui a réaffirmé hier le droit du Québec à l'autodétermination, a dû en quelque sorte retenir de nombreux délégués qui voulaient discuter immédiatement de l'avenir du Québec. »
Quand la question référendaire du gouvernement Lévesque fut connue, les trois centrales appuyèrent, sous des formes plus ou moins officielles et plus ou moins critiques, le oui péquiste [20].
Dans les mois qui suivirent le référendum, un certain nombre de critiques ont été formulées à l'intérieur des organisations syndicales du Québec sur l'orientation qui fut la leur à cette occasion. Nous citerons à ce sujet les termes d'un premier bilan établi par Gérald Larose, alors président du Conseil central de la CSN à Montréal et devenu depuis président de la centrale.
À l'automne 1980, Larose écrivait que selon lui, lors du référendum, le mouvement syndical avait « subi un échec ». « Le 20 mai 1980, disait-il, aura été la victoire de la formidable coalition des forces de la réaction capitaliste, patronale et fédéraliste du pays. »
Quelle avait été la caractéristique de l'orientation politique des syndicats jusqu'au référendum ? La réponse de Larose était sans équivoque :
- Faut-il préciser, affirmait-il, qu'au détour de la dernière décennie, le mouvement syndical s'est pratiquement désisté de la question nationale en faveur du Parti québécois et, ce faisant, a laissé à ce dernier toute la place pour se tailler un rôle hégémonique concernant les droits et le statut du Québec. Il en fut ainsi que le caractère indépendantiste et progressiste de la question nationale s'est rapidement effrité pour ne devenir qu'un vague projet de réaménagement des structures politiques du Québec dans un cadre capitaliste et encore canadien.
Dans ce contexte, les « voies à suivre » pour reprendre l'initiative de la lutte n'étaient pas faciles à définir, mais « le mouvement syndical ne peut plus laisser au Parti québécois le soin de définir seul l'avenir des droits et du statut du Québec » (Larose, 1980, p. 62).
[169]
À ces éléments, il importe d'ajouter le constat suivant qui découle, croyons-nous, de l'étude des congrès et des prises de positions pré-référendaires des centrales syndicales : si le mouvement ouvrier s'est « désisté » de la question nationale au Québec, cela s'est notamment articulé autour de l'absence d'une position constitutionnelle précise. C'est de cette manière que la politique de souveraineté-association du PQ et la stratégie qui en découla sont plus facilement demeurées hégémoniques.
Au lendemain du référendum, il n'y eut pas de bilan officiel de l'action des centrales syndicales, même si les critiques que nous avons résumées favorisaient une réorientation stratégique. L'intervention politique des syndicats et leur rapport au gouvernement péquiste restèrent fondamentalement les mêmes. Les menaces constitutionnelles que faisaient peser les initiatives post-référendaires du gouvernement fédéral, la marche au rapatriement unilatéral agirent comme autant de pressions pour le maintien de l'alliance avec le PQ.
Et cela, même si en octobre 1980, après l'annonce du plan de rapatriement de l'AANB, le président Robert Gaulin de la CEQ (1980) avait pu déclarer :
- Le gouvernement du Parti Québécois a ouvert la voie au rapatriement de la constitution [...] Le PQ aura servi de marchepied pour les entreprises de Trudeau. Il incombe aux différentes organisations syndicales et populaires d'organiser la riposte contre cette agression antidémocratique et anti-populaire.
Quand, le 6 décembre 1982, la Cour suprême du Canada statua à l'unanimité que, selon la constitution canadienne, le Québec ne détenait pas de droit de veto formel en matière d'amendement constitutionnel, les trois centrales FTQ, CSN et CEQ, réunies au sein d'un front commun de diverses organisations, émirent une déclaration politique qui affirmait notamment :
- Cette constitution [...] n'est pas, ne peut pas être et ne sera jamais la nôtre. Et puisque nous n'avons plus de constitution, nous devons maintenant nous en donner une. Et comme le processus actuel joue toujours contre nous, nous devons nous donner un mode de détermination constitutionnelle qui nous convienne : le seul qui convienne à cette époque de démocratie, c'est celui qui consiste à redonner la constitution à celui à qui elle appartient c'est-à-dire au peuple lui-même (CSN-CEQ-FTQ, 1982).
La revendication d'une constitution élaborée par le peuple comme moyen d'une riposte effective était avancée, dans un cadre qui supposait la convocation d'une assemblée constituante québécoise. L'appel n'eut cependant pas de suite immédiate. Mais il révélait que les échecs de 1980 et de 1982 du PQ avaient provoqué une distanciation critique des syndicats envers ses orientations et stratégies, et suscité la volonté d'une plus grande autonomie de leur part face à l'enjeu de la question nationale.
Quand s'engagent en 1987 les discussions sur l'accord du lac Meech, les centrales québécoises interviennent cette fois en fonction même de ces nouvelles dispositions.
Très vite, elles rejettent l'accord, parce que son élaboration et le processus de son adoption ne sont pas fondés sur une large participation démocratique de la population et parce que ses clauses ne satisfont pas aux besoins nationaux du Québec. Avant l'échec définitif de l'accord, la CEQ, la CSN et la FTQ se prononcent officiellement au printemps 1990 en faveur de l'indépendance du Québec et (selon des termes et des [170] modalités spécifiques dans chaque cas) pour la convocation d'une assemblée constituante du peuple québécois [21]. On doit donc noter que c'est en étant poussées par l'approfondissement de la crise constitutionnelle et en agissant de manière plus autonome face au PQ que les trois principales centrales du Québec ont opté explicitement pour l'indépendance, et non du fait de leur alliance avec lui.
La crise du lac Meech se répercuta d'ailleurs si fortement qu'elle divisa les délégués aux assises du Congrès du travail du Canada (CTC) (dont la FTQ est membre) qui se tenait à la mi-mai 1990 à Montréal. S'il y avait une large majorité des délégations qui refusaient l'accord, les motifs de la FTQ sont apparus diamétralement opposés à ceux des autres composantes du CTC, ce qui la conduisit presque à quitter le congrès.
- Le point de rupture
La conjoncture de crise des années 1982-1983 entraîna par ailleurs une transformation qualitative de la position politique du syndicalisme québécois. Elle accéléra un processus à travers lequel l'appui au PQ se changea soudainement en rejet massif. Le « préjugé favorable aux travailleurs », selon l'expression de René Lévesque, avait fait place à des politiques de réductions des programmes sociaux, d'amputations des salaires et d'affrontement ouvert avec les syndicats, dans un contexte où le gouvernement péquiste s'avérait incapable de réduire le chômage.
Nous ne pouvons reprendre toutes les péripéties de la crise sociale à laquelle conduisit l'affrontement entre le gouvernement du Québec et les 300 000 employés des secteurs public et parapublic à cette époque. Il faut noter cependant que son déroulement constitua le moment concret de la nette rupture de l'alliance qui s'était opérée entre le syndicalisme et le parti de René Lévesque. Et il s'agit du développement le plus important à être survenu au cours de la dernière période dans l'évolution politique du mouvement ouvrier.
Ce processus connut diverses expressions. C'est contre le gouvernement issu d'un parti qui avait concentré les énergies politiques et les aspirations du syndicalisme que fut votée dans chaque milieu des secteurs public et parapublic, puis à l'unanimité des 800 délégués du Conseil d'orientation du Front commun, le 9 janvier 1983, la grève générale. La manifestation de 50 000 personnes devant l'Assemblée nationale le samedi 29 janvier suivant fut une démonstration de nature essentiellement politique. Par la suite, l'invective contre tous les ministres, à chacune de leurs sorties publiques, la colère exprimée à leur endroit par les enseignants lors de la réunion de mars 1983 du Conseil national du Parti québécois traduisaient la même déception. C'est aux cris d'« élections ! élections ! », « PQ battu, vendu », etc., que des fonctionnaires intervinrent lors de conférences de presse ministérielles.
En exigeant la démission du gouvernement, la CSN et son président expliquèrent que le Parti québécois s'était « disqualifié au plan national, économique et social » (CSN, 1982). Louis Laberge, de la FTQ, déclara à la même époque que le gouvernement était condamné, et qu'on allait maintenant voir s'il restait une chance de sauver le parti. Il demanda en conséquence au Conseil national du PQ, dont une réunion était convoquée pour le 5 mars, d'exprimer sa dissidence. Mais le Conseil national appuya plutôt les démarches gouvernementales « dans toute leur rigueur » (Le Devoir, 7 mars [171] 1983), ce qui constituait sa réponse à la question soulevée par le président de la FTQ et à l'espoir qu'il avait exprimé de pouvoir dissocier le parti du gouvernement qui en émanait. Certaines instances de la centrale semblent alors avoir envisagé d'intervenir au sein du PQ pour y accroître l'influence syndicale [22]. Mais cela n'eut pas vraiment de suite. Lors du colloque du CTC tenu du 5 au 8 mars 1983 à Québec sous le thème « L'égalité maintenant » (colloque convoqué comme contribution à la lutte contre l'oppression spécifique aux femmes), les quelque 600 déléguées adoptèrent à 1'unanimité une recommandation affirmant notamment :
- – Qu'il soit résolu que le mouvement syndical fonde un parti des travailleuses, travailleurs au niveau provincial (Québec), dans l'année qui suit afin de présenter des candidats à de futures élections. Les syndicats devront défrayer les coûts nécessaires à la mise sur pied de ce parti et assurer le suivi (CTC, 1983).
Enfin, soulignons qu'à la Fédération des affaires sociales-CSN, la décision fut prise, lors d'une réunion du Conseil fédéral tenue en ce même mois de mars 1983, d'organiser une « anti-campagne de financement du PQ ». Encore là, ces décisions n'eurent pas d'effets immédiats concrets. Mais elles reflétaient une évolution dont l'influence allait être durable. Les relations privilégiées entre le Parti québécois et les syndicats venaient de se dissoudre dans une grave crise sociale qui remettait directement en cause les formes mêmes de l'action politique syndicale telles qu'elles avaient progressivement été façonnées depuis la révolution tranquille. Le Parti québécois n'était plus vu comme le véhicule politique et le porte-parole parlementaire des aspirations syndicales. En ce sens il y avait rupture, rupture parce que se combinaient pour les syndicats les échecs péquistes sur la question nationale elle-même et l'effondrement de son orientation progressiste en matière sociale.
Les syndicats (et les autres mouvements populaires) du Québec entraient dans une nouvelle période de redéfinition de leur rapport à la politique. L'alliance avec le Parti québécois, qui avait duré quelque quinze ans, faisait place à une situation d'expectative. Les résultats de l'élection du 2 décembre 1985, qui portait au pouvoir les libéraux de Robert Bourassa, le démontraient à leur façon : les pertes péquistes s'avéraient « deux fois plus importantes que les gains libéraux », avec « augmentation concomitante des abstentions » (Drouilly, 1990a, p. 106). À l'élection du 25 septembre 1989, le taux d'abstention atteignait même « un niveau record » ; comme il était le produit, d'abord, de l'électorat francophone et péquiste (Drouilly, 1990b, p. 260-262), on peut supposer qu'il témoignait de nouveau de la rupture des relations privilégiées entre de vastes secteurs de la population laborieuse et le Parti québécois.
LES ANNÉES BOURASSA, BIS
Sur les plans économique et social, le retour au pouvoir de Robert Bourassa en 1985 et sa réélection en 1989 n'entraîneront pas un tournant brusque dans les relations gouvernement-syndicats. On voit plutôt se poursuivre les mêmes orientations et le même type d'interventions que ce qu’on a observé depuis le début des années 1980. Mais la situation du syndicalisme est marquée par de nouvelles formes d'hostilité ouverte [172] à son endroit de la part des milieux patronaux et gouvernementaux. Les syndicats paraissent plus que jamais sur la défensive, attaqués par des adversaires coriaces que les protestations ouvrières ne semblent plus ébranler. Il est facile de situer cette nouvelle conjoncture dans celle des politiques inspirées quelques années plus tôt par le reaganisme ou le thatchérisme. Non seulement les gouvernements redoublent-ils d'ardeur face aux syndicats, mais ils semblent décidés à reprendre le terrain perdu (les conquêtes sociales) des années antérieures. Dans ce contexte, l'orientation des états-majors syndicaux apparut incontestablement décontenancée.
- La place des syndicats
dans les rapports sociaux
Depuis 1985, les libéraux ont fait leurs certaines des pièces législatives les plus marquantes du péquisme, telle la loi 37 dans le secteur public, adoptée pour fournir au gouvernement de nouveaux moyens d'enrayer le caractère conflictuel des négociations et des luttes revendicatives. Par ailleurs, parallèlement à cette législation préventive, le gouvernement de Robert Bourassa n'hésite pas à recourir à des lois ponctuelles pour mater la combativité syndicale. En témoigne, plus que d'autres, l'adoption en 1989 de la loi 160 qui vient briser, par des dispositions d'une extrême sévérité (eg. les pertes d'ancienneté), l'action collective des employés du secteur de la santé.
Puis, le gouvernement Bourassa va annoncer des mesures de gel des salaires au printemps de 1991 pour tous les salariés des secteurs public et parapublic, lesquelles rappelleront les actions analogues du gouvernement péquiste au début des années 1980. Il reviendra à la charge deux ans plus tard avec le même type de législation salariale (la loi 102) et fera adopter en juin 1993 la loi 198 qui impose de lourdes réductions d'effectifs et des compressions budgétaires massives pour les mêmes secteurs.
Du côté syndical, on voit d'abord s'affirmer, devant l'ampleur de ces mesures, la volonté de négocier, comme cela avait été le cas par suite des revers subis au début des années 1980. Les dirigeants des trois centrales s'unissent pour dénoncer publiquement, le 8 mai 1990, la politique du gouvernement Bourassa qui « bafoue à tour de bras le droit à la négociation libre au Québec » (Le Monde ouvrier, mai-juin 1990, p. 12). Mais plutôt que de miser sur la confrontation avec le gouvernement, pour le faire reculer, ils comptent d'abord sur la négociation pour obtenir le rappel au moins partiel des mesures les plus draconiennes de la loi 160, ce qui sera chose faite en juin 199 1.
De même, après avoir violemment dénoncé la prolongation des conventions collectives du secteur public en ce qui a trait aux salaires en 1991, les dirigeants syndicaux obtiendront, par la négociation, non pas le rappel de cette décision gouvernementale mais son adoucissement. En 1993, les tentatives de négociation pour obtenir l'abrogation des lois 102 et 198 n'auront guère plus de succès ; les orientations gouvernementales demeureront en vigueur et, pour l'essentiel, les centrales FTQ et CEQ obtiendront en échange que le gouvernement s'engage dans l'ouverture de grandes négociations sur l'organisation du travail.
Si l'on compare cette attitude à celle des responsables syndicaux dix ans plus tôt, on ne peut manquer de percevoir une évolution. Tout porte à croire que le poids des défaites subies ou des luttes plus difficiles incitent les états-majors syndicaux à [173] privilégier la recherche de compromis plutôt que la lutte et la mobilisation. Mis à part les rassemblements et les manifestations de protestation, les grandes actions et la grève semblent devenues impossibles. Mais si d'aucuns sont prêts à faire ce diagnostic, d'autres, au contraire, estiment que les déboires du syndicalisme s'expliquent par le recours insuffisant à l'action résolue, deux positions qui alimentent fortement les débats internes dans les centrales en cette première moitié des années 1990.
Toujours est-il que l'orientation prédominante des syndicats semble, dans la conjoncture, pencher nettement vers une approche des relations avec le gouvernement et le patronat qui soit fondée sur la concertation, l'initiative économique, la contribution au développement social plutôt que sur l'affrontement. Le fonds de solidarité créé par la FTQ en 1983 pour constituer à même les épargnes des salariés un fonds de capital d'investissement destiné à préserver ou à créer des emplois est certainement une des manifestations les plus poussées, à l'heure actuelle, de cette orientation. De même, on ne peut qu'être frappé par la nouvelle participation des syndicats aux initiatives de développement régional en concertation avec le patronat, le gouvernement et les autres partenaires économiques. C'est le cas, en particulier, des régions qui subissent les taux de chômage les plus élevés ou de quartiers défavorisés comme il en existe à Montréal. Il convient d'ajouter à ces initiatives les prises de position plus fréquentes du mouvement syndical en coalition avec les organismes représentatifs du patronat sur des enjeux tels l'environnement, la politique monétaire, la question autochtone, l'appauvrissement, etc.
D'un autre côté, face à l'ampleur des mesures d'austérité prises par les gouvernements, les centrales cherchent également à exprimer les attentes de leurs membres et de la population salariée par des initiatives qui rallient les organisations sociales populaires sur la base de leurs intérêts communs. Ainsi a-t-on vu s'organiser en mars 1994 le premier grand forum de solidarité sociale, en présence des représentants de plusieurs dizaines d'organisations populaires. Mais comment ce type d'initiatives peut-il déboucher sur une véritable mobilisation et changer le rapport de force en faveur des besoins et des aspirations de la population laborieuse ? La question demeure posée et constitue un défi de taille, en particulier pour tout le mouvement syndical.
- L'intervention politique
Sur un plan plus directement politique, comment évaluer le développement des positions syndicales sous les gouvernements Bourassa depuis 1985 ?
Il importe d'abord de noter de nouveau le rejet unanime de l'accord du lac Meech, suivi des prises de position en faveur de l'indépendance du Québec en mai-juin 1990. Ces faits, tout comme les débats qui ont entouré la négociation et l'échec du projet d'accord de Charlottetown, soulignent la nette opposition du syndicalisme à l'orientation constitutionnelle du gouvernement Bourassa.
En 1990, la prise de position indépendantiste a favorisé une percée du mouvement syndical sur la scène politique en lui permettant de jouer notamment un rôle-clé au sein de la commission Bélanger-Campeau. Mais le poids du syndicalisme comme acteur politique demeure limité. C'est entre les partis représentés à l'Assemblée nationale que [174] se négocient souvent les accords politiques les plus déterminants. Par exemple, c'est le premier ministre Bourassa qui proposa la tenue d'une commission parlementaire (plutôt que des états généraux ou une constituante) pour sortir de l'impasse constitutionnelle après l'échec du lac Meech et qui en négocia les termes avec les dirigeants du PQ. Le cadre du débat fut celui qui avait été convenu entre les deux principaux partis.
En 1989, la FTQ avait renouvelé son appui au PQ, mais il n'en fut pas ainsi officiellement à la CEQ et à la CSN. Cette dernière, qui voulait donner le maximum d'effet à sa participation à la campagne des forces souverainistes, a cherché à relancer dans ses rangs le débat sur son engagement politique. En mai 1991, ses dirigeants ont proposé d'établir des liens d'appui privilégié avec le Bloc québécois sur la scène fédérale. Cette proposition laissait cependant intact, en même temps qu'elle le soulignait, l'enjeu que représente l'engagement politique de la centrale et de tout le mouvement syndical au Québec.
Depuis 1985, l'autre grande bataille politique des syndicats au Québec a été celle du libre-échange. Cet enjeu, comme celui de la constitution, a placé les syndicats et le gouvernement Bourassa dans des camps opposés. Les syndicats l'ont combattu, rejoignant ainsi une position identique à celle des organisations ouvrières au Canada anglais. Malgré cette opposition soulevée par les organisations sociales les plus importantes, il a pu sembler que le Québec dans sa totalité soutenait le libre-échange, contrairement au Canada anglais. Cette impression s'est nourrie de ce que les deux partis représentés à l'Assemblée nationale, le PQ et le PLQ, défendaient la même position d'appui. Or, si cela ne suffit pas à ranger la société québécoise en bloc dans le camp libre-échangiste, cela rappelle tout au moins, et une fois de plus, que les positions politiques des syndicats et des organisations populaires n'étaient pas représentées au Parlement québécois. À la fin des années 1980, l'enjeu du libre-échange a aussi remis ce fait en évidence.
CONCLUSION :
VERS UN TOURNANT POLITIQUE
DU SYNDICALISME ?
Un cycle d'évolution politique, marqué par la croissance quantitative et qualitative du mouvement syndical depuis le milieu des années 1950, est terminé. Avec le tournant de la décennie 1990, le pourcentage de syndicalisation, quelque peu en régression durant les années 1980, a dépassé de nouveau le cap des 40 %. Ce niveau semble cependant un plateau dans les circonstances actuelles (en raison notamment de l'impossibilité de l'accréditation multipatronale). Mais il peut contribuer aussi à entretenir quelque illusion sur la force numérique exceptionnelle du syndicalisme québécois si on la compare à celle de plusieurs autres pays. Le système de perception obligatoire des cotisations syndicales à la source, qui représente un acquis syndical, est un extraordinaire point d'appui pour assurer la force numérique du syndicalisme au Québec et au Canada. Dans d'autres pays, l'appartenance syndicale des travailleurs et les contributions financières reposent presque exclusivement sur le militantisme et l'engagement volontaire. Il est possible que ces conditions aient pu contribuer à la baisse spectaculaire des taux de syndicalisation là où la conjoncture économique favorisait le recul des syndicats.
[175]
Avec la disparition de l'Union nationale, le PQ est devenu l'une des deux formations dominantes d'un bipartisme reconstitué. Mais l'appui électoral qu'il pourrait solliciter de nouveau des syndicats sera obligatoirement négocié à la pièce, sans commune mesure avec ce qu'il représenta dans les années 1970. L'alliance entre ces deux forces ne peut plus désormais se fonder sur le même rapport de confiance, les positions économiques et sociales du PQ étant très semblables à celles du PLQ. Encore une fois, seule la question nationale représente un facteur de démarcation important entre les deux partis sur le plan électoral.
Nous avons constaté, au début de ce chapitre, que le syndicalisme des années 1950 a été amené, par le cours des événements, à se poser la question de sa propre représentation politique, avant même que des pans entiers de la force de travail aient pu accéder aux droits de s'organiser et de négocier. Il serait erroné d'attribuer à ce seul facteur l'échec de la première tentative de constituer, à partir des syndicats, un nouveau parti politique. Mais l'élargissement du syndicalisme par la suite et l'accroissement quantitatif de sa force numérique et organisationnelle lui ont effectivement conféré une influence et un poids politiques qu'il n'avait jamais eus antérieurement. Son rapport à l'État s'est aussi modifié du seul fait qu'une large fraction de ses nouveaux adhérents provenait des services publics et déployait une action d'envergure nationale.
Pourtant, la nouvelle puissance du syndicalisme, qui pouvait, en principe, faciliter son rôle de levier dans l'émergence d'une formation politique indépendante, n'a pas d'abord joué en ce sens. Elle a plutôt incité le mouvement syndical à agir lui-même comme groupe de pression politique, en profitant au maximum de l'ouverture qu'offrait la conjoncture post-duplessiste. Dans la mesure où son action semblait lui permettre de modifier les rapports de force en faveur de la population laborieuse, la question d'un parti politique indépendant prolongeant l'action revendicative parut revêtir moins d'importance.
L'idéologie d'un syndicalisme autosuffisant a progressivement imprégné toute son action, d'autant plus que l'entrée en scène du PQ semblait promettre à l'intervention syndicale un renforcement de son influence directe sur l'activité gouvernementale.
La pratique d'une telle orientation politique est conditionnée cependant par deux facteurs essentiels : d'une part, la possibilité effective d'obtenir des concessions réelles du gouvernement et du patronat ; d'autre part, la possibilité pour le système politique de produire une ou des alternatives (pour assurer l'alternance bi-partisane) qui représentent le changement et l'ouverture face à des partis et gouvernements usés et rejetés. Il est aisé d'imaginer que si ni l'une ni l'autre de ces conditions n'est respectée, il pourrait survenir une situation plus propice aux tentatives de structurer l'auto-représentation politique ouvrière, sous des formes dépassant qualitativement la simple non-partisanerie.
Si l'on tente d'évaluer la situation au milieu des années 1990, on peut dire que ces deux conditions ne sont pas pleinement réunies : les syndicats obtiennent peu de concessions réelles du gouvernement et du patronat et, sur les plans économique et social, ni l'un ni l'autre des partis en présence ne se présente comme une réelle solution de changement radical pour satisfaire leurs attentes. Mais du fait de la question nationale qui demeure, quoiqu'on le veuille, l'enveloppe de toutes les questions à résoudre, le PQ pourra continuer d'apparaître au syndicalisme comme une alternative au PLQ.
[176]
À partir de là, de quoi sera faite l'évolution politique du mouvement syndical, une évolution qui de toute façon ne peut pas être entrevue comme un processus linéaire ? Nous pensons que si une réelle avancée devait se produire pour le règlement de la question nationale, le débat sur l'action politique aurait tendance à ressurgir dans les syndicats non comme il y a vingt-cinq ans, avant que l'alliance avec un grand parti ait été tentée comme ce fut le cas avec le PQ, mais sur la base même de cette expérience. Cela, à terme, est un facteur supplémentaire de maturation, parce qu'il est difficile de concevoir un rapport non partisan plus étayé et complet que celui qui fut aménagé durant les années 1970 avec le Parti québécois. Pour cette raison, le syndicalisme québécois se trouvera inévitablement placé, à plus ou moins court terme, devant une alternative posant, d'un côté, la poursuite du recul de son influence économique et politique et, de l'autre, un engagement plus direct, compatible avec la préservation de son autonomie, dans la mise en forme d'un nouvel instrument partisan pour les classes populaires. Sa situation politique actuelle ne saurait être, en ce sens, que transitoire.
[178]
BIBLIOGRAPHIE
ARCHIBALD, C., 1983, Un Québec corporatiste ?, Hull, Asticou.
BERNIER, G. et R. BOILY, 1985, Le Québec en chiffres, de 1850 à nos jours, Montréal, Acfas, (Collection « Politique et Économie »).
BRUNELLE, D. et P. DROUILLY, 1985, « Analyse de la structure socio-professionnelle de la main-d'œuvre québécoise » dans Interventions économiques, nos 14-15, p. 233-260.
[179]
CARLOS, S. et D. LATOUCHE, 1976, « La composition de l'électorat péquiste » dans LATOUCHE, D., G. LORD et J.-G. VAILLANCOURT, Le Processus électoral au Québec : les élections provinciales de 1970 et 1973, Montréal, HMH.
CEQ, 1980, Communiqué de presse, 3 octobre, Québec.
CEQ, 1990, Résolution générale du 32e congrès, 26-30 juin, Québec.
CEQ, 1974, Documents du 24e congrès, juin-juillet, Québec.
CEQ, Bureau national, 1977, Documents pour le Conseil général, 14 mars, Québec.
COMITÉ DES DOUZE, 1973, Évaluation de la réflexion collective sur le document « Ne comptons [...] », Montréal, Cahier Orientation, CSN.
CSN, 1971, Déclaration de principes, Montréal.
CSN, 1973, Élections générales, Québec : 29 octobre 1973, Cahier Orientation no 2, Montréal.
CSN, Exécutif de la, 1977, Rapport d'orientation : la CSN aujourd'hui, Montréal, 48e congrès régulier.
CSN, 1979, Cahier des résolutions, Montréal, congrès spécial, 1er et 2 juin.
CSN, 1982, « La faillite du gouvernement du Parti québécois », document soumis au Conseil confédéral, Montréal, 17 décembre.
CSN, 1990, « Rapport du Comité exécutif », Montréal, 55e congrès, 5-11 mai.
CSN-CEQ, 1984, L'Histoire du mouvement ouvrier au Québec, Montréal, Confédération des syndicats nationaux et Centrale de l'enseignement du Québec.
CSN-CEQ-FTQ, 1977, Mémoire commun sur le projet de loi 53, Montréal, décembre.
CSN-CEQ-FTQ, 1982, (avec la Société Saint-Jean-Baptiste, section Montréal, le Mouvement national des Québécois-es et l'Alliance des professeur(e)s de Montréal), Déclaration conjointe des présidents de la CSN, CEQ, FTQ, SSJB-M, MNQ et APM, Montréal, 11 décembre.
CTC, 1983, « Résolution d'action politique », colloque spécial, « L'égalité maintenant », Québec, 5-8 mars.
DENIS, R., 1979, Luttes de classes et question nationale au Québec, 1948-1968, Montréal, Paris, PSI-EDI. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
DENIS, S., 1984, « Développements, tensions et lignes de clivage du mouvement ouvrier au Canada », dans BERNIER, G. et G. BOISMENU (dir.), Crise économique, transformations politiques et changements idéologiques, Montréal, Cahier de l'Acfas, no 16, p. 373-398.
DROUILLY, P., 1990a, « Une analyse des résultats de 1985 » dans Roch DENIS (dir.), Québec : dix ans de crise constitutionnelle, Montréal, VLB, p. 105-110.
DROUILLY, P., 1990b, « L'élection du 25 septembre 1989 » dans Roch DENIS (dir.), Québec : dix ans de crise constitutionnelle, Montréal, VLB, p. 260-267.
FAVREAU, L. et P. L'HEUREUX, 1984, Le Projet de société de la CSN, Montréal, CFP-Vie ouvrière.
FLEURY, G., 1984, Évolution de la syndicalisation, Montréal, Centre de recherche et de statistiques sur le marché du travail.
FOURNIER, M., 1979, Communisme et anti-communisme au Québec, 1920-1950, Montréal, Albert Saint-Martin. [Livre disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
FRASER, G., 1984, Le Parti québécois, Montréal, Libre Expression.
FTQ, 1979, La FTQ et la question nationale, Montréal.
[180]
FTQ, 1990, 23 juin, « Le temps de la souveraineté est venu » dans La Presse.
HAMILTON, R. et M. PINARD, 1984, « The class bases of the Quebec independence movement : conjectures and evidence » dans Ethnic and Racial Studies, vol. 7, no 1 (janvier), p. 19-54.
HAUPT, G., 1981, « Socialisme et syndicalisme » dans Jean Jaurès et la classe ouvrière, Paris, Les éditions ouvrières, p. 29-66.
INGERMAN, S., 1983, « La syndicalisation dans le contexte économique québécois » dans La Syndicalisation dans le secteur privé au Québec, 38e Congrès des relations industrielles de l'Université Laval, Québec, les Presses de l'Université Laval, p. 37-69.
LABERGE, L., 1971, Un seul front, Montréal, FTQ.
LABERGE, L., 1975, Cible et force de frappe, Montréal, FTQ.
LAMOUREUX, A., 1985, Le NPD et le Québec, Montréal, du Parc.
LAROSE, G., 1980, « Les syndicats et le référendum » dans LAURIN-FRENETTE, N. et J.-F. LÉONARD (dir.), L'impasse, Montréal, Nouvelle Optique. [Livre en préparation dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
LAVIGNE, M., 1992, « Les femmes et la Révolution tranquille, 30 ans après : bilan et perspectives » dans M.-R. LAFOND (dir.), La Révolution tranquille, trente ans après : qu'en reste-t-il ?, Hull, de Lorraine.
PEPIN, M., 1966, Une société bâtie pour l'homme, Montréal, CSN.
PEPIN, M., 1970, Un camp de la liberté, Montréal, CSN.
PEPIN, M., 1970, Le deuxième front et Pour une société bâtie pour l'homme, 2e édition, Montréal, CSN.
PEPIN, M., 1976, « Mémo à tous les syndicats affiliés », Montréal, CSN, 10 février.
ROUILLARD, J., 1989, Histoire du syndicalisme québécois, Montréal, Boréal.
[14]
NOTES SUR
LES COLLABORATEURS
Roch Denis
Roch Denis est professeur au département de science politique de l'Université du Québec à Montréal. Il est président de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d'Universités. Il a publié notamment Luttes de classes et question nationale au Québec (1979), Québec, 10 ans de crise constitutionnelle (1990) et Les syndicats face au pouvoir (1992).
Serge Denis
Serge Denis est professeur agrégé au département de science politique de l'Université d'Ottawa où il occupe les fonctions de doyen associé et de secrétaire de la Faculté des sciences sociales. Il a publié notamment Un syndicalisme pur et simple : mouvements ouvriers et pouvoir politique aux États-Unis, 1919-1939 (1986), Le long malentendu : le Québec vu par les intellectuels progressistes au Canada anglais, 1970-1991 (1992) et Les syndicats face au pouvoir (1992).
[1] Nous avons traité de cette problématique dans Roch Denis et Serge Denis, Les Syndicats face au pouvoir, (Ottawa, Vermillon, 1992), dont nous reproduisons ici quelques passages, avec l'aimable autorisation de l'éditeur. Le lecteur intéressé pourra aussi se reporter à ce livre pour une analyse comparative de l'évolution politique du mouvement ouvrier au Québec et au Canada anglais, depuis les années 1960.
[2] La FUIQ, formée en 1952, regroupe quelque 30 000 membres ; elle fusionne avec la Fédération provinciale du travail du Québec (FPTQ) en 1957 pour former la FTQ.
[3] On sait qu'en 1958 la FTQ a fait sien le projet de création d'un nouveau parti qu'avait lancé le Congrès du travail du Canada. Créé en 1961, ce parti a pris le nom de Nouveau Parti démocratique. Mais des désaccords sur les questions constitutionnelles et sur les rapports d'organisation à établir entre la section québécoise et le parti pancanadien ont conduit rapidement la nouvelle formation au Québec à l'impasse. Elle s'est divisée bientôt en deux organisations, une aile provinciale du NPD pancanadien pour les élections fédérales et un parti « séparé » pour les élections provinciales, appelé Parti socialiste du Québec (PSQ). Devant toutes ces difficultés, la FTQ s'éloigne, à partir de 1963, du processus engagé. Le NPD au Québec et le PSQ, qui allait disparaître en 1968, ne parviendront pas à s'enraciner.
[4] Dont les principales manifestations seront alors longuement démontrées dans les rapports de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (commission Laurendeau-Dunton).
[5] C'est ce fait, à notre avis, qui rend principalement compte du fait que le nationalisme québécois se situe dorénavant en discontinuité par rapport aux spéculations philosophico-religieuses et aux thèmes ultramontains qui avaient jusque-là survécu dans les divers courants autonomistes.
[6] À cet égard, les contributions écrites par des représentants reconnus de chacun de ces courants, dans N. Laurin-Frenette et J.-F. Léonard (dir.), L'impasse, Montréal, Nouvelle Optique, 1980, sont fort révélatrices.
[7] Voir, entre autres textes, le rapport moral de Marcel Pepin au congrès de 1966 de la CSN, intitulé Une société bâtie pour l'homme.
[8] Dans le rapport moral présenté au congrès de la CSN en 1970, Un camp de la liberté, on parle de « la collusion de l'État et du pouvoir économique [qui] a donné naissance à un super pouvoir économique-politique », rapporté par L. Favreau et P. L'Heureux, 1984, p. 58.
[9] Voir son rapport Un seul front, discours inaugural au 12e congrès de la FTQ, Montréal, 1971, p. 15-16.
[10] Il est intéressant de noter avec Louise Quesnel-Ouellet que l'engagement syndical nouveau en politique municipale correspond notamment aux « modifications apportées aux règles électorales (suffrage universel, tenue des élections) en 1968 » dans les villes et municipalités par législation provinciale, qui incitèrent ainsi davantage à une participation organisée ; Louise Quesnel-Ouellet, « Les partis politiques locaux au Québec » dans Vincent Lemieux (dir.), Personnel et partis politiques au Québec, Montréal, Boréal Express, 1982, notamment les pages 279 et 280.
[11] Déclaration reproduite de La Presse, 29 août 1970.
[12] CSN, Élections générales, Québec : 29 octobre 1973, Orientation no 2, Montréal, 1973.
[13] Marcel Perreault, président du Conseil du travail de Montréal (FTQ), précisa d'ailleurs que les syndicats appuyaient le RCM « malgré le fait [qu'il] n'est pas un parti des travailleurs » (texte de la conférence de presse du Conseil régional intersyndical de Montréal, jeudi 7 novembre 1974). La disparition du FRAP, en ce sens, illustrait et symbolisait à la fois le net recul de l'option « troisième parti » ouvrier dans les syndicats du Québec.
[14] Du côté de la CSN, par exemple, on entendit :
« Je pense que les syndiqués seraient d'accord pour accepter des fusions de postes (dans le domaine de la santé) qui auraient été impensables sous l'ancien gouvernement [...] » Le Devoir, 19 novembre 1976.
À la FTQ, en février 1977, s'ouvrit une discussion sur les questions suivantes :
« Les militants croient-ils possible que leur centrale s'engage à réduire certaines revendications pour “donner sa chance au PQ” ?
« Peut-on aller jusqu'à prendre l'engagement de restrictions volontaires au niveau des revendications salariales ? Si oui, à quelles conditions ? » (Le Monde ouvrier, journal de la FTQ, février 1977).
[15] Encore que ces réformes aient été inégalement appréciées selon les centrales, la FTQ se montrant en règle générale plus réceptive : e.g., loi sur les accidents de travail, loi « anti-scab », etc.
[16] D'abord, à notre avis, la reconnaissance généralisée de la négociation multipatronale : compte tenu de la structure économique de la province, un véritable nouveau pas en avant des syndicats exige un cadre juridique de cette nature. L'exemple de la loi 290 dans la construction, qui avait centralisé et unifié les négociations pour l’ensemble de ce secteur en 1969, était vu comme une référence positive à cet égard par le mouvement syndical.
[17] Par exemple, à son congrès de 1977 où elle définit déjà la situation économique comme la pire depuis la crise des années 1930, la CSN demande la création de secteurs économiques d'entraînement – en utilisant au besoin l'arme de la nationalisation, l'établissement d'un système bancaire québécois ou, parmi d'autres moyens, la « transparence économique » des entreprises (Favreau et L' Heureux, 1984, p. 128).
[18] Dans leur Mémoire commun sur le projet de loi 53, présenté au gouvernement en décembre 1977, les trois centrales soulèvent, par exemple, l'idée d'une transparence de la fonction publique, que les dossiers et documents préparés par les employés de l'État, notamment ceux du ministère du Travail et de la Commission des accidents du travail, devraient circuler librement et alimenter le débat public, qu'on devrait séparer la fonction publique des préoccupations des partis au pouvoir et la lier davantage à la population. Comme il ne le fait pas, on dit que le PQ ne respecte pas ses promesses électorales (voir p. 2 et suivantes).
[19] Si Robert Burns (de la CSN) est membre du premier cabinet Lévesque, c'est après 1979 que les Clément Richard (CSN), Guy Chevrette (CEQ), Robert Dean (FTQ), etc., y ont accédé. Au fil des ans, la FTQ s'est avérée la centrale la plus liée au Parti québécois. Elle est probablement la centrale pour laquelle l'hypothèse ici esquissée s'applique le plus directement.
[20] Voir Rouillard (1989, p. 379-380), pour une explication de la situation particulière de la CEQ ; la CSN appuya officiellement le « oui » le 11 avril 1980, lors d'une réunion spéciale de son conseil confédéral ; quant à la FTQ, 2 500 délégué(e)s réuni(e)s en un congrès spécial adoptèrent à la quasi-unanimité le 19 avril 1980 l'appui au « oui »référendaire, comme le leur proposait le conseil général de la centrale.
[21] La CSN se prononça en faveur de la souveraineté à son 55e congrès, tenu du 5 au 11 mai 1990 ; la CEQ fit de même à son 32e congrès, tenu du 26 au 30 juin 1990 ; la FTQ rendit publique sa prise de position souverainiste le 23 juin 1990.
[22] Par exemple, par des aspirants issus du mouvement syndical, qu'on aurait présentés aux assemblées d'investiture du PQ lors des mises en nomination. Développement qui est demeuré à l'état d'indice cependant, et qui nous a été mentionné lors d'une entrevue avec des militants syndicaux du Nord-Ouest québécois.
|

