Monique Desroches
“Indo-créolité,
mémoire et construction identitaire”.
Un article publié dans Le monde caraïbe. défis et dynamiques. Tome I. Visions identitaires, diasporas, configurations culturelles. Actes du Colloque international, Bordeaux, 3 et 7 juin 2003, pp. 385-392. Sous la direction de Christian Lerat. Pessac : Maison des sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2005, 579 pp.
- Introduction
-
- Le vocabulaire comme mode de représentation sociale
-
- Retour aux sources et stratégies identitaires
-
- Conclusion
-
- Références
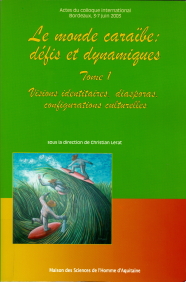
Introduction

Les pratiques musicales des descendants tamouls aux Antilles françaises posent des questions et des défis importants pour quiconque s'intéresse aux études créoles. Aux Antilles, les créolistes nous ont appris à appréhender le concept de créolité dans la foulée de l'idéologie dominant/ dominé, voire dans un dualisme « Noir-Blanc ». Mais la réalité est parfois plus complexe. Cette apparence de dichotomie sociale se vit en effet selon un spectre ou une gradation où les subtilités de la couleur de la peau agissent souvent comme des marqueurs de statut social (voir les écrits de Micheline Labelle sur Haïti et de Jean-Luc Bonniol sur Les Saintes). De plus, quand on rencontre la culture indo-créole sur le terrain, la question se complique, et il apparaît que les spécialistes de la créolité ont raté le rendez-vous avec la communauté d'origine tamoule arrivée dans les îles au milieu du XIXe siècle. Un regard sur leurs pratiques musicales profanes et sacrées met en exergue la présence d'un patrimoine religieux souvent métissé, de pratiques musicales ancestrales, d'une esthétique particulière, et d'un lexique (ni tamoul, ni créole au sens strict) qui nous obligent aujourd'hui à repenser, ou à tout le moins, à élargir le concept de créolité. Àl'instar des musiques afro-créoles, le patrimoine musical indo-créole pose aussi la question de la mémoire collective sous deux angles : quel sens donner à la tradition ancestrale et dans quel sens la poursuivre ?
Dans les sociétés créoles auxquelles les Indo-créoles appartiennent, le métissage ne signifie pas le résultat d'une combinatoire d'éléments divers, ou encore, l'aboutissement d'un processus d'emprunt et de rejet, mais plutôt, un point de départ, une manière de penser les choses, de penser le monde, la religion, la musique. C'est une culture. Les cultures métisses ont intégré des mécanismes d'ajustement, d'adaptation : ces états d'esprit sont devenus en quelque sorte, la norme ; dans ce sens on peut affirmer que la variation et le mélange sont la règle.
François Laplantine et Alexis Nouss dans leur ouvrage Métis Sage (2001) définissent en ces termes, le phénomène :
- « ... le métissage est une pensée... qui met en question les acquis (8) (...) c'est une aire sans aire de repos. Il envisage [ainsi] un devenir dans la rencontre de l'Autre.
En outre, « Le métissage ne pratique pas le face à face, mais le côteà-côte » (14).
Dans cette pensée, on peut identifier deux modes de métissage:
- celui de « la liaison, de l'hybridation des matériaux, des formes, des émotions », etc. ;
-
- celui de la « graduation par transformation progressive » des expressions et valeurs attachées à ces expressions. (op. cit., 9).
Mais revenons à notre question de départ quant au sens de la mémoire.
Dans une chanson désormais célèbre, Avec le temps, Ferré écrivait : « Avec le temps... tout s'en va... même les plus chouettes souvenirs... Avec le temps... tout s'évanouit ».
Voilà une bien triste façon de voir ainsi le temps passer. Car tout s'évanouit-il avec le temps ? Je n'en suis pas convaincue. C'est donc un peu de cette question que je vais vous entretenir dans les pages qui suivent, en tentant d'abord de saisir ces termes complexes de : mémoire, temps, souvenirs, et traditions.
La première fois que j'ai été confrontée au problème du temps remonte à une recherche conduite à la fin des années soixante-dix dans le cadre de mes études doctorales en ethnomusicologie. Je tentais alors de comprendre les raisons de la pérennité d'une tradition ancienne, qui, de plus, avait été transplantée dans un court laps de temps et de façon presque brutale, dans un autre milieu : la musique de possession à caractère sacrificiel des Tamouls du sud de l'Inde installés aux Antilles françaises depuis le milieu du XIXe siècle.
J'ai dit pérennité, car à cette époque, il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait ici d'un « nativistic movement » (par opposition au « revivalistic movement », dichotomie proposée par l'anthropologue Linton en 1965). Le rapport au passé pour ces Tamouls nouvellement arrivés dans les îles pour travailler dans les grandes plantations de la Martinique et de la Guadeloupe ne me posait alors aucun problème : la tradition de référence semblait bel et bien l'Inde villageoise dont ils étaient issus. Mais, la problématique du « temps » est venue complexifier cette première analyse. Car le temps ne peut se conjuguer, sans intégrer ou sans avoir en arrière-plan, la « mémoire ».
Mais qu'est-ce au juste que la mémoire ? D'abord il importe de spécifier qu'elle n'est pas un espace statique. La mémoire n'est pas qu'un lieu neutre de stockage d'événements, de connaissances, de souvenirs. C'est un espace sensible, passionné, émotif, imaginatif, bref un espace de construction symbolique. Par exemple, si je donne à quelqu'un une série de mots sans lien significatif, il les retiendra beaucoup plus difficilement que s'il s'agit d'une histoire qui mettra ces mots en liens imaginaires et sensibles. On peut ainsi faire ressurgir tout un passé à partir d'un détail (un son, une voix, un parfum, comme l'a bien illustré le célèbre roman de Suskind, Le parfum)
La mémoire relève donc de l'imagination et est, de ce fait, dynamique. Elle est construction ou plus exactement, re-construction ou re-composition du réel. La quête de la trace conduit à la construction d'une nouvelle identité. Le jazz et les musiques créoles en sont de merveilleux exemples. Enfin, il importe de souligner, comme le faisait à juste titre Glissant dans une conférence donnée à CUNY-New York University en 2001 que, « la mémoire, accumule et densifie. Ceux qui l'assument la mettent en acte... Mais la mémoire n'est pas que collective. Elle est aussi éclatée ; elle ne rassemble pas toujours les individus autour d'un seul projet unique de société ». Je retiendrai ici ces derniers propos de Glissant, car ils s'appliquent en tous lieux, à l'exemple culturel dont il sera maintenant question.
Le vocabulaire comme mode
de représentation sociale

Le contexte migratoire a modifié la dynamique sociale et culturelle des Indo-créoles dont la raison majeure tient aux modalités d'arrimage avec la société d'accueil. Les nouveaux paramètres des cadres physiques et sociaux ont conduit les Indiens à réajuster les modalités des pratiques rituelles et culturelles. À tout le moins, on constate aujourd'hui des modifications dans les représentations de ces pratiques.
Pour illustrer ces propos, examinons des exemples concrets et contemporains des Indo-créoles, notamment de la terminologie et le vocabulaire utilisés au cours de leurs cérémonies religieuses aux Antilles françaises. Ce regard est important car la terminologie autour des cérémonies, les façons de nommer les événements rituels se sont transformées au fil des ans et je tenterai de montrer qu'à travers ces choix linguistiques se profilent des modifications des représentations sociales du « soi » et des « autres ».
Dans les années soixante et soixante-dix, il était d'usage de recourir par exemple, à l'appellation « bon dyé kouli », pour désigner une cérémonie rituelle sacrificielle originaire de l'Inde du Sud. Il s'agit en fait d'une cérémonie assez spectaculaire où le « prêtre » guidé par le rythme des tambours, entre en transe, monte sur le côté tranchant de la lame d'un coutelas, pousse alors des cris, tente de guérir des personnes atteintes de maladies physiques ou psychologiques, etc. Dans l'univers magico-religieux insulaire, cette cérémonie est parfois crainte par les créoles, ou au contraire, respectée, en raison même de sa puissance et de ses règles singulières étrangères au monde créole. Derrière l'appellation « bon dyé kouli » désignée ainsi par le groupe créole puis graduellement intégré au vocabulaire des descendants tamouls (la majorité des Indiens a perdu sa langue d'origine, le tamoul) se profilent deux phénomènes : celui de vouloir dissocier la cérémonie indo-créole des autres rituels magico-religieux insulaires créoles, et celui qui dénote un certain caractère péjoratif marqué ici par l'attribut « kouli ». Ce terme renvoie en effet à la main-d'œuvre servile qu'on qualifiait alors aux Antilles anglaises de « cheap labour », ou « coolie » (le terme « kouli » venant de cette expression anglaise). Aux Antilles françaises, les expressions courantes telles « kouli mangé chien », ou encore « chapé kouli » sont ainsi marquées, du moins à cette époque, d'un caractère négatif.
Autour des années quatre-vingt, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du groupe, les modes de représentations sociales commencent à changer. Aussi voit-on poindre l'appellation « sèvis zendyen » pour désigner la cérémonie sacrificielle autrefois appelée « bon dyé kouli ». On conserve là, une appellation « créole » mais on voit poindre aussi le désir d'une affirmation identitaire non pas « kouli », mais « indienne ». On semble également vouloir se distancier de l'influence chrétienne dominante en laissant tomber le renvoi à « bon dyé » (bon dieu). On remarque donc ici un désir de s'afficher comme Indien dans un univers créole.
Comme ailleurs dans le monde, les années quatre-vingt-dix sont marquées aux Antilles par le mouvement du retour aux sources. Que ce soit au niveau de l'architecture, de l'histoire orale ou de la musique, on remarque dans bon nombre de sociétés une forme de valorisation des racines, ou à tout le moins, une recrudescence du culte patrimonial. Les créoles, comme les Indo-créoles n'échapperont pas au mouvement. C'est en effet à cette période que les termes tamouls du sud de l'Inde font leur apparition : je pense notamment à « l'abbé-kouli » qui devient le « pouçari » ; le culte des ancêtres s'appelle désormais « samblani » ; on mettra aussi en place des fêtes religieuses collectives comme les « mela », etc. Dans la continuité de ce mouvement, je mentionnerai l'exemple des Indo-créoles de l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Là aussi, le terme tamoul « tappu » a supplanté l'appellation populaire de « tambour malbar ». J'aimerais à cet égard ouvrir une parenthèse sur le rôle du chercheur dans la chaîne de transmission des savoirs. Au début de mes enquêtes martiniquaises à la fin des années soixante-dix, il ne faisait aucun doute pour mes informateurs que le terme « tapou » provenait d'une déformation du mot français, « tambour ». Nul ne faisait alors la relation avec une quelconque origine terminologique tamoule, Mes recherches ont permis de mettre en parallèle les appellations créoles « tapou » et « dappu » ou « tappu », ces deux derniers termes relevant de l'organologie tamoule encore en vigueur dans le sud de l'Inde et qui désignent le même type de tambour utilisé par les Indo-créoles durant les cérémonies d'offrandes et mentionnés dans les écrits de Deva (1974 et 1977), de Krisnaswami (1976) et Desroches (1996).
La liste de ce genre d'exemples pourrait être longue. Le point essentiel que je souhaite mettre ici en relief est le fait que le vocabulaire et la terminologie utilisés par les divers locuteurs vont au-delà de la seule fonction de communication. Ils reflètent notamment l'évolution des mentalités autour de l'Indien, et plus spécifiquement, celle de la perception à la fois du soi par soi, et du soi par l'autre. Ne pourrions-nous pas voir là également une forme de dé-créolisation graduelle de la terminologie cérémonielle et musicale, modification qui émanerait d'un ajustement perceptuel du soi par soi, de l'Indien par l'Indien et conséquemment de soi par l'autre ? Par ailleurs, en tamoulisant ainsi le vocabulaire courant, on se construit certes une identité, mais laquelle ? N'y a-t-il pas également un risque de tourner le dos à une certaine identité indo-créole (insulaire) qui, elle, participe du métissage et d'une ré-interprétation des origines ?
Un regard sur la communauté indienne insulaire montre un groupe en pleine effervescence, en quête de son identité non seulement indienne, mais aussi et surtout, indo-créole, indo-guadeloupéenne, indo-martiniquaise. Dans cette optique, il est intéressant de se demander à quels impératifs la musique indienne actuelle tente de répondre. À celle de la filiation des sources, des racines, qui la conduirait en Inde ? Ou à l'histoire plus récente des conditions d'insertion des Tamouls dans les îles créoles ? Celle de leur apport à cette nouvelle identité créole, martiniquaise ou guadeloupéenne ? Et comment interpréter le choix des parcours empruntées ?
Plusieurs scénarios s'offrent ainsi aux musiciens actuels. Dans une récente introduction écrite pour un livre sur Les spectacles des autres Jean Duvignaud souligne avec force que les musiques traditionnelles sont devenues... « des spectacles quand elles ont été données à voir, quand elles se délocalisent ». Elles entrent dans l'univers du commerce, du marché, de la rentabilité, certes, mais on peut dire qu'elles s'ouvrent aussi à « l'échange universel des imaginaires ». Cette observation me semble bien caractériser la culture indienne des îles créoles. De nos jours, les Indo-créoles sont en effet tiraillés entre deux pôles de référence : celui d'une Inde à partir de laquelle on veut instaurer ou implanter une mémoire dont on n'a pas ou peu de traces mais qui demeure pour certains la référence ultime du patrimoine musical et religieux. Les retours en Inde sont fréquents pour bon nombre d'Indo-créoles, mais le pays retrouvé est une Inde contemporaine qui est souvent bien loin des imaginaires sociaux et religieux qui marquaient l'Inde du XIXe siècle. Un deuxième pôle de référence pourrait être qualifié d'insulaire (indo-créolité). Il renvoie au milieu de la plantation, à celui des contacts avec les autres composantes sociales des îles, au monde fusionnel. Cette source que l'on sait plus ou moins fidèle à l'origine s'inscrit dans le courant de circonstances bien particulières, celles de l'immigration réglementée, qui autorisait la France et l’Angleterre à recruter une main-d'œuvre servile amenée dans les îles sous contrat. Contraints d'évoluer, du moins dans les premiers temps, dans un espace exigu, celui de la plantation, méprisés par la population locale qui refusait leur présence, beaucoup d'Indiens se sont graduellement métissés avec la communauté noire, les créoles, tout en conservant tant bien que mal, certains éléments de leur culture, dont la musique rituelle.
Retour aux sources et stratégies identitaires

La diversité des schémas possibles m'amène à une problématique soulevée par de nombreux chercheurs, notamment par le sociologue Hennion (1993), celle de l'authenticité des pratiques musicales. À quelles origines est-on fidèle quand on exécute une musique ? À celle du temps, du lieu ? à l'organologie spécifique de la pratique musicale, à ses modes d'accord, etc. ? Ou, au contraire, à celle des attentes sociales et esthétiques du monde contemporain coupé de ses racines, un monde où les habitus obligent souvent les musiciens et mélomanes à emprunter de nouvelles trajectoires et à réinterpréter les sources ? D'où le questionnement initial de cet exposé : à quelle mémoire (ici, collective) se référer et quel « sens » lui donner ? C'est un des dilemmes auquel l'Indo-créole est aujourd'hui confronté car dans cette aventure complexe, il n'y a jamais qu'un seul itinéraire. La volonté évoquée antérieurement de « tamouliser » le patrimoine musical ne s'inscrit pas uniquement dans un mouvement de « retour aux sources ». Elle est aussi la résultante d'une dynamique particulière au sein de la société insulaire globale. Le désir de redorer l'image de l'Indien dans l'ensemble de la société créole n'est sûrement pas étranger aux choix esthétiques et stylistiques que l'on met désormais publiquement en l'avant. Une enquête ethnomusicologique que j'ai menée récemment dans le cadre d'un projet conjoint avec Jean Benoist, Gerry l'Étang et Francis Ponaman à la Guadeloupe en 2000 montre que l'appel des divinités par la musique demeure la finalité première des cérémonies religieuses à caractère sacrificiel, mais cette fonction de communication est dans d'autres espaces sociaux, publics et privés, mise de côté au profit d'une véritable esthétique des musiques, voire, de la promotion des talents individuels. On voit ainsi surgir des instruments de musique jusque-là méconnus. C'est le cas des tablas, des cithares, de la « tampura », tout comme la danse classique indienne. Les nouvelles plates-formes publiques, comme les spectacles dans les hôtels, changent la perception qu'ont les créoles des Indo-créoles, tout en favorisant la création d'un nouveau regard du soi sur soi. Ainsi, le recours aux éléments culturels indo-créoles dans la société antillaise, s'inscrit-il non seulement dans la foulée d'un simple geste artistique ou religieux, mais aussi dans la logique d'une véritable valorisation socioculturelle du groupe et d'une meilleure intégration sociale. Ces choix montrent aussi et surtout, combien l'authenticité, à l'instar de l'identité culturelle, est un processus dynamique, une réelle construction symbolique.
Conclusion

Aborder l'histoire des comportements et des modes de représentation du groupe permet d'observer certains éléments et de fonctions culturelles distinctes. La sélection qui dans le cas des Indiens, s'opère en harmonie ou selon leur stade d'intégration à la société d'accueil. Si l'expression musicale d'origine indienne avait autrefois tendance à se confiner aux impératifs des rituels sacrés, il semble désormais que son profil cherche à se diversifier. Et ce sont là les conduites d'attente du public, tant créole qu'indo-créole, qui semblent guider le choix des expressions musicales.
Je terminerai cette présentation en disant qu'à l'instar des créoles, les Indo-créoles ont choisi le nomadisme culturel et identitaire ; toutefois dans cette mobilité sociale et culturelle, il importe de se rappeler qu'un peuple « errant » n'est pas un peuple « égaré ». Comme le disait si bien E. Glissant, lors de sa conférence à l'Université de New York : « l'errance est une forme de renoncement à la fixité de l'être et non de "perte" de l'être ». Les Indo-créoles, comme les créoles d'ailleurs, sont à cet égard de véritables nomades.
Références

DEVA B.C., « Indian Music », New Delhi, Indian Council for Cultural Relations, 1974.
DEVA B.C., Musical Instruments (India : the Land and the People), National Book. Trust India, 1977.
DESROCHES Monique, « Tambours des Dieux », Montréal et Paris, L'Harmattan Inc., 1996.
DESROCHES Monique et GUERTIN Ghyslaine, « Construire le savoir musical, enjeux épistémologiques, esthétiques et sociaux », Paris, L'Harmattan, 2003.
DESROCHES Monique, BENOIST Jean et DUVIGNAUD Jean, Préface à Les spectacles des Autres, Paris, Maison de la culture, 2001, Coll. Internationale de l'imaginaire, no 15.
GEERTZ Clifford, The Interpretation of Culture, New York, Basic Books, 1973.
KRISHNASWAMI S., « Drums of India through the Ages », in Journal of Music Academy, Madras, 38, 1976, 72-82.
LINTON Ralph, « Nativistic Movements », in Reader in Comparative Religion : an Anthropological Approach, Los Angeles, University of California, 1965.
LAPLANTINE François et NOUSS Alexis, Métis Sage, Paris, Flammarion, 2001.
SUSKIND Patrick, Le parfum, histoire d'un meurtrier, (1976), trad. française de B. Lortholary, Poche, France-Poche, 1988.
Monique Desroches
Faculté de musique, Université de Montréal
Montréal, Québec H3C 3J7

