Introduction
par
le docteur Edwin James
(1827)
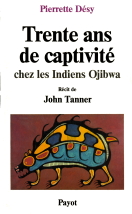 John Tanner, dont on va lire la vie et les aventures dans les pages suivantes, est âgé d'une cinquantaine d'années. Cet homme, dont la constitution robuste et la stature droite montrent qu'il a gardé toute sa vigueur, est malgré tout sévèrement marqué par les nombreuses épreuves et les souffrances qu'il a subies. La passion, les sentiments et l'âge ont altéré la beauté de son visage ; ses yeux bleus et perçants reflètent bien la violence, la sévérité et l'indomptabilité de son caractère. Ce caractère, qui lui a valu d'être souvent un objet de terreur pour les Indiens parmi lesquels il vivait, lui vaut aujourd'hui d'être incapable, dans une certaine mesure, d'adopter les manières complaisantes et dociles que sa condition de dépendance parmi les Blancs exigerait. Instruit soigneusement dès son enfance dans les principes et les règles qui constituent le code moral d'Indiens purs et intègres, il n'est pas étonnant que ses idées sur le bien et le mal, l'honneur et le déshonneur différent profondément de celles des Blancs. Isolé, sans amis, vivant dans une société où l'on reconnaît aux individus le droit de faire la guerre et, ce faisant, de défendre ses biens personnels – une façon de distinguer un homme d'un autre – tous ces facteurs l'ont empêché d'acquérir les vertus propres à nos sociétés dont l'une d'entre elles consiste à oublier ses droits individuels pour se plier devant l'autorité suprême représentée par la loi. Ainsi, John Tanner possède-t-il un sens inné de la justice personnelle allié à un esprit de vengeance infatigable et irréductible caractéristique du tempérament des Indiens. Les circonstances qui l'ont jeté littéralement dans une société sauvage et sans loi, lui ont enseigné à régler chaque fois chacune de ses querelles personnelles ; si, depuis son arrivée dans cette communauté (Sault-Sainte-Marie) plus au fait des lois que celle où il vivait auparavant, il lui est arrivé de demander réparation ou de faire justice à l'occasion d'une grave insulte ou d'une injustice flagrante, ne nous étonnons pas qu'il l'ait fait car, depuis longtemps, l'exemple et l'influence d'une coutume solidement acquise lui ont appris à considérer sa conduite comme juste et honorable. Il revient dans le giron de notre civilisation beaucoup trop tard dans la vie pour acquérir les habitudes mentales qui lui permettraient de s'adapter à sa nouvelle situation. Il est fort regrettable qu'il ait rencontré parmi nous des gens dénués de générosité au point de prendre avantage de son ignorance inévitable des us et coutumes de notre société civilisée. Il s'est toujours montré bon et juste jusqu'à ce que des querelles ou des insultes viennent réveiller en lui un esprit de vengeance et de haine ; par contre, sa gratitude a toujours été égale à son ressentiment. Mais il est vraiment superflu de s'étendre ainsi sur les traits de son caractère ; ceux-ci sont révélés avec beaucoup plus de relief dans ses mémoires auxquels on pourrait ajouter cette épigraphe connue : John Tanner, dont on va lire la vie et les aventures dans les pages suivantes, est âgé d'une cinquantaine d'années. Cet homme, dont la constitution robuste et la stature droite montrent qu'il a gardé toute sa vigueur, est malgré tout sévèrement marqué par les nombreuses épreuves et les souffrances qu'il a subies. La passion, les sentiments et l'âge ont altéré la beauté de son visage ; ses yeux bleus et perçants reflètent bien la violence, la sévérité et l'indomptabilité de son caractère. Ce caractère, qui lui a valu d'être souvent un objet de terreur pour les Indiens parmi lesquels il vivait, lui vaut aujourd'hui d'être incapable, dans une certaine mesure, d'adopter les manières complaisantes et dociles que sa condition de dépendance parmi les Blancs exigerait. Instruit soigneusement dès son enfance dans les principes et les règles qui constituent le code moral d'Indiens purs et intègres, il n'est pas étonnant que ses idées sur le bien et le mal, l'honneur et le déshonneur différent profondément de celles des Blancs. Isolé, sans amis, vivant dans une société où l'on reconnaît aux individus le droit de faire la guerre et, ce faisant, de défendre ses biens personnels – une façon de distinguer un homme d'un autre – tous ces facteurs l'ont empêché d'acquérir les vertus propres à nos sociétés dont l'une d'entre elles consiste à oublier ses droits individuels pour se plier devant l'autorité suprême représentée par la loi. Ainsi, John Tanner possède-t-il un sens inné de la justice personnelle allié à un esprit de vengeance infatigable et irréductible caractéristique du tempérament des Indiens. Les circonstances qui l'ont jeté littéralement dans une société sauvage et sans loi, lui ont enseigné à régler chaque fois chacune de ses querelles personnelles ; si, depuis son arrivée dans cette communauté (Sault-Sainte-Marie) plus au fait des lois que celle où il vivait auparavant, il lui est arrivé de demander réparation ou de faire justice à l'occasion d'une grave insulte ou d'une injustice flagrante, ne nous étonnons pas qu'il l'ait fait car, depuis longtemps, l'exemple et l'influence d'une coutume solidement acquise lui ont appris à considérer sa conduite comme juste et honorable. Il revient dans le giron de notre civilisation beaucoup trop tard dans la vie pour acquérir les habitudes mentales qui lui permettraient de s'adapter à sa nouvelle situation. Il est fort regrettable qu'il ait rencontré parmi nous des gens dénués de générosité au point de prendre avantage de son ignorance inévitable des us et coutumes de notre société civilisée. Il s'est toujours montré bon et juste jusqu'à ce que des querelles ou des insultes viennent réveiller en lui un esprit de vengeance et de haine ; par contre, sa gratitude a toujours été égale à son ressentiment. Mais il est vraiment superflu de s'étendre ainsi sur les traits de son caractère ; ceux-ci sont révélés avec beaucoup plus de relief dans ses mémoires auxquels on pourrait ajouter cette épigraphe connue :
- quae que ipse miserrima vidi,
- Et quorum pars magna fui.
Les remarques précédentes n'auraient jamais été faites si des accusations fort déplaisantes n'avaient été portées à l'endroit de notre narrateur, dans le district résidentiel où il s'est établi. Ces accusations, engendrées par des différences d'opinion, n'ont strictement rien à voir avec la mentalité indienne dont il faut avouer que beaucoup de traits saillants ont marqué notre narrateur de manière indélébile. Quelles que soient les circonstances qui l'ont poussé à poser des gestes qui ont suscité des sentiments de désapprobation ou d'antipathie, il nous semble que l'indulgence doit prédominer ; en effet n'avons-nous pas affaire à un sauvage isolé, lequel, imbu de ses habitudes et de ses idées, est mis en contact brutal avec les mœurs hypocrites et les institutions complexes de notre société ?
Afin d'aider cet homme infortuné à communiquer directement avec ses compatriotes, il nous a semblé préférable de laisser à sa narration les mots et les pensées qui lui sont personnels. Le narrateur ne manque pas d'ailleurs de cette sorte d'éloquence si particulière aux Indiens. Cependant, comme cette éloquence s'exprime beaucoup mieux dans l'action, l'emphase et l'expression du contenu que dans les mots et les phrases, le récit conserve un aspect modeste. Cette simplicité, espérons-le, rendra l'histoire plus accessible au lecteur moyen, tandis qu'elle permettra à un esprit plus philosophique de suivre sans trop de problèmes l'évolution mentale d'un sujet qui a subi, pendant de longues années, l'influence de la vie sauvage. Qu'il soit bien compris ici que toute cette histoire est rapportée telle quelle ; rien n'est venu la tronquer : ni insinuations ni suggestions questions ni conseils ; seule la volonté de « ne rien cacher »nous a guidés. Les opinions exprimées par le narrateur à propos du caractère ou de la conduite d'individus vivant « sur la frontière » ou en territoire indien, ou sur la condition des Indiens, sont exclusivement les siennes. Nous n'avons pris qu'une seule liberté, celle de retrancher ou d'omettre certains détails à propos d'aventures de chasse, ou de voyage, etc. Ces aventures n'ajoutent rien de spécial à la vie simple des Indiens, qui, à défaut d'autre chose, aiment beaucoup les raconter et s'étendre là-dessus pour la plus grande joie de leurs auditeurs. Il est possible que la narration eût été plus acceptable aux yeux de bien des lecteurs si nous avions omis plus de détails, mais il ne faut pas oublier que la vie du sauvage – comme celle du civilisé – est remplie de ces petits riens qui, s'ils sont mis en lumière, permettent de se faire une idée plus juste de la situation générale.
On trouvera certainement dans l'histoire de Monsieur Tanner des détails qui susciteront l'incrédulité, en particulier chez ceux qui ne connaissent ni l'histoire ni les conditions de vie des Indiens d'Amérique du Nord. La crédulité des lecteurs sera certainement ébranlée quand ils liront certains passages, en particulier ceux qui montrent que des rêves, des prophéties ou des prémonitions, impliquant l'intervention de forces invisibles et spirituelles, deviennent réalité. À certains, le narrateur apparaîtra comme un être faible et crédule ; à d'autres, comme stupide et malhonnête. Mais n'en serait-il pas ainsi parmi nous si certains s'avisaient de rapporter comme vérité des légendes qui (l’évolution de l'éducation et de la pensée aidant) étaient, il y a deux siècles, des doctrines et sont aujourd'hui des contes de fées ? Pour renforcer cette remarque, point n'est besoin de se référer à Cotton Mather ou à d'autres contemporains aussi réputés pour leur savoir que pour leur piété exemplaire. L'Histoire du genre humain à travers les âges, touchant toutes les nations, abonde en exemples de crédulité ; et ces exemples ressemblent étrangement à ceux qui suscitent notre incrédulité ou forcent notre pitié envers le sauvage. Si l'on veut comprendre la personnalité indienne, il est important de souligner ici que notre narrateur a toujours cru en l'ubiquité et en l'intervention fréquente d'une Providence toute-puissante dans les affaires des hommes. Si son théisme semble avoir été plus cohérent que celui de ses ignorants camarades indiens, on peut affirmer que ses croyances religieuses étaient exactement les mêmes. À la différence de ses camarades, il s'est montré moins dupe qu'eux à propos de ces rusés prophètes qui s'agitent constamment, mais en revanche, il n'a pas toujours cru en son jugement qui l'incitait à les considérer comme des canailles, et à tourner en ridicule leurs prétentions. Dans les moments de grande détresse comme de danger Imminent, les Indiens, à l'instar de tous les hommes, ont coutume d'adresser leurs suppliques à des puissances supérieures dont ils attendent, en général, une réponse favorable. Cette croyance ne doit pas choquer les gens pieux ; et elle ne risque pas de paraître extraordinaire à ceux qui ont pour pratique d'étudier le fonctionnement de la pensée humaine en différents lieux et circonstances. Nous croyons qu'il ne saurait y avoir d'illogisme ou d'incohérence dans la vraie religion. Nous pensons ne pas faire injure à la vraie religion ou au bon sens en disant qu'il n'y a qu'un seul et même Dieu bienveillant envers tous ceux qui le vénèrent avec sincérité. On verra aussi comment des esprits supérieurs arrivent à exploiter les sentiments religieux pour dominer des esprits plus faibles. Pour les Indiens comme pour les autres races (depuis l'époque de la retraite des Dix Mille sous la direction du chef philosophe jusqu'à nos jours), la religion reste l'instrument privilégié de ceux qui, par la vertu d'une supériorité fortuite ou intellectuelle, s'arrogent le droit de gouverner les autres.
Certaines idées que l'on trouve dans le récit sont influencées par deux facteurs : d'abord par la mentalité particulière du narrateur, et ensuite par les circonstances spéciales dans lesquelles il s'est trouvé. Cela dit, même en faisant la part des choses, ces idées n'en donnent pas moins une image bien ténébreuse sur la condition des hommes non civilisés. Depuis que le narrateur vit parmi nous, il a fini par se faire une opinion sur ce qui est répréhensible ou non ; aussi ne serait-il pas étonnant qu'il n'ait pas eu quelque réserve à communiquer des détails particuliers sur son séjour dans une communauté dont le mode de pensée est si différent du nôtre. S'il n'a pas hésité à confesser en toute liberté des choses qui nous paraissent graves, nous ignorons s'il a tu volontairement certains aspects de sa vie où il aurait commis des fautes encore pires à nos yeux. Mais n'oublions pas que, si certains actes sont jugés comme condamnables voire criminels dans notre société, il n'en va pas de même pour les Indiens qui considéreront ces mêmes actes comme relevant de la plus haute vertu. Ainsi, nulle part dans le récit, le narrateur n'apparaît-il sous un jour aussi défavorable que lorsqu'il raconte sa dureté envers une pauvre fille captive qui, à cause de sa négligence, a laissé brûler le wigwam et tout son contenu au beau milieu de l'hiver. Cet exemple de cruauté en rappelle d'autres : ainsi l'habitude d'abandonner les malades, les personnes âgées ou les mourants que l'on rencontre chez les Chippewyan, les Indiens nordiques et, plus ou moins, d'autres tribus. Tout ceci doit nous rappeler (jusque dans les plus petites choses qui nous paraissent spontanées et normales) ce que nous devons à l'influence de la civilisation. Dans un cas comme celui-là, la conduite des Indiens – quelle que soit notre réaction à cet égard – n'est jamais anormale ; en effet, elle obéit strictement et formellement à cette loi naturelle qui pousse irrésistiblement à l'autodéfense. Mais combien admirable est ce mécanisme complexe qui, dans bien des cas, oblige à surmonter et à contrôler cette impulsion, car, en dernière instance, le bonheur et la vie de l'individu passent après l'intérêt commun !
Les scènes de ce récit qui décrivent les malheurs et la misère de la vie sauvage sont probablement libres d'exagérations ou de déformations. Peu de lecteurs les liront sans éprouver des sentiments de compassion pour un peuple si dénué, dégradé et désespéré. Nous serions heureux si cette lecture avait pour conséquence d'attirer l'attention de citoyens éclairés et bienveillants sur les besoins de ceux qui sont du côté des ténèbres. Il est parfaitement vain d'essayer de se convaincre -ou de convaincre d'autres personnes – « qu'en ce qui concerne leur condition morale et leur avenir, les Indiens sortent gagnants de leur rencontre avec les Européens ». Qui peut croire que l'introduction parmi eux des spiritueux « n'ajoute pas grand-chose à la liste de leurs vices ou n'enlève rien à celle de leurs vertus » ? Rares sont ceux qui ont eu l'occasion – et encore plus rares ceux qui ont eu le désir – de visiter et d'observer les Indiens dans leurs lointains territoires ou tout près sur la frontière. Ceux qui l'ont fait n'auront pas de mal à se convaincre que, ou que ce soit et dans quelque but que ce soit, chaque fois que l'Indien et le Blanc entrent en contact, c'est toujours le premier qui, du point de vue moral, en sort irrémédiablement victime. N'importe quel enquêteur impartial qui prendrait la peine de se servir des sources d'information mises à la disposition du public, se convaincra facilement que, depuis plus de deux cents ans, en dépit des efforts bénévoles d'individus, d'associations philanthropiques ou des gouvernements, la fréquentation de ces deux races a pour résultat direct, la dégradation rapide et uniforme de la condition de vie des Indiens.
L'une des causes les plus fatales et les plus importantes de cette détérioration déplorable et évidente, réside dans le marché des fourrures dont on retrouve l'origine dès l'arrivée des Blancs dans ce pays. Le récit que l'on va lire donne un aperçu du marché des fourrures tel qu'il existait dans le Nord-Ouest, et tel qu'il continue d'exister dans les territoires revendiqués par les États-Unis. Ces points de vue ne sont ni ceux d'un homme d'État ni ceux d'un économiste politicien, mais ils ont du moins le mérite de montrer correctement l'influence du marché des fourrures en milieu aborigène. Il y a peu de temps, à la suite de la fusion de deux compagnies de fourrures, les Indiens, qui vivent dans cette région importante de l'Amérique du Nord exploitée par la Compagnie de la Baie d'Hudson, ont pu enfin se libérer des désavantages (comme des avantages) qui résultaient de la rivalité active entre les deux. Parmi les avantages que la fin de cette rivalité est censée apporter, citons-en un et non des moindres : il s'agit de l'interdiction de la libre circulation des spiritueux en territoire indien. Même les commis et les gérants, qui vivent dans les comptoirs les plus reculés de l'intérieur, n'ont pas le droit d'entreposer la plus petite quantité de vin ou de spiritueux dans leur magasin. Cette seule et unique mesure, qui a infiniment plus de poids que tout ce qui a été prôné aujourd'hui ou dans le passé par les gouvernements et les associations bénévoles, a été dictée à la société de marchands de fourrures par la prudence et l'appât du gain. Si, d'une part, cette mesure démasque bien les intentions de ceux qui sont le plus au fait des résultats de l'introduction du whisky parmi les Indiens, d'autre part, elle donne l'espoir de remédier à un mal si funeste.
À l'époque où les compagnies de fourrures rivales étaient libres d'exploiter à leur guise le Nord-Ouest de ce continent, ceux qui vivaient dans les coins réputés les plus reculés et les plus inaccessibles, pouvaient peser le pour et le contre du système mis en place (le même qui prévaut aujourd'hui dans les territoires des États-Unis). Il est à peu près certain que l'Indien pouvait alors réaliser plus de profits sur ses pelleteries qu'il ne peut espérer le faire maintenant. A quelque prix que ce fût, le chasseur indien savait toujours où et comment se procurer les moyens de s'enivrer, lui et sa famille, et il disposait du produit de sa chasse de la manière qui lui semblait la plus apte à satisfaire ses besoins funestes. En conséquence, à l'époque où la compétition faisait rage, on a dû se rendre à l'évidence, les animaux à fourrure comme les chasseurs aborigènes se dirigeaient à grands pas, les uns comme les autres, vers une disparition inéluctable. La compétition acharnée entre les compagnies de fourrures a toujours eu lieu dans des régions situées en dehors de la juridiction des gouvernements ou des pays civilisés. Dans ces circonstances, nul ne doit s'étonner que la population animale ait disparu quand on sait que les peaux de fourrure constituaient l'unique objet d'intérêt des marchands. Étant donné les habitudes vagabondes et nomades des Indiens, il est virtuellement impossible à un individu ou à un groupe d'empêcher ou de contrôler la destruction des animaux à fourrure. En tout état de cause, si des mesures de protection étaient prises, le marchand rival sauterait sur l'occasion pour exploiter la situation.
Le résultat n'a pas été long à se faire sentir : des régions où le gibier existait en abondance ont été décimées en quelques années au point que ses habitants ont dû émigrer dans des régions moins appauvries afin d'éviter la famine. Mais, comme les loups et les busards suivent les bisons, les marchands suivent les Indiens partout où ils vont. D'après ce qui ressort de la situation actuelle dans le Nord, les marchands paraissent contrôler entièrement tous les mouvements des Indiens. De tous les territoires de la Compagnie de la Baie d'Hudson, c'est la forêt qui présente le plus de richesses. Prenons l'exemple des Indiens des plaines qui subsistent presque uniquement en chassant le bison ; lors de leurs visites au comptoir, les marchands se contentent de leur acheter des peaux de bison ou des pelleteries s'ils en ont, en les payant sur-le-champ. En dehors de leurs chevaux, leurs arcs et leurs flèches, leurs vêtements de peau, les habitants des plaines ont peu de possessions ; de surcroît, les animaux qu'ils chassent présentent peu de valeur aux yeux des marchands, aussi ces Indiens sont-ils libres d'acheter ce qui leur plaît et de se passer de crédit. Le cas est tout à fait différent en ce qui concerne les Indiens des forêts. En effet, ils ont un besoin urgent de balles, d'armes à feu, de pièges, de haches, de couvertures de laine et autres biens manufacturés, au point qu'à l'approche de l'hiver, leur situation peut devenir désespérée si on les prive de tous les objets qu'ils sont accoutumés à recevoir. À l'époque des rivalités marchandes, et encore plus de nos jours, cette situation de dépendance a suffi, jusqu'à un certain point, à contraindre les chasseurs à se libérer ponctuellement et honnêtement des dettes qu'ils avaient contractées. Lorsque les animaux à fourrure commencent à se faire rares dans un territoire donné, la pratique des marchands consiste à fermer leur comptoir pour en ouvrir un autre plus loin, obligeant, ce faisant, les Indiens à les suivre. Toutefois, cette mesure produit un effet positif puisqu'au bout de quelques années, les animaux à fourrure commencent à repeupler le territoire abandonné. De surcroît, deux règlements contribuent à renforcer cet effet : le premier interdit aux marchands et aux commis des comptoirs d'acheter des peaux venant d'animaux qui n'ont pas atteint leur développement ; le second proscrit l'utilisation de trappes détruisant sans discrimination les animaux de tous les âges. Il n'est pas douteux que ces règlements contribuent largement à produire les résultats positifs que l'on sait. L'intérêt et l'opportunisme ont dicté ces mesures sévères à la Compagnie qui dispose actuellement du monopole du marché des fourrures ; ces mesures doivent être maintenues à tout prix si la Compagnie désire améliorer effectivement la condition des chasseurs nordiques. Seul le temps nous dira si ces mesures finiront par récompenser les Indiens pour les lourds sacrifices qu'ils devront consentir afin d'arriver à un bon résultat.
Il est évident que les plans que le gouvernement a adoptés et renforcés dans le but de servir les intérêts des marchands de fourrures, l'ont été également dans le but d'améliorer le rendement des chasseurs indiens ; en dernier ressort, ces plans sont en contradiction flagrante avec tous les efforts qui sont faits pour donner aux Indiens des habitudes sédentaires, un attachement à la terre et le goût du travail, conditions qui constituent la première étape vers la civilisation. Quoi qu'il en soit, le climat et le sol de la contrée située au nord des Grands Lacs sont tels qu'il apparaît hautement improbable qu'un peuple autre que celui de ces rudes chasseurs puisse jamais y demeurer ; si c'était le cas, il lui faudrait alors renoncer à l'idée d'un régime autre que celui engendré par le despotisme d'une poignée de marchands de fourrures. En revanche, on trouve à l'intérieur du territoire des États-Unis plusieurs tribus primitives qui vivent dans des forêts immenses ou le long de vallées rieuses et fertiles, chez qui l'on pourrait introduire le travail et la civilisation. Il est douteux que, dans ces régions, le commerce des fourrures puisse jamais devenir un monopole protégé et exclusif. Puisque ce commerce est et continuera d'être ce qu'il a été, c'est-à-dire la source principale de tous les maux dévolus aux Indiens, espérons que, dans le futur, les tribus qui restent pourront échapper à son influence en devenant indépendantes des moyens de subsistance qu'il offre.
Au cours des deux derniers siècles, on peut supposer qu'il y a eu évolution des sentiments que les envahisseurs européens éprouvent envers leurs barbares voisins. Toute proportion gardée, certains ont changé d'avis. Ceux qui étaient faibles sont aujourd'hui puissants, ceux qui offrent aujourd'hui aide et protection, jetaient autrefois un regard anxieux sur cette race supérieure et tremblaient devant elle ; cette même race qui a fini par périr littéralement sous ses yeux. Au début de notre histoire coloniale, le prosélytisme religieux et l'esprit philanthropique – moins suspect que le premier – n'ont jamais, ni l'un ni l'autre, réussi à surmonter de façon générale la haine profonde de la race sauvage. Cette haine découle de facteurs indissociables : la faiblesse et la dépendance des premières colonies et l'invasion par nos ancêtres des territoires que les Indiens possédaient de droit. Dans les écrits des premiers historiens, en particulier ceux des puritains théologiens de la Nouvelle-Angleterre, les Indiens sont présentés ordinairement comme des brutes, des démons, des bêtes sauvages, des chiens et des diables païens ; aucune épithète n'est assez ignominieuse, aucune abomination assez terrible, pour les décrire [1] On peut supposer encore que les Indiens, en perdant leur puissance qui les rendait invulnérables, ont fini par atténuer la haine des Blancs à leur égard. En conséquence, il est à la fois facile et de bon ton maintenant de professer le bien envers une race si infortunée et d'afficher de la compassion envers elle. Des efforts ont été faits – d'autres le seront dans le futur – pour que les Indiens viennent à la civilisation et se convertissent à la vraie religion. Ici et là, un Penn est apparu parmi nos hommes d'État ; un Elliot ou un Brainerd parmi nos hommes d'Église ; d'autres ont trouvé dans le bénévolat ou l'amour de la justice les motifs nécessaires pour travailler avec foi et persévérance au bien des Indiens. Si, en tant que peuple, nous faisions implicitement confiance aux déclarations de ceux qui écrivent et parlent à ce sujet, nous pourrions conclure que le seul désir qui nous anime envers nos voisins indiens, est celui de voir ardemment leurs intérêts menés à bien. Par ailleurs, si nous déterminons l'intensité des sentiments du public par rapport aux décisions officielles, alors nous devons conclure que la génération actuelle recherche avec tout autant de zèle et de conviction que ses pères, l'extermination complète de ces Cananéens sanguinaires et idolâtres. La vérité est la suivante : aujourd'hui comme hier, on continuera de trouver plus commode de croire que cette race, possédée par le démon, est vouée en vertu d'un destin inéluctable à une disparition complète et brutale. Cette opinion va de pair avec le dogme si commode du philosophe moraliste qui enseigne que ceux qui cultivent la terre ont le droit de déposséder et de chasser ceux qui, par ignorance et paresse, ne s'occupent pas de la travailler. Il est inutile de souligner le manque d'équité d'une telle proposition. En cas de force majeure, les mêmes règles semblent s'appliquer aux deux parties : de même qu'il est devenu impossible d'éviter de chasser les Indiens et d'occuper leur pays, de même il leur est devenu impossible de nous empêcher de le faire.
Le sujet si longuement débattu de « l'amélioration de la condition des Indiens » amène d'ores et déjà à poser deux questions d'importance capitale : 1) une intervention de notre part peut-elle apporter quelque chose ? 2) Possédons-nous dans notre caractère collectif une qualité particulière pour mettre un frein à la décadence des Indiens ? Tous ceux qui connaissent la politique établie par le gouvernement vis-à-vis des Indiens répondront par la négative à la deuxième question. Ainsi, la détermination avec laquelle une grande partie de la population et de ses représentants agit pour éliminer les droits territoriaux des Indiens de ce côté-ci du Mississippi (en refoulant le reste de ces tribus dans des régions déjà occupées et dont les moyens de subsistance sont déjà exploités) montre, avec beaucoup plus d'éloquence que maintes déclarations vides et futiles, nos intentions à leur égard. Les traités ne sont que moqueries mensongères, car le sens donné aux mots négociation, réciprocité et bénéfices ne servent qu'un seul camp. Quant aux petits efforts bien gauches que nous faisons afin d'amener les Indiens vers la civilisation et l'éducation, cela ne devrait pas nous faire croire que nous avons des droits sur eux (ainsi toutes les fois que leurs intérêts communs entrent en conflit avec les nôtres) ou que nous sommes possédés d'un désir sincère de leur apporter une éducation morale. Les organisations de charité, dont les intentions de sincérité ne devraient pas être mises en cause, paraissent a priori plus dignes d'intérêt ; cependant, nous estimons que leurs actions sont mal dirigées : ainsi, dans quels buts va-t-on chercher dans le Sud quelques enfants indiens pour leur enseigner des rudiments « d'astronomie, de philosophie morale, d'arpentage, de géographie, d'histoire et de lecture des mappemondes » [2] ? Pourquoi enseigne-t-on, dans le Nord, aux petits métis nés de marchands de fourrures ou de Canadiens vagabonds, le travail de chantier, l'art de construire des bateaux réservés au transport sur les Grands Lacs ? Pourquoi les emploie-t-on comme ouvriers dans nos villages frontaliers ? En elles-mêmes, ces mesures sont sans doute utiles, voire bénéfiques, mais ne nous leurrons pas en prétendant qu'elles sont essentielles aux Indiens ! Il est douteux que les Choctaw et les Chickasaw retiennent bien longtemps les notions liées à l'astronomie et à l'arpentage, comme si elles étaient nécessaires pour guider leurs pas errants ou mesurer leurs possessions quand on les aura obligés à vivre dans ces territoires torrides et stériles comme c'est notre intention. Le fait de donner une instruction à quelques individus d'une tribu – sans parler du peu de rayonnement que cela peut avoir – les rend inaptes à poursuivre le mode de vie auquel on les destine ; aussi, en le faisant, et avec quelque bonne intention que ce soit, nous ne faisons pas le bien. Si, pendant que nous donnons des rudiments d'instruction à quelques individus, nous pratiquons une politique égoïste qui consiste à renvoyer les autres à un état de barbarie encore plus grand, alors même que nous prétendons vouloir leur apporter des qualifications utiles, que signifient alors nos efforts ou nos déclarations en leur faveur ? Nous ne pouvons ignorer qu'en privant les Indiens d'une existence de vie confortable, nous les privons du même coup de la possibilité et de l'envie de cultiver le savoir qu'on leur enseigne à l'école. Est-ce que le jeune Indien qui rentre chez lui après un séjour de dix ou quinze ans à l'école de la Mission saura devenir un meilleur chasseur ou un guerrier plus brave que ceux qui sont restés et qui ont reçu l'éducation que la tribu leur réservait ? Est-ce que ce jeune Indien ne sera pas encombré d'un tas de connaissances aussi inutiles et vaines aux yeux des autres que des billets de loterie ou du papier-monnaie ? Sur ce sujet, comme sur d'autres, les Indiens sont doués pour faire des réflexions fort justes dont ils ne se privent pas d'ailleurs. Dire, par exemple, qu'ils considèrent le savoir des Blancs comme nul et non avenu, ne serait pas la vérité. Au contraire, ils parlent, en termes hautement admiratifs, de certains domaines comme celui de l'écriture et de la lecture ; ainsi ils disent que cela a l'avantage de nous permettre de savoir ce qui se passe au loin, de se rappeler avec la plus grande précision ce que d'autres ont dit dans le passé. En revanche, ils ajoutent que ces choses – comme la religion des Blancs par exemple – « n'ont pas été faites pour eux ». « Le Grand Esprit a créé pour vous et pour nous des choses différentes selon nos conditions de vie respectives. Il a peut-être été plus généreux envers vous qu'envers nous, mais nous ne nous plaindrons pas de notre sort pour cela. »
Quelques mots suffisent pour aborder cette partie de notre discussion, c'est-à-dire la question de savoir à quel point les Indiens peuvent tirer des bénéfices de l'instruction publique ? Plus de deux cents ans ont passé durant lesquels on a cru que des efforts systématiques et complets avaient été entrepris pour la civilisation et la conversion des Indiens. L'échec total de tous ces efforts devrait nous convaincre non pas que les Indiens sont irrécupérables, mais que nous-mêmes sommes responsables, car en donnant d'une main, nous avons toujours ôté de l'autre. En dépit de la force de nos propos ou de notre zèle philanthropique, force est de constater que nos intérêts, notre égoïsme et notre opportunisme l'ont toujours emporté. Voilà bien les causes auxquelles on peut attribuer le déclin régulier et la détérioration rapide des tribus indiennes. On pourra toujours venir nous parler de leur indolence innée, de leur tempérament asiatique qui les destineraient à jamais à un état stationnaire sinon régressif, il n'empêche que des monuments, des vestiges et des sources historiques irréfutables, démontrent qu'il y a quelques siècles, les Indiens, bien que primitifs, formaient un grand peuple, heureux et prospère. Ne perdons pas de vue que l'injustice et l'oppression sont à l'origine des causes qui ont réduit les Indiens à cet état actuel si déplorable. L'insouciance inouïe, la débauche scandaleuse, le laisser-aller total qui les affectent, sont les conséquences inévitables de leur condition de vie à la fois dégradante et désespérée [3].
Personne ne peut sérieusement prétendre de nos jours qu'il y a des obstacles insurmontables – du point de vue physique et du point de vue moral – pour amener les Indiens à notre civilisation. Cependant, ceux qui les connaissent intimement et qui ont eu l'occasion d'observer les sentiments réciproques que les deux races éprouvent entre elles, considèrent comme très improbable que les Indiens deviennent civilisés ; ils en sont si bien convaincus qu'ils ne prennent pas la peine d'étudier quelles mesures il faudrait adopter pour atteindre ce but tant désirable. Mais quels avantages la civilisation a-t-elle apportés à ces malheureux Séminoles qui, il y a à peine quelques années de cela, ont été chassés de leur beau territoire fertile en Floride et ont dû se réfugier dans les marécages profonds inaccessibles de la baie de Tampa ? Non seulement ils sont gardés militairement, mais le gouvernement doit leur fournir des vivres jour après jour, année après année. Devons-nous leur donner une éducation afin qu'ils puissent apprécier encore mieux notre munificence et notre générosité, nous qui les condamnons à errer dans des marécages de cyprès, des déserts sablonneux ou ailleurs, chaque fois que nous estimons que le sol ne présente aucune valeur pour nous ?
Le projet de rassembler les Indiens qui vivent sur le territoire américain actuel dans une région située, non seulement à l'ouest du Mississippi, mais au-delà des terres arables du Missouri et de l'Arkansas, dans ces déserts brûlants qui bordent le côté orientai des Rocheuses, est sans doute, de tous les projets, celui qui est le plus grevé d'injustice et de cruauté. Il y a entre ces peuples de cultures différentes et parfois voisines, tels les Ojibwa et les Dakota, les Cherokee et les Osages, une hostilité traditionnelle et séculaire. Or, le fait de les regrouper dans une région déjà occupée par des chasseurs belliqueux et jaloux de leurs prérogatives ne fera qu'accélérer leur destruction mutuelle. Dans son opuscule, M. McKoy propose de regrouper les Indiens dans une région dont le caractère dénudé et inhospitalier aurait vite fait de réduire des hommes civilisés en barbares ; dans ces conditions, comment douter qu'une destruction inévitable attend un rassemblement de sauvages ennemis, violents et rusés à la fois ?
De tous les plans qui ont été pensés pour venir en aide aux Indiens, il en est un bien meilleur, quoique difficile à appliquer : c'est de les laisser tranquilles. Ainsi s'il était possible de leur laisser les restes de leurs territoires tout en écartant d'eux l'influence néfaste des comptoirs de fourrures, des postes militaires et de tout ce qui leur est rattaché, le besoin forcerait peut-être les Indiens à se remettre au labeur. Le travail ainsi remis à l'honneur apporterait avec lui prospérité, vertu et bonheur. Mais, puisque nous ne pouvons raisonnablement espérer que ce plan soit jamais appliqué, les humanistes doivent continuer d'espérer que dans l'avenir une solution intermédiaire soit adoptée ; solution qui, dans une certaine mesure, saurait pallier la misère inévitable, et retarder la disparition éventuelle des Indiens. La tâche principale du philanthrope qui s'attachera à cette cause sera de calmer ou de supprimer cet « esprit d'extermination » si bien ancré dans nos esprits, et entretenu par ces combinards de propriétaires terriens ou ces bons à rien de squatters, qui demandent à cor et à cri que les Indiens partent à« l'ouest du Mississippi ». Il se pourrait bien que certains d'entre nous, et surtout les législateurs, imaginent que la région située au-delà du Mississippi est une sorte de pays de Cocagne où les hommes se nourrissent de l'air du temps ; d'autres pensent sans doute qu'une fois les frontières de ce pays de chimères refermées sur les Indiens, on n'entendra plus parler d'eux. Supposons à présent que cette mesure, qui paraît si urgente à certains, soit appliquée, et que les Indiens soient envoyés à « l'ouest du Mississippi », combien de temps alors attendrons-nous pour entendre un nouveau slogan : « à l'ouest des Rocheuses » ? On peut toujours envoyer les Indiens dans ces étendues désertiques, mais on ne pourra pas les convaincre d'y rester, et il n'y a pas de doute qu'ils apparaîtront en peu de temps aussi dangereux aux yeux des colons de la rivière Rouge, de la rivière White ou du bas Arkansas qu'à ceux des habitants de la Géorgie, de l'Alabama, du Missouri ou de l'Illinois.
Alors que nous attirons vers nos rivages tous les insatisfaits ou les nécessiteux des pays étrangers en leur vantant les avantages de nos institutions (sans même nous préoccuper de savoir si les crimes qu'ils ont commis dans leur pays, ou si les régimes oppressifs qu'ils ont connus les ont irrémédiablement transformés), est-il vraiment possible qu'en même temps nous puissions persister à vouloir déraciner les derniers représentants d'une race, qui sont de surcroît les propriétaires originaux de ce sol, et dont beaucoup sont certainement mieux qualifiés pour devenir d'utiles citoyens à notre république que ces étrangers que nous sommes si désireux de naturaliser ? Par ailleurs, il n'est pas souhaitable que les tribus aborigènes vivant au milieu des Blancs, et qui auraient saisi les avantages de notre civilisation, croissent en nombre suffisant pour créer un État indépendant, lequel, avec le temps, pourrait s'avérer dangereux pour ses voisins. Quant au projet de colonisation, devrait-il être mené à bonne fin que, mis à part son aspect éminemment injuste, il est aussi douteux que celui qui voulait renvoyer les descendants des esclaves en Afrique. On dit que tôt ou tard, les crimes d'ordre individuel ou national reçoivent une juste punition. Est-il impossible dans ces conditions qu'en dépit des efforts de la « Société de Colonisation », les représentants de la race africaine – dont beaucoup sont profondément enracinés chez nous – puissent garder rancune au point de chercher vengeance à nos descendants pour des crimes commis par nos contemporains et nos ancêtres ?
L'histoire et les conditions actuelles des Indiens démontrent avec force que, si les États-Unis désirent autre chose que la disparition rapide et complète de ce peuple, des mesures appropriées doivent être immédiatement adoptées. Pour commencer, le plus important serait d'empêcher, dans la mesure du possible, tous les maux et malheurs qui résultent de la compétition marchande, des abus qui sont liés au trafic des fourrures et à la consommation de whisky ; il faudrait ensuite encourager la pratique des travaux domestiques et agraires qui rendrait les Indiens plus indépendants du marché des fourrures. On pourra vaincre peu à peu la paresse et le dégoût du travail que l'on rencontre chez eux, en leur offrant des chevaux, du bétail, des outils, de beaux vêtements, des ornements de bon goût destinés à ceux qui se seront distingués par un travail soigné et constant. En suscitant le goût de travailler physiquement et celui de se cultiver l'esprit chez tous les enfants sans exception, en enseignant uniformément l'anglais, on pourra ainsi marquer des progrès. Aucun effort ne devrait être épargné pour parvenir à cette fin. Nous croyons qu'en apprenant l'anglais, les Indiens doivent oublier leur propre langue et tout ce qui les motive à agir et à penser à leurs manières. Si tout cela pouvait être accompli, si, de plus, les droits et les privilèges rattachés à la citoyenneté étaient accordés en récompense d'une bonne conduite ou si on leur permettait de posséder des biens matériels, nul doute que l'effet sur le niveau d'élévation du caractère indien serait rapide et bénéfique. L'adoption d'une série de mesures de la sorte permettrait aux derniers survivants de ce peuple d'être assimilés par les Blancs. Aussi longtemps que les tribus conserveront leur langue, leurs mœurs et leurs idées, et qu'elles vivront dans l'indépendance, il y a lieu de croire qu'elles ne pourront pas survivre.
[1] « Les petits royaumes et la renommée des grands chefs parmi les Indiens, écrit Cotton Mather, ont été un obstacle suffisant au succès de la mission du révérend Elliot. Par ailleurs, observons que plusieurs des nations qui ont refusé de recevoir la parole de Dieu ont été par la suite possédées du démon et influencées par lui au point de faire une guerre injuste et sanglante aux Anglais. Mais mal leur en prit puisque cette guerre a eu pour effet de les effacer rapidement et définitivement de la surface de la terre divine. Le résultat est particulièrement remarquable pour Philip, meneur principal de la guerre effroyable qui a été menée contre nous. Notre Elliot ayant promis au souverain le salut éternel, le monstre opposa mépris et colère, et, conformément à l'usage indien qui joint le geste à la parole, il prit un bouton de manteau de notre révérend, lui signifiant qu'il trouvait son évangile aussi passionnant que ce bouton. Le monde entier a appris par la suite le sort funeste que ce monarque et son peuple ont connu. Il n'y a pas si longtemps, la même main qui écrit aujourd'hui, a détaché, lors d'une occasion particulière, la mâchoire appartenant au crâne (exposé au public) de ce léviathan blasphématoire ; depuis, le renommé Samuel Lee, pasteur d'une congrégation anglaise, chante les louanges du ciel, à l'endroit précis où Philip et ses Indiens se livraient à l'adoration du Diable » (Christian Magazine, p. 514, vol. 1, Boston). D'autres passages du même genre et qui témoignent du même esprit, reviendront sûrement à la mémoire de ceux qui connaissent les écrits des premiers puritains de la Nouvelle-Angleterre. Quand on sait que des croyants éclairés ont choisi de léguer de tels discours à la postérité, comment s'étonner du sentiment général de la population envers les Indiens ?
[2] Lettre du directeur de l'école Lancasterian Choctaw (Great Crossings, Kentucky) au colonel M’Kenney, parue dans le National Intelligencer, en juillet 1828.
[3] « Il n'y a pas de mendiants parmi eux ou d'orphelins abandonnés. » Roger William (Key, chapitre 5).
« Observations : Ils font beaucoup d'affaires, et ils sont tout aussi impatients de les conclure (à leur manière) que tout autre marchand européen. Plusieurs d'entre eux, des princes de sang ou des personnes laborieuses, sont riches, et les plus pauvres prétendent ne rien désirer de plus » (Williams, chapitre 7). « Les femmes font facilement sécher dans de larges cercles, deux ou trois tas de grains de maïs de douze, quinze ou vingt boisseaux chacun ; et elles en font volontiers encore plus avec l'aide de leurs enfants ou d'amies » (chapitre 16). « Il n'y a pas chez eux d'excès en ce qui concerne tous les péchés scandaleux si répandus en Europe. Ils ignorent en général tout de l'ivrognerie et de la gloutonnerie. Bien qu'ils n'aient pas appris à se contrôler aussi bien que les Anglais (par rapport à la crainte de Dieu aux lois des hommes), on n'entend cependant jamais parler à leur propos de crimes tels que le vol, l'assassinat ou l'adultère » (chapitre 22). Ce genre de citations revient constamment chez tous les anciens auteurs. Et on voudrait nous faire croire que, eu égard à leur condition morale, les Indiens sortent gagnants de leurs rapports avec les Blancs ! Beaucoup de personnes se souviennent encore que les énormes quantités de maïs nécessaires au commerce des fourrures dans la région du lac Supérieur, étaient achetées aux Indiens. C'est d'ailleurs eux-mêmes qui cultivaient le maïs à un endroit appelé Ketekawwe sibi ou rivière Garden, un petit ruisseau qui se jette dans le détroit entre les lacs Supérieur et Huron, à six milles environ en aval de Sault-Sainte-Marie. « Lors de la première colonie anglaise, les Indiens rendirent beaucoup de services aux colons ; ils leur enseignèrent la façon de planter et de préparer le maïs. Quand les colons souffrirent de la famine, les Indiens assouvirent leur faim en leur vendant du maïs ; ce geste leur évita de périr dans une contrée étrangère aux vastes espaces incultes. » Trumbull (History of Connecticut, vol. I, chapitre 3). À propos d'une famine qui sévit chez les colons, le même auteur écrit d'ailleurs : « La situation était devenue désespérée ; et une délégation alla au village indien de Pocomtock pour acheter de grandes quantités de maïs. Il y en avait tellement que les Indiens durent venir une fois à Windsor et à Hartford dans cinquante canots remplis à ras bord » (vol. I, chapitre 6). D'après le même auteur, les Indiens de l'île Block « possédaient deux cents acres de champs de maïs ». Mais les Anglais, après être restés deux jours dans l'île, « brûlèrent les wigwams », « détruisirent les canots (et le champ de maïs) » avant d'appareiller pour le pays des Péquots (ib., chapitre 5). Charlevoix, dont l'autorité en ce domaine est moins grande que celle des premiers auteurs français, écrit que lors d'une incursion dans le pays des Seneca, les Français détruisirent quatre cent mille minots de maïs (c'est-à-dire 1 200 000 boisseaux). « Ils tuèrent également un nombre prodigieux de porcs, ce qui fut cause de maladie » (Histoire de la Nouvelle France, liv. XI). Il est inutile de continuer de donner des citations par centaines ; en effet elles ne serviraient qu'à confirmer ce que peu d'auteurs – sauf celui qui vient d'être cité plus loin dans le texte – considèrent comme douteux.
|

