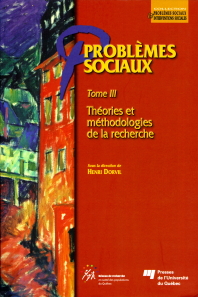 Introduction Introduction
Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, lors de son premier voyage de Southampton à New York, le paquebot transatlantique britannique Titanic coula après avoir heurté de plein fouet un iceberg au sud des côtes de Terre-Neuve. Cet accident, l’un des pires désastres maritimes de tous les temps, coûta la vie à plus de 1500 personnes, soit plus des deux tiers des 2 200 passagers à bord. Alors que le navire coulait à pic dans les eaux tumultueuses et glacées de l’océan, les femmes et les enfants eurent un accès privilégié aux vestes de flottaison. Pourtant, le taux de mortalité chez les femmes du Titanic est loin d’être aléatoire, mais relié d’une manière saisissante au statut social de ces femmes. Selon Carrol et Smith (1997), parmi les femmes à bord du paquebot, seulement 3% des passagères de première classe perdirent la vie, en comparaison des 16% de seconde classe et des 45% qui se trouvaient en troisième classe. Ce sont la qualité et le coût de location de la cabine, des marqueurs du rang social, qui ont signé, évidemment, la probabilité de survie. Comme on peut s’en douter, la relation entre l’espace social habité et l’espérance de vie ne constitue guère un cas unique au Titanic. On n’a qu’à penser aux écarts de l’espérance de vie en bonne santé à Montréal entre les habitants de Westmount et ceux du quartier Saint- Henri, situé de l’autre côté du chemin de fer, soit 10 ans environ. Les choses ont peu changé depuis l’accident maritime de 1912, puisque l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, le 29 août 2005, a inondé et détruit les shacks (cabanes très modestes, faites de bois, de carton et de tôle) tout en épargnant les résidences huppées des quartiers chics de cette ville du sud des États-Unis. L’association étroite entre le statut socioéconomique et la santé a été établie au regard de plusieurs indicateurs dans toutes les sociétés où elle a été examinée. La santé mentale ne fait pas exception à cette règle. Depuis le XIXe siècle en fait, un très grand nombre d’experts de plusieurs disciplines ont souligné la solidité de l’impact des inégalités socioéconomiques sur la santé des individus et des populations. Cependant, du fait de sa spécificité bigarrée, qui a des racines anthropologiques, culturelles, philosophiques, psychologiques, sociologiques et politiques, la maladie mentale n’est pas une maladie comme les autres. Comme l’observe Jaccard (2004), l’idée d’assimiler la folie à une maladie, de vouloir coûte que coûte qu’elle soit semblable en son principe aux autres maladies, n’a jamais pu s’imposer absolument (p. 10). Aucune anomalie biochimique, ajoute-t-il, aucune lésion, aucune malformation génétique ne peuvent être tenues responsables de la folie (p. 59). Comme l’écrit un médecin psychiatre (Bourguignon, 1971), les recherches biochimiques sont certes à poursuivre, mais nous ne croyons pas qu’elles apporteront une solution totale et définitive à un problème qui se pose en d’autres termes. La folie est irréductible aux seules structures anatomiques ou physicochimiques. Aussi faut-il tenir compte de cette spécificité avant d’étudier les inégalités socioéconomiques. D’entrée de jeu de ce chapitre, je vais baliser l’entité « maladie mentale » ainsi que le stigma lui conférant une place à part dans le catalogue des malheurs existentiels qui affectent le genre humain. Ensuite, je m’attarderai un peu plus sur les inégalités socioéconomiques, objet principal de ce chapitre.
|

