[77]
Les institutions québécoises :
leur rôle et leur avenir.
L’ÉGLISE
Situation
de l’Église québécoise
Fernand DUMONT
professeur, Département de sociologie. Université Laval.
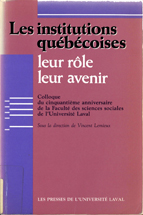 Une institution est composée de trois éléments essentiels, qui font sa cohérence. C’est d’abord une organisation, la dimension la plus tangible : une infrastructure, des cadres, des gestionnaires, une idéologie. On y reconnaît aussi des modes d’appartenance avec une procédure d’entrée et de sortie, des pratiques. Enfin, des valeurs sont en cause, qui donnent un sens aux pratiques, modèlent des attitudes, confèrent une identité à ceux qui adhèrent à l’institution. Une institution est composée de trois éléments essentiels, qui font sa cohérence. C’est d’abord une organisation, la dimension la plus tangible : une infrastructure, des cadres, des gestionnaires, une idéologie. On y reconnaît aussi des modes d’appartenance avec une procédure d’entrée et de sortie, des pratiques. Enfin, des valeurs sont en cause, qui donnent un sens aux pratiques, modèlent des attitudes, confèrent une identité à ceux qui adhèrent à l’institution.
Or, projetant sur l’Église cette grille élémentaire, que constatons-nous au Québec et un peu partout en Occident ? Le premier élément persiste : l’Église est toujours une organisation visible, et même de plus en plus visible. Ce sont les deux autres éléments, les modes d’appartenance et les valeurs, qui deviennent problématiques. De sorte que non seulement l’institution évolue et se transforme, mais sa signification même est vouée à une errance dont nous n’entrevoyons pas l’achèvement.
Ce phénomène, j’essaierai d’en mesurer l’ampleur et la portée pour l’Église, bien entendu, et aussi pour notre société. Ai-je besoin d’en prévenir ? Pour poursuivre pareil dessein, au moins un livre serait nécessaire ; je me bornerai ici à indiquer rapidement quelques balises.
[78]
RAJEUNISSEMENT DE L’ORGANISATION
Il n’y a pas si longtemps, pour expliquer les changements qui ont affecté l’Église dans notre société, on invoquait la sécularisation. Sécularisation ? Le mot est bien vague, et c’est peut-être pourquoi il a connu une telle fortune. Si on veut lui donner un sens un peu circonscrit, on lui fera désigner deux processus. Des fonctions, jadis assumées par l’Église, sont passées à d’autres instances : il en fut ainsi de l’éducation, de l’assistance et de bien d’autres responsabilités. Par ailleurs, des représentations de la société, jadis définies ou marquées par le discours religieux, relèvent désormais d’idéologies séculières. D’un processus à l’autre, se produit un déplacement d’institutions, et plus encore un déplacement de visions du monde.
À l’extérieur comme à l’intérieur de l’Église, on s’est souvent réjoui de ce double déplacement. Enfin, a-t-on dit, sont advenues la reconnaissance de la densité propre de ce monde et, en contrepartie, la redécouverte de la spécificité de la foi. Une espèce de concordat, en somme, sauvegardant, de part et d’autre, l’originalité des organisations, des pratiques, des valeurs.
Dans d’autres sociétés de l’Occident, ce processus de sécularisation a été enclenché depuis longtemps. Au Québec, il s’est effectué par une brusque poussée discernable au tournant des années 1960. Encore qu’il faille être prudent quant à ce genre de datation. Des mutations subites sont d’ordinaire préparées par des transformations souterraines dont l’origine est plus ancienne. Un édifice apparemment aussi solide que l’Église du Québec du siècle dernier dissimulait certainement des failles, des retraits, des abandons, une tradition latente de contestation qui se sont manifestés avec une intensité d’autant plus grande qu’ils avaient été longtemps réprimés.
Cette rapide remise en question de l’Église québécoise a coïncidé avec le concile Vatican II : un rafraîchissement de l’institution, de son organisation et de sa doctrine.
En d’autres pays, le Concile avait été préparé par une longue fermentation au sein des Églises : mouvements divers, courants idéologiques, travaux théologiques, initiatives pastorales. Certes, il n’est pas certain que la communauté chrétienne, dans les milieux populaires notamment, ait été atteinte dans son épaisseur ; des recherches historiques, menées en France par exemple, nous laissent [79] entendre que le Concile a pris un peu de haut des changements de mentalités et s’est trop vite replié sur des textes. Car le Concile a été l’œuvre de théologiens et de gestionnaires ; son message a ensuite été diffusé surtout par des pasteurs. Diffusé ou assimilé ? Comme tous les conciles dans l’histoire de l’Église, celui-là supposait un travail de reprise au sein de la communauté. Ce travail était-il possible au Québec, au moment même où une communauté minée secrètement depuis longtemps semblait s’effondrer ?
Grâce au Concile, l’Église s’est définie face au monde, dans son originalité, dans sa cohérence comme organisation. Qu’est-il arrivé aux deux autres domaines, celui des pratiques et celui des valeurs ?
ÉROSION DES PRATIQUES
Le déclin de la pratique religieuse (dominicale, particulièrement) frappe d’abord l’observateur. Malheureusement, si nous disposons d’indications chiffrées assez nombreuses, elles datent de moments différents et ont été obtenues par des enquêtes parcellaires et pas toujours fiables. Souhaitons qu’un chercheur réunisse bientôt un dossier d’ensemble, en y mettant toutes les précautions critiques. En attendant, il me suffira de citer des chiffres à eux seuls éloquents quant à la rapidité des changements.
- Entre 1961 et 1971, le taux de pratique dans le diocèse de Montréal passe de 61% à 30% ; dans le diocèse de Saint-Jean, la chute est encore plus brutale, de 65% à 27%. À la fin des années 1970, ce taux oscille, d’après les sondages, entre 37% et 45% pour l’ensemble des catholiques québécois. Si l’on fait la distinction entre les milieux urbains et ruraux, les différences s’accusent davantage [1].
Le Québec a ainsi rejoint la tendance qui se vérifie partout en Occident. Les données sont, là-dessus, d’une extrême abondance. Je retiendrai quelques notations de Danièle Hervieu-Léger dans un ouvrage récent :
- Si 82% des Français, en 1984, se déclarent catholiques, 13% seulement assistent régulièrement à la messe du dimanche, 7% pratiquent une ou deux fois par mois, les autres ne pratiquent pas, ou très irrégulièrement [...] 60% des Anglais disent appartenir [80] à la Church of England, et 2,5% seulement assistent plus ou moins régulièrement aux offices. Et dans un pays où l’Église est aussi massivement présente qu’en Italie (avec ses 330 évêques, soit 10% de l’épiscopat mondial), on compte à peine 20% de pratiquants réguliers [2].
Il serait imprudent d’extrapoler pour l’avenir. Des retournements peuvent se produire, imprévisibles pour ce phénomène comme pour tant d’autres. L’histoire réserve toujours des surprises. Quelle sera l’orientation de la génération actuelle des jeunes ? Elle ne suivra pas nécessairement la pente dessinée par les aînés. Par contre, dans la plupart des pays d’Occident, la tendance au déclin de la pratique est plus ou moins ancienne, et il se pourrait qu’elle continue de s’accentuer.
S’il est difficile de prévoir l’évolution de cet éloignement de la pratique, il est plus facile d’en mesurer les conséquences pour aujourd’hui.
En soi, la fréquentation régulière de la messe dominicale n’est pas un indice indubitable d’appartenance ; elle ne préjuge pas fatalement de la présence de la foi dans la conscience et dans les comportements quotidiens. Néanmoins, la désertion de la pratique implique une prise de distance envers l’institution dont on ne méconnaîtra pas l’importance. Une institution produit nécessairement des définitions de comportements. Ceux-ci sont la marque officielle de l’appartenance ; en retour, ils instaurent l’individu dans une manifestation publique de son adhésion. Ces pratiques constituent aussi des occasions, rythmées en temporalité, de reprendre contact avec la doctrine, de refaire l’orthodoxie. Enfin, dans le cas de l’Église, les pratiques principales sont des sacrements : des jonctions avec la vie profonde de la communauté en tant que médiatrice du Christ. On ne saurait donc minimiser les indices du déclin de la pratique religieuse, sous prétexte qu’ils ne peuvent amener à conclure de la foi authentique.
Au constat général, ajoutons une réserve importante. Si la messe dominicale est de moins en moins fréquentée, se décèle par ailleurs une relative stabilisation de certaines pratiques ; baptêmes, [81] mariages religieux, funérailles. De même les offices rallient un nombre plus considérable de participants lors des grandes fêtes, à Noël particulièrement. On consultera là-dessus l’ouvrage récent de Reginald Bibby ; celui-ci, à partir de nombreux sondages, a bien mis en évidence cette constante et ce, pour toutes les confessions chrétiennes au Canada [3].
Une première explication vient à l’esprit : résisterait à l’érosion ce qui est lié aux rythmes essentiels de l’expérience humaine ; subsisteraient des « rites de passage ». Ont été désintégrés les lieux multiples d’anciens raccordements entre le religieux et le profane, les contaminations sans lesquelles il n’y a pas d’institutions religieuses autrement que désincarnées ; resteraient les moments décisifs de l’existence et les rares fêtes unanimes. La collusion ancienne demeurerait, plus restreinte, mais selon une même exigence sociologique.
Une autre explication se présente, qui ne contredit pas la précédente. L’appartenance religieuse changerait actuellement de signification. La référence à la religion serait devenue une référence parmi d’autres. Ou, si l’on veut, la référence fondamentale de l’existence ne serait plus religieuse, du moins dans les termes d’une religion déterminée et identifiable à une Église. Si tel était le cas, cela ne pourrait manquer d’avoir des conséquences, non plus seulement sur les modalités de l’appartenance, mais sur le contenu de la croyance, sur les valeurs qui rallient les croyants, sur leur identité par rapport à l’institution.
Nous voilà conduits vers le troisième niveau de nos analyses.
DES VALEURS ÉVANESCENTES
Cette fois, ce que les enquêtes nous révèlent déborde les indices de pratiques. D’innombrables sondages, au Québec, au Canada, dans d’autres pays nous apprennent que, chez ceux qui se réclament de l’appartenance à une Église, sont extrêmement variables les énoncés concernant les croyances en Dieu, à la divinité du Christ, à sa résurrection, aux sacrements, à l’immortalité. Sur ce [82] point aussi, il n’y a pas de différences notables entre les confessions chrétiennes [4].
Pour s’en expliquer, il faut mettre en relation ce constat avec le déclin des pratiques. Nous avons cru percevoir un effritement des attaches entre les comportements prescrits par l’Église et les comportements profanes ; la distance ainsi créée entraîne un réaménagement, plus libre pour ainsi dire, des croyances elles-mêmes. Nous serions devant une autre étape, dont le déclin des pratiques serait un premier symptôme. L’idée d'orthodoxie en est compromise. Elle l’a été, il y a longtemps, par les réformes à l’intérieur du christianisme ; elle le serait maintenant, en une autre phase infiniment plus cruciale, dans le catholicisme autant qu’ailleurs.
C’est à ce point qu’il convient d’aborder un phénomène récent que les sociologues ont quelque peine à cerner et à qualifier. Après avoir insisté sur la sécularisation, on assiste à ce qu’on appelle (d’une expression fort ambiguë elle aussi) le « retour du religieux ». On y met beaucoup de choses disparates. Évoquons brièvement la multiplication des sectes et la prolifération des pratiques magiques.
Les sectes et leurs adhérents croissent en nombre, en même temps que décroît la pratique dans l’Église. N’omettons pas de noter une précaution élémentaire ; ces groupes et leurs membres sont difficiles à dénombrer ; les adhésions sont souvent brèves ; on passe aisément de la ferveur à l’abandon ; on émigre facilement d’un groupe à un autre. Du reste, ces sectes sont de nature fort diverse, et il n’est pas certain que la dénomination globale dont on les coiffe ne masque pas des différences essentielles. Sans prétendre dresser une typologie, encore moins un catalogue, distinguons quelques grands ensembles : des spiritualités coupées de leurs racines proprement religieuses, importées de cultures étrangères à l’Occident, et qu’il est permis de rapprocher de la vogue des techniques du mieux-être psychologique ; des communautés où l’on cherche la fraternité ; des industries de la religion, qui recoupent parfois les deux variétés précédentes.
[83]
Sur l’essor, également extraordinaire, des pratiques plus ou moins magiques (astrologie, horoscope, etc.), nous ne disposons guère, au Québec, de données un peu précises. Il est cependant loisible de faire l’hypothèse que, sur ce point comme sur d’autres, nous en sommes à une situation comparable à celle d’autres pays occidentaux. Je me reporte donc à des études sociologiques récemment publiées pour la France. En 1982, 60% des Français croyaient aux horoscopes et 42% à la télépathie. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ces croyances ne sont pas d’abord répandues dans les milieux peu instruits ; on les trouve surtout dans les milieux cultivés. Par exemple, les instituteurs y adhèrent davantage que les autres, et les jeunes davantage que les personnes âgées, et plus encore dans le monde étudiant [5].
Comment ne pas être déconcerté ? Comment s’orienter vers quelque interprétation plausible ? En remettant en cause, une fois de plus, les idées accoutumées sur la sécularisation. Contrairement à une vue primaire, la propagation de la rationalité scientifique et technique dans la vie sociale ne fait pas disparaître le sacré. Au contraire, elle l’exaspère ; elle le fait proliférer en tout sens. Le sacré est libéré et renforcé par la sécularisation. Il se pourrait d’ailleurs que ce soit une loi générale applicable à tous les phénomènes sociaux : l’affirmation de l’un d’entre eux, loin de supprimer son contraire, le provoque à se développer.
Et puis, ce « retour du religieux » est plutôt, à tout prendre, un retour du sacré.
On aurait tort de voir dans cette distinction une simple querelle de vocabulaire. La religion qui se réclame de la tradition chrétienne n’est pas identifiable au sacré. Évidemment, le sacré est dévouement à un imaginaire et, par conséquent, à un dépassement de l’existence humaine ; sans l’expérience qu’il engendre, aucune religion, fût-elle chrétienne, ne serait possible. En retour, le christianisme et, plus avant, la foi d’Israël ont toujours contesté le sacré par le renvoi aux impératifs du profane, surtout aux exigences éthiques. Consentant au sacré, notre tradition religieuse s’efforce de l’empêcher de se perdre dans le désir et le phantasme. Il suffit, pour s’en convaincre, de se souvenir de l’incessant combat contre [84] les idoles dont l’Ancien Testament nous a gardé témoignage. Si le sacré est, pour la religion chrétienne, l’indispensable ouverture sur le monde du mystère, il ne s’y identifie pourtant pas ; il y est apprivoisé, institué.
Le sacré est maintenant délié de cet apprivoisement, de cette institution. Ne nous étonnons pas qu’il devienne multiforme.
INTERROGATIONS POUR LE CROYANT
Fidèle à un certain détachement propre à l’exercice de la sociologie, je me suis efforcé d’esquisser un diagnostic aussi objectif que possible. Ce diagnostic doit cependant demeurer ouvert : certes, parce qu’il est trop sommaire, mais aussi parce qu’il débouche sur des interrogations qui ne concernent pas seulement le sociologue, mais aussi le croyant et le citoyen.
Commençons par le croyant.
J’ai cru discerner un enchaînement : du retrait de l’Église de ses enracinements de naguère à l’érosion de la pratique et, finalement, au brouillage des valeurs religieuses. L’ancienne emprise de l’Église dans notre société avait fait de celle-ci une société religieuse où la distinction des ordres et des valeurs n’était guère marquée. Cette collusion dissipée, les pratiques religieuses ne pouvaient persister à l’écart, dans une société religieuse parallèle à l’autre. Par voie de conséquence, il était inévitable que les valeurs religieuses vacillent, dénuées de support dans un milieu concret qui leur eut donné fermeté.
Qu’en conclure pour l’avenir de l’Église ? Sinon que celle-ci doit retrouver peu à peu de nouveaux enracinements dans notre société.
Pour y parvenir, est-il suffisant qu’elle se consacre aux œuvres d’assistance ou qu’elle proclame ces droits de l’homme qu’elle a longtemps suspectés ? Sans aucun doute : des valeurs évangéliques sont en cause. Mais l’Église n’a-t-elle pas à se situer au cœur même des débats sociaux ? Elle s’y emploie. Certains messages des évêques ont fait grand bruit. On leur a reproché de s’immiscer dans des questions économiques qui ne relevaient pas de leur compétence : un signe parmi d’autres de la volonté de confiner la religion à la vie privée, ou tout au moins de l’écarter des enjeux des pouvoirs, alors que c’est d’abord sur ce terrain que se posent les questions décisives concernant la justice et la dignité des [85] personnes. La voie tracée par les évêques était la bonne. Mais c’est la communauté elle-même qui doit s’y engager, et par un mouvement plus vaste dans ses manifestations. Cela aussi est de tradition et n’a rien à faire avec je ne sais quelle volonté de domination ecclésiastique. On songe, par exemple, à la magnifique floraison de la pensée sociale et économique dans le catholicisme et le protestantisme français depuis plus d’un siècle ; il faut reprendre cette tradition, la remettre à jour par rapport aux problèmes d’aujourd’hui.
On l’a souvent répété : en son dynamisme profond, notre civilisation a été inspirée par le christianisme. Cette inspiration a revêtu des formes diverses, toutes provisoires. Sommes-nous capables d’inventer une autre de ces formes, en gardant à l’esprit qu’elle sera provisoire elle aussi ? Tout consentement à l’absence de l’Église dans nos débats de société ne mènerait pas seulement à une privatisation de la foi ; elle conduirait à l’ébranlement de la croyance elle-même. Il n’est pas question de revenir à l’ancien monopole de l’Église ; on ne doit pas pour autant dénier au christianisme une présence collective, efficace et parfois gênante.
Il me semble que, là-dessus, Emmanuel Mounier (s’inspirant d’Henri Desroches) a formulé un critère essentiel dans un article qui fit grand bruit en son temps. Mounier voyait la vie de l’Église battre selon deux mouvements : « un mouvement d’insertion dans le temporel où elle demandera aux structures temporelles le maximum pour subsister en elles, et un mouvement de repli du temporel, où elle leur demandera le minimum pour subsister en dehors d’elles. Temps fort et temps faible de l’Incarnation, temps fort et temps faible de la Transcendance [6] ».
Réenracinement indispensable donc, sans lequel l’Église ne serait plus une Église. Il n’est pourtant pas suffisant pour que se retrouve une cohésion des pratiques et des valeurs. Faut-il alors entreprendre une vaste entreprise d’endoctrinement, traduire le Concile en de nouveaux catéchismes, espérant que l’effervescence du sacré soit enfin domestiquée par un corset doctrinal convenablement ajusté ?
[86]
Je me borne à inscrire deux remarques.
L’errance hors des pratiques et des énoncés de doctrine peut avoir une portée bénéfique. Pour être vivante, la foi doit se dépouiller du conformisme de ses pratiques et de ses énoncés. Il se peut que la mise à l’écart d’une pratique qui fut trop coutumière, souvent légaliste, permette un retour sur l’expérience personnelle susceptible d’être réinvesti dans une institution qui en serait rajeunie autrement que par des textes. N’est-il pas vrai que l’expérience religieuse a toujours été un recommencement ? Dans l’Ancien Testament, on assiste à la perpétuelle reconquête de la visée de foi sur des représentations inadéquates, et grâce à la vitalité de l’expérience. Pourquoi relisons-nous la Bible, qui n’a rien d’un système, sinon pour tâcher de reprendre à notre compte ces recommencements, qui sont aussi les nôtres ? Et ce n’est pas vrai que de la Bible. Aux origines de l’Église, le corps à corps avec la gnose (qui incidemment ressemble fort aux doctrines de beaucoup de sectes contemporaines), les tensions suscitées par la devotio moderna à la fin du Moyen Âge, le modernisme du début de ce siècle, pour ne rappeler que quelques exemples : toute l’histoire de l’Église, et donc celle de sa vivante tradition, est faite de crises et de rajeunissements, le plus souvent suscités par une histoire qui interrogeait les pensées et les pratiques apparemment acquises. Pour aujourd’hui encore, réclamons un travail pastoral soucieux, non pas seulement de rectifier, mais d’accueillir recherches et tâtonnements.
Cela paraît nous limiter à la doctrine, au contenu de la croyance. Allons plus loin. En Occident, et avec une rapidité déconcertante depuis trente ans, nous assistons à une révolution des mœurs. Après avoir bouleversé l’industrie, l’organisation du travail et les façons de conduire la guerre, la technique transforme la sexualité, la reproduction humaine. En même temps, les anciennes institutions, la famille, la conjugalité, les valeurs mêmes de la vie privée sont ébranlées. Dans cet immense brassage des relations des personnes avec autrui et avec elle-même, l’éthique chrétienne apparaît dépassée. Des voix ecclésiastiques officielles donnent l’impression à la plupart des hommes et des femmes de n’avoir à proclamer que des stratégies de défense et de refuge où sont confondus la contraception, l’avortement, le divorce, le sacerdoce des femmes et bien d’autres choses encore. Dans toutes ces affirmations abruptement répétées, nos contemporains ne perçoivent guère [87] la jeunesse des valeurs chrétiennes, leur teneur de questionnement parce que ne s’y manifeste pas assez un désir de comprendre, de s’instruire, oserais-je dire, à l’écoute de cette révolution des mœurs. L’éthique chrétienne ne retrouvera sa présence qu’en avouant sa faculté d’attention et, par conséquent, sa capacité d’incertitude.
En somme, si l’Église est une institution vivante, elle doit le montrer au grand jour, aussi bien quant aux projets de société que dans la recherche de styles de vie dont elle ne connaît pas à l’avance le point d’arrivée.
INTERROGATIONS POUR LES CITOYENS
Tout cela, dira-t-on peut-être, concerne les croyants, qui sont libres d’en discuter entre eux. Maintenant que l’Église est devenue une institution parmi d’autres, que nous vivons dans une société pluraliste où les croyances sont l’affaire de chacun, le consensus collectif dépend d’une éthique civique où aucune allégeance religieuse ne doit entrer en ligne de compte. Bien sûr, autrefois l’Église a joué un rôle que l’on a qualifié de suppléance ; à la limite, on s’en explique, non sans le regretter. Mais notre collectivité est parvenue à maturité. Désormais, nous sommes en démocratie où aucune faction ne peut réclamer le droit de parler plus haut que les autres.
Fort bien. Je n’en crois pas moins que le destin de l’Église au Québec intéresse, et au plus haut point, le sort de notre société. L’Église s’est retirée de son ancienne emprise : ne nous reste-t-il que l’idéal d’une société où, les croyances étant enfin renvoyées à l’intimité, ne subsistent plus pour rassembler les citoyens que les complicités des intérêts et la politique ? Maintenant qu’est tombée la fièvre de la Révolution tranquille et que le Québec est entré dans un tranquille sommeil, la question resurgit dans sa nouveauté.
Quand elle se veut démocratique, la Cité est un lieu de débats sur les fins à poursuivre en commun. Suffit-il que ces finalités soient tenues dans le silence des consciences ou qu’elles dépendent du poids des pouvoirs ? Pour qu’il y ait vitalité de la démocratie, ne faut-il pas qu’une société s’examine à distance d’elle-même, qu’elle se considère comme perpétuellement inachevée ? Une société (comme chaque individu d’ailleurs) se juge face à une transcendance : je ne veux pas dire face à Dieu nécessairement, mais face à sa finitude, à ses manques.
[88]
Les Églises ne représentent pas, à elles seules, les visées de transcendance des sociétés. Y arriveraient-elles qu’elles ne seraient que la conformation des préjugés collectifs. Il est indispensable qu’une société refuse de se définir comme une société religieuse, il est non moins nécessaire qu’une société comporte, en son sein, des institutions qui lui rappellent sa finitude et l’inéluctable défi de son perpétuel dépassement.
En définitive, le destin de l’Institution-Église dans la société québécoise actuelle, comme dans la civilisation contemporaine tout entière, n’est pas uniquement le souci du croyant ; ce devrait aussi être celui de tout citoyen, croyant ou non, qui se veut participant d’une société ouverte, c’est-à-dire authentiquement humaine. Mais, pour cela, et à l’inverse, il faut que l’Église elle-même se réenracine profondément en notre sol, qu’elle ne soit pas qu’un simple écho du Vatican, qu’elle recouvre la singularité de sa présence dans les enjeux de ce pays. [7]
Après une phase inévitable et bienfaisante de repli, il serait scandaleux que la communauté chrétienne accepte de vivre dans une situation de ghetto toléré ou dans une paisible coexistence avec les pouvoirs. C’est pourquoi nous devons chercher la jonction entre un renouveau pastoral et missionnaire, qui se poursuit de l’intérieur, et l’affirmation publique des valeurs chrétiennes. Je le répète : on n’appelle pas au dépassement et à la transcendance en ne livrant en pâture aux médias que des querelles sur la contraception ou l’accession des femmes au sacerdoce. On y arriverait davantage en dégageant des valeurs et des tâches susceptibles d’interroger les autres institutions, auxquelles manque si souvent ce souffle prophétique qui bouleverse les imageries traditionnelles de l’avenir. Le poète Malcolm de Chanzal le disait admirablement : « Il n’est de véritable religion que celle qui pousse de l’avant, car Dieu n est pas immobile. »
[1] Paul-André Linteau, René Durocher, Jean-Claude Robert et François Ricard, Histoire du Québec contemporain, II, Montréal, Boréal Express, 1986, pp. 592, 593.
[2] Danièle Hervieu-Léger, Vers un nouveau christianisme?, Paris, Cerf, 1986, p. 19.
[3] Reginald W. Bibby, Fragmented Gods, édition française : La Religion à la carte, trad. de Louis-Bertrand Raymond, Montréal, Fides, 1988.
[4] Nombreuses enquêtes de l’I.F.O.P. en France ; indications dans l’ouvrage cité de Reginald W. Bibby ; enquête du Devoir en 1984, à l'occasion de la visite du Pape (20% des baptisés ne croient pas ou ne savent pas que Jésus-Christ est Dieu...).
[5] Daniel Boy et Guy Michelat, « Croyances aux parasciences : dimensions sociales et culturelles », dans Revue française de sociologie, vol. XXXVII, n° 2, 1986, pp. 175-204.
[6] Emmanuel Mounier, Feu la chrétienté, Paris, Le Seuil, 1950, p. 268.
[7] Les vieilles stratégies centralisatrices de la bureaucratie romaine n’ont pas disparu. Lors du dernier concile, on a insisté sur l’autonomie des Églises, sur la collégialité épiscopale; les textes ont été impuissants à faire de ces déclarations une réalité. Entre autres témoignages, on lira la traduction récente d’un article de David Seeber, directeur de la Herder Korrespondenz : « La grande illusion du catholicisme », dans Esprit, septembre 1988, p. 76 ; de même que les remarques du traducteur, Jean-Louis Schlegel, pp. 77-79.
|

