|
Didier FASSIN
Anthropologue, sociologue et médecin,
Professeur à l’Université Paris 13
et Directeur d’études à l’EHESS, Directeur de l'Iris.
“Le sens de la santé.
Anthropologie des politiques de la vie”.
Un chapitre publié dans l’ouvrage sous la direction de Francine Saillant et Serge Genest, Anthropologie médicale. Ancrages locaux, défis globaux. Chapitre 14, pp. 383-399. Québec : Les Presses de l’Université Laval; Paris : Anthropos, 2005, 467 pp. Collection Sociétés, cultures et santé.
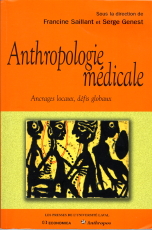
- Introduction
-
- LA SANTÉ, ENTRE RÉALISME ET CONSTRUCTIVISME
- ÉCONOMIE MORALE ET RAISON HUMANITAIRE
- HISTOIRE SOCIALE ET INÉGALITÉ INCORPORÉE
-
- Références
Introduction

L'anthropologie médicale constitue un espace académique et scientifique qui s'est caractérisé, au cours des deux dernières décennies, par un double mouvement, d'une part, de différenciation en de multiples domaines particuliers, de l'ethnomédecine ou de l'ethnopharmacologie aux anthropologies du corps, de la maladie, de la souffrance, et, d'autre part, d'appropriation et de reformulation des grandes questions de l'anthropologie, en rupture avec la propension initiale à construire une spécialité prétendument autonome et, de fait, volontiers médicalisée. Le paysage qu'elle dessine ainsi, en France en particulier, apparaît donc à la fois remarquablement diversifié par ses objets comme par ses terrains et de moins en moins distinct au sein de la discipline anthropologique. Le territoire qui sera décrit ici est celui de l'anthropologie de la santé. Si les problématiques à travers lesquelles il a été construit abordent des dimensions inédites de ce que l'on continue de nommer, par commodité, anthropologie médicale, elles rejoignent ou renouvellent les interrogations que formulent, de façon plus générale, les anthropologues qui traitent des questions politiques et morales. Plutôt qu'un état des lieux de ce champ naissant, on s'efforcera d'en montrer les lignes de force, en s'appuyant sur ses développements français et en traçant des liens avec d'autres lieux. On comprendra ainsi qu'au-delà de la santé, elle participe d'une anthropologie des politiques de la vie.
LA SANTÉ, ENTRE RÉALISME
ET CONSTRUCTIVISME

La représentation la plus commune de la santé en fait une simple donnée de nature, dont Georges Canguilhem (1966) a conceptualisé les limites. Son inscription dans le corps, qui la rend visible à travers la maladie ou, de façon plus discutable, à travers le bien-être, semble la faire aller de soi qu'on lui donne pour substratum matériel des organes ou des gènes. Cette évidence se trouve encore renforcée par le développement de professions et d'institutions qui, par le double jeu de la production de savoirs et de la légitimation de pouvoirs, disposent d'une autorité forte dans la définition de ses limites. Si l'on dit que la tuberculose, le sida ou l'encéphalite spongiforme bovine sont des problèmes de santé, chacun voit à l'œuvre des bactéries, des virus et des prions qui se transmettent, des infections qui se développent et des malades qui souffrent. Si l'on parle dans les mêmes termes de la consommation de drogues ou d'alcool, de la maltraitance infantile ou des désordres post-traumatiques, nul ne remet en cause les effets physiques ou psychiques délétères de la dépendance ou de la violence. La vision de la santé qui s'impose ordinairement, au responsable sanitaire comme au patient, au décideur politique comme au citoyen, est donc fondamentalement une vision naturaliste - plus encore que biomédicale comme on le croit souvent - que les statistiques de morbidité et de mortalité viennent finalement objectiver (Dozon et Fassin 2001). Le nombre de personnes malades ou décédées atteste la vérité du problème de santé contre lequel les pouvoirs publics et souvent la société tout entière doivent lutter.
Mais les choses sont-elles si simples ? Contre l'évidence commune, l'anthropologie politique propose une double grille de lecture. La première est constructiviste ; elle montre comment ce qu'on appelle la santé est également le résultat du travail individuel et collectif des agents à travers des modèles et des images, au prix de conflits et de controverses, en mobilisant des alliances et en développant des stratégies. La seconde est réaliste ; elle analyse comment les faits supposés de nature sont aussi le produit des structures et des agencements, des modes de différenciation et des processus d'inégalité, de l'action publique et des initiatives privées qui ont pour effet de prévenir ou d'accélérer l'usure ou la souffrance. La santé est donc à la fois un construit social, au sens de ce que les agents traduisent dans le langage de la maladie, et une production de la société, au sens de ce que l'ordre du monde inscrit dans les corps. On peut donc, d'un côté, parler de sanitarisation du social et, de l'autre, de politisation de la santé (Fassin 1998). Les deux mouvements opèrent de façon dialectique. Ce point est essentiel. En effet, la littérature des sciences sociales de la santé a souvent adopté, de façon exclusive ou largement prédominante, l'une ou l'autre des deux perspectives : soit, dans la veine de Peter Berger et Thomas Luckman (1966), en décrivant comment se construisent les objets de la santé, tels la maltraitance infantile ou le traumatisme psychique (Hacking 1995, 1999) ; soit, dans la ligne dont Merill Singer et Hans Baer (1995) se font les porte-parole, en insistant sur les conditions socio-économiques de la production de la maladie, pour souligner les disparités et les violences qui se manifestent dans les corps (Farmer 1992, 1999). Dans l'approche défendue ici, les deux processus se mêlent et les deux lectures s'informent.
Prenons le cas du saturnisme infantile en France. Et partons du fait suivant. En 1981, une recension de tous les cas d'intoxication au plomb parmi les enfants français retrouve 10 observations publiées au cours du quart de siècle qui a précédé. Les auteurs de ce travail, pédiatres et toxicologues de Lyon, constatent d'ailleurs que la France, au contraire des États-Unis où cette affection sévit de façon préoccupante, semble épargnée. En 1999, une expertise nationale de l'Institut de la santé et de la recherche médicale (Inserm), s'appuyant sur diverses enquêtes épidémiologiques, fait état d'une population contaminée de 85000 enfants. Et les spécialistes de s'inquiéter de ce que la France connaisse une situation à cet égard bien plus grave que celle des États-Unis. En moins de deux décennies, on est passé de cas exceptionnels à une épidémie dont la presse généraliste se fait régulièrement l'écho et pour laquelle une loi a été votée. Faut-il penser qu'en si peu de temps le plomb se serait disséminé dans le corps des jeunes enfants au point de faire de cette pathologie naguère considérée comme rare une nouvelle priorité de la santé publique ? Deux éléments sont à prendre en compte : la mobilisation des agents pour faire reconnaître le problème et la modification des contours cliniques de la maladie. L'épidémie de saturnisme est donc la conséquence de l'intervention des individus et de la transformation des indicateurs, en somme une affaire d'humains et de non-humains (Latour 1991), à cela près que ce sont toujours des femmes et des hommes qui agissent et interagissent.
Sur le premier front, principalement parisien, une jeune pédiatre reconnaît un cas de saturnisme chez une petite fille d'origine malienne et en fait le signalement au service social, procédure souvent négligée à l'époque ; saisie de ce cas, une assistante sociale décide, fait exceptionnel au regard de l'habitus hospitalier, de se rendre au domicile de la famille pour constater sur place les conditions d'habitat et en revient tellement bouleversée par la dégradation des lieux qu'elle fait appel à son tour aux institutions de protection materno-infantile ; l'une des médecins de ce service, en collaboration avec un toxicologue, un peu plus tard deux généralistes amis travaillant dans deux organisations non gouvernementales, l'une humanitaire, l'autre s'occupant de la santé des immigrés, et à peu près au même moment un spécialiste de santé publique d'un département universitaire - et quelques autres encore - en font, chacun à sa manière, une cause qu'ils ont à cœur de défendre. Le terme n'est pas trop fort, tant les résistances qui leur sont opposées sont grandes : pour les uns, parce que le saturnisme leur semble un phénomène marginal, pour les autres, parce qu'ils entrevoient les conséquences pratiques en matière de relogement et de réhabilitation de l'habitat. Il faudra finalement cinq ans pour que le problème soit reconnu et qu'une enquête nationale soit diligentée, huit encore pour que la législation soit modifiée afin de permettre le dépistage et le suivi des enfants, et surtout de rendre obligatoires les interventions préventives sur les bâtiments.
Sur le second front, remarquablement international, le seuil de plombémie à partir duquel on considère qu'il existe une intoxication passe en quelques années de 250 µg/l à 100 µg/l. Avec le premier chiffre, on dénombrait quelques centaines de cas que la mobilisation des agents avait conduit à découvrir. En se basant sur le second, ce sont des dizaines de milliers d'enfants dont on admet la contamination dans le rapport d'expertise. Entre ces deux valeurs, s'immisce le travail de deux équipes d'épidémiologie, l'une nord-américaine, l'autre australienne, qui ont mis en évidence, dans les années 1980, les effets toxiques du plomb à des niveaux plus faibles sur les capacités d'apprentissage et les performances scolaires. La démonstration n'a pas été simple à établir, car on imagine la multiplicité des facteurs non biologiques qui interfèrent avec les compétences cognitives, s'agissant de milieux défavorisés, afro- ou hispano-américains pour ce qui est des États-Unis. Il a fallu en passer par des enquêtes complexes recourant à des analyses multivariées et par des controverses scientifiques divisant les milieux académiques avant que le nouveau seuil ne soit admis par l'autorité la plus légitime en la matière, les Centers for Disease Control d'Atlanta, référence y compris pour la santé publique européenne.
Dire qu'il y a eu construction sociale du saturnisme infantile, ce n'est donc nullement en contester la réalité clinique ou épidémiologique. C'est rappeler deux choses. Premièrement, que, sans les agents pour faire exister cette réalité, elle serait demeurée ce qu'elle était jusqu'aux années 1980, à savoir une affection considérée comme exceptionnelle ou encore une pathologie enfouie dans le corps des enfants immigrés d'origine africaine. Deuxièmement, que la maladie décrite désormais comme épidémique n'est plus tout à fait la même réalité que celle des cas rares rapportés dans les études cliniques, ces derniers correspondant souvent à des manifestations neurologiques graves accompagnées de coma et de convulsions et liées à des plombémies très élevées, la première n'ayant généralement pas d'expression clinique décelable et se traduisant essentiellement en matière de risque statistique de diminution du quotient intellectuel. Les deux dimensions sont éminemment politiques : d'un côté, on met en exergue le rôle des agents sociaux pour faire reconnaître un problème de santé ; de l'autre, on souligne l'importance des instruments techniques dans l'appréhension des phénomènes sanitaires. Mais à ce stade une question demeure : d'où vient l'intoxication au plomb ? ou encore : comment l'expliquer ? Question posée avec d'autant plus d'insistance qu'en France, 99% des enfants atteints vivent dans des familles africaines. Analyser la production sociale du saturnisme, c'est rendre compte de ce chiffre.
Au début des années 1970, le gouvernement français annonce sa volonté de mettre un terme à l'immigration dite de travail. jusqu'à cette époque, la régulation des flux migratoires s'était faite essentiellement par rapport aux besoins de l'économie et la possession d'un contrat avec un employeur suffisait généralement à l'obtention d'un titre de séjour. La crise du pétrole et les restructurations de l'industrie bouleversent le marché du travail. Les immigrés, surtout lorsqu'ils sont peu qualifiés, deviennent de moins en moins nécessaires, sauf dans quelques secteurs particuliers, comme les travaux publics, l'agriculture, la restauration. Cette nouvelle politique laisse toutefois ouverte l'immigration dite de peuplement, dans le cadre du regroupement familial qui permet au conjoint et aux enfants de rejoindre la personne déjà installée. Au milieu des années 1980, cette procédure subit à son tour d'importantes restrictions, de même que la plupart des autres voies d'entrée légale sur le territoire français. Dans le même temps, les titres de séjour commencent à être moins systématiquement renouvelés pour les chômeurs, les travailleurs de certains secteurs protégés, les étudiants qui échouent à leurs examens. Dorénavant, par le double effet des arrivées illégales et des renouvellements interrompus, les étrangers en situation irrégulière voient leurs effectifs s'accroître. Parmi eux, les Africains, originaires surtout d'Afrique de l'Ouest, sont alors les plus nombreux ou tout au moins ceux pour lesquels les mécanismes d'invisibilisation sont les moins efficaces.
Or, au cours de la même période, les mêmes causes économiques conduisent, pour l'ensemble de la population résidant en France, à un accroissement du nombre des demandeurs d'emploi et, plus généralement, à une diminution de la mobilité sociale et spatiale. Dans un contexte de relative pénurie de logements, l'habitat à loyer modéré devient alors de moins en moins accessible aux étrangers, en raison notamment de politiques occultes de quota. Les immigrés les plus nouvellement venus doivent désormais se contenter des appartements privés les plus dévalorisés sur le marché, les plus vétustes et les plus insalubres, et ce, d'autant plus qu'ils sont, pour certains, en situation irrégulière, autrement dit tenus d'accepter ce qu'on leur propose. C'est précisément dans cet habitat que l'on trouve encore les anciennes peintures au plomb, interdites depuis 1948. Et c'est là que les enfants d'origine africaine se contaminent.
L'histoire des politiques françaises de l'immigration et de l'habitat, telle qu'elle vient d'être brièvement évoquée, offre une interprétation consistante des raisons de l'incidence élevée du saturnisme parmi les enfants vivant dans les familles immigrées pauvres. Elle révèle comment une contamination liée à l'environnement local est le produit des inégalités sociales et particulièrement de celles qui touchent les étrangers les plus précaires économiquement et juridiquement. Pourtant, telle n'est pas l'explication qui a prévalu dans les années 1980 en France. Pour rendre compte de l'intoxication préférentielle dans les foyers africains, on a supposé l'existence de pratiques culturelles particulières à ces familles. Après avoir évoqué la responsabilité des encres des marabouts musulmans et des produits de maquillage des femmes, on s'est finalement rabattu sur une interprétation qui, tout en reconnaissant le rôle des peintures anciennes, mettait en cause une appétence supposée pour les matières minérales, la géophagie, que les mères ouest-africaines auraient transmises à leur progéniture. Contre cette lecture culturaliste, les activistes du saturnisme ont dû se mobiliser pour faire valoir leur analyse matérialiste qui ne s'est que progressivement imposée au cours des années 1990. C'est dire que la construction sociale du saturnisme (par les agents qui, au terme de luttes, en font exister non seulement la réalité, mais aussi l'étiologie) et sa production par la société (en tant que résultat de mécanismes économiques et de choix politiques) doivent être pensées ensemble.
Exemplaire, le cas de l'intoxication au plomb n'est évidemment pas unique. On pourrait, à propos du délire de la faim au Brésil (Scheper-Hughes 1992), du stress post-traumatique aux États-Unis (Young 1995) ou de la psychopathologie africaine (McCulloch 1995), montrer cette double mécanique de construction et de production, de modèles cognitifs et de logiques politiques que la société tend pourtant à effacer, en faisant des catégories nosographiques un simple reflet de la nature des choses et en éludant les processus sociaux qui les inscrivent dans les corps. Mais, au-delà de cette lecture constructiviste et réaliste des phénomènes de santé, dont les constats font écho à nombre de travaux de l'anthropologie médicale dite critique, l'épidémie de saturnisme a peut-être quelque chose de plus à nous apprendre sur les fondements anthropologiques des sociétés contemporaines.
Lorsque l'assistante sociale découvre les familles africaines vivant dans des taudis au cœur de Paris, le saturnisme lui apparaît soudain presque accessoire au regard de l'état de délabrement de leur logement dont les planchers s'affaissent et les escaliers branlent. Pourtant, c'est bien en oeuvrant contre cette affection et en plaidant pour la santé des enfants malades, qu'elle-même et quelques autres vont parvenir à imposer aux édiles parisiens de faire quelque chose pour ces familles. Et lorsqu'un peu plus tard un membre d'une grande organisation humanitaire, devenue entre-temps fonctionnaire du ministère de la Santé chargée des populations défavorisées, décide de travailler à la présentation d'un texte législatif, elle met à son tour en avant l'icône pathétique des enfants victimes d'intoxication au plomb. Les deux ministres qu'elle parviendra successivement à convaincre de l'importance de sa cause sont du reste deux anciens fondateurs de Médecins sans frontières déjà acquis à cette logique. Autrement dit, la réaction politique locale et nationale que l'indignité des conditions d'habitat des étrangers n'avait pu susciter, c'est l'invocation de la détérioration des corps qui a permis de l'obtenir. La légitimité de la maladie a eu raison de l'illégitimité de la population. Ce ressort moral qui va chercher dans la vie physique ce que l'existence sociale ne suffit pas à justifier, en l'occurrence le relogement des familles immigrées, opère aujourd'hui dans de nombreux registres de l'action publique.
ÉCONOMIE MORALE
ET RAISON HUMANITAIRE

Dans un texte souvent cité, Michel Foucault (1976) a proposé une théorie du biopouvoir qui va permettre d'éclairer le propos. Pendant des siècles, écrit-il, la politique s'est organisée autour du pouvoir souverain, qui est un « droit de mort » sur les sujets. À partir du XVIle siècle, par une inversion progressive des principes et des valeurs du gouvernement, c'est la gestion des vivants qui devient l'objet central de la politique, sous la forme désormais d'un « pouvoir sur la vie ». Ce biopouvoir concerne à la fois la discipline des corps, telle qu'elle s'exerce à travers une série d'institutions, de l'école à l'armée et à la prison en passant par l'hôpital, et le contrôle des populations, tel qu'il se manifeste dans l'invention des outils de la démographie, de la sociologie, de la psychologie, et dans la régulation des naissances, des maladies, des flux migratoires. En première analyse, la santé publique semble donc parfaitement s'inscrire dans ce cadre, puisque, d'une part, elle prétend imposer des normes individuelles de conduites saines et, d'autre part, elle organise la connaissance épidémiologique et l'administration sanitaire des collectivités humaines. L'exemple du saturnisme invite pourtant à une autre lecture.
Certes, il s'est bien agi d'intervenir sur des corps et dans des populations pour dénombrer et prévenir les cas d'intoxication au plomb parmi les enfants. Mais 20 airs plus tard, alors que l'on dispose de tous les éléments de description, d'analyse et de mesure, alors que des associations se sont mobilisées et qu'une loi a été votée, moins d'un pour cent des familles dont on estime qu'elles sont contaminées ont bénéficié d'un relogement ou d'une réhabilitation de leur habitat. Biopouvoir bien fragile, donc, au regard des enjeux à la fois économiques liés au coût de ces mesures et politiques en rapport avec la montée de la xénophobie. Et pourtant, un consensus s'était établi autour des victimes du saturnisme de manière suffisamment large pour que deux ministres appartenant à deux majorités parlementaires opposées qui se sont succédé au gouvernement en défendent tour à tour l'inscription dans la législation. Plutôt que de parler de pouvoir sur la vie, qui supposerait une action publique efficace, il faut donc parler de pouvoir de la vie, en entendant sous cette expression la reconnaissance que la société accorde à la question du corps souffrant ou malade. On a donc moins affaire à un biopouvoir qu'à une biolégitimité (Fassin 2000). À travers ce mot, il s'agit d'énoncer un ordre des valeurs - et non une hiérarchie des pouvoirs – qui existe dans le monde contemporain et dont les traductions concrètes sont innombrables, tant dans les espaces locaux de la santé publique que sur les scènes mondiales de l'action humanitaire. Cet ordre, deux philosophes peuvent aider à en tracer la généalogie et en appréhender la signification. D'une part, Hannah Arendt (1967) le fait naître, dans le mouvement des Lumières, sous la Révolution française qui a fait de la vie « le bien suprême » et de la « pitié » le ressort premier de l'action ; selon elle, s'impose alors une vérité du corps qui relève de la nécessité et du besoin plutôt que de la liberté et de la dignité et qui annonce la suprématie des droits de l'homme sur les droits du citoyen. D'autre part, Giorgio Agamben (1997) distingue, à partir d'une relecture d'Aristote, les deux sens que recouvrent les mots grecs signifiant la vie, zoé, la vie nue, l'existence physique, « simple fait de vivre », et bios, la vie qualifiée, l'existence politique, « façon de vivre propre à un groupe » ; cette tension entre les deux formes de vie, et plus particulièrement la manière dont la vie biologique sert en permanence à justifier, voire à fonder la vie en société, est ce qui caractérise, pour lui, les politiques contemporaines.
L'exemple de la gestion de l'immigration éclairera cette discussion théorique. À la suite des grandes mutations économiques et sociales qui ont induit, à partir des années 1970, des politiques de plus en plus restrictives en matière d'entrée et de séjour des étrangers, l'ensemble des voies d'accès légal au territoire français s'est progressivement refermé. Dans le même temps, une mobilisation partisane s'est opérée, d'abord avec le Parti communiste puis avec le Front national, autour de ce qui est alors devenu « la question immigrée », autrement dit une manière de construire la présence étrangère comme problématique par rapport à l'emploi, à l'insécurité et même au sida. Cette double évolution, politique et idéologique, a eu pour effet de générer des représentations suspicieuses à l'encontre de l'autre et de justifier des pratiques de plus en plus inhospitalières à son égard. Avec l'édification de l'espace dit de Schengen au cours des années 1990, la suspicion et l'inhospitalité se sont étendues à l'Union européenne au détriment des « extra-communautaires », c'est-à-dire, pour l'essentiel, des ressortissants de pays du tiers-monde. Dans ce contexte, deux phénomènes remarquables se sont produits.
Premier phénomène : l'asile politique a connu une perte de légitimité considérable. Alors qu'au début des années 1980 il bénéficiait encore d'un crédit symbolique qui se traduisait par un niveau élevé d'avis favorables donnés aux demandeurs d'asile (environ 80% étaient reconnus comme réfugiés), il a fait l'objet d'un processus de disqualification croissant au cours de la décennie suivante (aboutissant à une proportion de reconnaissance de 12% par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui s'élève à 18% après intervention de la Commission des recours à laquelle les déboutés peuvent s'adresser). En 10 ans, le nombre de réfugiés politiques a été divisé par six, atteignant le chiffre étonnamment faible de 2000 reconnaissances nouvelles par an (en ne comptant pas les enfants qui, lorsqu'ils atteignent la majorité, bénéficient du même statut que leurs parents). Parallèlement, une série de mesures supposées dissuasives à l'encontre des éventuels candidats futurs a eu pour effet de précariser et d'affaiblir un peu plus la condition de réfugié : en 1989, perte des aides au logement qui les oriente vers les dispositifs d'urgence et, en 1991, interdiction de travailler qui les rend dépendants de la charité publique. Loin des déclarations généreuses qui avaient entouré la signature de la Convention de Genève en 1951, la France et l'Europe considèrent de plus en plus les demandeurs d'asile comme des étrangers indésirables dont la plupart sont du reste, compte tenu du taux très faible d'accords, destinés à devenir des clandestins.
Second phénomène : la raison humanitaire s'est désormais imposée comme un nouveau droit. Elle concerne essentiellement les étrangers malades, pour autant qu'ils puissent faire valoir que leur affection est suffisamment grave et qu'ils ne sont pas en mesure d'être correctement soignés dans leur pays (deux critères dont l'appréciation est, on le devine, éminemment subjective). Le nouveau dispositif s'est mis en place sous la double pression, d'une part, de l'accroissement des étrangers malades du sida dans une période où les antirétroviraux n'étaient pas disponibles dans le tiers-monde et, d'autre part, de la mobilisation des associations de défense du droit à la santé des immigrés regroupées dans un collectif. L'institutionnalisation de ce droit s'est produite en trois temps. Au début des années 1990, les préfets ont commencé à user de façon de plus en plus fréquente de leur pouvoir discrétionnaire de régularisation des étrangers sans titre de séjour pour des dossiers de malades. Peu après, une législation sur l'immigration qui avait pour objectif général de rendre plus difficile l'accès au territoire français a inclus une clause spéciale indiquant que les malades ne pouvaient plus être reconduits à la frontière et devenaient par conséquent non régularisables, non expulsables. En 1997, une nouvelle loi fit un pas de plus en instituant le droit au séjour et au travail pour les malades après expertise démontrant l'adéquation de leur situation médicale aux deux critères de gravité de l'affection et d'inaccessibilité des traitements. Au cours de la décennie, le nombre des régularisations effectuées au titre de ce que l'on a longtemps appelé, dans l'administration, la « raison humanitaire », a ainsi été multiplié par sept, concernant désormais 2000 personnes chaque année. De toutes les voies existantes pour l'obtention d'un statut légal, c'est celle qui a, et de loin, progressé le plus vite, dans une période où les autres sources de reconnaissance se tarissaient.
Perte de légitimité de l'asile politique, d'un côté, regain de légitimité du corps souffrant, de l'autre. Deux manières de définir une politique des vivants. On est d'autant plus fondé à établir ce parallèle entre les deux phénomènes non seulement qu'ils se développent au cours de la même période, mais qu'ils opèrent de manière interactive. Ainsi, certains déboutés de l'asile tentent de faire valoir une pathologie, souvent encouragés en cela par des avocats, des associations ou même des agents préfectoraux bien intentionnés. C'est donc à un véritable déplacement de légitimité que l'on a affaire : des droits du citoyen du monde (menacé dans son pays) aux droits de l'être humain (éprouvé par la maladie), si l'on pense dans les catégories d'Hannah Arendt ; de la vie politique (bios) à la vie biologique (zoé), si l'on s'exprime comme Giorgio Agamben. Aujourd'hui, la société française est moins encline à reconnaître l'existence mise en danger de la victime d'un régime autoritaire ou de violences guerrières et plus sensible à la maladie ou à la souffrance de la personne atteinte d'une affection grave. Cette forme de reconnaissance est aussi souvent celle qui est à l'œuvre, sur le plan international, dans la gestion humanitaire des déplacés et des réfugiés (Agier 2002). De façon plus anecdotique, mais non moins significative, on sait que c'est l'état de santé qui a été invoqué pour éviter au général Pinochet un procès en Espagne pour crime contre l'humanité et pour justifier la mise en liberté du préfet Papon emprisonné sous ce même chef d'accusation ; dans les deux cas, le terme « humanitaire » a été employé par les avocats défenseurs des criminels.
Parler d'économie morale pour traiter des politiques des vivants, c'est donc considérer les valeurs qui sous-tendent les choix faits par les sociétés contemporaines sur les questions qui mettent en jeu l'existence physique, mais aussi sociale des individus. Elle offre un contrepoint nécessaire à l'économie politique dont l'analyse des rapports de production éclaire sous un autre angle le sens des décisions prises en matière de vies humaines. Quand il s'agit des immigrés, l'économie politique permet de comprendre comment leur force de travail de centrale qu'elle était dans le processus de modernisation européenne de l'après-guerre est devenue marginale sous l'effet des restructurations économiques des trois dernières décennies ; cependant que l'économie morale donne à lire cette inversion qui s'est produite parallèlement lorsque leur corps valide est devenu illégitime et leur corps souffrant a fondé une nouvelle reconnaissance, lorsque leur existence n'a plus été justifiée par leur contribution à la richesse collective, mais par l'institution d'un protocole compassionnel. Le malade auquel on accorde un titre de séjour simplement parce qu'il est malade acquiert ce qu'Adriana Petryna (2002), qui a travaillé sur les rescapés de Tchernobyl, appelle une « citoyenneté biologique » et découvre une forme inédite et radicale de ce qu'à propos du programme du génome humain Paul Rabinow (1996) qualifie de « biosocialité ». La menace qui pèse sur sa vie physique devient sa raison politique de vivre.
L'opposition tranchée entre les deux formes de vie ne rend pourtant pas totalement compte de la complexité des logiques à l'oeuvre. En fait, mieux vaudrait parler ici de configurations et de tensions, mettant en œuvre à travers les enjeux de valeurs des jeux d'acteurs, autrement dit faisant place aux subjectivités et aux stratégies dans la confrontation aux normes et aux pouvoirs. Lorsque le demandeur d'asile débouté reconforme sa sollicitation d'un titre de séjour en invoquant une pathologie, voire les troubles psychologiques liés aux circonstances qui ont présidé à son exil, lorsqu'il construit donc sa justification non plus en tant que militant pourchassé ou victime d'un ordre violent mais en tant qu'être souffrant ou victime d'un traumatisme psychique, on peut raisonnablement penser que cette mutation de la représentation de soi qu'il donne aux autres et à lui-même n'est pas sans effet sinon sur son statut de sujet psychologique, ce que l'anthropologie n'est guère à même de saisir, du moins sur son statut de sujet politique, appelant la compassion (pour sa condition clinique) plutôt que revendiquant un droit (à l'asile politique). Pour autant, les enquêtes montrent que les individus ne sont pas des êtres passifs dans ce processus, qu'ils déploient des tactiques et parfois des résistances et, la fin justifiant les moyens, reconstruisent, une fois le précieux titre de séjour obtenu, une existence sociale en dehors de la clandestinité et parfois même de la précarité. En d'autres termes, si leur reconnaissance à travers la vie biologique a été un passage obligé de leur trajectoire, ils la prolongent dans le registre de la vie politique et tout simplement comme acteurs dans la cité. Ils montrent ainsi que les vies concrètes échappent en partie à la normalisation.
HISTOIRE SOCIALE
ET INÉGALITÉ INCORPORÉE

Toutefois la vie ne se résume pas à cette seule distinction entre un phénomène biologique et une existence politique. Si ce qui fait l'homme, c'est le langage, et si le langage est aussi ce qui résiste le plus au déchiffrement du sens (Wittgenstein 1961), alors la vie est aussi la mémoire que l'on en a et le récit que l'on en fait. Les politiques de la vie ne sont donc pas seulement des politiques des vivants, elles sont aussi des politiques du vécu. Mémoire et récit procèdent de deux logiques évidemment distinctes qui ont cependant en commun d'inscrire un sens de ce qui a été vécu à la fois dans des corps et dans des mots. L'un et l'autre sont à la fois individuels, dans l'expérience biographique singulière, et collectifs, dans l'expérience historique partagée. De ce point de vue, la vie de l'immigré ne se manifeste pas seulement dans les phrases qu'il prononce sur son itinéraire personnel, elle l'est aussi dans les traces qui affleurent d'un passé où puisent ses racines et dans les signes d'un présent qu'il construit avec la société où il est désormais.
On qualifiera d'incorporation la façon dont les structures et les normes de la société, les épreuves et les marques du temps s'inscrivent dans les corps. Dans le domaine des sciences sociales, Marcel Mauss (1980), analysant les techniques du corps, et, plus près de nous, Pierre Bourdieu (1979), proposant sa théorie de l'habitus, ont donné des modèles permettant de rendre compte de l'empreinte du social dans les manières de faire et d'être. Pour penser cette empreinte, deux concepts éclairent de façon complémentaire le rapport à la société et au temps. On peut parler, d'une part, de condition sociale pour désigner la façon dont les faits structurels s'impriment dans les corps et, d'autre part, d'expérience historique pour qualifier la façon dont ils sont vécus, interprétés et racontés. La première correspond plutôt à la dimension objective de l'incorporation, la seconde à sa dimension intersubjective. Toutes deux sont simultanément individuelles et collectives. Sans qu'elle recoure nécessairement à ces catégories, l'anthropologie médicale a souvent eu tendance à privilégier implicitement l'une ou l'autre. Pour les approches dites critiques, la question des violences structurelles prévaut, mais souvent au détriment du sens que les faits ont pour les agents (Kim et al. 2000 ; Scheper-Hughes 2002). Pour les lectures phénoménologiques, le récit traduit l'expérience mais laisse échapper la matérialité des existences (Kleinman 1988 ; Good 1994). Il importe de les penser ensemble, notamment dans une perspective de compréhension des mécanismes des inégalités.
L'épidémie de sida en Afrique du Sud est à cet égard tragiquement exemplaire. Telle qu'elle se construit et s'énonce, la trame narrative de l'épidémie mêle plusieurs lignes de récit. La première est épidémiologique. En une décennie, le taux de séroprévalence est passé de moins de 1 à plus de 25% de la population adulte et le sida est devenu la première cause de mortalité des hommes et des femmes entre 15 et 49 ans. Les projections démographiques sont plus inquiétantes encore en montrant qu'entre 1990 et 2010, l'espérance de vie pourrait baisser de 20 ans. La seconde est historique. Elle met en relation deux séries d'événements, la fin du régime honni de l'apartheid et la progression inexorable du sida, comme si la deuxième découlait au moins partiellement de la première, ce que certains suggèrent, ou comme si l'une et l'autre participait de la même affliction éternelle du continent africain. La troisième est politique. Plusieurs controverses se sont succédé au cours des dernières années autour notamment de l'étiologie virale du sida et de la toxicité des antirétroviraux, divisant l'alliance tripartite au pouvoir, opposant le premier gouvernement démocratique à ses anciens alliés d'hier dans la société civile, faisant de l'épidémie la menace la plus grave pour l'unité nationale à peine ébauchée. La quatrième est biographique. Les récits de vie que recueillent chercheurs et journalistes, les fragments d'histoire que l'on raconte dans les associations ou lors des enterrements, les enregistrements et les souvenirs laissés dans des memory boxes comme seuls legs à ses enfants et à ses proches, autant de formes par lesquels on s'efforce de faire exister ce qui a été, est encore, et bientôt ne sera plus. Mais comment rendre compte de cette trame sans en dénouer chacun des fils ? Pour conserver à la matière narrative son épaisseur et sa vérité, on peut l'appréhender en tant qu'elle dit une condition et une expérience.
La condition sociale du sida lie les récits épidémiologique et historique, tout en venant nourrir les deux autres. Pour interpréter cette progression inédite de l'infection, il faut en effet la saisir à la lumière de l'histoire qui est aussi une histoire de l'inégalité la plus profonde, celle sans issue qui trouve sa justification dans des différences de nature humaine pour justifier à son tour les solutions les plus inhumaines. L'apartheid, qui est devenu la biopolitique officielle de l'Afrique du Sud à partir de 1948, prolonge en les radicalisant des politiques de colonisation, de domination, d'exploitation et de ségrégation dont la dimension raciale et raciste a toujours été présente. La rapidité de l'évolution du sida et les disparités de sa distribution résultent de phénomènes complexes où se mêlent inégalités, violences et migrations. Chacun de ces facteurs est un produit de l'héritage du régime antérieur et s'exacerbe paradoxalement au moment de sa disparition : les inégalités socio-économiques et socio-raciales devenues bien plus apparentes avec la fin de la division officielle de la société suivant la ligne de la couleur ; les violences ordinaires et sexuelles induites par un dispositif de terreur et d'exclusion mais libérées ou rendues visibles par la levée brutale des dispositifs de contrainte extrême ; les déplacements de populations directement provoqués par les guerres menées par le pouvoir précédent ou accélérés par la liberté de circuler et la levée des sanctions internationales après 1994. Les niveaux de contamination particulièrement élevés parmi les jeunes hommes et femmes des townships, des cités minières et des anciens homelands attestent la dynamique de cette incorporation de l'ordre social à travers l'extension du sida. Ainsi, bien plus que dans les spécificités comportementales ou culturelles hâtivement qualifiées de « promiscuité » par lesquelles on a voulu rendre compte de l'épidémiologie de l'infection, c'est dans la manière dont chaque histoire individuelle est marquée par l'histoire collective, dont les rapports entre les individus, entre les hommes et les femmes, entre les citoyens et le pouvoir conservent les traces de ce passé récent qu'il faut chercher l'interprétation des faits et, par conséquent, les pistes pour en corriger le cours.
L'expérience historique du sida établit une correspondance entre les récits politique et biographique, mais sa dureté résulte du choc des deux autres. Plutôt que de parler de déni de la maladie, comme on le fait aussi bien à propos des choix du gouvernement que des attitudes de la population, il faudrait analyser comment cette conjonction entre la fin de l'apartheid et le début de l'épidémie apparaît à beaucoup comme intolérable et impensable. La prolifération des récits de contestation des vérités savantes ou officielles relève de cette logique d'incrédulité ou d'incompréhension. Mais là encore, la présence du passé saurait d'autant moins être sous-estimée que les événements les plus douloureux sont aussi les plus récents. Si les premières mesures de ségrégation raciale ont été prises au nom de la santé publique, lors de la peste de 1900 puis de la grippe de 1917, si la tuberculose est à la fois le produit de l'exploitation de la main-d'œuvre dans les mines et la raison invoquée pour renouveler la force de travail, le sida lui-même a donné lieu, sous le régime précédent, de la part de la médecine, à des discours et des pratiques discriminatoires et stigmatisantes à l'égard des populations noires. Suspicion à l'égard de la science biomédicale et souvenirs des violences commises au nom de la raison sanitaire, constructions imaginaires de complots et productions avérées de projets génocidaires, l'héritage historique mêle ainsi les niveaux de réalité aussi bien dans les déclarations du président sur le virus ou les antirétroviraux que dans les propos recueillis sur les terrains d'enquête et faisant état d'une volonté des pouvoirs publics actuels de se débarrasser d'une population inutile de pauvres et de malades. Pour ceux qui les tiennent, ces récits disent une vérité plus profonde encore que celle des chiffres de l'infection et des messages de prévention.
Le corps, en tant qu'il matérialise en chacun de nous l'empreinte de la société et le travail du temps, porte ainsi témoignage, à travers la maladie comme donnée physique et matérielle mais aussi comme récit individuel et collectif À cet égard, l'anthropologie de la violence, telle qu'elle s'est développée dans des perspectives diverses en Colombie (Taussig 1987), en Irlande (Feldman 1991), en Inde (Das 1995) ou au Sri Lanka (Daniel 1996), fait assurément écho aux préoccupations à la fois épistémologiques et éthiques de toute anthropologie qui s'efforce d'appréhender la vie comme fait objectif et production subjective.
Une anthropologie des politiques de la vie excède ainsi de beaucoup l'horizon théorique et empirique de l'anthropologie médicale classique. Comme je l'ai montré en m'y référant à maintes reprises, elle rejoint en de nombreux points ce qu'outre-Atlantique on appelle souvent l'anthropologie médicale critique, dont elle partage un certain regard sur l'autorité des savoirs et les usages du pouvoir, sur les violences structurelles et les inégalités sociales. Peut-être se singularise-t-elle cependant par trois ordres d'inflexion. Premièrement, si le corps, la maladie, la santé lui fournissent une matière à penser, elle s'attache à en analyser les modes de construction et de production et, ainsi, à analyser la manière dont ils éclairent la compréhension des mondes sociaux. Deuxièmement, à la recherche de la signification de la place croissante occupée par ces problèmes dans les sociétés contemporaines, elle développe une critique des nouvelles formes de légitimité sanitaire ou humanitaire qui en découlent et semblent ainsi s'imposer presque naturellement aux dépens d'autres configurations possibles. Troisièmement, attentive à la fois aux conditions objectives et aux expériences subjectives de mise à l'épreuve des existences, elle s'efforce de mettre en tension la lecture des faits par l'anthropologue et la vision qu'en ont celles et ceux qui les vivent, afin d'éviter les analyses en surplomb ou, à l'inverse, l'absence de distance. Inflexions qu'il faut toutefois d'autant moins durcir qu'elles s'inscrivent bien sûr de façon variable par rapport aux différents auteurs et à leurs oeuvres. L'étude des politiques de la vie ouvre des espaces propices au dialogue des anthropologues non seulement entre eux, tel qu'on l'a engagé ici, mais aussi avec les hommes et les femmes dont ils disent les histoires.
RÉFÉRENCES

AGAMBEN G., 1997 [19951, Homo sacer Le pouvoir souverain et la vie nue. Paris, Seuil.
AGIER M., 2002, Au bord du monde, les réfugiés. Paris, Flammarion.
ARENDT H., 1967 [1963], Essai sur la révolution. Paris, Gallimard.
AUGE M. et C. HERZLICH, 1984, Le sens du mal. Anthropologie, histoire, sociologie de la maladie. Paris, Éditions des archives contemporaines.
BERGER P. et T. LUCKMAN, 1966, The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York, Anchor Books.
BOURDIEU P., 1979, La distinction. Critique sociale du jugement. Paris, Minuit.
BROSSAT A., 2003, La démocratie immunitaire. Paris, La Dispute.
CANGUILHEM G., 1966, Le normal et le pathologique. Paris, Presses universitaires de France.
DANIEL V., 1996, Charred lullabies. Chapters in an Anthropology of Violence. Princeton, Princeton University Press.
DAS V., 1995, Gritical Events. An Anthropological Perspective on Contemporary India. Oxford, Oxford University Press.
DOZON J. P. et D. FASSIN (dir.), 2001, Critique de la santé publique. Une approche anthropologique. Paris, Balland.
FARMER P., 1992, AIDS and Accusation. Haiti and the Geography of Blame. Berkeley, University of California Press.
1999, Infections and Inequalities. The Modern Plagues. Berkeley, University of California Press.
FASSIN D., 1998, « Politique des corps et gouvernement des villes » : 7-46, dans D. Fassin (dir.), Les figures urbaines de la santé publique. Enquête sur des expériences locales. Paris, La Découverte.
2000, « Entre politiques de la vie et politiques du vivant. Pour une anthropologie de la santé », dans Anthropologie et Sociétés, 24, 1 : 95-116.
FELDMAN A., 1991, Formations of Violence. The Narrative of The Body and Political Terror in Northern Ireland. Chicago, University of Chicago Press.
FOUCAULT M., 1976, La volonté de savoir Histoire de la sexualité. Tome 1, Paris, Gallimard
GOOD B., 1994, Medicine, Rationality and Experience. An Anthropological Perspective. Cambridge, Cambridge University Press.
HACKING I., 1995, Rewriting The Soul. Multiple Personality and The Sciences of Memory. Princeton, Princeton University Press.
1999, The Social Construction of Mat ? Cambridge, Harvard University Press.
JAFFRE Y. et J. P. OLIVIER DE SARDAN, 2003, Une médecine inhospitalière. Les difficiles relations entre soignants et soignés dans cinq capitales d'Afrique de l'Ouest. Paris, Karthala.
KIM J. Y., J. MILLEN, A. IRWIN et J. GERSHMAN (dir.), 2000, Dying For Growth. Global Inequality and The Health of The Poor. Monroe, Common Courage Press.
KLEINMAN A., 1988, The Illness Narratives. Suffering, Healing and The Human Condition. Basic Books.
LANZARINI C., 2000, Survivre dans le monde sous-prolétaire. Paris, Presses universitaires de France.
LATOUR B., 199 1, Nous n'avons jamais été modernes. Essais d'anthropologie symétrique. Paris, La Découverte.
LEMARCIS F., 2004, « L'empire de la violence. Un récit de vie aux marges d'un township » : 235-272, dans D. Fassin (clin), Afflictions. L'Afrique du Sud, de l'apartheid au sida. Paris, Karthala.
LOCK M., 2002, Twice Dead. Organ Transplants and The Reinvention of Death. Berkeley, University of California Press.
MAUSS M., 1980 [1934], « Les techniques du corps » : 363-386, dans Sociologie et anthropologie. Paris, Presses universitaires de France. [Texte disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
McCULLOCH J., 1995, Colonial Psychiatry and the African Mind. Cambridge, Cambridge University Press.
MEMMI D., 2003, Faire vivre et laisser mourir Le gouvernement contemporain de la naissance et de la mort. Paris, La Découverte.
PETRINA A., 2002, Life Exposed. Biological Cilizens After Chernobyl. Princeton, Princeton University Press.
RABINOW P., 1996, Essays on The Anthropology of Reason. Princeton, Princeton University Press.
1999, French DNA. Trouble in Purgatory. Chicago, University of Chicago Press.
RAPP R., 2000, Testing Women, Testing the Fetus. The Social Impact of Amniocentesis in America. New York, Routledge.
SCHEPER-HUGHES N., 1992, Death Without Weeping. The Violence of Everyday Life in Brazil. Berkeley, University of California Press.
2002, « Bodies for sale - Whole or in Part » : 1-8, dans N. Scheper-Hughes et L. Wacquant (dir.), Commodifying Bodies. Londres, Sage Publications.
SINGER M. et H. BAER, 1995, Critical Medical Anthropology. Amityville NY, Baywood.
TAUSSIG M., 1987, Shamanism, Colonialism, and the Wild Man. A Study in Terror and Healing. Chicago, University of Chicago Press.
VIDAL L., 1996, Le silence et le sens. Essai d'anthropologie du sida en Afrique. Paris, Anthropos.
WAHNICH S., 2003, La liberté ou la mort. Essai sur la terreur et le terrorisme. Paris, La Fabrique.
WITTGENSTEIN L., 1961 [1945], Investigations philosophiques. Paris, Gallimard.
YOUNG A., 1995, The Harmony of Illusion. Inventing Post-Traumatic Stress Disorder. Princeton, Princeton University Press.
|

