Mona-Josée Gagnon
sociologue-historienne, Université de Montréal
“L'organisation du travail et les syndicats :
reprendre l'initiative”.
Un article publié dans Travailler au Québec. Actes du Colloque annuel de l'ACSALF, 1980, pp. 61-69. Montréal : Les Éditions coopératives Albert Saint-Martin, 1981, 427 pp. Textes publiés sous la direction de Colette Bernier, Roch Bibeau, Jacques Dofny et Pierre Doray.
- Table des matières
-
- Introduction
-
- Autour d'un concept
- Pratiques syndicales
- Des contradictions aux stratégies
-
Introduction

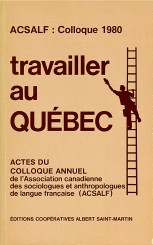 De plus en plus de colloques et conférences sont convoqués, dans les milieux intéressés aux relations de travail, sur l'organisation du travail ; loin de clarifier cette notion cependant, tous ces discours semblent contribuer à l'obscurcir. Le mouvement syndical paraît tiraillé entre deux perceptions. À certains moments on ramènera à l'organisation du travail absolument tout ce qui se passe a partir de et entre les quatre murs de l'entreprise : la technologie mais aussi les horaires de travail, la division du travail mais aussi les grilles salariales, toutes ces réalités entraînant pêle-mêle sur leur passage cogestion, santé au travail et discrimination à l'endroit des femmes, le négociable et le rarement négocié. A d'autres moments, on associera plutôt ce concept fourre-tout à l'intérêt très particulier que lui porte le patronat et qui fait référence à tous les raffinements et grossièretés de l'organisation scientifique du travail, de la socio-technique et des divers programmes de qualité de vie au travail. Quelque peu empêtré dans ces définitions, le mouvement syndical parle peu d'organisation du travail, alors qu'il s'agit d'un sujet de dissertation préféré du patronat. Cette confusion, ces malentendus, recouvrent en fait des hésitations et des interrogations du côté ouvrier ; en matière d'organisation du travail, les syndicats accusent un certain retard dans l'articulation de leurs positions et plus encore dans la mise à jour de leurs pratiques. Retard explicable bien sûr, mais qui deviendra de plus en plus handicapant, à mesure que le patronat affûtera de plus en plus, de son côté et isolément, ses outils. De plus en plus de colloques et conférences sont convoqués, dans les milieux intéressés aux relations de travail, sur l'organisation du travail ; loin de clarifier cette notion cependant, tous ces discours semblent contribuer à l'obscurcir. Le mouvement syndical paraît tiraillé entre deux perceptions. À certains moments on ramènera à l'organisation du travail absolument tout ce qui se passe a partir de et entre les quatre murs de l'entreprise : la technologie mais aussi les horaires de travail, la division du travail mais aussi les grilles salariales, toutes ces réalités entraînant pêle-mêle sur leur passage cogestion, santé au travail et discrimination à l'endroit des femmes, le négociable et le rarement négocié. A d'autres moments, on associera plutôt ce concept fourre-tout à l'intérêt très particulier que lui porte le patronat et qui fait référence à tous les raffinements et grossièretés de l'organisation scientifique du travail, de la socio-technique et des divers programmes de qualité de vie au travail. Quelque peu empêtré dans ces définitions, le mouvement syndical parle peu d'organisation du travail, alors qu'il s'agit d'un sujet de dissertation préféré du patronat. Cette confusion, ces malentendus, recouvrent en fait des hésitations et des interrogations du côté ouvrier ; en matière d'organisation du travail, les syndicats accusent un certain retard dans l'articulation de leurs positions et plus encore dans la mise à jour de leurs pratiques. Retard explicable bien sûr, mais qui deviendra de plus en plus handicapant, à mesure que le patronat affûtera de plus en plus, de son côté et isolément, ses outils.
Autour d'un concept

Du côté patronal, la discussion sur les modifications qu'il convient d'apporter à l'organisation du travail va bon train. Pour les patrons « de choc », on n'en est plus à l'époque des boîtes à suggestions. Certaines réserves s'imposent cependant. D'une part, certains secteurs industriels (intensifs en main-d’œuvre, technologie peu développée, bas salaires) semblent demeurer intouchés par ces discussions, pour des raisons qui s'assimilent probablement aux caractéristiques qui définissent ces secteurs ; il ne faudrait donc pas, lorsque nous parlons des tendances modernes, oublier cette importante fraction de la main-d’œuvre, justement la plus exploitée, qui n'est pas près de connaître des changements à son quotidien terne.
D'autre part, cet intérêt du patronat pour les modifications à l'organisation du travail allant, d'un point de vue superficiel, vers une amélioration des conditions objectives de travail doit d'abord être vu comme un moyen pour hausser la productivité ou le rendement au travail via une hausse de la satisfaction ou de la motivation, critique centrale des syndicalistes et avec laquelle on peut difficilement être en désaccord tellement c'est évident. Mais cet intérêt patronal a aussi une autre fonction qui est de répondre à des besoins, pas nécessairement exprimés, des travailleurs ; de répondre aussi à des manifestations d'écoeurement qui transforment souvent le champ de la production en champ de bataille ou de querelle larvée, ce qui n'est pas sans effet sur la productivité. Le mouvement syndical est fort conscient que les multiples formes de sabotage industriel, l'absentéisme, entraînent maintenant fréquemment des réformes patronales sophistiquées. Peut-être avons-nous cependant un certain malaise à avouer que le contenu de certaines réformes répond à des besoins ou désirs des travailleurs auxquels les pratiques traditionnelles de négociation ouvrière n'ont pas su répondre.
De quoi parlent les patrons lorsqu'ils s'interrogent sur l'organisation du travail ? On peut ranger les modifications les plus discutées dans les catégories suivantes :
- (1) Les modifications d'ordre matériel au processus de production les plus rares parce que les plus coûteuses, et qui ne sont doute jamais qu'un aspect d'une modification nécessitée d'autre part par des impératifs technologiques et économiques.
-
- (2) Les modifications d'ordre social au processus de production qui ont trait à la division du travail entre les travailleurs essentiellement : travail par équipes semi-autonomes, enrichi, rotatif, tout le domaine dit de la socio-technique.
-
- (3) Les modifications d'ordre social au régime de relations humaines dans l'entreprise, qui laissent intact le processus de production mais visent à créer un climat harmonieux dans l'entreprise : l'école des « relations humaines » du vieux Mayo se porte encore bien.
-
- (4) Les modifications d'ordre financier comme la participation aux bénéfices.
Face à cette avalanche de mesures qui sont discutées et utilisées du côté patronal, les syndicats doivent sortir de la défensive, et en arriver à aller un peu plus loin que la traditionnelle dénonciation des objectifs mercantiles qui sous-tendent ces modifications ; bien sûr, il faudra continuer à le dire, mais il faut aussi se demander pourquoi ces réformes sont souvent bien reçues par les travailleurs. Démasquer, mais pas seulement démasquer ; analyser aussi et ne pas craindre la remise en cause.
Les syndicats se réfèrent souvent, lorsqu'ils parlent d'organisation du travail, à une définition si large que rien de ce qui touche le milieu de travail ne lui est finalement étranger. Ce n'est pas sans raison que la F.T.Q., pour ne nommer que celle-là, manifeste peu d'enthousiasme lors des « sommets économiques » devant les tentatives gouvernementales d'amorcer une discussion sur la « qualité de vie au travail » ; comment en effet pouvait-on mettre des énergies sur la recherche d'une plus grande autonomie dans la vie de travail alors qu'on en est encore à l'ABC dans la défense d'une qualité minimale de vie au travail : salaires décents, sécurité et santé, droit au travail, etc. On ne pouvait être contre la Q.V.T. mais on ne pouvait la prioriser. Cette attitude syndicale est particulièrement compréhensible dans un contexte de crise économique, ou L'inévitable priorité est la défense des emplois existants et la création d'emplois tragiquement absents. Le discours syndical tend donc à dire « tout est organisation du travail », à commencer par et y compris le fait de n'en pas avoir ; il n'y a pas loin, de cette définition globalisante, à une légitimation d'indifférence face à l'organisation du travail dans un sens plus restreint qui me semble plus apte à cerner la réalité : soit le processus de division du travail entre les travailleurs ainsi qu'entre les machines et « les » travailleurs (le « travailleur collectif »), y compris les dimensions matérielle et sociale de l'organisation du travail.
Pratiques syndicales

Certains terrains de lutte syndicaux et certaines préoccupations m'apparaissent être de ceux qui font déboucher sur des remises en cause de l'organisation matérielle du travail. La lutte pour la santé-sécurité au travail, tout d'abord, a fait déboucher le mouvement syndical sur la constatation que la dangerosité n'était pas un mal inévitable mais plutôt la conséquence d'une organisation, d'un processus pensés par des gens qui ne se souciaient pas de l'aspect santé-sécurité. Les luttes en santé-sécurité mettent inévitablement au rancart l'illusion de la « neutralité » de l'organisation du travail, de l'objectivité du risque.
Dans le même ordre d'idées, plusieurs syndicats sont confrontés à des problèmes sérieux au lendemain des processus de désexisation des conventions collectives ; cette opération oblige, dans certains secteurs, des travailleuses pas nécessairement très jeunes ni très fortes à accomplir des travaux dits « lourds » qu'elles ne sont pas toujours capables d'accomplir, ou (et) qu'elles sont davantage portées à refuser que leurs camarades masculins. Qu'il y ait dans ce phénomène une part de conditionnement social, c'est certain, de même qu'il est assuré que les femmes n'ont généralement pas développé leur musculature au même degré que les hommes, pour un ensemble de raisons trop connues. Il reste que ces situations, lorsqu'elles éclatent, sont susceptibles d'engendrer une remise en cause générale de l'organisation matérielle du travail, un refus de cette organisation et une prise de conscience de son caractère inhumain et périlleux. Cette prise de conscience pouvait avoir été retardée par la tradition voulant que les travaux pénibles soient réservés aux « moins anciens », soit les travailleurs mâles dans la vingtaine, qui n'échappent pas nécessairement à la symbolique force musculaire-virilité.
Une autre occasion a amené le mouvement syndical à s'intéresser à l'organisation matérielle du travail : c'est lorsqu'il a dû amèrement constater que ses acquis étaient sapés par des changements dans l'organisation du travail contre lesquels il était impuissant. L'introduction de changements technologiques ayant pour effet de supprimer des emplois ou de modifier des horaires de travail « vivables » est sans doute ici l'exemple privilégié. Les syndicats tentèrent alors de modifier les effets des changements technologiques, généralement incapables d'aller à la source du problème.
La question des cadences et du travail au rendement a aussi été une préoccupation syndicale dans certains secteurs. De même, le phénomène de la taylorisation du travail et ses « remakes » contemporains ont été dénoncés, des points de vue de la parcellisation, déqualification et ainsi de suite. La critique syndicale n'a cependant pas engendré de projet revendicatif à opposer à ces phénomènes ; nos contradictions, sur lesquelles je reviendrai, commencent alors à faire surface.
J'ouvre ici une parenthèse., Il n'est pas dans mon propos de décréter que certaines revendications syndicales sont plus ou moins justes, plus ou moins nobles que d'autres. Je crois que personne ne peut s'arroger le droit de distinguer entre, par exemple, des revendications « qualitatives » et « quantitatives », les premières étant bien sûr les « plus avancées », et les seules aptes à attaquer l'organisation du travail. Il est si important de « contextualiser » ce genre d'analyses, qu'il devient en pratique quasi impossible de parler autrement qu'en général, en termes de projet syndical global.
La F.T.Q., en 1973, lançait une brochure intitulée « Notre place dans l'entreprise », qui constituait un premier essai de définition de stratégie syndicale dans le domaine de l'organisation du travail.
On y parlait de l'aliénation au travail, de ses effets sur les travailleurs et des intérêts qu'elle servait. Les nouvelles méthodes d'organisation étaient - fort sommairement - décrites et discutées : l'absence de contrôle ouvrier réel était mise en relief. La brochure se terminait sur des suggestions de nouvelles avancées revendicatives : contrôle des fonds de pension, santé-sécurité, sécurité d'emploi, contrôle accru sur l'organisation matérielle et sociale, accès aux livres comptables. Ce premier essai devait, par la suite, céder la place à des questions plus « urgentes » : la santé-sécurité et le droit au travail devenaient les grandes priorités syndicales.
À partir de ce tour d'horizon rapide, je voudrais maintenant faire ressortir ce qui me semble un point de convergence entre les positions patronales et syndicales, soit la valorisation du travail, de l'activité-travail. Comme si, au-delà des divergences idéologiques dans le mouvement syndical, pensées marxiste et judéo-chrétienne confondues, on se référait uniformément à un certain héritage culturel prolétarien qui imprime une valeur sacrée à l'activité travail. Les uns seront plus sensibles au caractère socialement -intégrateur du travail, les autres à la promesse de prise de conscience ouvrière qu'il contient, de développement d'une conscience de classe qui irait de pair avec un inévitable développement des contradictions du système.
Le résultat est le même. À gauche comme à droite, en effet, le chômage est une tare et un fléau, on réclame à grands cris la création d'emplois sans trop se soucier de l'utilité de la production en cause, ou du genre de société qu'elle nous prépare, l'important étant que la roue tourne. Les syndicalistes aguerris se désolent parfois de voir que les jeunes travailleurs n'adoptent pas les comportements de leurs aînés, utilisant au maximum les possibilités de congés de maladie et de congés sans solde, rêvant de mises à pied saisonnières, de semaines comprimées ou d'horaires de travail allégés, abandonnant même des jobs « steady » ; et ce sont ceux-là souvent qui seront tièdes à l'égard de l'institution syndicale.
La seule solution syndicalement acceptable pour se dégager d'un travail aliénant ou pour lui redonner une certaine signifiance semble bien être l'implication... et la « libération » syndicales *.
Les revendications pour une semaine de travail plus courte -exemple, les 32 heures du C.T.C. - n'ont pas, dans un passé récent, donné lieu à une stratégie syndicale d'envergure. Rares sont les syndicats qui n'essaient pas de raccourcir les heures de travail mais le discours syndical ne priorise plus cette revendication. Or, peut-être que les jeunes travailleurs n'acceptent plus aussi facilement cette « éthique du travail » qui réunit gauche et droite. Et la vraie question que recouvrent les tentatives de rendre le travail plus vivable est peut-être « faut-il chercher à diminuer l'emprise du travail sur nos vies ou travailler à redonner signifiance aux gestes que nous posons quotidiennement ? ». Ni l'un ni l'autre terme de l'alternative ne constituent une grande préoccupation syndicale.
Des contradictions aux stratégies

Au premier rang des contradictions syndicales, je rangerais cet immense facteur de démobilisation - conscient ou inconscient - qu'est l'incapacité des pays dits socialistes à se démarquer valablement de l'organisation du travail capitaliste ; nous savons que Taylor a eu des émules particulièrement enthousiastes à l'Est... Voilà qui constitue un mauvais départ quand on est convaincu que le développement industriel pourrait servir à la libération des individus et non les enchaîner toujours et davantage à un travail débilitant et dépouillé de signification.
Dans un deuxième temps, le mouvement syndical reproduit, à l'occasion, un certain nombre de contradictions - écart théorie-pratique - dans le domaine de l'organisation du travail. Par exemple, alors que l'on dénonce le caractère abêtissant du travail, la parcellisation, etc., on s'accroche à une ligne de conduite qui, au nom de la sécurité d'emploi ou de la limitation du fardeau de travail, amène à refuser et à dénoncer les tentatives d'enrichissement des tâches, l'introduction d'une certaine polyvalence. Il m'apparaît que c'est un choix tronqué que de se voir imposer le choix entre « une job plate » et « pas de job du tout », puisque c'est souvent pour prévenir la disparition de postes que l'on met de l'avant cette attitude syndicale. Cette crainte des baisses d'effectifs a entraîné un blocage syndical face à toute possibilité de changement de contenu d'un travail, alors que les principaux intéressés sont souvent, dans leur for intérieur, accablés par la monotonie et la répétitivité de leur travail. Dans d'autres cas enfin, les luttes contre la déqualification ne sont pas toujours sans charrier une part de réflexes corporatistes. Bien sûr, les nuances sont toujours de mise. Ainsi, l'attachement à un métier, une formation, une compétence, un diplôme spécifiques trahit aussi la dépossession vécue par les travailleurs par rapport à leur cadre de travail.
Une autre zone d'ombre me semble être toute la question de la division du travail (créateur-exécutant) et de la hiérarchisation. Le mouvement syndical ne remet pas - ou plus -fondamentalement en cause le type de division du travail qui a cours dans nos sociétés industrielles. Il la reproduit dans ses appareils et l'entérine par ses pratiques de négociation qui ont souvent pour effet de figer et d'accentuer la hiérarchisation, non seulement des postes, mais parfois même aussi des salaires.
Le mouvement syndical commence seulement d'autre part à se dégager du réflexe de la « monnayabilité » : on troque la sécurité ou des horaires de travail supportables contre des « primes ». Le refus de la « monnayabilité » mène tout droit à des contestations globales de l'organisation de la production.
J'ai en outre mentionné auparavant les ambiguïtés syndicales sur la réduction de la semaine de travail ; ainsi, il est parfois difficile de dire si le mouvement syndical est contre le travail à temps partiel en principe ou de façon conjoncturelle, parce que c'est souvent un moyen de surexploiter la main-d’œuvre ou d'économiser des postes. De même pour la semaine comprimée de travail, qui a l'immense avantage pour les patrons de diminuer les coûts de production dans certains secteurs (baisse de l'absentéisme, économies d'ordre technique) ; le discours syndical souligne cet aspect, et c'est excellent d'y penser, mais qui convaincra les travailleurs concernés que voilà une raison suffisante pour rejeter la semaine comprimée ? Le même raisonnement peut être appliqué aux horaires flexibles ; là où les syndicats ont la force nécessaire pour garantir une non-augmentation du fardeau de travail, sur quoi repose la pertinence du refus « de principe » de tels horaires ?
Le mouvement syndical s'est trop souvent heurté au mur des « droits de la direction » pour ce qui a trait à l'organisation matérielle et, dans une grande mesure, sociale, du travail. Contraint de négocier les effets et les aménagements de décisions difficilement contestables, il trouve toute proposition patronale automatiquement suspecte ; le fait que trop souvent les travailleurs aient fait les frais de supposées améliorations techniques sans que les syndicats, impuissants au niveau de la gestion, aient pu valablement réagir, doit être pris en compte : dans pareil contexte, le refus global n'est pas sans logique. Ceci dit, le mouvement syndical ne serait-il pas lui-même victime de son discours antagonique qui, tout juste qu'il soit, l'empêche cependant de voir que les travailleurs voient parfois des initiatives patronales venir au-devant de leurs désirs ? De même, l'attachement du mouvement syndical à la notion de collectivité l'empêche peut-être de distinguer que l'expression d'aspirations individuelles telles qu'autonomie, liberté, qualité de la vie privée - non pas en soi réactionnaires mais plutôt étrangères au public, au collectif - est tributaire d'un mouvement social avec lequel il faut compter.
Contentons-nous maintenant de souligner quelques enjeux que soulèvent l'organisation du travail et les modes les plus courants de modifications.
Un premier enjeu en cause pour le mouvement syndical, et pour chaque syndicat pris isolément, concerne le sentiment d'appartenance. On se rend compte en effet que, dans plusieurs cas où des initiatives patronales ont amené la constitution de groupes intégrés de travail dans un cadre moins ou pas du tout hiérarchisé, l'appartenance syndicale cède le pas à l'appartenance de groupe. Ailleurs, où la mode est plutôt aux « relations humaines », l'appartenance d'entreprise prend le pas sur l'appartenance syndicale. Voilà un problème d'envergure, qu'il serait cependant naïf d'imputer en entier à l'initiative patronale ; l'allégeance syndicale et la conscience de classe ne sont pas à ce point volatiles : il se peut que l'enracinement syndical ait été faible au départ.
J'aurais, en outre, tendance à croire que les syndicalistes québécois, du fait du monopole syndical d'entreprise et des rivalités intersyndicales, sont particulièrement sensibles - et sans doute déconcertés - face à ce phénomène. La faillite du sentiment d'appartenance syndicale peut se traduire par le passage d'un groupe à une organisation rivale, et non uniquement par une perte de vitalité syndicale, toujours récupérable. Des améliorations « autonomisantes » peuvent donc avoir pour effet de modifier l'appartenance syndicale, et les syndicats doivent savoir distinguer les origines du problème, en tentant de concilier la survivance d'une organisation forte et antagonique et les aspirations individuelles qui ont trouvé tout à coup un nouveau canal d'expression.
Le point de départ pour l'établissement d'une stratégie syndicale valable sur le terrain de l'organisation du travail me semble être de reprendre l'initiative. Le mouvement syndical est actuellement, au-delà de quelques formules stéréotypés, essentiellement sur la défensive dans ce domaine : défense de l'emploi, défense du statu quo... Cette situation entraîne deux conséquences. D'une part les syndicats, pris un à un, se retrouvent non pas devant des faits accomplis - ils existent et les changements doivent quand même être négociés - mais très certainement pris de court et obligés de situer leur riposte en fonction de paramètres définis par la partie adverse. Ils risquent en plus de voir leurs membres développer l'impression que, même si les syndicats ont fait du bon travail sur le plan de certaines conditions de travail, c'est de l'employeur qu'en dernier ressort viennent les améliorations concrètes au vécu du travail. D'autre part, et par définition, un syndicat en position défensive n'est plus maître de ses priorités.
Les syndicats devraient en arriver à développer eux-mêmes des alternatives à la présente organisation du travail, sans attendre que d'autres y pensent avant eux et ne récupèrent à leur profit la hausse de la satisfaction des travailleurs. Sans doute n'y a-t-il pas un modèle vers lequel les syndicats devraient se diriger, s'agissant plutôt d'un faisceau d'avenues qui pourraient être explorées. Toute revendication avancée en rapport avec l'organisation sociale et matérielle du travail doit nécessairement se compléter d'une réflexion sur les changements souhaitables ou indispensables qui devraient prendre place en corollaire au niveau de l'action syndicale. Les valeurs à la base de l'action syndicale dans ce domaine doivent être celles de non-compétition et d'égalitarisme, mais aussi de respect des différences individuelles, qu'il s'agisse des capacités différenciées ou de responsabilités extérieures au travail. Prendre l'initiative syndicale dans le domaine de l'organisation du travail implique aussi le refus de s'incliner devant le caractère inévitable de la technique, devant sa pseudo-neutralité. Bien sûr, tout ceci nous amène en plein dans des droits de la direction particulièrement protégés et difficilement attaquables ; mais l'action syndicale n'est en somme qu'un grugeage perpétuel des droits de la direction, l'imposition toujours répétée d'un pouvoir ouvrier en redéfinition constante.
Une telle orientation syndicale est porteuse d'une contestation globale des modes de production, et partant des incidences de ces modes de production sur nos vies à tous. Il est possible de continuer à revendiquer le plein emploi, le droit au travail, tout en se préoccupant davantage du genre d'emploi en cause, tout en prenant conscience des conséquences potentielles pour les travailleurs d'une orientation strictement productiviste du développement social.
Mais est-il possible pour le mouvement syndical de procéder à un tel réalignement dans le contexte juridique des relations de travail que nous connaissons en Amérique du Nord : négociation entreprise par entreprise, rapports de force inégaux et désavantageux ? Il s'agit là en effet de luttes qui doivent être élargies, faire l'objet de fronts communs, d'une mobilisation qui se situe au-dessus des syndicats locaux pris un à un. Ce sont là des problèmes sur lesquels les syndicalistes doivent poursuivre leur réflexion, mener des débats. L'organisation du travail capitaliste et les moyens à prendre pour la combattre constituent un (autre) domaine où les certitudes militantes semblent difficiles à formuler.
Mona-Josée Gagnon
F.T.Q.
* Libération au sens de dégrèvement partiel ou total.
|

