[177]
Nicole Gagnon
sociologue, Université Laval
“L’identité équivoque.”
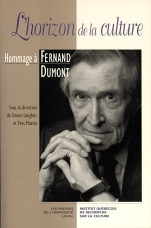 Un texte publié dans l’ouvrage sous la direction de Simon Langlois et Yves Martin, L’horizon de la culture. Hommage à Fernand Dumont, pp. 177-185. Troisième partie : La symbolique de référence. Québec : Les Presses de l’Université Laval, 1995, 556 pp. Un texte publié dans l’ouvrage sous la direction de Simon Langlois et Yves Martin, L’horizon de la culture. Hommage à Fernand Dumont, pp. 177-185. Troisième partie : La symbolique de référence. Québec : Les Presses de l’Université Laval, 1995, 556 pp.
- Identité personnelle/identité collective
- Identité et personnalité
- Nous/vous/eux
- Je/moi/soi
- L'identique et l'authentique
Proliférante dans le discours anthropologique actuel, la notion d'identité est équivoque : identité personnelle, identité collective ; identité culturelle de l'individu, identité de la culture ; identité du coupable, identité de la personne adulte... S'agit-il de définir un tiers ou de reconnaître autrui dans sa subjectivité ? « Identité » serait-il le concept moderne tenant lieu de l'ancienne idée de substance, dégagée de ses accidents ? Est-ce la même chose que la subjectivité, la singularité ou l'unité de la personne – ou de la société ? Cette polysémie contribue à embrouiller des phénomènes déjà complexes par eux-mêmes ; elle invite par contre à mettre en rapport des réalités qu'il importe de commencer par démêler.
IDENTITÉ PERSONNELLE /
IDENTITÉ COLLECTIVE

Posons que l'identité désigne ce qu'on appelait naguère « l'âme » et aujourd'hui le Soi. Les sciences humaines ont en effet appris à faire l'économie de deux des idées kantiennes de la Raison (Dieu, l'âme) pour ne conserver que la troisième (le monde). Ce que l'ancienne raison concevait comme une substance immatérielle déterminant l'existence des personnes est devenu une structure psychique qui doit être appréhendée génétiquement : le Soi ne sort pas tout armé du ventre de sa mère ; il se forme au cours de l'enfance et n'atteint son plein état de développement qu'au terme de l'adolescence. Bref, alors que l'âme est substantive, le Soi est historique.
À proprement parler, il n'y a de Soi que personnel et l'expression même d'identité collective relève de la métaphore, comme cette Âme des peuples que publiait encore en 1950 André Siegfried – et qu'il aurait pu aujourd'hui intituler « L'identité des peuples ». Puisqu'on en parle, pourtant, et que cette question est devenue un des thèmes majeurs de la sociologie contemporaine, il doit bien y avoir quelque réalité visée par la notion d'identité collective. Fernand Dumont l'a [178] conceptualisée sous le terme plus exact de référence – référence identitaire, conviendrait-il de préciser. Il s'agit d'une symbolique commune à laquelle se réfèrent semblablement les membres d'une collectivité pour l'attribuer à leur Soi (la France, l'Église ou le prolétariat, « c'est moi »). Ces personnes forment alors un groupe par référence (Dumont). Levons ici une confusion possible avec la théorie des groupes de référence chez R.K. Merton : ceux-ci sont des autruis significatifs, alors que les groupes par référence sont des Nous, des identités collectives. Dumont aborde ces Nous comme « institutions de l'expérience humaine » à laquelle le discours est essentiel, parce que « l'existence fait irrésistiblement appel à l'expression ».
Certains de ces discours restent tout proches des signes existentiels. Ce sont les traditions, le plus souvent orales, que l'enfant accueille au cours de sa première socialisation, dans les cercles de famille et de voisinage. D'autres discours, plus amples, sont dus aux historiens qui, pour être préoccupés de rigueur scientifique, n'en sont pas moins des diseurs de traditions. Il est des discours plus systématiques encore, des idéologies qui ambitionnent de mettre en forme le destin d'une collectivité : tel mouvement social, tel parti veut définir ce qu'est la vraie France, ou le vrai Québec, au nom du pays réel. Les États totalitaires poussent cette tendance à la limite, en confisquant la symbolique de la référence au profit d'un discours qui prétend à la fois la résumer et trancher quant à son interprétation en orthodoxie. [1]
IDENTITÉ ET PERSONNALITÉ

Réalité d'ordre symbolique, la référence identitaire est donc tout autre chose que cette personnalité collective ou ce caractère national que s'efforçait de dépeindre, par exemple, Siegfried, en des termes aujourd'hui difficilement recevables : « Dans ce qui se voit de l'Allemand, ce qui nous frappe surtout, c'est son absence de personnalité [2] » ; ou encore : « Le Français, avec une psychologie de petit rentier, veut toujours trouver à tout une solution [3] ». L'identité de la personne, de même, n'est pas sa personnalité, à savoir, d'après la définition classique d'Allport : le système psychophysique qui détermine les comportements. Elle concerne plutôt, selon une formule qui se trouve aussi chez Siegfried, « l'idée que les Anglais se font d'eux-mêmes [4] » : une conscience de Soi, un idéal du Moi – à la limite, un pur imaginaire.
Faute d'opérer correctement la distinction entre identité et personnalité, Alain Finkielkraut est amené à dénier son identité juive, dans un essai sur Le Juif imaginaire, qui n'est pourtant rien d'autre que l'élaboration d'une référence identitaire. « "Juif" n'est jamais une réponse pertinente à la question : "Qui suis-je ?" [5] ». L'auteur, en réalité, n'a en rien renoncé à cette identité ; il a simplement dépassé la naïveté narcissique de son adolescence, pour s'approprier la judéité sous un mode qui ne soit plus celui de la possession directe. « Juif » n'est pas un trait [179] distinctif de sa personnalité ; c'est « un vocable saint », une transcendance. « Ce nom inappropriable résiste à la représentation, reste extérieur à tous ceux qui l'incarnent [6]. »
Fils de survivants du génocide émigrés en France, Finkielkraut estime avoir été gavé jusqu'à l'obsession du « ronronnement » identitaire. Mais en même temps qu'on lui inculquait l'orgueil d'être Juif, fils du Peuple-Victime, du Peuple-Juste, du Peuple-Rebelle – ajoutons : du Peuple-Élu, du Peuple-Monde, du Peuple indestructible – on le sommait de s'instruire. Mes parents, explique-t-il, ont voulu éviter de concurrencer l'École en interposant quelque particularisme que ce soit entre leur progéniture et le savoir universel : « Ils gardèrent pour eux le trésor de la Yiddishkeit [7]. » Adolescent, leur fils pouvait, tel un « rentier de la souffrance », « jouir en toute quiétude d'un destin exceptionnel » : « par un privilège nommé judaïsme », il était « dispensé de bêtise », « exempt de toute grégarité [8] ». Adulte, il s'est plutôt découvert Juif « déficitaire », « sans substance », « impeccable de similitude » ; bref, un Français comme les autres, doté d'une identité imaginaire.
L'imaginaire tel qu'en parle Finkielkraut est une illusion, un faux-semblant. On peut toutefois envisager un imaginaire qui soit un mode d'être de la réalité : le monde fictif surgi de l'imaginaire littéraire, notamment, ou encore, « l'institution imaginaire de la société » (Castoriadis), dont les conséquences pratiques sont tout à fait réelles. En ce sens, toute identité relèverait de l'imaginaire, sans être pour autant nécessairement illusoire. Quoi qu'il en soit, Finkielkraut a troqué sa judéité fictive pour une mémoire, qu'il lui arrive de qualifier d'« histoire imaginaire [9] ». « Une nostalgie inépuisable pour la vie juive d'Europe centrale : voilà tout mon héritage. La judéité, c'est ce qui me manque, et non ce qui me définit [10]. »
Pourtant, c'est bien par ce manque même que l'auteur se définit. Il a beau nier que l'histoire du Peuple-Juste soit sa propre vérité et faire du Juif une figure universelle de la transcendance, « l'Autre de notre civilisation [11] », la judéité ne lui manque qu'à titre de Juif. Pour l'Occidental quelconque, il y a sans doute un devoir de mémoire envers le génocide, mais qui s'arrête à l'acte même de déraison ; la vie juive d'Europe centrale qui a été anéantie n'a aucun privilège sur celle, par exemple, des anciennes Réductions. Car tant d'ethnies et de civilisations ont disparu, alors qu'Israël et quelques grandes villes nord-américaines abritent encore des îlots transplantés de Yiddishkeit.
Placée dans une conscience historique, à distance de la personnalité, l'identité juive est une institution imaginaire. « Athées, assimilés, indiscernables de leurs voisins, des Juifs persistent à rester juifs même s'ils ne comprennent pas très bien eux-mêmes le sens de leur obstination [12]. » Et même si on admet que « l'étrangeté juive n'est pas une altérité comme les autres [13] », on pourrait dire la même chose de bien d'autres identités. La plupart des Nord-Amérindiens, par exemple, ont perdu leur langue, leur mode de vie, leurs croyances quand ce n'est pas leur facies distinctif. Métissés, modernisés, en proie à toutes les pathologies sociales, ils ne [180] ressemblent plus guère aux « sauvages » de l'imagerie occidentale. Ils n'en continuent pas moins à se proclamer Indiens.
NOUS/VOUS/EUX

L'affirmation identitaire est confrontée au regard catégorisant, « identifiant », d'autrui. Rien de moins Indien, aux yeux de son concitoyen, que ce fonctionnaire emplumé brandissant son appartenance à la Terre-Mère pour revendiquer d'un seul tenant le droit de propriété foncière et la souveraineté territoriale. Rien de plus Juif, en revanche, que cet intellectuel déniant que « Juif » soit une réponse pertinente à la question « Qui suis-je ? ». Le discours contradictoire du premier dénonce, semble-t-il, le caractère illusoire de son identité ; la dénégation du second serait impuissante à masquer l'irréductibilité de la prétention juive.
Qu'elle intériorise ou récuse le jugement d'autrui, l'identité se définit inévitablement dans un rapport d'altérité. « On se définit en s'opposant », dit la sagesse commune. La science structurale a effectivement mis en évidence comment le rapport d'opposition est constitutif de la signification même. Or cette opposition structurale est différentielle, pas nécessairement conflictuelle. C'est dire que l'Autre face auquel le Nous se pose peut être un interlocuteur plutôt qu'un adversaire ; ou encore, qu'il pourra passer du Vous au Eux, si on décide de lui tourner le dos. Le rapport d'altérité n'est pas pour autant dissous, mais il devient alors imaginaire. Sans interlocuteur qui lui renvoie l'image de sa réalité pour autrui, sans autre adversaire auquel confronter sa prétention identitaire qu'un Eux fantasmatique, le Nous perd son principe de réalité et risque de sombrer dans l'illusion.
Quoi qu'il en soit de la valeur euristique de la métaphore grammaticale pour l'étude des identités collectives, le rapport identitaire est de type variable. La figure du Juif français, par exemple, telle que la retrace Finkielkraut, a connu plusieurs avatars : Juif du ghetto opposant à la persécution son mépris silencieux du Goy (Eux) ; Israélite émancipé, devenu « contemporain irréprochable » et citoyen de la Nation universaliste (Nous), sous la formule « Juif en dedans, homme au dehors [14] » ; rescapé de l'Holocauste affichant son nom comme un étendard, ou Juif de France (Vous) s'identifiant à l'État d'Israël. À l'ère de l'individualisme et de la dissolution des grandes figures du Nous, le Juif s'offre même en modèle de la consistance identitaire :
À ces prisonniers de l'égosphère, les Juifs apparaissent comme des privilégiés de l'histoire. [...] Ils ont un patrimoine, une fidélité, un territoire spirituel. L'intrigue qu'ils nouent avec le monde ne se réduit pas à une anecdote privée. [...] Le privilège de la consistance historique leur semble réservé [15].
[181]
Pour prendre un exemple plus modeste mais plus clair, Fernand Dumont a bien mis en lumière la différence du rapport identitaire chez les Canadiens-anglais * et les Canadiens-français, à travers une analyse de la référence que ceux-ci ont élaborée au milieu du XIXe siècle. D'un côté, le discours anglophone sur les Canadiens-français véhicule une constante, de la Conquête à l'Union, dont la teinte varie du mépris bienveillant au comble de l'injure : ils sont des « laissés-pour-compte » de l'Histoire. C'est qu'« en définissant les francophones, les anglophones se trouvent à se décrire eux-mêmes par inversion, à proclamer les valeurs dont ils se croient les porteurs [16] ». Les Canadiens-français, commente Dumont, étaient à portée de nez pour servir de repoussoir ; d'autres auraient aussi bien fait l'affaire. Quant aux Canadiens-français, ils ont accédé à la conscience de soi par intériorisation du regard de l'autre : « L'assimilation à laquelle on les voue, la réserve à laquelle on les confine finiront par inspirer leur propre discours ». Et ce discours de la survivance « ne cessera jamais par la suite, traumatisme originaire ou position de repli, de hanter la conscience historique des Canadiens [17] » d'autrefois et des Québécois d'aujourd'hui.
Pour tenter une généralisation, suggérons que les dominants, comme les marginaux, se définissent contre Eux, tandis que les minoritaires s'identifieraient sous le regard du Vous.
JE/MOI/SOI

L'usage des pronoms personnels s'embrouille lorsqu'on revient de la référence identitaire au Soi. Si Nous/Vous/Eux n'ont qu'une signification euristique globale et peu problématique, la première personne du singulier s'articule en Je/Moi/Soi, qui ont une valeur conceptuelle plus précise mais divergente selon la théorie de référence.
On s'accordera facilement sur le mot « Je » pour désigner le sujet, mais plus du tout lorsqu'il s'agit de définir ce qu'on entend par là. Le sujet-conscience de la philosophie ou du sens commun est ramené par la raison structurale à un effet de langage ou d'idéologie, tel que l'énonce l'aphorisme structuro-marxiste : « L'idéologie interpelle l'individu en sujet. » À cet individu assujetti qui baigne dans l'illusion du Je, Alain Touraine oppose un sujet de l'action, qui n'est pas lui non plus conscience, mais désir de soi, exigence de liberté, puissance de résistance au pouvoir des appareils. Mouvement social et principe non social d'historicité, le sujet tourainien est « créateur de lui-même et producteur de la société [18] ». Beaucoup plus ancienne et d'inspiration behavioriste, la théorie psychosociologique de [182] George H. Mead présente un sujet-conscience qui est engendré socialement sans être pour autant illusoire. Ce sujet-conscience étant réflexif, il est toutefois conceptualisé comme Soi, tandis que le Je est sujet de l'action. Plus exactement, le Je est partie prenante du processus social, à titre de réaction individuelle, indéterminée ou du moins imprévisible, à l'action socialement déterminée du Moi. Comme chez Touraine, l'individu créateur est Je, principe non social de changement social ; mais il dérive ici du Moi, qui en est la condition d'apparition.
Le Moi meadien est la partie de l'acte social assumée par l'individu. À la limite, il s'agit d'un rôle extérieur à la personne, avec toutes les connotations péjoratives que le terme comporte : conformisme, aliénation, inauthenticité. C'est en réalité à ce Moi que s'en prend Touraine, en le confondant avec le Soi, auquel il oppose le sujet autocréateur. Chez Mead, cependant, le Moi est bel et bien « mien », dans la mesure où il est approprié, où il est présupposé à l'émergence du Je et où il persiste comme structure de base dans la constitution du Soi. Le Moi de la psychanalyse est tout autre chose. Chez Freud, il s'agissait d'ailleurs d'un Je (das Ich), mais d'un Je fonctionnel, simple opérateur d'unification de l'appareil psychique. Voici la définition qu'en donne Erikson : « Un moi inconscient qui décide de faire pour nous, à la manière du coeur et du cerveau, ce que nous ne pourrons jamais "calculer" ou combiner consciemment [19]. » Ce Moi a pour fonction de filtrer les impulsions du Ça, les injonctions du Surmoi et les exigences de la réalité extérieure, de façon à les transformer en vouloirs cohérents et à préserver ainsi l'unité de l'individu. Pour bien distinguer cet organe de commande dans l'appareil psychique du sujet-conscience qui se pense ou se ressent comme centre d'expérience (le Je), on a rendu en français le Ich par Moi, ce qui oblige à déplacer le Moi meadien vers le troisième terme, Soi – qui désigne, chez Mead, l'unité réflexive du Moi et du Je. Erikson, le grand classique de la théorie de l'identité, tente de fixer l'usage de la façon suivante :
On peut donc parler d'identité du moi quand on discute du pouvoir synthétique du moi à la lumière de sa fonction psychique centrale – et d'identité de soi quand l'objet de la discussion porte sur l'intégration des images de soi et des images de rôle chez l'individu [20].
Le Soi est une notion plus complexe sinon plus confuse, mais qui prête moins à équivoque. On conviendra généralement qu'il s'agit du sentiment que l'individu a d'être une personne, c'est-à-dire un être social, distinct d'autrui, stable dans le temps. Ce sentiment se manifeste tôt dans l'enfance mais n'atteint sa pleine structuration qu'au terme de l'adolescence, sous forme de conscience d'identité. Bien qu'il s'éprouve subjectivement et qu'il présuppose le fonctionnement réussi du Moi de l'appareil psychique, le Soi est social. Il s'élabore par identification aux figures parentales et il exige la confirmation d'autrui. Ainsi, l'enfant autiste qui se barricade dans son Moi pour éviter d'être détruit par la réalité extérieure n'a pas de Soi : c'est une « forteresse vide » (Bettelheim) ; c'est pourquoi il est incapable de dire « je » et n'y parvient qu'après avoir acquis l'usage du « toi ». Dans la perspective [183] radicalement sociologique de Mead, le Soi ne peut faire partie de l'expérience subjective que sous mode d'objet ; l'individu ne devient donc un Soi qu'en adoptant l'attitude objectivante d'autrui vis-à-vis lui. Paul Ricoeur retrouvait récemment une idée analogue dans sa réflexion sur Soi-même comme un autre.
Sauf chez un Touraine, qui récuse le Soi social au profit d'un Sujet auto-engendré, on conviendra encore que la conscience d'identité est indispensable à la personne normale.
L'IDENTIQUE ET L'AUTHENTIQUE

Si Touraine s'inscrit en faux et avec vigueur contre l'idée d'identité, c'est qu'il y perçoit une double menace d'enfermement dans « ce que l'on est » : ghetto de l'appartenance ethnique, « étouffante subjectivité des nationalités », ou encore, « cocooning du souci de soi [21] ». Erikson, et avant lui Mead, ont pourtant indiqué une voie de solution au danger de la fermeture identitaire, qui n'implique ni rejet des origines, ni dissolution du Soi : l'anticipation d'une identité élargie [22], par le recours à « une référence plus large » que celle du groupe d'appartenance immédiate [23]. Cette voie d'ouverture par universalisation du Soi est peut-être moins évidente à l'ère du « droit à la différence » ; elle n'est cependant pas incompatible avec celle de l'esthétisation, qui est l'expression d'un style singulier d'existence dont « la similitude et la continuité font qu'une personne est significative pour d'autres, elles-mêmes significatives [24] » – et qui est tout le contraire d'un repli dans son cocon.
L'identité n'est pas repli dans une essence intemporelle du Soi ou de la culture, ni reproduction à l'identique d'un ordre social. Bettelheim a montré au contraire que l'obsession de l'identique est un symptôme clé de l'autisme, qui est une déficience profonde du Soi par refus d'interagir avec un monde éprouvé comme destructeur [25]. L'enfant autiste existe si peu qu'il panique devant la chasse d'eau, craignant d'y être emporté avec son excrément ; il redoute de même toute modification de rites quotidiens ou d'espace physique, la permanence de l'environnement matériel étant sa seule garantie contre l'anéantissement. Le philosophe rejoint ici le psychanalyste, lorsqu'il oppose la « mêmeté » (l'identique) à l'ipséité, qui « n'implique aucune assertion concernant un noyau non changeant de la personnalité [26] », mais « l'attestation fiable » de soi. Il s'agit, explique Paul Ricoeur, de la confiance de l'individu en son pouvoir de dire, de faire, de se raconter et de répondre « me voici [27] ! »
C'est à la dimension morale du « me voici ! » que Ricoeur attribue le plein développement de l'identité. « L'autonomie du soi [est] intimement liée à la sollicitude pour le proche et à la justice pour chaque homme [28]. » Cette thèse rejoint en un sens celle d'Erikson, pour qui la formation du Soi dans l'adolescence repose sur la force vitale de la fidélité, et qui fait de l'idéologie – Fernand Dumont dirait plutôt : la référence – l'institution gardienne de l'identité. « Sans un tel engagement [184] idéologique, quelque implicite qu'il soit, dans un mode de vie, la jeunesse souffre d'une confusion de valeurs qui peut être spécifiquement dangereuse pour certains [et] sûrement dangereuse pour l'édifice de la société [29]. » Autrement dit, sans une cause à laquelle répondre « me voici ! », le jeune s'enlise dans la confusion narcissique du « souci de soi ».
L'oeuvre d'Erikson date déjà. L'éthique contemporaine est davantage axée sur les valeurs de l'authenticité, qui subvertit l'idée de fidélité en « fidélité envers soi-même » (Taylor [30]), que sur celles de l'engagement. Faut-il voir dans cette poussée actuelle d'individualisme expressiviste « une nouvelle conception de l'identité », comme le dit Charles Taylor, ou une désintégration de l'institution qui en était la gardienne et qui se solderait en réalité par un affaissement du Soi ? Comment être fidèle envers soi-même si on n'a pas encore fini de décider de qui on est ? Mais si la référence identitaire reste nécessaire pour assurer le passage à l'âge adulte et la socialisation des nouvelles générations, le Nous est-il encore un constituant essentiel du Soi accompli ?
Dans un article dont j'ai perdu la référence, Julien Freund reliait la question des identités collectives au vieux problème durkheimien de l'anomie. Cette problématique, écrivait-il, est apparue en sociologie « quand diverses communautés ou collectivités ont eu le sentiment de l'avoir perdue ou d'être en train de la perdre ». Ce serait dire, par analogie avec la crise d'adolescence, que l'obsession identitaire des groupes ethniques ou nations dominées est un signe que leur identité est à refaire pour affronter le monde contemporain. Dans ces mouvements de revendication identitaire, comment alors discerner l'exigence autistique de l'identique et la quête d'authenticité ?
Je me demande enfin si le regain d'intérêt des sciences humaines pour les identités collectives ne se ramène pas à une simple reprise, sous un terme plus suggestif ou plus valorisé, des anciennes études sur le caractère national, la personnalité de base ou l'âme des peuples. Ou bien si le recours à la notion d'identité signifie qu'on serait passé d'une anthropologie du Eux à une anthropologie du Vous. Selon la philosophie expressiviste de Charles Taylor, l'identité est inventée par chacun et non attribuée de l'extérieur. « Aussi longtemps que je ne la reconnais pas comme la forme de mon originalité, on ne saurait la déclarer mienne. »
[1] Fernand Dumont, L'institution de la théologie. Essai sur la situation du théologien, Montréal, Fides (collection Héritage et projet, 38), 1987, p. 48.
[5] Alain Finkielkraut, Le Juif imaginaire, Paris, Seuil, 1980, p. 45.
* L'auteur tient à écrire avec un trait d'union « Canadiens français » et « Canadiens anglais ».
[16] Fernand Dumont, Genèse de la société québécoise, Montréal, Boréal, 1993, p. 126.
[19] Erik H. Erikson, Adolescence et crise. La quête de l'identité (1968), Paris, Flammarion, 1972, p. 232.
[21] Alain Touraine, op. cit., p. 213 et 306.
[22] Erik H. Erikson, op. cit., p. 337.
[23] George H. Mead, L'Esprit, le Soi et la Société (1934), Paris, Presses universitaires de France, 1963, p. 231.
[24] Erik H. Erikson, op. cit., p. 49.
[25] Bruno Bettelheim, La forteresse vide. L'autisme infantile et la naissance du soi (1967), Paris, Gallimard, 1969.
[26] Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 13.
[29] Erik H. Erikson, op. cit., p. 198.
[30] Charles Taylor, « Les sources de l'identité moderne », conférence au Colloque « Identité et modernité au Québec », Québec, Faculté des sciences sociales, Université Laval, 22 octobre 1993.
|

