|
Hubert Gerbeau [1937- ]
Poète et romancier, Agrégé d’histoire et docteur d’État,
professeur d’université, Chercheur au CERSOI depuis 2002.
“La liberté des enfants de Dieu.
Quelques aspects des relations
des esclaves et de l'Église à la Réunion”.
Un article publié dans Problèmes religieux et minorités en Océan indien. Table ronde IHPOM, CHEAM, CERSOI. Sénanque, mai 1980, pp. 45-95. Institut d'histoire des pays d'outre-mer, Université de Provence. Études et documents, no 14, 1981.
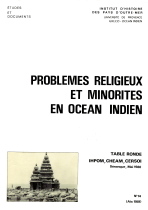
- Liste des abréviations
-
- Remerciements
-
- Introduction
-
- Église et esclavage : le débat théorique.
- Nègres : païens ou nègres chrétiens ?
- Le mythe révolutionnaire et la restauration impossible.
- Mission des Noirs ou mission des maîtres ?
-
- Conclusion
Liste des abréviations

|
ADR
|
Archives Départementales de la Réunion (Le Chaudron).
|
|
AER
|
Archives privées de l'Évêché de la Réunion (Saint-Denis de la Réunion).
|
|
AFMR
|
Archives privées de la congrégation des Filles de Marie (Saint-Denis de la Réunion).
|
|
AH
|
Archives de Vile Maurice (Coromandel, Maurice).
|
|
AN
|
Archives Nationales (Paris).
|
|
ANOM
|
Archives Nationales, Section Outre-Mer (rue Oudinot, Paris).
|
|
AP
|
Archives & la Congrégation de la Propagande (Rome), Scritture riferite nei Congressi Africa, Isole dell'Oceano Australe, ecc... (classement chronologique).
|
|
APRP
|
Archives privées de la paroisse de la Rivière des Pluies (Réunion).
|
|
ASE
|
Archives de la Congrégation du Saint-Esprit (rue Lhomond, Paris).
|
|
AVR
|
Archives privées de la famille de Villèle (étaient à la Réunion quand nous les avons consultées).
|
|
Lib.
|
Série de 13 tomes de sources imprimées, publiés à Paris, 30, rue Lhomond, par les Spiritains, de 1929 à 1941 (la série comprend en outre 2 volumes d'appendice, de 1939 1941, et un de compléments, de 1956). Le titre en est : "Notes et Documents relatifs à la Vie et à l'Oeuvre du vénérable François-Marle-Paul LIDERMANN, Supérieur général de la congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Coeur de Marie" (Libermann a vécu de 1803 à 1852).
|
|
RD
|
Recueil de documents et travaux inédits pour servir à l'histoire de la Réunion, ADR, no 1 à 4, Nérac, G. Couderc, 1954 à 1960.
|
|
RT
|
Recueil trimestriel de documents et travaux inédits pour servir à l'histoire des Mascareignes françaises, 8 tomes (subdivisés en fascicules) publiés par Albert LOUGNON de 1932 à 1949. Celui-ci a édité et commenté de nombreux textes essentiels pour l'étude des relations de l'Église et des esclaves au XVIIième siècle, émanant, pour l'essentiel, de sources manuscrites conservées aux Archives Nationales ou dans les Archives privées des Lazaristes (Paris) et dans celles de la Congrégation de la Propagande (Rome).
|
Remerciements

Je remercie vivement les personnes qui ont bien voulu me permettre l'accès aux archives privées dont elles ont la propriété ou la responsabilité, en particulier Mgr. Guibert et Mgr. Aubry, respectivement ancien et actuel évêque de la Réunion, et les prêtres du clergé diocésain ; la T.R. Mère supérieure Générale des Filles de Marie et le P. Niouaille, à Saint-Denis le P. Bernard Noël, archiviste des Pères du Saint-Esprit à Paris ; le F. Raphaël Berrou, qui m'a communiqué à Port-au-Prince un manuscrit conservé par les Frères de l'Instruction Chrétienne ; Mmes, Mlles et MM. de Villèle (archives des familles de Villèle et Desbassayns), M. Ricquebourg (archives de la famille Brunet). J'exprime aussi ma reconnaissance aux Archivistes des Dépôts de Rome, de l'Île Maurice, de la Réunion et de Paris qui ont eu l'amabilité de me guider dans mes recherches.
Introduction

Dans un colloque dont les deux axes de réflexion sont les minorités et les questions religieuses, il nous a semblé que le problème de la religion des esclaves de Bourbon Pouvait se rattacher à l'un et à l'autre débat. En jouant sur le mot "minorité", il serait aisé de dire que, pour l'esclave, elle est éternelle ; l'âge adulte ne lui est reconnu que par l'affranchissement. L'infantilisation du captif, son humiliation, sont conçues par les lois et la société coloniales comme l'un des remparts de l'ordre. Insérés dans une population chrétienne, ces "enfants" vont-ils recevoir le message évangélique ? Y aura-t-il volonté de christianisation de la part des autorités administratives, des maîtres, du clergé ? Ne doit-on, a priori, se demander si de la fin du XVIIème au milieu du XIXème siècle il est envisageable qu'une majorité d’esclaves de Bourbon aient eu la possibilité de vivre chrétiennement et de recevoir une formation religieuse ? Une réponse affirmative signifierait que l'institution servile y a été particulièrement originale. Si l'on retient comme seul critère le baptême, tous les esclaves qui vivent dans l'île sont-ils chrétiens ? Si quelques autres exigences s'ajoutent à celle-ci, que devient le nombre de fidèles véritables ? Dépasse-t-il à certains moments et en certains lieux le niveau d'une infime minorité ?
À la demande de l'Académie de la Réunion, et en hommage à Mgr. Mondon, nous avons présenté à Saint-Denis, en avril 1980, quelques réflexions sur ce sujet. Nous essayons d'en développer aujourd'hui la substance. Il y a plus de quarante ans, Herbert Mondon fait une communication sur "l'Esclavage et le clergé à Bourbon (Aperçu historique)" [1]. L’histoire de la Réunion en est alors à ses balbutiements l'auteur peut s'appuyer sur quelques ouvrages anciens et sur les premières recherches d'Albert Lougnon, mais il n'a pas le loisir d'explorer les dépôts d'archives ; et les travaux des Pérotin, Barassin, Scherer, Wanquet et quelques autres sont encore à venir. En trente pages Mgr. Mondon trace les principales étapes du peuplement de Bourbon., de son histoire religieuse et des rapports du clergé avec les esclaves. À notre arrivée à la Réunion, en 1968, ce texte est l'un des premiers qui nous ait introduit à la connaissance de l'île, tout en nous invitant à méditer sur un problème historique fondamental. [2]
Au moment où se réunit ce colloque, nous n'avons pas connaissance du travail que Claude Prud'homme est en train de rédiger sur l'Église réunionnaise au XIXe siècle mais nous avons eu l'occasion d'en suivre les étapes préliminaires et pensons que la contribution apportée au sujet sera essentielle [3].
Naïve ou outrecuidante, une question nous obsède : l'étude des esclaves est-elle plus aisée que leur gouvernement ? La tentation première de l'historien comme du maître est de simplifier le propos. L'esclave s'achète, s'entretient, s'use, se vend, ou se perd. Il est rouage -voire moteur- de l'économie. La familiarité de l'institution servile, qu'elle soit pratique de vie ou pratique d'archives, pousse à ne considérer d'abord qu'une nature dans l'esclave, celle d'outil de production. Mais, quotidiennement, une nature irréductible, celle d'homme, dérange l'ordre des ateliers et les schémas d'explication. Cette ambivalence n'est confortable ni pour le maître ni pour l'historien, qui constatent qu'on peut privilégier tels types d'esclaves ou tels documents mais qu'il est impossible de commander absolument aux uns et aux autres. vus de près, parfois Passés au tamis d'une lecture au second degré, d'innombrables textes montrent comment ce dialogue entre les deux natures est perçu par les négociants, les Propriétaires, les administrateurs, les prêtres -parfois par les esclaves eux-mêmes, ces faux silencieux- et comment il modifie la réalité institutionnelle et économique de l'esclavage. Pour illustrer ce dualisme, aucun champ n'est sans doute plus riche à fouiller, dans le domaine colonial européen, que celui de la christianisation de l'esclave et de ses conséquences.
Église et esclavage : le débat théorique.

Réunis en concile, les évêques de la Province de Bordeaux et ceux des jeunes diocèses coloniaux déclarent en 1853 : "L'Église catholique a toujours déploré le dur esclavage dans lequel on retenait une multitude d'hommes pour la perte de leurs âmes (...) elle n'a cessé de travailler à remédier à un si grand mal (...). Nous nous réjouissons dans le Seigneur du bienfait capital accorde à tant d'hommes qui, bien que d'une couleur différente, sont nos frères en Adam et en Jésus-Christ, et paraissent vouloir user de la liberté si longtemps désirée pour acquérir la liberté des enfants de Dieu" [4].
Jamais, peut-être, la hiérarchie catholique n'a exprimé une condamnation si nette de l'esclavage. Celle-ci intervient, il est vrai, opportunément, cinq ans après l'Émancipation : il n'y a plus d'esclaves dans les colonies françaises qui pourraient en tirer argument pour se révolter ; ni de maîtres pour vilipender les clercs.
En revanche, avant 1848, le thème de la "liberté des enfants de Dieu" est maintes fois utilisé pour légitimer la servitude ; celle-ci apporte les bienfaits de celle-là, les Noirs en éprouvent "un bonheur inestimable", estime le P. Pelleprat au XVIle siècle [5]. En 1845, l'abbé Rigord reprend en écho : "on est porté à considérer la traite comme un fait providentiel (...) Que de milliers de ces malheureux ont trouvé dans la servitude la liberté des enfants de Dieu !" [6]. On aurait tort de ne voir dans ces formules que pieux jeux de mots. Plus d'un souverain chrétien ne justifie pas autrement l'esclavage, semblant préférer le langage des prêtres à celui des marchands. Louis XIII eut, écrit le P. Labat, "toutes les peines du monde à consentir que les premiers habitants des îles eussent des esclaves, et ne se rendit (...) que parce qu'on lui remontra que c'était un moyen infaillible, et l'unique qu'il y eut, pour inspirer le culte du vrai Dieu aux Africains" [7]. Le lien entre esclavage et christianisation étant implicitement admis, il reste à en tirer les conséquences pour les protagonistes. Louis XV évoque une sorte de contrat moral, aux termes duquel on ne peut refuser aux victimes de la traite les voies d'accès au salut : "Les rois doivent à Dieu l'offrande et l'hommage des peuples qu'il a soumis à leur empire, ce devoir devient plus étroit dans les colonies, par la dette du souverain envers les esclaves (...) qui n'ont pu perdre leur liberté que pour l'espérance meilleure des biens futurs" [8]. Louis XVI, pour sa part, semble avec quelque cynisme apporter plus d'attention aux vertus terrestres du christianisme qu'à ses buts lointains, quand il écrit au gouverneur de Guyane : "C'est surtout par le frein que la religion impose que peuvent être contenus les esclaves, trop malheureux par l'esclavage même, et également insensibles à l'honneur, à la honte et aux châtiments" [9].
Le fonctionnement de l'institution servile fait-il peu à peu dériver les points de vue ? La théorie initiale n'est sans doute pas reniée et Louis XIII n'est pas le seul à considérer que le but de l'esclavage est la christianisation ; bien d'autres que Louis XV estiment que cette christianisation est un devoir pour le souverain ou ses représentants, ainsi à Bourbon, Poivre invite Crémont à s'assurer que les maîtres ont soin de dédommager les esclaves "de la perte de leur liberté par la connaissance de la religion" [10]. Mais plus nombreux sont sans doute ceux qui, comme Louis XVI, évoquent en premier lieu les vertus policières de l'évangélisation : les habitants de Maurice, par exemple, adressant en 1828 une pétition à leur gouverneur, déplorent que leurs "esclaves absolument sans religion" ne soient "pas retenus par ce frein, qui est en même temps le plus doux et le plus fort qui puisse être imposé aux hommes" [11]. Dans cette perspective, salut de l'esclave et salut de l'institution servile vont encore de pair, même s'ils intéressent inégalement les responsables de l'ordre public ou domestique. Il est d'autres analyses moins rassurantes, telle celle de Milius, gouverneur de Bourbon de 1818 à 1821, qui écrit dans un rapport officiel :
- "Ce n'est ni dans la religion, ni dans la vertu, ni dans l'honneur qu'il faut chercher un contre poids aux vices de ces natures sauvages ou peu civilisées. Elles ne connaissent ni principe ni frein ; un seul existe : c'est l'autorité du maître. Cette force peut seule comprimer leur naturel mais jamais le réduire" [12].
Le même Milius, nous le verrons, s"emploie en agent zélé de la Restauration à ramener -ou à amener- l'esclave à la pratique religieuse. Duplicité sans doute pas, mais obéissance aux ordres, sans abandon d'une conviction fondée sur la pratique : il n'y a pas d'honneur pour l'esclave ; Louis XVI avait énoncé le même principe, mais le roi et le gouverneur ne proposent pas le même remède pour le maintien de la paix sociale. D'autres administrateurs vont plus loin et laissent entendre qu'au strict regard de leurs responsabilités gubernatoriales, la religion de l'esclave n'est pas qu'un colifichet inutile, elle peut être une arme mortelle. Cette découverte, qui contredit durement les théories initiales, exprime-t-elle l'abîme qu'il y a entre celles-ci et la pratique quotidienne de l'esclavage ? Le témoignage d'un gouverneur des Antilles pourrait le faire penser. Le fait qu'il intervienne avant celui de Milius, et même avant le texte de Poivre auquel nous avons fait référence, montre que la progression chronologique du raisonnement n'est que partielle. Ce dernier se fonde sur des expériences différentes : le milieu servile et l'encadrement religieux des Mascareignes ne sont pas identiques à ceux des Antilles ; les témoins, en outre, sont plus ou moins discrets sur leur sentiment profond, et sont plus ou moins lucides ou opportunistes. C'est en 1764 que le Ministre de la marine reçoit une lettre du gouverneur de la Martinique dans laquelle celui-ci lui expose qu'il est arrivé dans l'île "avec tous les préjugé d'Europe contre la rigueur avec laquelle on traite les nègres". Mais, au fil des jours, l'opinion du gouverneur évolue : il est désormais certain qu'une discipline "très sévère est un mal indispensable" ; il admet, certes, les principes selon lesquels on doit aux esclaves un enseignement religieux, "mais la saine politique et les considérations humaines les plus fortes s'y opposent". Lui-même hésiterait à laisser conduire à Dieu ses propres esclaves, s'il ne craignait que "les moines ne mandent en France" qu'il ne croit pas en sa religion. Pourtant, affirme-t-il, "ma croyance est dans mon intérieur, et mes principes de gouvernement et de politique appartiennent à l'État", ceux-ci et celle-là sont sans doute peu conciliables puisque le gouverneur, après avoir sollicité le secret, conclut qu'il faut mener les esclaves "comme des bêtes et les laisser dans l'ignorance la plus complète", car, s'il arrive jamais "une révolution dans les colonies par les nègres (...) elle n'arrivera que par les corps monastiques" [13].
De fait, certains ecclésiastiques, moins habiles casuistes que le gouverneur de la Martinique, font mal le partage entre leur foi et leurs devoirs. Loin de prôner l'ignorance pour les esclaves, ou de s'en tenir aux enseignements rassurants d'un catéchisme de la soumission, ils proclament les vertus explosives de l'Évangile : il faut expulser le P. Michel de Vesoul qui, à Saint-Domingue, prêche ouvertement en chaire contre l'esclavage ; le même sort est réservé à des Capucins de l'île Saint-Christophe qui, affirmant que des enfants chrétiens ne pouvaient être esclaves, "baptisaient les petits noirs comme libres" [14]. Et l'abbé Raynal ne semble-t-il pas souhaiter l'Apocalypse quand il écrit : "Où est-il ce grand homme que la nature doit à ses enfants vexés, opprimés, tourmentes (...) ? Tous leurs tyrans deviendront la proie du fer et de la flamme" [15]. Bourbon, bien qu'il soit peut-être difficile d'y trouver un exemple aussi extrême d'éloquence, offre, à travers une masse considérable d'archives publiques et privées, une palette très variée pour l'étude des problèmes posés par la christianisation des esclaves [16].
Nègres : païens ou nègres chrétiens ?

La main-d'oeuvre est asservie plus tard dans les colonies françaises de l'Océan Indien qu'aux Antilles. On peut même lire dans les "Statuts, ordonnances et règlements (... pour) l'île de Madagascar et adjacentes" qu'il est "très expressément défendu de vendre aucuns Habitans Originaires du pays comme Esclaves, ni d'en faire traffic, sur peine de la vie" [17]. Cependant les serviteurs malgaches venus à Bourbon comme libres y connaissent, pendant les dernières décennies du XVIIe siècle, un asservissement progressif. Fait lourd de symbole pour notre propos, c'est un moine qui vend, en 1687, à un habitant de l'île, le premier esclave nommément cité. Bientôt des traites massives vont arriver de Madagascar, de l'Inde et d'Afrique [18].
Aux Antilles, le Code Noir de 1685 stipule que les habitants "qui achètent des nègres nouvellement arrivés "doivent en avertir dans les huit jours les autorités, qui "donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable" [19]. Les lettres patentes de 1723, qui jouent pour les Mascareignes le rôle de Code Noir, confient aux habitants eux-mêmes le soin de "faire instruire et baptiser" leurs esclaves nouveaux [20]. Faut-il voir dans ce changement de libellé, différence fortuite ou intention précise ? Il est tentant de penser qu'en une quarantaine d'années une évolution analogue à celle que nous avons rencontrée au sein du débat théorique s'esquisse au niveau de la législation. Le postulat de la christianisation de l'esclave reste affirmé, mais en accordant plus d'initiative aux colons des Mascareignes qu'à ceux des Antilles, l'administration montre peut-être qu'elle s'y intéresse moins, ou qu'elle cherche à ne plus y engager sa responsabilité. Le consentement de l'intéressé, son niveau de formation, sa piété ne retiennent d'ailleurs pas l'attention du législateur, mais les règlements s'attachent à ce que la pratique religieuse soit ostentatoire.
À lire tel mémoire de Feuilley qui, au début du XVIIIe siècle, mentionne que les esclaves de Bourbon sont tous "catholiques romains" comme leurs maîtres, on pourrait croire que l'île abrite une population fervente. Le baptême semble avoir été donné systématiquement aux domestiques malgaches libres du XVIle siècle et aux esclaves des décennies suivantes. Ces derniers doivent obligatoirement assister à la messe les dimanches et jours de fêtes, s'ils s'y dérobent, "on leur donne le chabouc, quy est les attacher à un poteau et les fouetter". Au cas où l'absence serait imputable au maître, celui-ci serait puni d'amende, voire de cachot [21]. Mais on ne s'inquiète pas de la portée réelle de cette prescription, à une époque où le hasard seul conduit, et retient parfois, un prêtre dans l'île. Celle-ci vit, non sans heurts, "l'ère des Aumôniers d'occasion", dont la présence plus ou moins passagère et les activités plus d'une fois pittoresques ont été étudiées par le P. Barassin [22]. Ces prêtres ont sans doute rarement le temps de s'occuper des esclaves, sinon peut-être quand ils recourent aux services de ceux qui sont "mis à leur disposition par les autorités locales" [23]. Le témoignage de celles-ci indique que les maîtres eux-mêmes sont de piètres chrétiens : ainsi Drouillard écrit de ses administrés que "la vie qu'ils mènent est comme si elle était païenne sans foi et sans loi" [24]. Le cardinal de Tournon, faisant escale à Bourbon en 1703, s'émeut, quant à lui, "de la grossièreté des moeurs, de l'insuffisance du pasteur", et attire l'attention de Rome sur ce problème [25].
L'arrivée des Lazaristes en 1714 va modifier les données de la vie religieuse. Le P. Renou, premier préfet apostolique de Bourbon, estime que si Saint Vincent de Paul souhaitait que "le salut des pauvres gens de la campagne" préoccupe ses disciples, ceux-ci doivent à plus forte raison se pencher sur le sort de ceux que "leur esclavage et leurs misères (...) rendent méprisables aux yeux des hommes". Les esclaves font, écrit-il, "l'objet de ma plus grande tendresse et de mes soins les plus empressez" [26]. La Métropole seconde cependant assez mal ces efforts quand, en 1712, le P. Bonnet, supérieur général, a donné ses recommandations aux Lazaristes désignés pour Bourbon, il n'a évoqué qu'en termes fort vagues ce que serait leur mission auprès des esclaves [27]. La même année, le Secrétaire d'État à la Marine s'est inquiété, avec un zèle aussi louable que mal informé, de savoir si les quatre prêtres qu'il allait envoyer dans l'Île suffiraient à "desservir les églises des françois et faire des missions chez les naturels du pays", ignorant à l'évidence que ces derniers n'existent pas. La Compagnie des Indes néglige ses engagements : elle devait fournir à chaque Lazariste une portion congrue de 300 livres et les services d'un esclave, or les prêtres se disent démunis de tout. On veut, écrivent-ils, les faire "vivre de l'air du tems", ils sont "à la veille d'aller tout nuds faute de toile", et d'ajouter que leurs frais d'installation ont été considérables. Au nombre de ces frais, ils mentionnent l'achat et l'entretien d'une main-d'oeuvre servile [28].
La possession d'esclaves n'est pas pour le clergé chose nouvelle ; dans maintes colonies il en dispose déjà et sait, à l'occasion, les conduire avec vigueur [29]. La dépendance ainsi établie peut favoriser l'évangélisation, mais la propriété, ou la direction, de "nègres" insèrent plus étroitement les prêtres dans un système disciplinaire dont les exigences risquent de ne pas concorder avec celles de la mission religieuse. Criais, successeur de Renou à la préfecture apostolique, expose par exemple comment il a dû faire courir sus à douze marrons, c'est à dire à la moitié du groupe d'esclaves qui "avoient été accordés pour la construction de l'église et du presbitère de St. Denis" [30]. La vie quotidienne peut être aussi l'occasion de dangereuses promiscuités. Le supérieur général avait écrit dans ses Instructions de 1712 : les Lazaristes de Bourbon "observeront comme un ordre inviolable de la religion, de leur conscience et de leur honneur ce point que jamais ils n'auront de femme à leur service". Dès 1721, le P. Houbert, curé de Sainte-Suzanne, explique que, malgré cette défense, les prêtres ont dû acheter des femmes car "une fâcheuse expérience" leur a montré que les esclaves qui défrichent leurs jardins et entretiennent leurs maisons "ont besoin d'être mariez". C'est donc, poursuit le P. Houbert, "un mal nécessaire qu'il y ait des négresses dans notre domestique, et c'est à nous à prendre toutes les précautions que la crainte de Dieu doit nous inspirer pour éviter les inconvénients qu'on a sujet de craindre" [31]. En voulant combattre le vagabondage amoureux de leurs esclaves, les Lazaristes s'exposent aux tentations que connaissent ordinairement les maîtres. À supposer que les femmes de la première génération ne soient admises que mariées, il est vraisemblable qu'elles auront des filles qui grandiront au foyer du prêtre, et ne seront pas forcément vendues ou mariées dès l'âge nubile [32]. Cet aspect, non négligeable pour la sérénité morale des ecclésiastiques, n'est d'ailleurs qu'une des facettes de l'immense problème que pose la vie conjugale aux sociétés fondées sur la servitude. Les Lazaristes ne vont pas hésiter à faire du mariage de l'esclave l'une des clefs de son accession au christianisme, risquant du même coup de lui en interdire à jamais le bénéfice.
Au début du XVIIIe siècle, estime le P. Barassin, les esclaves avaient "une vie familiale et religieuse normale : baptême, catéchisme, offices, mariage solennel, sépulture chrétienne" [33]. Même si, nous l'avons vu, les lacunes de la pratique religieuse des maîtres peuvent faire douter du contenu de cet apparent âge d'or, il est vraisemblable que l'âge suivant a été pire. Les registres paroissiaux de Saint-Paul montrent, par exemple, que de 1735 à 1756 près de la moitié des naissances serviles du quartier sont légitimes, c'est à dire se produisent dans des foyers d'esclaves mariés ; en 1780, les naissances légitimes ne représentent plus que 5% du total [34]. Au nombre des ateliers où les esclaves se marient encore, se trouvent ceux de Madame Desbassayns, principale propriétaire de la région : en 1789, il existait chez elle, lit-on dans le Journal de la paroisse de Saint-Gilles les Hauts, "plus de cinquante ménages ainsi constitués entre jeunes gens qui eux-mêmes étaient le fruit d'unions légitimes plus anciennes" [35]. La famille Desbassayns, renforcée par une alliance matrimoniale avec le futur ministre de Villèle, va bientôt étendre son influence, mais le soin qu'elle apporte à la vie morale et religieuse des esclaves semble, à cette époque, rencontrer peu d'imitateurs. Les mariages serviles s'expliquent partiellement par les scrupules religieux de quelques maîtres, mais plus sans doute par d'autres facteurs : sur les grands domaines où réside la famille du propriétaire, ils introduisent un élément de régularité dans les moeurs et de stabilité dans le travail ; ils sont d'autant plus aisés que le groupe d'esclaves d'une habitation est plus important et que l'équilibre des sexes y est mieux respecté [36]. Or, tandis qu'en moyenne générale le nombre des esclaves mâles est plus considérable que celui de leurs compagnes potentielles, Criais constate qu'il existe "quantité d'habitants, surtout des pauvres, qui n'ont que des négresses sans noirs, ou cinq ou six négresses avec un seul noir" [37]. Si cette répartition paradoxale est aussi répandue que le préfet apostolique le suggère, le déséquilibre des sexes sur les plantations où dominent les hommes en est d'autant aggravé et les mariages deviennent, dans l'un et l'autre type d'habitation, d'autant plus difficile. Le XVIIIe siècle, prolongé par le premier tiers du XIXe, étant une période de traite intensive, un certain accaparement de "nègres nouveaux" adultes a pu être réalisé par des propriétaires fonciers ou des entrepreneurs dont les tâches, l'esprit de spéculation et les moyens financiers l'emportaient sur ceux des habitants pauvres. Les hommes sont en effet préférés pour nombre de travaux rudes et leur prix moyen se situe à un niveau plus élevé que celui des femmes. Si le vagabondage nocturne permet bien des rencontres, il ne règle pas le problème des unions légales. Celles-ci imposent déjà des contraintes au maître des deux futurs conjoints, par exemple celle de ne plus pouvoir les vendre séparément ; quand l'homme et la femme n'appartiennent pas à la même personne, s'y ajoute la difficulté, souvent grande, d'un transfert.
Les esclaves ne trouvent pas eux-mêmes que des avantages à se marier. Dans quelques cas le refus de l'union peut être motivé par le refus de la descendance : le P. Dutertre cite le cas d'une jeune esclave des Antilles qui garde résolument sa virginité et refuse l'époux qu'il lui propose. "Je me contente, dit-elle, d'être misérable en ma personne, sans mettre des enfants au monde qui seraient peut-être plus malheureux que moi" [38]. La population servile connaît d'ailleurs l'usage d'autres moyens qui permettent d'éviter les naissances, fussent-elles ou non légitimes : l'auteur d'un mémoire sur Bourbon, cité par C. Wanquet, y voit en 1785 la principale cause de l'échec de la politique nataliste des autorités. Si l'analyse est juste, elle traduirait à la fois l'ampleur des pratiques d'avortement et la hantise de la transmission de l'esclavage, celle-ci exprimée, de façon frappante, en termes presque analogues à ceux employés, au XVIIe siècle, par le P. Dutertre : "La plupart de ces femmes détruisent leur fruit ne voulant pas mettre au monde des enfants aussi malheureux qu'elles" [39]. Si l'un des problèmes posés à l'esclave par le mariage peut être résolu par l'avortement, bien d'autres paraissent sans remède. Ceux qui sont liés à la vie familiale se posent d'ailleurs de façon identique pour les couples illégitimes dotés de quelque stabilité : médiocrité des notions d'autorité et de responsabilité des parents, risque d'assister -ou de devoir participer- à des traitements inhumains infligés à des êtres proches, risque d'être séparé pour toujours des enfants (à Bourbon, ils peuvent être vendus légalement dès l'âge de sept ans), risque enfin d'être freiné dans ses élans de révolte ou de fuite par la présence d'otages. La cohabitation avec un conjoint légitime présente aussi des inconvénients spécifiques : celui d'être privé de liberté, dans un des rares domaines ou l'esclave peut en jouir ; celui -si l'on est fille et jolie- de se voir interdire la voie royale d'accès à la promotion et à l'affranchissement qui est luxure au concubinage avec les puissants. Il est même des maîtres zélés qui s'inquiètent de la fidélité des époux : Milbert, évoquant le "mariage des nègres" à l'Île de France, indique qu'on leur recommande, lors de la cérémonie, "l'affection et la fidélité réciproques, en menaçant de punition exemplaire celui des époux qui se comporterait mal envers l'autre", ladite punition se ramenant, comme pour la plupart des délits de l'esclave, au fouet du commandeur [40].
Pareille pudibonderie sied mal à la société blanche des Tropiques qui, partout où elle a implanté et dominé des groupes serviles, a succombé à la licence. De multiples témoignages montrent que, dans l'Île Bourbon du XVIIIe siècle, la facilité des aventures amoureuses et des liaisons durables avec les esclaves détournent beaucoup d'Européens et de Créoles du mariage [41]. Ce sacrement y acquiert ainsi une ambiguïté supplémentaire. Prestigieux pour l'esclave, dans la mesure où il le rattache au modèle blanc, où il constitue une sorte de certificat d'assimilation -c'est à dire de civilisation- le mariage ne risque-t-il pas d'être déconsidéré si ceux qui l'ont créé le négligent ou n'en font qu'un emploi sacrilège ? La question, nous le verrons, pourra se poser, de façon plus générale, pour la pratique religieuse. Le problème du sacrement de baptême, en revanche, se présente en termes très différents pour la population blanche et pour les esclaves, dans la mesure où chaque arrivée de négrier introduit sur l'île un certain nombre de "nègres payens" de tout âge.
Le journal tenu par Dejean, lors de la traite effectuée à la côte orientale d'Afrique par la Vierge de Grâce, montre qu'au Mozambique la formalité du baptême est obligatoirement accomplie avant que le navire ne lève l'ancre. "Le Curé, note Dejean (...), veut baptiser tous nos noirs, nous ayant mandé que cela luy appartienne de droit", et le marchand de poursuivre, non sans malice, "Quelle Rigidité à l'Isle de Bourbon, quel relâche icy ! Il faut sans doute que l'extrait des Conciles qu'on a envoyé en Portugal diffèrent de ceux qu'on a envoyé en France". Renseignements pris, Dejean constate que si les prêtres portugais sont si empressés à revendiquer le monopole du baptême de tous les "nègres" embarqués -alors qu'un aumônier français se trouve à bord- c'est qu'ils perçoivent un droit sur chaque tête. Tout en essayant d'obtenir un rabais, le marchand conclut à "la profanation du premiers des sacrements ; car baptiser des gens qui ne sçavent pas peut-être encore qu'il y ait un Dieu c'est faire un jeu de notre croyance" [42]. L'allusion faite par Dejean à la rigidité du clergé de Bourbon, au sujet des baptêmes, est confirmée par les Lazaristes. Considérant que tout esclave adulte devenu chrétien tombera nécessairement dans le péché de chair s'il n'est pas marié, ces prêtres préfèrent refuser le baptême s'ils ne peuvent offrir, en même temps, le bienfait du sacrement de mariage. Le P. Caulier, qui vit à Bourbon de 1749 à 1771, rassemble dans un "Coutumier", destiné à ses confrères et approuvé par le Préfet apostolique, les "usages des missionnaires" de l'île. Concernant les esclaves de traite récemment arrivés, deux cas de baptême sont prévus : celui des "enfants de cinq à dix ans, en recommandant aux maîtres de les faire instruire promptement", et celui des "adultes qui arrivent malades, s'ils sont en danger", danger pressant, s'il en est, puisque le P. Caulier évoque un peu plus loin la difficulté de se faire comprendre de ces "pauvres moribonds". Les Lazaristes n'ignorent pas que les esclaves venant des possessions portugaises ont pu recevoir un simulacre de sacrement, "ondoiés sans instruction, sans désir du baptême, sans connoissance", dans ce cas, tranchent-ils, "il faut réitérer le baptême, ou plus tôt le leur conférer". Si un doute subsiste sur la validité de ce premier et "prétendu baptême", on le renouvellera "sous condition", non sans avoir essayé d'instruire les postulants "des principaux mystères de la religion". Le P. Caulier traite à part des autres esclaves adultes, sous-entendant, par là même, qu'il s'agit de ceux qui sont dans l'île depuis plus longtemps -et sans qu'on puisse exclure l'hypothèse qu'il y a parmi eux des esclaves créoles non baptisés, dont la naissance, négligée ou dissimulée par le maître, aurait échappé à l'attention du clergé paroissial. L'auteur du Coutumier indique qu'il "n'est pas d'usage d'admettre au baptême" ces esclaves adultes, sauf s'ils sont très âgés, "habituellement infirmes", ou sur le point de se marier "après avoir été instruits et préparés de longue main" [43].
Nous avions remarqué, d'emblée, combien risquaient d'être compromises les possibilités d'accès de l'esclave au christianisme, si l'une des clefs en était le mariage. Le texte de Caulier révèle, à cet égard, deux faits d'importance : le premier est la naissance d'une sorte de cérémonie mixte -nous serions presque tenté de dire de sacrement mixte- réservée aux esclaves. Pour eux, "on joint ces deux sacremens-, on les baptise avant la messe, on publie au prône un ban, on les déclare dispensés des deux autres en faveur du baptême, on les fiance après vespres, et on les marie le lendemain" [44]. Le second fait est la constatation formelle qu'il y a des esclaves destinés à rester éternellement hors du christianisme, quelle que soit l'ancienneté de leur implantation à Bourbon. Fait qui, contrairement aux engagements royaux, aux prescriptions administratives et aux déclarations solennelles, est énoncé sans masque ; fait qui ne semble donc plus susceptible de provoquer indignation ou sanction. Par une sorte de discours schizophrène, d'aucuns qui continuent à justifier l'esclavage parce qu'il est seule voie vers Dieu, dénoncent comme mascarade le baptême expéditif qui sauve, à défaut d'instruire : ainsi Dejean, d'un même souffle, vilipende les prêtres portugais mais se félicite d'une heureuse tractation qui lui a permis d'obtenir deux captifs en échange d'un "proffit pour la Comp(agnie) et pour l'Église puisque, pour un âme que nous remettons à son premier sort, nous en sauvons deux. Qu'on doutte après que nous ne faisons de bonnes âmes !" [45]. Comme Caulier, le Préfet apostolique Teste montre que les Lazaristes ont renoncé à considérer chaque esclave comme un chrétien potentiel et qu'entre les trois maux du baptême parodique, du péché de concubinage et de l'état de paganisme, ils choisissent le dernier. Ainsi se trouve reconnue une catégorie d'esclaves que le législateur n'avait pas prévue. Elle apparaît par exemple dans cette énumération de Teste, qui distingue des "nègres esclaves, tant indiens que caffres, madégasses ou insulaires, dont partie sont chrétiens, partie cathécumènes, partie payens sans religion" [46]. Bourbon n'a pas le monopole de cette renonciation à la conversion au début du XIXe siècle, Milbert observe qu'à l'Île de France, "dans les habitations bien tenues, on a soin de faire faire la prière aux noirs qui ont été baptisés ; on laisse aux autres l'exercice complet de leur culte" [47].
Si l'accès au baptême est raréfié pour des raisons de principe, il l'est aussi pour des raisons pratiques : l'obstacle de la langue n'est pas l'une des moindres. En 1714, pour une population blanche de 623 individus, le groupe servile n'en comptait que 534. Celui-ci, beaucoup plus par la traite que par les naissances, connaît ensuite une croissance rapide : il y a 6 573 esclaves en 1735, 21 047 en 1767 et environ 54 000 en 1808. Les travaux d'A. Toussaint et de J.-M. Filliot ont montré la diversité des lieux d'origine de ces esclaves et ont permis de mieux connaître la chronologie des arrivées : de 1769 à 1810 les Mascareignes auraient ainsi fait entrer à peu près 115 000 captifs, dont une cinquantaine de mille à Bourbon et le reste à l'Île de France [48]. Quand les '"noirs de traite'' débarquent à l'article de la mort, les Lazaristes essaient de trouver un interprète ou se munissent d'un cahier où est inscrite la traduction "des principaux mystères de la religion". En revanche, dès que les esclaves sont implantés dans l'île, les missionnaires attendent, pour les accueillir, qu'ils aient fourni un effort linguistique qui doit être considérable, les quelques notions de créole -vite apprises aux "noirs nouveaux" pour les gestes élémentaires de la vie quotidienne et du travail- étant sans commune mesure avec les abstractions imposées par l'apprentissage d'une religion. Il "est d'usage, émit le P. Caulier, de ne point recevoir les esclaves des habitans pour les instructions préparatoires au baptême et au mariage qu'ils n'aient une connoissance particulière ou passable de la langue" [49]. Commence alors un long travail, étendu parfois sur des années, qui fait surtout appel à la mémoire. Lors de séances, organisées à l'issue des messes ou au hasard de rencontres, les postulants écoutent, et répètent, les formules d'un catéchisme élémentaire [50]. Les maîtres sont invités à participer à cet effort en envoyant leurs esclaves aux instructions, mais aussi en se livrant à un travail préparatoire car ces derniers n'y sont acceptés "qu'ils n'aient étés dégrossis chez leurs Maîtres pour les prières du catéchisme" [51]. Les propriétaires ne sont guère tenus que par des prescriptions réglementaires, d'autant plus souvent répétées qu'elles sont sans doute moins suivies. Expérience quotidienne et débat théorique semblent conjuguer leurs efforts pour faire de la christianisation de l'esclave un souhait, dont on espère qu'il continuera à masquer ce que l'institution servile a de honteux, mais qui est de plus en plus dépourvu d'application. Les esclaves qui reçoivent le choc d'un monde nouveau, doivent faire l'apprentissage de tous les codes. Le compte des traumatismes et des révoltes serait long à dresser mais il n'entre pas dans le présent propos ; peu à peu le noyau, plus ou moins étroit, se forme de ceux qui semblent à la fois les plus soumis et les plus doués pour un vertigineux saut culturel. L'accès à Dieu peut alimenter le rêve de l'assimilation, c'est à dire de la promotion, et peut-être un jour de l'affranchissement par les voies du travail, de la vertu et de l'imitation scrupuleuse du modèle blanc. Deux problèmes majeurs se posent alors : le premier tient au dosage qu'il convient de réaliser entre "sauvagerie" et civilisation pour que, tout en étant "aliéné" et coupé de ses racines, le néophyte reste à jamais à distance respectueuse de son modèle ; le deuxième tient au comportement religieux du modèle lui-même.
Dans un mémoire adressé en 1772 à l'archevêque de Paris, un Lazariste mentionne qu'il a vu à Bourbon, parmi les chefs de famille, un "bon nombre servir eux-mêmes leurs esclaves malades, les veiller la nuit, leur parler de Dieu et de l'Éternité,s'affliger amèrement sur leur état ; en un mot, ne rien épargner pour leur traitement corporel et spirituel" [52]. Comme nous l'avons vu pour le mariage des esclaves, il peut se trouver, lors de leurs maladies, des maîtres qui sachent concilier humanité, croyances religieuses et intérêt bien compris ; le pourcentage en resterait à déterminer. De nombreux témoignages nous inclinent à penser qu'il était faible, au moins en ce qui concerne les motivations religieuses. Dès 1720, le premier Préfet apostolique de Bourbon "implorait les prières" du Général des Lazaristes en faveur des esclaves, "nos travaux auprès d'eux, écrivait-il, n'aient pas eu jusqu'à présent tout le succez qu'il seroit à désirer" [53]. Au cours des décennies suivantes, les plaintes vont se préciser, sans doute à la fois parce que la christianisation de l'esclave est plus difficile mais aussi parce que la prise de conscience de ce phénomène est plus aiguë et que l'interaction de ses trois composantes est mieux perçue : pesanteurs tenant aux Noirs et pesanteurs tenant au mauvais vouloir des Blancs ainsi qu'à leur mauvais exemple. Par référence à un âge d'or primitif -dont le P. Barassin a, nous l'avons rappelé, lui aussi soutenu la thèse - Criais évoque en 1742 la détérioration des croyances et des moeurs. Le Préfet apostolique cite parmi les principaux responsables de cette situation, l'ouverture de l'île aux influences extérieures, la présence de marins et de soldats, l'immoralité des maîtres, et leur peu de souci de la vie religieuse de l'esclave, et l'esprit de spéculation lié à l'implantation du café [54]. Sans nous engager plus avant que précédemment sur le contenu de "l'’âge d'or" de la chrétienté bourbonnaise des débuts du XVIIIe siècle, nous pouvons penser que les mutations de la vie économique ont effectivement entraîné des mutations de la vie religieuse, peut-être dans la forme plus que dans le fond, en ce qui concerne les aspects évoqués par Criais ; mutations plus fondamentales, en revanche, pour une raison sur laquelle il passe et qui est l'afflux de main-d'oeuvre servile, le renversement de plus en plus marqué de la proportion Noirs-Blancs et les évolutions socio-économique, juridique et psychologique qui lui sont liées [55]. Vers la même époque, un frère de Saint-Lazare dresse en termes d'une extrême vivacité le constat de carence de la communauté catholique de Bourbon : paroissiens ivres à la messe, tabernacle plein "de gratures et de crotte de rats", fidèles qui se cachent quand leur curé tente de leur rendre visite, ou qui sortent de l'église quand il monte en chaire, Noirs qui "ne sçave du françois que les juremens et les sotises"... [56]. À la veille de la Révolution, un mémorialiste indique que la plupart des Bourbonnais, à cause du grand éloignement de leur domicile des lieux de culte, "n'ont paru à l'église que lorsqu'on les y a portés pour recevoir le baptême". C. Wanquet, qui cite ce texte, y ajoute divers témoignages sur l'ignorance religieuse et la liberté sexuelle qui règnent dans l'Île. Le sous-encadrement, ajoute-t-il, est manifeste : selon l'accord passé en 1736, la congrégation de Saint-Lazare devait envoyer à Bourbon autant de frères qu'il y avait de paroisses et vingt prêtres ; pour diverses raisons, dont les principales tiennent à la carence de la Compagnie des Indes, ce nombre ne fut jamais atteint : en 1763, il y a treize prêtres dans l'île et onze en 1789 [57].
Le mythe révolutionnaire
et la restauration impossible.

Sous l'Empire, le Supérieur des Lazaristes demande à ce que sa congrégation soit déchargée du souci de l'Île de France et de Bourbon. Dans un mémoire adressé au Ministère des Cultes, qu'il appuie de divers extraits de lettres des missionnaires, il fait observer que les questions temporelles ne sont pas en cause mais que, dans ces Îles, "il y a très peu de bien à faire". Longtemps avant la Révolution, indique-t-il, "elles étaient regardées parmi nous comme extrêmement ingrates, pénibles", et de poursuivre qu'on savait pourtant pouvoir "y faire une espèce de fortune par les plantations plus ou moins florissantes que chaque missionnaire y avait" [58]. En moins d'un siècle, le désenchantement l'a donc emporté : Renou et ses premiers compagnons se plaignaient de difficultés matérielles mais croyaient leur mission possible et une certaine aisance est venue mais la mission s'est engluée, et engluée surtout, pensons-nous, dans et par l'esclavage. L'échec est, à l'évidence, sans relation avec la Révolution française, que le clergé de la Restauration accusera volontiers de bien des maux. "Longtemps avant la Révolution...", est-il écrit dans le réquisitoire dressé en 1808 par le Supérieur, et C. Wanquet montre dans sa thèse que la Métropole n'impose pas, au cours de cette période, sa politique religieuse à la Réunion et que "le clergé catholique n'y fait l'objet d'aucune persécution" [59]. L'expérience lazariste s'achève donc dans l'île : en 1816 les Spiritains acceptent d'y prendre le relais.
Dès 1799-1800, la renaissance religieuse a été encouragée par les autorités car elle pouvait donner une "sorte de caution morale à leur pouvoir". Comme le Premier Consul, les administrateurs locaux pensaient que le clergé devait "contribuer à maintenir l'ordre social et à moraliser les habitants" [60]. Ainsi, par-delà l'épisode révolutionnaire, surgissaient des consignes que l'Ancien Régime avait su aussi exprimer. Il eut été étonnant qu'elles eussent plus d'effet sur la christianisation des esclaves qu'au cours des décennies précédentes. En revanche, certains événements auxquels avaient été mêlés des membres du clergé pendant la Révolution pouvaient laisser à la population servile quelque souvenir d'une époque où l'"ordre social" n'était pas défendu par la totalité des prêtres. La place étonnante qu'occupe encore aujourd'hui le P. Lafosse dans la sensibilité populaire est peut-être révélatrice de la force d'un message qui a pu être recueilli et transmis par des esclaves de son entourage. En 1791, par exemple, le Lazariste affirme que tout homme étant essentiellement libre, on ne peut vendre des esclaves pour payer les dettes de la colonie. Son ardeur révolutionnaire, sa sympathie pour le groupe servile vont s'affirmer lors de maints épisodes. On ordonne finalement son arrestation. Ce n'est qu'au bout de deux jours de recherches qu'on peut appréhender Lafosse, "dont deux esclaves se sont faits les protecteurs" (C. Wanquet). Exilé puis autorisé à rentrer à la Réunion, le prêtre, si l'on en croit certaines traditions orales, aurait été assassiné en 1817 par un riche propriétaire, un "gros Blanc". Actuellement, dans toute la région de Saint-Louis, les "demandes de messe au père Lafosse" seraient nombreuses chaque semaine et il resterait, pour la population, "le prêtre des esclaves, celui qui en son temps se fit leur défenseur, celui dont les esclaves emportèrent le corps après sa mort pour qu'il repose parmi eux, dans leur cimetière" [61].
À des combats politiques récents ont pu faire naître, ou renaître, telle ou telle tradition populaire dont l'ancienneté n'est pas toujours démontrée, il est vraisemblable qu'ils ont avivé aussi certains souvenirs historiques ou, dans quelques cas extrêmes, les ont construits sur des données mythiques [62]. L'intérêt porté au P. Lafosse au cours de ces dernières années par des prêtres et laïcs "de gauche" a sans doute amplifié les résurgences mais, fut-ce par un cours souterrain - et apparemment silencieux pour les historiens qui travaillaient seulement sur des textes -il nous semble que quelques bribes de l'héritage du Lazariste ont cheminé le long de la mémoire populaire pendant près de deux siècles. En revanche, le souvenir de prêtres qui, au cours de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, vont s'occuper des esclaves avec abnégation, voire enthousiasme, n'a pas été conservé dans les traditions orales que quelques chercheurs et nous-même avons pu recueillir : tel est le cas des Pères Minot, Monnet, Levavasseur, Blampin, Collin... Cette "punition posthume", si elle n'est pas fortuite, pourrait traduire l'ancienneté d'une prise de conscience politique, peut-être même la déception devant l'abandon d'un langage révolutionnaire tel que celui de Lafosse. Si les indices de l'ancienneté du culte religieux voué à ce dernier se confirmaient, l'image traditionnelle d'une chrétienté bourbonnaise, soumise et ronronnante au cours du XIXème siècle, devrait être revue. Cette révision s'imposerait d'autant plus que les hardiesses de certains des clercs sanctionnés par l'oubli étaient plus apparentes que réelles et que si des milieux coloniaux avaient pu s'en émouvoir, elles traduisaient en réalité une volonté de conservatisme plus intelligent - donc plus efficace- que celui de la majorité des propriétaires blancs de Bourbon. Cette hypothèse, particulièrement bien étayée par certains documents d'archives privées auxquels nous nous référerons, conduirait à penser, d'une part que la chrétienté servile de Bourbon n'avait pas été insensible aux charges libertaires contenues dans l'Évangile -dont elle avait, un instant, guetté l'explosion- d'autre part que la mémoire populaire est parfois meilleure historienne, dans ses pressentiments et ses ressentiments, que l'histoire officielle [63].
Lafosse aurait été un des très rares à souhaiter, à la Réunion, que la décision d'émancipation des esclaves soit appliquée. Le décret du 16 pluviôse an II avait été écarté résolument par les assemblées coloniales des Mascareignes, la loi du 30 floréal an X en faisait cesser la menace : Bonaparte décidait que l'esclavage serait ''maintenu dans toutes les colonies françaises, conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789" ; Louis XVIII s'en tenait à la même disposition. Ces colonies qui retrouvaient, ou conservaient légitimement, leurs esclaves, avaient de moins en moins de prêtres : un rapport adressé au Ministère en dénombre au début de 1816, dix à la Martinique, sept à la Guadeloupe, cinq à Bourbon, un seul en Guyane et plus du tout dans les Comptoirs de l'Inde, au Sénégal et à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit, au total, 23 prêtres, tous âgés et plus ou moins malades, pour une population de plus de 300 000 habitants, Le P. Janin, qui fait état de ce document, précise : "Il n'y avait eu pourtant ni persécutions, ni désordres (...). De sorte que la disparition du clergé ne vient pas de là. L'unique cause est dans la cessation totale du recrutement" [64]. Le nombre de prêtres qui vivent à Bourbon au début de la Restauration semble, selon les sources, varier de quatre à huit. Plus qu'à des erreurs ou à de légers déplacements dans l'année de référence, il semble que ces différences soient dues à l'appréciation, plus ou moins restrictive, des fonctions que peuvent encore exercer ces clercs. Minot fait partie du groupe d'ecclésiastiques qu'après maintes difficultés les incitations gouvernementales et l'entremise de la Congrégation du Saint-Esprit ont pu constituer en France à l'intention de Bourbon. Évoquant son arrivée dans l'île en 1817, Minot écrira quelques années plus tard à la Propagande : "Nous vous n'y avons trouvé que les six prêtres parmi lesquels il y en a trois de morts, dont deux de ceux-ci étoient alliénés". Venu par le même navore, Pastre, futur préfet apostolique, écrit pour sa part : "Une huitaine de vieillards (...) tel était le personnel du clergé dans la colonie (...) deux seulement, et trois au plus peuvent être de quelque utilité". Témoignages confirmés par le Gouverneur : d'un tel, "on doute s'il a reçu les ordres", tel autre est sourd, tel autre n'a plus sa tête... [65].
De l'état du clergé, on peut induire l'état religieux des fidèles, et tout particulièrement celui des esclaves. Les limites de leur christianisation étaient apparues dès l'époque où les Lazaristes disposaient de l'intégralité de leurs forces physiques et mentales et croyaient leur mission possible. Le bilan dressé par les nouveaux arrivants montre que la dégradation s'est accentuée dans divers domaines. Minot estime que plusieurs régions de l'île ignorent "totalement les principes et la pratique de la véritable religion" et que là où il y a des ecclésiastiques, celle-ci n'est "guère mieux prattiquée" [66]. Cottineau ne voit quelque vie religieuse qu'à Saint-Paul, ailleurs "on est heureux quand on a trois ou quatre personnes qui font leurs pâques. Les églises sont presque désertes les jours de fêtes et entièrement vides les jours ouvrables" [67]. En outre l'état de presque tous les bâtiments de culte est lamentable. Les paroisses de Sainte-Suzanne, Saint-André et Saint-Joseph sont même dépourvues d'église [68]. Les habitations où la pratique religieuse semblait solidement établie sont touchées, ainsi les esclaves de Mme Desbassays se marient moins ; "ici comme ailleurs, commente le P. Meersemann, la Révolution exerça sa funeste influence" [69]. Influence peut-être plus manifeste sur la vie conjugale des Blancs qui, selon le témoignage du P. Cottineau, ont abusé pendant vingt ans de la loi sur le divorce, si bien que dans presque toutes les familles on trouverait des personnes remariées civilement. Quant aux esclaves, précise Cottineau, "le mariage leur est presqu'inconnu et qui plus est leur fait peur. Il n'y a guère que les noirs de plus de soixante ans qui soient unis légitimement" ; dans les autres domaines, le bilan est aussi médiocre : en grande majorité, les esclaves "sont aussi ignorants sur l'article de la Religion que ceux qui arrivent nouvellement d'Afrique et la moitié d'entre eux ne sont pas même batisés" [70]. Plus que quelque idéologie révolutionnaire, dont nous avons constaté la modération, plus même que la raréfaction du clergé, ne faut-il pas accuser de cette dégradation le murissement de potentialités contenues dans l'institution servile ? Le témoignage des Lazaristes avait montré, au cours du XIIIème siècle, le recul progressif de la pratique religieuse, des mariages et des baptêmes serviles. L'effort de "restauration" qui, en France, s'attachait au domaine religieux comme au domaine politique pouvait-il amener au christianisme la masse croissante des esclaves païens de Bourbon et y ramener ses fidèles égarés ?
Le gouvernement de Louis XVIII tente de véritables opérations de racolage au profit des colonies : en 1823 un tiers de leurs paroisses, soit 30 sur 88, manquent encore de curés. La France, certes, a des besoins en prêtres, écrit-on aux évêques métropolitains mais, dans ce domaine, "la détresse des Colonies l'emporte sur toute autre", or, où la religion est-elle plus nécessaire que "dans les pays d'esclavage, dans ces sociétés imparfaites, toujours faciles à ébranler". Pour inciter les clercs à partir, le gouvernement leur donne un trousseau de 600 francs, une indemnité de route jusqu'au port d'embarquement, le passage gratuit sur les vaisseaux du Roi et, à l'arrivée, un traitement de 1 800 à 3 000 francs selon l'importance des paroisses [71]. Malgré ces avantages matériels, les volontaires sont peu nombreux : l'éloignement de la famille et du cadre de vie habituel, les dangers du voyage et de la vie sous les Tropiques, l'incertitude du retour semblent freiner certaines vocations. Quelques-uns s'embarquent, mus par le zèle missionnaire ; d'autres semblent être tentés surtout par l'aventure, le profit ou la liberté plus grande que les colonies passent pour offrir. Il arrive qu'un évêque pousse ainsi un de ses prêtres les moins sûrs à partir. Le séminaire du Saint-Esprit, dirigé par l'abbé Bertout, fournit à Bourbon, en 1824, les trois premiers prêtres qu'il a formés depuis sa réouverture. Ce clergé, spécialement destiné à l'apostolat lointain, devrait être plus fiable, mais il ne suffit pas à la tâche et Bertout doit non seulement assurer le départ de ses élèves aux colonies mais aussi celui de candidats dont il ne peut que rarement vérifier la valeur. Ainsi Minot jugeant six de ses nouveaux confrères, estime que deux qu'a choisis M. Bertout "donnent tous les exemples de vertu ecclésiastique", mais que les quatre autres, "venus de leur propre autorité", ne méritent pas les mêmes éloges [72]. À côté de prêtres de qualité, les sujets douteux ne vont pas, au fil des années, être l'exception. Sans doute ne faut-il pas s'arrêter à toutes les plaintes : les unes trahissent des conflits personnels, d'autres virent des délits d'opinion qui, lorsqu'ils concernent l'esclavage, honorent souvent les accusés. Mais il arrive aussi que supérieurs ecclésiastiques, directeurs de l'intérieur ou gouverneurs reprochent à des clercs l'insubordination, l'avidité, l'ivrognerie ; tel, qui avait feint de partir, est soupçonné de vivre en cachette à Bourbon ; tels autres sont retournés à la vie civile, se marient et se consacrent à l'agriculture ou au commerce [73].
L'exemple de telles conduites peut gêner l'action missionnaire auprès des esclaves mais, par son caractère presque général, l'exemple des laïcs est sans doute plus nocif. Comme au XVIIIème siècle, le "modèle blanc" s'avère défaillant : ce n'est pas que la pratique religieuse -dont nous avons indiqué les limites- qui est en cause, mais aussi bien la volonté des maîtres que le laxisme de la vie quotidienne. Dès 1817, Pastre a fait un constat que ses confrères renouvellent, et expriment en termes à peu près analogues dans leur correspondance :
- ''Les noirs, qui vivent comme les animaux et meurent presque de même, seraient susceptibles de quelque instruction, et même d'un changement de moeurs, si leurs maîtres voulaient tant soit peu nous aider (...) Les Européens qui habitent cette île sont si relâchés dans leurs moeurs et leurs croyances... (que) lorsque nous expliquons les maximes du saint Évangile, on nous jette de suite à la face les exemples de nos malheureux compatriotes" [74].
Il arrive cependant que l'absence de formation religieuse, par conséquent de ''moralisation", soit utilisée comme alibi par les maîtres pour s'opposer à des lois qui restreignent leur arbitraire, ou pis qui semblent annoncer l'émancipation des esclaves. L'antériorité des projets anglais dans ce domaine, place sous les yeux des habitants de Bourbon l'exemple de l'Île Maurice avec laquelle leurs relations sont fréquentes. Les propriétaires d'esclaves s'y insurgent, en 1828, contre des mesures gouvernementales qui tendent à protéger la population servile et prétendent que leur sécurité s'en trouve menacée. Ni les membres de la force armée, ni ceux du clergé, expliquent-ils, ne sont en nombre suffisant pour contenir les esclaves, et ils justifient leur point de vue par la formule suivante : "L'ordre et la sécurité publiques sont dans tous les pays du monde, le résultat de la discipline qui elle-même n'est maintenue que par la force ou la superstition. Ces deux moyens manquent tout à fait à Maurice" [75]. "Force ou superstition", les termes expriment avec ingénuité le niveau d'instruction religieuse souhaité pour les esclaves. En même temps, ceux-ci se voient contester les facilités minimales qui leur permettraient d'acquérir une formation religieuse, par exemple le repos dominical : les maîtres affirment qu'ils doivent, le dimanche, les envoyer au marché, leur confier des travaux agricoles urgents et un certain nombre de corvées [76]. À l'évidence, comme un peu plus tard la quasi-totalité des habitants de Bourbon devant de semblables échéances, les maîtres mauriciens ne souhaitent pas hâter le moment où la maturité de leurs esclaves permettrait de relâcher le joug de la discipline domestique ou de la servitude. Bien des traditions vont d'ailleurs survivre à l'émancipation : en 1841, huit ans après le bill qui supprimait l'esclavage, Mgr. Collier, arrivant à Maurice, sera surpris de voir que "le travail continuait le dimanche comme en semaine" [77].
Le gouverneur Milius, nous nous en souvenons, ne nourrissait aucune illusion sur le "frein" que pouvait représenter la religion pour l'esclave. Ce rôle était dévolu à "l'autorité du maître". D'une opinion assez analogue, sur ce point, à celle des propriétaires mauriciens, Milius devait, par respect de ses responsabilités d'administrateur, feindre encore plus qu'eux de déplorer le paganisme de la population servile. Cottineau se félicite de la conviction avec laquelle le gouverneur a évoqué "l'urgente nécessité de rétablir au plutôt la Religion dans la colonie". C'est lui le premier, poursuit le prêtre, "qui a exhorté les habitants à marier leurs noirs et à les faire instruire dans la Religion, il nous a écrit ensuite me circulaire à tous dans ces mêmes vues" [78]. Tandis que se poursuit le mouvement pendulaire qui fait passer, tour à tour, praticiens et théoriciens, de la prise de conscience des dangers de la christianisation de l'esclave à celle de ses avantages, les sujets d'un chef d'État à nouveau Très Chrétien ne peuvent trop hésiter. En 1821, les Comités consultatifs des colonies émettent le voeu que "les curés de chaque paroisse rétablissent les instructions et prières publiques qui avaient lieu autrefois, le dimanche, et que les maîtres soyent invités à y envoyer leurs esclaves". Le Ministre, qui se rallie à cette proposition, la commente ainsi : "Vous savez combien d'avantages sont attachés au maintien parmi les esclaves des principes religieux" [79]. Et de renchérir deux ans plus tard : il faudra aussi "rétablir partout, où on le pourra, la messe dite des nègres" [80]. À Bourbon, celle-ci était dite, en 1818, par Cottineau à Sainte-Marie ; en 1824, elle n'est plus célébrée dans l'Île, sauf épisodiquement à Saint-Paul, quand le préfet apostolique y réside. Quand il s'en va, ''Mr. le Curé de St. Paul a plus d'occupations qu'il ne lui en faudroit avec les Blancs et les Libres" [81].
L'administration ne dissimule pas -au moins au niveau de la correspondance échangée entre le Ministère et les gouverneurs, le caractère pragmatiste qu'elle veut donner à l'évangélisation : il faut communiquer à l'esclave "le désir d'être obéissant et soumis", il faut augmenter sa "reproduction dont le concubinage est l'ennemi" [82]. Innocemment, un ministre suggère que l'on propose à Dieu un marché de dupe : on mesurera au plus juste ce que la raison conseille de donner mais on réclamera cent fois plus... "La religion rend au centuple ce que l'on fait pour elle dans des limites raisonnables, c'est par elle seule que les colons peuvent aujourd'hui repeupler leurs attéliers" [83]. Les intentions de la Métropole se traduisent par quelques améliorations : les effectifs du clergé augmentent, des bâtiments destinés au culte sont réparés ou construits, mais sur l'essentiel la stagnation semble l'emporter. Ainsi Minot, dans le même document, se félicite de l'édification d'églises à Saint-André, Sainte-Suzanne et Saint-Joseph mais se plaint de ce que la conversion des esclaves soit presque impossible en raison des difficultés que font leurs maîtres pour qu'ils assistent aux saints offices. Le prêtre critique d'ailleurs aussi les esclaves, mais fait peut-être, inconsciemment, plus le procès de l'institution servile que de ses victimes. Flétrissant "leurs mauvaise volonté, leur grossièreté, leur penchant invincible sur le vol, leur libertinage", il constate qu'ils "offrent sur tous les points les plus grands obstacles à la pratique de la religion" et qu'il faut "leur différer souvent le Baptême jusqu'à la mort quand ils ne l'ont reçu dans leur enfance" [84]. Habitude confirmée par Pastre, qui précise : "Les enfants nouveaux-nés sont baptisés. Mais les adultes demeurent étrangers à l'église, ne pouvant assurer la grâce du baptême que par le mariage nous ne les baptisons ordinairement qu'en danger de mort" [85]. Ainsi, comme à l'époque des Lazaristes, seuls les esclaves créoles reçoivent systématiquement le baptême en venant au monde, ceux qui auraient échappé à l'attention des prêtres et les esclaves de traite se heurtent ensuite à la formalité du sacrement de mariage. À leur tour les Spiritains optent pour le paganisme des adultes plutôt que pour la systématisation du péché de chair. Or, malgré les abjurations des prêtres et les souhaits de l'administration, le mariage servile semble être tombé en désuétude aussi bien à l'époque de la Restauration qu'au début de la Monarchie de Juillet. Rapports et statistiques confirment ce phénomène, qui est loin, d'ailleurs, d'être propre à Bourbon : en 1835, en totalisant les unions légitimes d'esclaves qui y sont célébrées et celles de la Martinique et de la Guadeloupe, on arrive au nombre global de 28 pour une population de près de 240 000 esclaves [86]. Comme l'écrit le procureur général Barbaroux, l'année suivante, "le mariage, dont le premier résultat est de donner un chef à la famille qu'il crée, est peu conciliable avec l'esclavage" [87]. En fait, c'est dans tous les domaines que l'inadéquation semble de plus en plus fondamentale entre les exigences de survie de l'institution servile et celles n'expriment l'Église et une société civilisée. Cette impression est renforcée à Bourbon par l'ampleur des transformations économiques et sociales des années 1820-1830.
Nous avions signalé avec quelle perspicacité le préfet apostolique Criais citait, en 1742, parmi les raisons de la détérioration des croyances et des moeurs, les mutations liées à la culture et à l'exportation du café, et nous indiquions combien il nous semblait que le sucre, au XIXème siècle, allait être à l'origine de changements encore plus profonds [88]. La concentration foncière et l'industrialisation liées à ce produit durcissent les rapports sociaux ; de nombreux petits propriétaires, ruinés, conservent comme seules références de leur supériorité la couleur et l'esclavage ; les grands propriétaires affrontés à des exigences plus lourdes d'investissement, de travail et de rentabilité, affirment comme, vital leur besoin d'une main-d'oeuvre plus productive et plus nombreuse. Les esclaves, qui avaient connu le rêve de l'émancipation et l'octroi d'affranchissements nombreux, aussi bien à l'époque révolutionnaire que lors de l'occupation anglaise -entre 1810 et 1815- se trouvaient placés sous une sujétion beaucoup plus pesante. Leur sort semblait se dégrader, dans divers domaines, au moment précis où leurs homologues de Maurice voyaient miroiter la liberté [89]. Les voeux du Ministère n'avaient pas eu plus de succès dans le domine du "repeuplement des ateliers" que dans celui des mariages, or la traite des esclaves était officiellement interdite à Bourbon depuis 1817 : au moment où le sucre exigeait plus de travailleurs, l'excédent des décès sur les naissances menaçait de faire disparaître la population servile. Une traite clandestine éhontée et les timides débuts de l'engagement de travailleurs libres sous contrat allaient être la première réponse des planteurs et des fabricants de sucre. La population locale voyait grandir, non sans exprimer parfois son effarement, une main-d'oeuvre qui lui apparaissait comme de plus en plus "sauvage et païenne" et dont la christianisation semblait être de moins en moins possible et souhaitable [90].
Mission des Noirs
ou mission des maîtres ?

Tandis qu'à Bourbon une heureuse issue au problème des relations de l'Église et de l'esclavage devenait, de jour en jour, moins plausible, le débat sur le maintien de l'esclavage lui-même s'intensifiait en Europe. La Monarchie de Juillet, après une période d'hésitation, s'orientait vers l'examen des possibilités, des avantages et des inconvénients de diverses formes d'émancipation. Sans préjuger de l'échéance, on établissait le principe que la "moralisation" des esclaves était le préalable indispensable à toute modification de leur sort.
Ainsi, tandis que depuis le début de l'époque coloniale les clercs doivent s'accommoder de l'esclavage, pour la première fois on les invite dans les colonies françaises à préparer à une liberté prévisible la totalité du groupe servile. Au lieu de tenter de réconcilier des points de vue inconciliables, l'Église reçoit la mission, infiniment plus exaltante, d'user de la religion comme moyen d'émancipation. Le travail d'information et de réflexion, qui avait été jusqu'alors surtout le fait de l'initiative privée des abolitionnistes, est officiellement coordonné par le Gouvernement. À partir des années 1835-1840 s'accumulent une masse d'enquête sur les résultats de l'émancipation dans les colonies anglaises et sur la situation des esclaves dans les colonies françaises. Les observations de Passy, de Rémusat, celles de Schoelcher, les rapports de la commission de Broglie, les débats parlementaires sensibilisent de plus en plus l'opinion métropolitaine au problème de l'esclavage colonial. À Bourbon comme aux Antilles, les colons suivent avec nervosité la progression d'un mouvement dont beaucoup s'accordent à dire qu'il débouchera sur la ruine, et peut-être sur le massacre, de la population des Îles. Par une série de lois et d'ordonnances, les autorités tentent d'offrir à l'esclave une meilleure protection contre l'arbitraire du maître, l'accession à un enseignement religieux et élémentaire et la possibilité de se racheter par la constitution d'un pécule. Administrateurs, magistrats et prêtres sont invités par Paris à faire appliquer ces mesures, malgré les préventions locales ; on exige d'eux des rapports circonstanciés où ils doivent rendre compte, périodiquement, du résultat de leurs efforts. Ce trop bref, et imparfait, résumé donne peut-être une idée de la masse prodigieuse de documents qui s'offre désormais à l'historien pour étudier les relations de l'Église et des esclaves. Pour l'avoir, en partie, réalisée dans notre thèse, nous devons avouer que son exploitation nous a semblé dépasser infiniment les dimensions, déjà excessives, de cette communication. Réservant pour un autre texte la plus grande partie de la documentation, nous choisissons donc de ne présenter ici que quelques éléments d'une question que la société de Bourbon juge fondamentale pour sa survie. Il s'agit du maintien au travail de ceux qui, par la couleur et le statut social, ont été dès l'origine cantonnés dans des tâches matérielles que les autres habitants de l'île croient infâme d'accomplir. Quelques documents trouvés pour l'essentiel dans tes archives privées nous semblent apporter un éclairage intéressant sur le rôle qu'une partie de l'Église de Bourbon a été amenée à jouer en cette circonstance.
Dans un article publié en 1870 par un journal local, le Dr. Jacob de Cordemoy écrit :
- "le travail avait fait pacte avec l'esclavage : il était marqué du sceau de l'infamie ; il s'était appelé l'oppression : il était déshonoré. Pour l'homme rendu à la liberté, travail et servage se confondaient, inspirant une égale horreur. Aux hommes nés libres, le travail n'était jamais apparu que comme oeuvre d'esclaves, et ne pouvait causer qu'une égale répugnance" [91].
Les cérémonies religieuses apportaient aux esclaves une halte dans le labeur quotidien. Sully Brunet, évoquant ses souvenirs de jeunesse, décrit la joyeuse animation dont les messes étaient le prétexte :
- "On quittait de partout les habitations pour affluer à l'église (...) les noirs faisant retentir l'air de leurs chants (...). Pendant l'office divin, les abords de la maison de Dieu étaient comme un camp bouleversé : là des nègres couchés d'autres ici s'ingurgitant d'arrack avec excès ; des repas improvisés, des négresses allaitant leurs nourrissons" [92].
L'oeuvre de "moralisation" va tenter de faire comprendre aux esclaves que messe et instruction religieuse ne sont pas des prétextes à l'oisiveté mais qu'elles exigent une présence assidue. Elle va tenter aussi de réhabiliter le travail manuel. Tâche presque impossible, tant l'analyse de Cordemoy semble confirmée par tous les témoignages, à l'époque même où l'on tente d'accomplir cette mutation dans les esprits. À un projet d'émancipation partielle, prôné par Barbaroux en 1841, qui concernerait les enfants, le Directeur de l'Intérieur riposte ; "Si vous les laissez exposés au contact de la race esclave, ils prendront ses goûts, ses habitudes, son horreur du travail, du travail qui constitue à ses yeux l'esclavage" [93]. Les affranchis semblent tellement persuadés de la relation qui existe entre servitude et travail manuel que, pour ceux qui persisteraient à se dérober à celui-ci, le Conseil Colonial débat de la possibilité du retour à l'esclavage [94].
L'abbé Monnet, après un court passage au séminaire du Saint-Esprit, arrive à Bourbon en juin 1840. Il va y tenter la première expérience de "Mission des Noirs", dans le sens des nouvelles intentions gouvernementales. À la même époque, Levavasseur, créole blanc de Bourbon, Tisserant, dont une partie de la famille est originaire de Saint-Domingue et Libermann mûrissent en France le projet de la "Congrégation des missionnaires du Saint-Coeur de Marie", qui se vouerait entièrement à la même oeuvre. Ils vont y associer le P. Laval, le futur apôtre de l'Île Maurice [95]. Monnet trouve, à son arrivée dans l'île, l'appui de la famille Desbassayns, et en particulier celle de Charles, fils de la grande propriétaire de Saint-Gilles-les-Hauts, beau-frère de l'ancien ministre de Villèle, et lui-même grand propriétaire sucrier dans la région de Saint-Denis et de la Rivière des Pluies. Ainsi se poursuit une tradition, à laquelle, nous l'avons remarqué, cette famille avait déjà montré son attachement. Pourtant la perspective de l'émancipation, qui se profile désormais derrière la formation religieuse des esclaves, peut détourner de cette dernière encore plus de maîtres que par le passé. Jusqu'alors, malgré la diversité des opinions et des résultats, on pouvait admettre que les propriétaires soutiennent une entreprise dont le but affirmé était de nouer plus solidement les liens du captif. N'était-il pas hardi d'espérer semblable adhésion à une entreprise dont le dessein avoué était d'acheminer, peu à peu, ce captif à la liberté ? Les rebuffades ne vont pas manquer aux "missionnaires des Noirs" : la correspondance de Levavasseur, qui a rejoint son île natale en 1842, et celle de ses jeunes compagnons, qui à partir de 1843 viennent de France pour oeuvrer à la même mission, en témoignent [96]. Monnet, au terme de quatre ans d'efforts, en arrive à la menace que les Lazaristes avaient mise à exécution quelques décennies plus tôt. Il écrit à Charles Desbassayns : "Je fais des voeux ardents pour que tous les missionnaires mettent le marché à la main au gouvernement et lui disent : ou vous mettez les esclaves à notre disposition pour les instruire et en faire des chrétiens ou nous partons". Et d'expliquer que "l'opposition à la moralisation des noirs est plus forte que jamais" : dans trois habitations, on a refusé de faire entrer le prêtre ; le nombre des esclaves qui assistent au catéchisme a diminué de moitié ; dans presque toute la colonie, il y a une "grande opposition au mariage" ; finalement "la grande majorité des colons sont des corrompus ne cherchant que leur intérêt et leurs plaisirs" [97]. Il arrive, beaucoup plus rarement, semble-t-il, que des esclaves refusent eux-mêmes de se laisser convertir, mettant en avant leur grand âge, le fait qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur explique ou qu'ils ont déjà leur propre Dieu [98]. Tel est, très sommairement esquissé, le cadre dans lequel va se dérouler l'effort de réhabilitation du travail, soutenu par l'apologie de la soumission volontaire.
Peu après son arrivée à Bourbon, Monnet prend en charge l'instruction religieuse des esclaves qui résident à Saint-Denis et prend l'habitude de célébrer la messe en plein air pour ceux qui vivent dans la campagne voisine. Le Journal de la paroisse de la Rivière des Pluies contient le récit des débuts de son apostolat et de l'édification de la chapelle qu'il entreprend avec l'aide de ses futurs paroissiens :
- "Chacun à l'envi s'empressait de contribuer à la construction nouvelle ; les propriétaires, par leurs outils et leurs charrois ; les hommes, en roulant les blocs de pierre, les femmes et les enfants, en avançant les matériaux de toute nature, et en égalisant le terrain" [99].
Le labeur est accompli à l'issue de la messe, mais on constate que la ferveur dominicale n'abolit pas les différences sociales : les "propriétaires", autrement dit les maîtres ne s'abaissant pas à travailler de leurs mains, fut-ce pour Dieu ; les tâches de manoeuvres sont réservées aux esclaves. Pourtant Monnet n'hésite pas à prêcher d'exemple : "s'aidant de la force que Dieu lui avait donnée, il prêtait bien souvent le se(co)urs de son bras vigoureux pour lever des pierres dont le poids faisait plier plusieurs hommes" [100].
Monnet, qui va continuer sa mission comme curé de Saint-Paul, est bientôt honoré de double façon : par le Gouvernement qui lui accorde la légion d'honneur, par le Pape qui le nomme vice-préfet apostolique. Se trouvant en France en 1846, il exprime en ces termes sa position sur son rôle et sur celui que l'on peut attendre des missionnaires : "Si je retourne à Bourbon (...) et si je retrouve la même confiance parmi les noirs et le même ascendant ce ne sera que pour leur prêcher plus fortement encore l'humilité, l'amour du travail, l'attachement à leurs maîtres et l'accomplissement de tous leurs devoirs". Expliquant qu'il s'est peut-être élevé en termes trop vifs contre certains abus et qu'il s'est, de ce fait, attiré l'animosité de divers colons, il affirme être pourtant le défenseur de tous, il vient de le montrer en protestant contre les lois qui prétendent réglementer la vie quotidienne sur les habitations. Et de conclure : "Je crois que jamais les colons n'auront plus besoins de bons missionnaires pour maintenir les esclaves dans la dépendance envers leurs maîtres et pour empêcher la division et la confusion que les nouvelles lois sont propres à fomenter entre les maîtres et les esclaves" [101]. Revenu en septembre 1847 dans l'île, Monnet est accueilli par des manifestations hostiles. Des Blancs lui reprochent en effet d'être favorable à l'émancipation. Il assiste aux vêpres avec une foule nombreuse d'esclaves rassemblés par Levavasseur, auxquels ce dernier recommande de ne pas intervenir, tandis que les clameurs hostiles à Monnet augmentent. Les esclaves se dispersent en larmes, mais en silence, les troubles se poursuivant, le gouverneur Graeb exige le départ de Monnet qui, quelques jours plus tard, doit rentrer en France. Désavoué par le Ministère, Graeb perd son poste. La hantise d'une nouvelle révolte d'esclaves pèse sur les colonies depuis les événements de Saint-Domingue. Le gouverneur va essayer de justifier sa décision, une première fois au moment des manifestations de la population blanche contre Monnet, en écrivant que celui-ci "se trouverait, bien involontairement sans doute, le drapeau de la révolte si des esclaves essayaient de se soulever" ; quelques mois plus tard, il affirmera que si Monnet n'avait pas été expulsé, il eut été "impossible de prévoir jusqu'où le mal aurait pu s'étendre, et peut-être que nous aurions eu à déplorer le commencement d'un autre St. Domingue" [102]. À la réception de cette lettre, quelqu'un a souligné, au Ministère, d'un simple point d'exclamation dans la marge, ce que ce rapprochement semblait avoir d'excessif. En effet, tout dans l'attitude et dans la correspondance de Monnet, de Levavasseur et des autres missionnaires des Noirs montrait leur volonté d'éviter la violence. Si certains indices, à la Martinique et à la Guadeloupe, pouvaient faire craindre la généralisation de troubles chez les esclaves, il n'en était rien à Bourbon. L'Église avait contribué à y écarter la grande menace de la révolte servile ; il lui restait à accentuer l'effort de réhabilitation du travail manuel.
Au départ de Monnet pour la cure de Saint-Paul, le P. Collin, du Saint Coeur de Marie, l'avait remplacé à la Rivière des Pluies. Collin, avec l'accord de Levavasseur, son supérieur, tente l'essai, en 1847, "d'un système d'éducation basé sur la religion et le travail manuel (...) et surtout celui de la terre". Deux heures par jour, seulement, sont consacrées "aux études élémentaires les plus indispensables, telles que la lecture, l'écriture, un peu d'arithmétique". Quelques élèves fréquentent l'école quand on apprend que l'émancipation entrera en vigueur le 20 décembre 1848. Collin sollicite aussitôt l'aide des esclaves pour pouvoir porter à une trentaine d'enfants ses possibilités d'accueil. Un bâtiment en torchis est édifié grâce à eux, car, lit-on dans le Journal de la paroisse, "la perspective de voir leurs enfants recevoir une certaine instruction, sourit généralement aux parents". Mais le Mme document justifie l'initiative de Collin par la remarque suivante : "L'émancipation devait jeter dans la société une foule d'enfants, qui, n'ayant jamais reçu aucune éducation, et n'étant plus obligés au travail, pouvaient (...) devenir plus tard un fléau pour la Colonie" [103]. Le quiproquo n'est pas exclu : les esclaves escomptent sans doute pour leurs fils la promotion sociale par la connaissance, meilleur moyen d'échapper au travail de la plantation et de diminuer le fossé qui les sépare des privilégiés ; le clergé pense surtout à maintenir les jeunes affranchis à la terre, en remplaçant le fouet du commandeur par l'entraînement de l'habitude et la notion de devoir moral.
Sous l'impulsion du P. Levavasseur, une jeune fille de la bonne société créole, Aimée Pignolet de Fresnes, va réaliser une oeuvre d'inspiration analogue pour les filles d'esclaves. Le dessein en sera toutefois beaucoup plus vaste puisqu'il va aboutir à la naissance d'une congrégation, dont le rayonnement international et la spécificité méritent attention. S'adressant en novembre 1849 au maire de Sainte-Marie pour justifier l'implantation des Filles de Marie dans sa commune, la fondatrice écrit : "Il faut ici pour les quartiers pauvres et la classe pauvre surtout des religieuses qui ne coûtent rien ou au moins fort peu ; il en faut qui forment les enfants à toutes sortes de travaux" [104]. Obligation du travail manuel, non seulement pour les élèves mais aussi pour les religieuses : la prescription en est plusieurs fois répétée dans les "Constitutions" qu'approuvent les ecclésiastiques. En tête des tâches demandées aux Filles de Marie, on mentionne : "Recueillir les enfants pauvres pour leur montrer à travailler et leur donner l'instruction qui convient aux pauvres femmes de la basse classe". Le danger social que représenterait trop d'instruction est évoqué dans la Constitution XLI, qui prévoit que l'on enseignera seulement à lire et à écrire [105]. En travaillant manuellement, les religieuses doivent poursuivre un double but : nourrir des pauvres, se mortifier. L'insistance des Constitutions sur ce dernier point confirme la force du préjugé colonial : "Nous sanctifier par un travail continuel : ce sera là notre pénitence". Et, quand les travaux sont énumérés, si certains sont féminins -lavage, repassage -voire délicats- travaux d'aiguilles, broderie - d'autres sont choisis dans le domaine le plus décrié, celui des "noirs et négresses de pioche" de la veille, celui dont les "nouveaux citoyens", c'est à dire les affranchis de 1848, ne veulent plus, celui que l'on abandonne maintenant aux engagés indiens ou africains, tout aussi méprisés que l'étaient les esclaves : la Constitution XVII précise qu'on travaillera la terre dans toutes les misons, on pourra même entreprendre dans les champs les travaux et les plantations". Occasion de rappeler aux religieuses qu'ainsi elles "doivent se punir, faire pénitence de leurs pêchés et mortifier leur chair" [106]. Mortification extrême, certes, pour ces Filles de Marie, recrutées parmi les esclaves et les maîtresses de la veille, qui, si elles étaient restées dans la vie civile n'auraient sans doute jamais accepté de se soumettre volontairement à ce que toute une société ressentait comme la ''malédiction de la pioche''.
Grande originalité pour une congrégation née en milieu colonial, que ce recrutement très divers ; l'évêque le signale au ministre comme un des points qui méritent son approbation : la Congrégation "place dans une égalité parfaite des personnes sorties de toutes les classes de la société (...) elle réalise ce qu'on aurait cru impossible : la fusion du maître avec l'ancien esclave" [107]. On peut d'ailleurs remarquer que des jeunes filles appartenant à un milieu social encore plus élevé que celui de la fondatrice, par exemple à la famille Desbassayns de Villèle, entrent en nombre non négligeable dans la Congrégation. Sans du tout mettre en cause l'abnégation des intéressées ni leur sincérité religieuse, ne peut-on risquer deux lectures des motivations du groupe social privilégié qui les oriente vers les Filles de Marie ? La première serait suggérée par ce que chuchote la tradition populaire expier les fautes du groupe familial, et en particulier les crimes contre les esclaves. La seconde serait plus machiavélique : participer à l'éducation des filles de couleur de façon à ce qu'elles soient maintenues dans la ''basse classe'', mais surtout, si l'on peut risquer ces expressions, jouer le rôle de rideau de fumée et de soupape de sécurité. Faisant le sacrifice de leurs préjugés dans un couvent où cela prête peu à conséquence puisque ni la descendance ni le patrimoine familial n'en sont adultérés, ces religieuses contribueraient à mieux faire accepter les différences considérables qui se maintiennent dans la société "réelle". Pour que se déchargent mieux les fureurs inconscientes du groupe dominé, le jeu social pourrait même aller jusqu'aux inversions rencontrées dans ces fêtes où, l'espace d'un jour, on tolérait que l'esclave fût roi. Dans le monde discret du couvent, l'inversion pourrait être durable : "Il est admirable de voir dans cette congrégation des personnes affranchies, non seulement se voir traitées comme des soeurs par leurs anciennes maîtresses, mais parfois devenir leurs supérieures" [108]. Inversion -quelle qu'en soit la proportion- dont la société coloniale pourrait un jour mesurer la portée révolutionnaire, si la contagion s'en répandait hors des couvents. Poursuivant son apologie, l'évêque de la Réunion, qui ne mesure peut-être pas la hardiesse de son propos, ajoute : "Le seul motif des distinctions entre elles, c'est la vertu et le mérite ; et Dieu, nous en sommes témoin, en a rendu capables toutes les classes" [109].
Vertu et mérite, deux qualités parmi d'autres dont beaucoup d'Européens et de Créoles refusaient de créditer la "race noire", pour justifier le rang inférieur où l'on entendait maintenir ceux dont on n'était plus protégé par la barrière juridique de la servitude. En 1853, le gouverneur de la Réunion prescrit par arrêté que dans "les écoles des frères de la doctrine chrétienne et dans celles des soeurs de Saint-Joseph, la plus grande partie du temps des enfants sera consacrée aux diverses professions manuelles et principalement aux travaux de l'agriculture". La mesure a été préparée par une lettre explicative où le Gouverneur expose que chez les pauvres il ne faut pas porter une "attention trop exclusive" à "l'avancement de quelques intelligences d'élite" mais qu'il faut "renfermer l'instruction des enfants dans la sphère modeste qu'ils occupent" et surtout leur "donner le goût du travail agricole" [110].
Au cours d'une mission d'inspection, Viant note, en 1874, que les écoles primaires de filles accueillent sur leurs bancs des élèves de trois ans aussi bien que de dix-huit. Il est surpris de voir qu'on apprend à lire à certaines grandes filles alors que d'autres ne font que répéter inlassablement à la suite de l'institutrice, des phrases de catéchisme. Le choix des élues, constate-t-il, "dépend exclusivement de la manière de voir de la Supérieure : si elle juge que la connaissance de la lecture ne fait courir aucun danger à la jeune fille, on l'instruit ; mais si elle croit que la lecture peut être un moyen de la détourner du devoir, on se contente de lui mettre dans la tête autant de phrases du catéchisme que l'on peut" [111]. Il semble que les bienfaits moraux de l'analphabétisme soient, dans ces écoles, réservés de préférence au groupe social issu de l'esclavage. Viant, ayant plaidé pour un apprentissage de la lecture qui forme l'intelligence, revient, en effet, en ces termes aux méthodes de mémorisation : "On ne serait plus obligé alors de condamner une soeur à répéter cinquante fois la même phrase à une pauvre petite négresse qu'on craint d'instruire ! Et pourtant combien qui ont perdu leur âme sans savoir lire !" [112].
La "norme" sociale n'est pas seulement préservée par l'oeuvre du gouvernement, du clergé et des congrégations, on peut y concourir par la domestication de cultes populaires. La cérémonie qui accompagne la pose de la "Vierge Noire" à la Rivière des Pluies, quelques années après l'émancipation, nous semble, à cet égard, extrêmement symbolique. La tradition veut qu'à cet endroit la Vierge ait réalisé un miracle en faveur d'un jeune esclave marron que ses poursuivants allaient atteindre. Dans certains récits, le fugitif est désigné comme étant un esclave de Charles Desbassayns, Ce dernier s'est révélé par ses libéralités, et en particulier par ses dons de terrains, comme un bienfaiteur de la paroisse de la Rivière des Pluies et de la Congrégation des Filles de Marie. Plusieurs de ses descendants participent, en 1856, à l'érection de la statue. Delphine de Villèle raconte au P. Collin, qui a quitté la paroisse depuis trois ans, comment se déroule la cérémonie : ''ma petite soeur, écrit Delphine, portait l'oriflamme de Marie (...) Après Ombeline, venait naturellement un de vos enfants. Au nom de ses frères, il s'offrit à cette tendre Mère et lui demanda d'être fidèle dans la pratique de la vertu et de l'amour du travail" [113]. À l'endroit même où un esclave révolté avait reçu l'aide mariale, le jeune garçon, qui est un représentant de la même lignée, prononce les paroles de soumission qu'on vient de lui souffler. La haute société créole requiert la Vierge populaire de changer de rôle. On pardonne au révolté mais on lui rend les outils de travail ; le sauvetage d'un marron ne doit pas être alibi pour un marronnage généralisé. Le temps d'une procession, le fils d'esclaves réclame comme une grâce pour tout son groupe la passion de la soumission et du travail. Mais la récupération d'un courant de ferveur n'est pas chose aisée : la mémoire populaire n'a gardé aujourd'hui que la trace de la protection accordée à celui qui avait fui la plantation et si beaucoup de fidèles continuent à prier la Vierge Noire pour en obtenir un miracle, aucun ex-voto ne parait rappeler qu'elle a communiqué à l'un d'entre eux un goût exclusif pour les tâches d'ouvrier agricole.
Conclusion

Affrontant, en cette deuxième moitié du XIXème siècle, les rythmes et les problèmes de l'industrie sucrière, la Réunion vient, à certains égards, de revivre en deux siècles l'histoire entière de l'humanité. Insérés pour la plupart, et pour la plus grande partie de cette période, dans le système servile, les travailleurs manuels ont eu avec l'Église des relations auxquelles nous avons essayé de prêter quelque attention.
Les premières décennies de l'installation de l'homme sur l'île se déroulent selon un schéma social original : les Blancs, constamment majoritaires, n'hésitent pas à épouser parfois des femmes de couleur et tolèrent que ceux que l'origine ethnique et la fonction désignaient dans d'autres colonies pour l'esclavage, connaissent ici une semi-liberté. Protégée des fureurs du monde par les barrières de la distance et les dangers de la mer, cette société patriarcale souffre à peine des excès de quelques-uns de ses membres. L'imagination peut y reconstruire des mythes rassurants : le sein maternel d'une île petite, chaude et close, le jardin où l'on vit en cueillant, l'Eden. Des bergers, d'autant moins pesants qu'ils sont souvent éphémères, paissent un troupeau si maigre et si lointain que sa sainteté fait illusion. La diversité du microcosme insulaire et la catholicité générale ne deviennent-elles pas symboles de l'unité du monde ? Le rêve d'une unité chrétienne, poursuivi au long des siècles par les clercs, va-t-il se concrétiser ici ? Aux granges du monde "indianocéanique" s'accomplit la rencontre des continents, et le dessein missionnaire peut être étayé, comme dans la primitive Église, par la ferveur des néophytes. Brève et rude est la chute qui conduit aux plantations de vivres, de café, d'épices -bientôt à celles de canne à sucre- et à la découverte d'une population servile désormais majoritaire, dangereuse, peu compréhensible ; chute qui conduit aux impossibles synthèses entre des exigences contradictoires.
En achetant l'esclave, dont on ne souhaitait que la force physique, on s'était encombré de l'âme qu'il possédait peut-être, et on ne savait qu'en faire. Nul, à ce sujet, ne semblait de bon conseil dans la société blanche : à épouser les hypothèses des uns et des autres - fussent-ils les mieux informés, prêtres, administrateurs, colons - on aboutissait à la confusion et au tourment. La christianisation de l'esclave est nécessaire mais impossible, disaient certains, et les uns de s'en expliquer par une incapacité native de l'intéressé, alors que l'argument des autres était révolutionnaire (un chrétien n'a pas le droit de maintenir son frère dans la servitude). Quelques-uns pensaient qu'une certaine christianisation était réalisable et qu'elle était utile à la discipline des ateliers, mais d'autres affirmaient qu'elle ne servait à rien, d'autres encore qu'elle y était nuisible. La plupart ne se rejoignaient finalement que sur une affirmation vague : conduire l'esclave à Dieu est un devoir. Les recettes qui auraient permis d'accomplir cette tâche ne satisfaisaient personne, et peut-être n'existaient-elles pas. Mais il convenait que le devoir -masque et alibi- restât inscrit au fronton de l'institution. La lucidité des Lazaristes de Bourbon, et leur honneur, étaient-ils d'avoir compris dans quel jeu de dupes s'égarait la société coloniale ? Eux seuls, au cas où ils en eussent été libres, auraient pu dire si le parti de la retraite leur était dicté par la crainte de se perdre, sans sauver l'esclave, et par le constat de l'impossible union en eux-mêmes des deux personnages de fonctionnaire des Blancs et de prêtre des Noirs. H. Mondon écrit qu'ils avaient mis "tout leur zèle et l'influence dont ils disposaient à atténuer les conséquences de l'injuste sort réservé aux esclaves en plaidant leur cause auprès de leurs maîtres, en rappelant à ceux-ci les devoirs de la charité envers leurs serviteurs" [114]. Sans doute, beaucoup agissaient-ils ainsi, prêtres et compatissants avant tout, aussi bien Lazaristes que Spiritains. Mais ces derniers, en succédant aux disciples de Saint Vincent de Paul, héritaient de toute l'ambiguïté de leur tâche. Pansant quelques plaies, mais prisonniers des mêmes dilemmes, ils étaient amenés, au cours d'un premier XIXe siècle, à cautionner l'esclavage et à négliger les esclaves. Renforcé par les prêtres de Saint Coeur de Marie, avec lesquels la Congrégation du Saint-Esprit allait bientôt fusionner, le clergé de la Monarchie de Juillet s'orientait finalement -à la demande des autorités civiles- vers la mission, infiniment plus exaltante, de préparer les esclaves à la liberté.
Il est diverses façons d'entendre l'émancipation. Elle peut être explosion libératrice, aboutissant à la vengeance ; il faudra apprendre aux esclaves la soumission volontaire et l'oubli des injures. Si l'émancipation est maîtrisée, le choix reste à faire entre deux desseins : on peut conduire l'affranchi à un statut d'adulte, apte à prendre une part de responsabilité dans la Cité et à recevoir une part des richesses ; on peut le maintenir dans un état de durable dépendance. Ce dernier parti semble avoir été celui de la haute société créole qui, liée par l'amitié ou le sang à des membres influents du clergé et des congrégations religieuses, a convaincu ceux-ci -peut être plus encore que ne le faisait le gouvernement- de contribuer à cette mission. En ce sens, mission des maîtres plus que mission des Noirs, elle devait permettre aux premiers de conserver me mainmise plus que séculaire sur la population des "nouveaux citoyens". Bien avant 1848, d'ailleurs, tandis que petits et moyens propriétaires essayaient au sein du mouvement des Francs Créoles de trouver les arguments qui assureraient la pérennité de l'esclavage, les grands propriétaires semblaient se résoudre plus facilement à son abolition. Peut-être avaient-ils compris qu'une main-d'oeuvre libre tenue solidement, soit engagée, soit affranchie, pouvait rendre d'aussi bons et, peut-être de meilleurs services, à me époque de concentration des terres, des usines et des capitaux.
L'Église, qui a contribué massivement à l'endiguement de cette liberté, a, à bien des égards, pendant comme après l'esclavage, dispensé me sorte d'“opium” au peuple colonial ; elle a cependant aussi contribué à son soulagement et à sa promotion, mais, malgré la hardiesse de certains prêtres, par les voies lentes du réformisme, pas par celle de la Révolution. Louant "M. l'abbé Levavasseur, M. Minot" et quelques autres pour l'usage qu'ils ont fait de "leur empire sur les masses", Le Moniteur de l'Île de la Réunion vilipenpe, en janvier 1850, le "Citoyen Joffard" [115]. Celui-ci, prêtre métropolitain envoyé à Bourbon en 1840 par la Congrégation du Saint-Esprit, a pris la défense des Noirs avec passion. Son expulsion et celle de plusieurs de ses collègues, jugés trop "démocrates" montrent combien les jugements sur les relations de l'Église avec le groupe servile ou affranchi doivent être nuancés. Dans ce monde qui avait vécu de l'esclavage et s'en arrachait à grand peine, jamais peut-être le partage entre les exigences de Dieu et celles de César n'avait été aussi difficile pour le clergé.
[1] Publiée dans le Bulletin de l'Académie de l'Île de La Réunion, vol. 15, 1938, p. 3-33.
[2] Problème que nous avions déjà abordé à propos d'un ouvrage d'A. GISLER, L'esclavage aux Antilles françaises : XVIIe-XIXe siècles : contribution au problème de l'esclavage. Fribourg (Suisse), Ed. universitaires, 1965, 213 p. Notre compte-rendu a paru sous le titre "Un mort-vivant : l'esclavage", in Présence Africaine, Paris, no 61, 1er trim. 1967, p. 180-198. On trouve aussi quelques réflexions sur ce sujet in GERBEAU (H.), Les esclaves noirs. Pour une histoire du silence. Paris, Éd. A. Balland, Coll. R. 1970, 217 p., en particulier aux p. 82-107, 129-131 et 165-166. À noter que, dans les deux cas, le style est volontairement polémique et que les références sont surtout puisées dans le domaine antillais.
[3] Cette note, ajoutée postérieurement à la soutenance de la thèse de 3e cycle de C. Prud'homme, nous permet de préciser qu'elle s'intitule "La Réunion - 1815-1871 - Un essai de chrétienté", et compte vii-616 p. dactyl. Préparée sous la direction du Professeur Gadille, elle a été soutenue le 15 décembre 1980 à l'Université de Lyon III, devant un jury présidé par le Professeur MIEGE. C. Prud'homme avait envisagé primitivement de centrer son étude sur l'époque de Mgr. Desprez et Mgr. Maupoint, c'est à dire sur le Second Empire. Il a bien voulu nous demander notre accord pour étendre sa recherche à la première moitié du XIXe siècle (période que nous étudions nous-même en vue de la soutenance d'une thèse d'État intitulée "Esclavage et société coloniale : la Réunion de 1815 à 1860".) Fondées sur des sources en partie complémentaires et sur des axes d'approche différents, ces deux thèses devraient s'éclairer mutuellement. Le lecteur qui souhaiterait obtenir des informations très complètes -et parfois très neuves- sur la vie religieuse réunionnaise peut dès maintenant se reporter au travail de C. Prud'homme. Pour les parties communes de nos recherches, nos conclusions sont très voisines. Précisons que, limité par le cadre de ce petit exposé, nous laissons de côté bien des aspects pour lesquels nous disposons de sources abondantes ; on en retrouvera la matière dans notre thèse.
[4] Decreta concilii provinciae Burdigalensis, Rupellae celebrati, anno Domini 1853, C. VI. 50, cité in COCHIN (A.), L'abolition de l'esclavage, Paris, Lecoffre et Millaumin, 1861, t. 1, p. 315-316.
[5] PELLEPRAT (P.), Relation des missions des PP. de la Compagnie de Jésus dans les Isles parue in Voyages et travaux des missionnaires de la Compagnie de Jésus, Paris, 1857, t. 1, p. 49.
[6] RIGORD (L'abbé), curé de Port-Royal (Martinique), Observations sur quelques opinions relatives à l'esclavage, émises à la Chambre des Pairs à l'occasion de la discussion de la discussion de la loi sur le régime des esclaves aux colonies, Port-Royal, 1845, p. 37.
[7] LABAT (R.P. J.-R), Nouveau Voyage aux Isles de l'Amérique, Paris, G. Cavelier, 1722, 6 vol. Réédit. abr. : Voyages aux isles de l'Amérique, Paris, Duchartre, 1931, 2 t., cf. t. 2, p. 38 et GISLER, op. cit, p. 55.
[8] AN, MI. F 3/71, p. 95, mémoire du roi au gouverneur de la Martinique, 25 janvier 1765.
[9] AN, Ml. F 3/71, p. 206-207, mémoire du 8 septembre 1776.
[10] AN, Col. C 3/12, lettre du 1er août 1767, citée par C. WANQUET, Histoire d'une Révolution : la Réunion 1789-1803. thèse d'État, Université d'Aix-Mrseille I, 1978, t. I, p. 229 (ou p. 206 du t. 1 de l'ouvrage édité sous le même titre par Jeanne Laffitte, Marseille, 1980).
[11] AM, HA9, Observations on the Slave Laws, lettre à S.E. l'honorable Sir Charles Colville, 7 août 1828. Cf. aussi MALOET (V.P.), Collection de mémoires et correspondances officielles sur l'administration des colonies, Paris, an X, 5 t., t. 3, p. 41 : l'enseignement religieux est "la plus forte barrière que la politique puisse opposer au désespoir et à la révolte des esclaves".
[12] Cité par H. Mondon, "L'esclavage et le clergé à Bourbon (Aperçu historique)", Bulletin de l'Académie de l'Île de La Réunion, vp ;. 15, 1938, op. cit., p. 24.
[13] AN, Col. F 3/90, p. 106-107, lettre du gouverneur Fénelon, 11 avril 1764.
[14] JANIN (R.P.J.), La religion aux colonies françaises sous l'Ancien régime. Paris, s.d. (1942), p. 130.
[15] Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, Genève, 1782.
[16] Les limites de notre propos ne nous permettent pas d'évoquer les débats sur l'esclavage qui figurent dans la tradition patristique et se développent dans l'Europe médiévale et moderne. Dans une société chrétienne, où les thèmes du salut et de la damnation sont essentiels, théologiens, hiérarchie catholique et parfois simples fidèles s'interrogent sur les moyens de concilier le message de fraternité évangélique avec la malédiction qui pèse sur la sauvage et païenne postérité de Cham, et sur la délimitation des exigences respectives de Dieu et de César". M trouvera sur ces points d'utiles précisions dans l'ouvrage d'A. GISLER (cf. supra, no 2).
[17] CHARPENTIER (F.), Relation de l'Establissement de la Compagnie Françoise pour le Commerce des Indes Orientales, Paris, 1666, p. 81.
[18] BARASSIN (J.), "L'esclavage à Bourbon avant l'application du Code Noir de 1723", RD, no 2, 1956, p. 19-20. FILLIOT (J.-M.), La traite des esclaves vers les Mascareignes au XVIIIe siècle. Paris, ORSTOM, 1974, p. 32-33 et 113-187.
[19] Art. II du Code Noir, cité par P. BAUDE, L'affranchissement des Esclaves aux Antilles Françaises, Fort-de-France, Imprimerie officielle, 1948, p. 106.
[20] DELABARRE de NANTEUIL, Législation de l'Île Bourbon, Paris, J.-B. Gros, 1ère édit., 1844, t. 2, p. 113.
[21] BARASSIN (J.), "L'esclavage...", RD, no 2, op. cit., p. 24-25.
[22] BARASSIN (J.), Naissance d'une chrétienté. Bourbon des origines jusqu'en 1714, Saint-Denis, Impr. Cazal, 1953, xxi-448 p. L'auteur applique l'expression d'“Ère des Aumôniers d'occasion" à la totalité de la période couverte par son ouvrage (cf. p. vii).
[23] MONDON (H.), op. cit : p. 12.
[24] BARASSIN (J.), Naissance d'une chrétienté..., op, cit., p. 159.
[25] LOUGNON (A.), "Quelques pièces touchant l'histoire religieuse des Îles pendant la régie de la Compagnie des Indes", RT, t. 5 no 34, p. 104.
[26] RT, t. 5 no 36, p. 360. L'essentiel de cette lettre, adressée par le P. Renou au général des Lazaristes, a été sauvé, avec divers fragments d'archives, lors du sac de la maison de Saint-Lazare à Paris, le 13 juillet 1789. A. LOUGNON, qui la date d'octobre 1720, en a donné une édition critique aux p. 356-366 du RT (Cf. aussi sa thèse, l'Île Bourbon pendant la Régence, Paris, Larose, 1956, p. 137, no 11)
[27] RT, t. 5 no 34, p. 115.
[28] Lettre du P. Renou, RT, t. 5 no 36, p. 361.
[29] Deux exemples parmi beaucoup d'autres : dans les grands domaines du Brésil, les moines contraignaient souvent leurs esclaves les plus clairs à épouser des filles foncées pour noircir la descendance (R. BASTIDE, Sociologie et psychanalyse, Paris, P.U.F., 1950, p. 243, no 1). À la Martinique, le P. Labat est resté vivant dans la mémoire populaire sous forme de croque-mitaine : la peur qu'il inspire aux enfants semble l'héritière de celle qu'il inspirait aux esclaves.
[30] Archives privées des Lazaristes, registre 1504, "Île Bourbon-Lettres", 20 janvier 1742, lettre publiée in RT, t. 6, no 38, p. 180-184 (180-181).
[31] Archives privées des Lazaristes, reg. 1504, 3 novembre 1721 et RT, t. 3 no 27, p. 286-314 (291-292).
[32] Malgré les Instructions de 1712, la Compagnie des Indes officialise l'habitude qu'avaient prise les missionnaires en attachant à chaque cure de Bourbon huit ménages d'esclaves (contrat du 27 juillet 1736), cf. RT, t. 5 no 34, p. 116 et 146. Le testament du P. Davelu, curé de Saint-Paul, qui résida dans cette paroisse de 1767 à 1815, montre que sur les 20 esclaves qu'il lègue à ses successeurs, se trouvent 3 femmes adultes et célibataires, l'une a 30 ans, elle vit avec sa mère (veuve ?) et 7 frères et soeurs ; les 2 autres femmes célibataires ont 20 et 22 ans et sont dites Malgaches, elles n'ont donc pas pu naître dans un des foyers serviles de la cure. À l'évidence, l'habitude s'est prise de conserver des esclaves créoles non mariés et d'acheter -ou de recevoir- des esclaves de traite des deux sexes (AER, "Journal de la paroisse de Saint-Gilles-les-Hauts", p. 98-99). Des documents des ASE et des ADR (par ex. série V, 7, 1822) permettent de connaître le sort de cet héritage.
[33] BARASSIN (J.), Mémoire pour servir à la connoissance... L'île Bourbon et Antoine Boucher (1679-1725) au début du XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, coll. Peuples et Pays de l'Océan Indien, 1978, p. 437.
[34] SCHERER (A.), Histoire de la Réunion, Paris, P.U.F., 1965, p. 28.
[35] AER, "Journal...", op. cit., p. 191.
[36] En 1776, il y a sur l'habitation Desbassayns 113 esclaves adultes de sexe masculin et 80 de sexe féminin ; en 1785, les totaux respectifs sont de 119 et 82. L'examen des feuilles de ménage établies pour les formalités de recensement montre qu'en 1789 il existe 89 "couples possibles" et 123 enfants, contre 72 "couples possibles" et 48 enfants en 1776 (cf. D. BARRET, "Monographie d'une habitation coloniale à Bourbon : la propriété Desbassayns (1770-1846)", mémoire de maîtrise dactyl., Paris I, 1976-1977, p. 8, 11, 139-140.
[37] Lettre à l'Archevêque de Paris, 28 janvier 1742, RT, t. 6, no 38, p. 188.
[38] Histoire générale des Antilles habitées par les Français, Paris, 1667, t. 2, p. 505
[39] WANQUET (C.), Histoire d'me Révolution..., op, cit., 1978, p. 37, no 6 (ou t. 1, 1980, p. 48).
[40] MILBERT (J.G.), Voyage pittoresque à l'Île de France, au Cap de Bonne Espérance et à l'Île de Ténériffe, Paris, A. Nepveu, 1812, t. 2, p. 175.
[41] WANQUET (C.), Histoire d'une Révolution..., op, cit., 1978, p. 67-68 (ou t. 1, 1980, p. 73-75), p. 879, no 2 (ou t. 1, 1980, p. 745, no 110) : "Il y a des maîtres, écrit Dioré, "qui négligent d'aimables et respectables épouses, de jolies femmes, pour des êtres bêtes, puants, laids (...), c'est à peu de chose près le crime de bestialité".
[42] Journal daté de "St. Paul Isle de Bourbon le 14e Xbre 1733" publié in RT, t. 4, no 32, p. 329-369 (cf. 360-361). Sur le baptême imposé par les Portugais, cf. J.-M. FILLIOT, La traite des esclaves..., op. cit., p. 198.
[43] Agréé par le P. Teste, préfet apostolique, en 1763, ce Coutumier fut proposé comme règle de conduite aux missionnaires fixés à l'Île de France, il est reproduit in RT, t. 6 no 37, p. 55-91 (cf. 65-66). Les registres de baptême, mariage et sépulture conservés aux ADR et aux ANOM peuvent être consultés à l'aide du Répertoire des registres paroissiaux et d'état civil antérieurs à 1849, dressé par P. CARRERE et A. SCHERER, ADR, Nérac, G. Couderc, 1963, 143 p.
[44] RT, t. 6 no 37, p. 65.
[45] Journal de Dejean, op. cit., p. 359.
[46] Lettre à Mgr. de Beaumont, archevêque de Paris, fin 1754. Le pape venait de confirmer à l'archevêque de Paris son droit de juridiction sur les Mascareignes. Cf. RT, t. 5 no 34, p. 169.
[47] MILBERT (J.G.), Voyage.., op. cit., t. 2, p. 174-175.
[48] TOUSSAINT (A.), La route des îles, Paris, SEVPEN, 1967 ; Histoire des Îles Mascareignes, Paris, Berger-Levrault, 1972 ; FILLIOT (J.M.) La traite des esclaves..., op. cit., Brève synthèse in GERBEAU (H.), "le rôle de l'agriculture dans le peuplement de la Réunion", Cahiers du Centre Universitaire de la Réunion, no 8, décembre 1976, p. 61-68, ou p. 133-142 du vol. 3 d'Études et Documents de l'Histoire générale de l'Afrique, Relations historiques à travers l'Océan Indien, Paris, UNESCO, 1980.
[49] Coutumier, op. cit., RT, t. 6 no 37, p. 66-67.
[50] MONDON (H.), op. cit., p. 13-14, et les témoignages de Caulier, RT, t. 6 no 37 p. 68 et de Teste, RT, t. 5 no 34, p. 172-174.
[51] RT, t. 6 no 37, p. 67.
[52] Archives privées des Lazaristes, reg. 1504, mémoire de Caulier, 20 juillet 1772, fragment cité par J. BARASSIN, "Pastorale d'hier et pastorale d'aujourd'hui", RT, no 4, 1960, p. 145 (et Bulletin de l'Académie de l'Île de la Réunion, vol. 19, 1959-1960, p. 103).
[53] Lettre du P. Renou, RT, t. 5 no 36, p. 360.
[54] Lettre du 28 janvier à l'Archevêque de Paris, RT, t. 6 no 38, p. 185-186.
[55] Nous évoqueront ultérieurement les mutations encore plus considérables qui, au XIXe siècle, semblent liées à l'ère du sucre, de la traite illégale et du "coolie-trade". On peut suivre les grandes lignes de l'évolution économique et sociale de la Réunion, des origines au XXe siècle, sur les trois cartes, accompagnées de graphiques et de notices, établies par J. BARASSIN, C. WANQUET et H. GERBEAU pour l'Atlas Des Départements Français d'Outre-Mer, I. La Réunion. Paris, CNRS et IGN, 1975.
[56] Les derniers feuillets de la lettre ayant disparu, le nom du signataire manque. Le document date de 1740 et a été publié in RT, t. 3 no 26, p. 236-266.
[57] WANQUET (C.), Histoire d'une Révolution..., op. cit., 1978, p. 65-68 (ou t. 1, 1980, p. 72-74).
[58] AN, P 19/6212, Réunion, mémoire du 2 février 1808.
[59] WANQUET (C.), Histoire d'une Révolution..., op. cit., 1978 ; l'auteur précise même : ''L'exemple peut-être le plus significatif de la modération du mouvement populaire réunionnais est donné par sa politique religieuse" (p. 1287-1289 ; au moment où nous remettons ces notes à l'imprimeur, le t. 2 de la thèse de C. Wanquet à paraître chez J. Laffitte en 1981, est sous presse).
[60] WANQUET (C.), Histoire d'une Révolution..., op. cit., 1978, p. 1865-1866. Cf. aussi PRENTOUT (H.), L'Île de France sous Decaen, 1803-1810, Paris, Hachette, 1901, p. 288.
[61] ADR, nombreux détails dans la série L, en particulier L 319/I "1791-1794, affaire du curé Lafosse" et L 322/I "deuxième affaire du curé Lafosse". Cf. aussi Émile TROUETTE, dont le t. 2, manuscrit, est déposé aux ADR (série J) et dont le t. I a été publié sous le titre L'Île Bourbon pendant la période révolutionnaire, Paris, Challamel, 1888 (p. 207 pour la déclaration de Lafosse de 1791). C. WANQUET (op. cit., 1978) présente l'action de Lafosse au cours de divers épisodes révolutionnaires : cf. notamment l'index, p. 102, et les p. 464-468, 539-540, 1267-1268 et 1698-1711 (p. 1709 pour les deux "esclaves protecteurs"). Un résumé de l'oeuvre du Lazariste, une réflexion sur ses prolongements politiques et religieux et une présentation des traditions orales la concernant se trouvent dans neuf articles parus en 1976 dans Témoignage Chrétien de la Réunion (no 133 à 138 et 140 à 142), le passage sur les "demandes de messe au père Lafosse" est dans le no 133. Le texte, légèrement abrégé, de ces articles a paru dans Les Cahiers de la Réunion et de l'Océan Indien, no 2, Nouvelle série, Saint-Denis, décembre 1976, p. 70-91, sous le titre "Jean Lafosse, prêtre abolitionniste". Dans les deux cas, l'auteur a gardé l'anonymat. Ces thèmes sont abordés également par P. EVE, dans un mémoire de maîtrise soutenu en juin 1977 à l'Université de Provence : Culte des Saints, Médiateurs et Intermédiaires à La Réunion, fascicule I, dactyl., p. 132-147, "Le culte voué au P. Lafosse.
[62] L'épopée des esclaves marrons, réfugiés dans les hauteurs de l'Île, au XVIIIème siècle, en fournit un exemple. La toponymie en a gardé la trace et un certain nombre de textes en permet l'étude : le P. Barassin en a proposé une sous le titre "La révolte des esclaves à l'Île Bourbon (Réunion) au XVIIIème siècle". Présentée en septembre 1972 au Quatrième Congrès de l'Association Historique Internationale de l'Océan Indien -réuni avec le Quatorzième Colloque de la Commission Internationale d'Histoire maritime- à Saint-Denis, cette communication avait suscité quelques réserves chez des militants politiques réunionnais (le texte en a été publié dans le volume des Actes intitulé Mouvement de populations dans l'Océan Indien, Paris, H. Champion, 1980, p. 357-391). Les chefs marrons sont en effet devenus les symboles de la résistance populaire au colonisateur et leur approche à travers les seules sources européennes semble, à juste titre d'ailleurs, comporter des risques de mutilation de la réalité. Mais l'historien doit admettre que, dans ce cas précis, le recours à la mémoire populaire comporte des risques encore plus grands. Eugène DAYOT (1810-1852), a écrit le roman de ces marrons sous le titre Bourbon pittoresque (publié en feuilletons dans Le Courrier de Saint-Paul puis dans un volume d'Oeuvres choisies, Paris, Challamel, 1878). L'auteur aurait utilisé quelques traditions orales qui semblent aujourd'hui définitivement enfouies sous d'autres récits nés du roman lui-même. Ce dernier, qui témoigne de dons épiques certains et d'une grande richesse d'imagination, a été popularisé par des feuilletons parus dans Le Peuple en 1914 et dans Croix-Sud en 1964, ainsi que par deux éditions présentées par Jacques LOUGNON (Saint-Denis, Imprimerie de Croix-Sud, 1966 et Nouvelle Imprimerie Dionysienne, 1977). Nous pensons que l'enrichissement des récits, c'est à dire la naissance d'une pseudo-tradition orale, sont attestés dès le dernier tiers du XIXème siècle. L'un des responsables en est un voyageur mauricien, C.H. LEAL qui, prétendant relater des histoires qu'il a "entendu conter" lors de ses séjours dans l'Île, propose un texte manifestement puisé dans E. Dayot (Cf. le chapitre de Leal intitulé "Les chefs noirs", aux p. 73-90 d'Un voyage à la Réunion. Récits, Souvenirs et Anecdotes. Septembre 1877, Maurice, General Steam Printing Company, 1878, 283 p.). Nous avons dû, ces dernières années, décevoir l'attente de plusieurs interlocuteurs qui espéraient que nous pourrions les aider à nourrir de précisions historiques les biographies séduisantes - mais mythiques- des chefs marrons. Le droit à l'historicité des esclaves est-il mieux défendu quand on tente de suppléer à leur silence par un bavardage romantique ?
[63] Outre les traditions orales sur le P. Lafosse recueillies par des auteurs cités, supra, no 61, nous avons utilisé des témoignages obtenus personnellement lors d'enquêtes réalisées depuis 1976 (Programme de recherche du Centre Universitaire Méditerranéen et du Centre Universitaire de la Réunion pour la constitution d'“Archives orales réunionnaises”). L'absence de traces laissées dans la "mémoire populaire par plusieurs prêtres de la période suivante est confirmée par P. EVE, Culte des Saints..., op, cit, p. 140-141, en ce qui concerne les PP. Minot, Monnet et Levavasseur.
[64] JANIN (J.), Le clergé colonial de 1815 à 1850. Paris, Maison Mm des PP. du Saint-Esprit, 1936, p. 17-18 et 21. Le nombre de cinq prêtres résidant à Bourbon après la Révolution est également donné par Mgr. A. LE ROY, in Le T.R.P. Frédéric LE VAVASSEUR, mort Supérieur général de la Congrégation du Saint-Esprit et du Saint Coeur de Marie (1882). Paris, Procure générale (des PP. du Saint-Esprit), s.d., p. 20 : "En 1814, il n'y restait que cinq prêtres (...) âgés et infirmes". H. MONDON, op. cit., p. 24, écrit même : "Après la tourmente révolutionnaire, il n'y avait plus à Bourbon, pour 150 000 âmes, que quatre prêtres âgés et infirmes". L'estimation de la population totale est manifestement erronée ; le prélat indique d'ailleurs lui-même, pour 1815, "16 400 Blancs, 3 496 libérés et 70 000 esclaves", (op. cit., p. 22). En réalité, au début de la Restauration, la population de l'Île ne doit pas atteindre les 80 000 habitants, au nombre desquels près de 60 000 sont esclaves (Cf. A. SCHERER, op. cit., p. 62-63 et H. GERBEAU, "Le rôle de l'agriculture...", op. cit., p. 135-137).
[65] AP, Scritture..., vol. 2, "Détails sur l'état de la religion dans les colonies donnés par M. l'Abbé Minot missionnaire à Bourbon", s.d. (c. 1824-1827), fol. 281 r.v. Les deux prêtres aliénés qu'évoque Minot n'ont peut-être pas été pris en compte par H. Mondon, ce qui expliquerait la différence d'effectif de 4 à 6 (cf. sapra, no 64). Pastre, nommé curé de Saint-Paul, donne des précisions sur son ministère dans une lettre du 7 septembre 1817, adressée à une correspondante métropolitaine (reproduite p. 104-107 de l'Almanach religieux de l'Île Bourbon ou de la Réunion pour l'année bissextile 1864. Versailles, Beau jeune, imprim., s.d., 336 p.). Pour l'opinion du gouverneur : ANOM, Réunion, C 456, d 5109, Lafitte de Courteil, Commandant pour le Roi, 5 septembre 1817.
[66] AP, Scritture..., vol. 2, "Détails...", op. cit., fol. 282 r.
[67] ASE, B 231, 1 I (= liasse I), letttre du 26 novembre 1818 au P. Bertout.
[68] Mînot, AP, op. cit., fol. 282 r. La médiocrité des constructions semble être un fait ancien : Thibault de Chanvalon écrivant au gouverneur Farquhar, pendant l'occupation anglaise, signale qu'il avait été frappé, dès 1785, "de l'indécence des sépultures". Tel cimetière, "ouvert maintenant de tous côtés, poursuit-il, laisse un libre passage aux chiens et à tous les animaux qui viennent déterrer les cadavres et traîner aux regards des parents les restes inanimés d'un père ou d'une mère chérie qu'ils avaient confiés à la terre". Quant aux églises, précise l'administrateur, il les voit "tombant partout en ruine" (ADR, L 180, Correspondance de l'Inspecteur général avec le gouvernement, 1810-1811". Chanvalon occupe ces fonctions à partir du 3 mai 1811 ; il était ordonnateur à Bourbon sous l'Ancien Régime).
[69] AER, "Journal de la paroisse de Saint-Gilles-les-Hauts", p. 191.
[70] ASE, B 231, 1 I, lettre du 26 novembre 1818, op. cit.
[71] ADR, 42 M 16, lettre du Ministre aux Archevêques et Évêques du Royaume, 10 juin 1823 (pièce jointe à la circulaire no 172 adressée aux gouverneurs).
[72] AP, Scritture..., vol. 2, "Détails...", op. cit., fol. 281 v. Sur l'action de la congrégation du Saint-Esprit et le problème du recrutement des prêtres destinés aux colonies, cf. par exemple : J. JANIN, Le clergé colonial de 1815 à 1850, op. cit., p. 37-52, 70-74, 104-117 ; G. GOYAU, La congrégation du Saint-Esprit, Paris, Grasset, 1937, p. 53-71 ou, du même, La France Missionnaire dans les Cinq Parties du Monde. Paris, Plon, 1948, t. 2, p. 144-151 ; R.P.M. BRIAULT, Le Vénérable Père F.-M.-P. Libermann, Paris, 1946, p. 168-181 ; Notes et Documents relatifs à l'histoire de la Congrégation du Saint-Esprit (...) 1703-1914, présentation par A. LE ROY, Supérieur général, Paris, Maison-Mère, 1917, p. 24-73.
[73] Le P. J. JANIN, Spiritain, consacre un chapitre de son volume sur Le clergé colonial de 1815 à 1850 à étudier la "valeur morale" de celui-ci (op. cit., ch. XVIII, p. 287-320). Sans avoir dissimulé un certain nombre d'excès, et ayant cité les opinions défavorables de Montalembert, de Cochin et de divers historiens ou témoins -dont plusieurs ecclésiastiques- l'auteur conclut pourtant dans un sens positif. Se référant, par exemple, au "grand nombre de prêtres qui furent expédiés pour inconduite", Janin analyse le cas de plusieurs d'entre eux qui, après leur expulsion des Antilles ou de la Réunion, furent réhabilités en France. Aux colonies, en effet, commente-t-il, ''quand on voulait se débarrasser de quelqu'un on mettait généralement en avant cette raison là sachant bien qu'elle était péremptoire (...) on ne se donnait même pas la peine de vérifier (...) on ne permettait jamais au prêtre de se défendre" (p. 299). L'auteur constate aussi que Libermann, le Supérieur Général, avait d'abord eu me opinion défavorable des prêtres des colonies, allant jusqu'à écrire à la congrégation de la Propagande : "Les uns n'ont aucun zèle, et ne s'occupent pas assez des âmes ; d'autres cherchent de l'argent ; d'autres sont ingouvernables et ont mauvaise tête ; d'autres enfin se conduisent mal soit contre les meurs, soit par la boisson". Ensuite, parce qu'il était mieux informé estime Janin, Libermann change d'opinion, écrivant par exemple dans son rapport aux Évêques, de 1850, que "le clergé colonial fut surtout composé de bons prêtres", qu'il y en eut un "très petit nombre" de mauvais et "un certain nombre" de médiocres. Se rangeant à cette conclusion, l'auteur pense que si le clergé a paru inférieur à sa tâche, c'est qu'aux colonies celle-ci "était exceptionnelle" et qu'il avait à résoudre des "questions épineuses et parfois inextricables" (p. 292 et 320). Sans pouvoir conclure nous-même sur le pourcentage des "bons" et des ''mauvais'', ajoutons quelques pièces au dossier, qui montrent des prêtres affrontés aux tentations et aux problèmes "inextricables", liés pour la plupart plus ou moins directement à l'esclavage : Mathieu néglige "sa paroisse pour se livrer au travaux d'agriculture" ; Lombardi fait de même, c'est un prêtre "non seulement inutile mais nuisible" (ASE, Clergé colonial II, Notes individuelles, 1829-1857, 7 E). De ce dernier, le vicaire apostolique Poncelet écrit : "Prêtre sans science, sans foi et très probablement sans meurs" et, dans un autre document, "Bon seulement à mettre dehors" ; rayé des cadres à Bourbon, Lombardi est accueilli par une paroisse de Maurice et figure parmi les confrères du P. Laval (MICHEL, J., C.S.Sp., Le Père Jacques Laval, Paris, Beauchesne, 1976, p. 105, qui cite Poncelet d'après ASE, lettres du 11 octobre 1835 et du 12 août 1836). Il n'est peut-être pas parmi les pires ; ''prêtres qui sont venus là pour gagner de l'argent et pour s'amuser", écrit Laval et, dans me autre lettre, "prêtre (qui) ont donné ici des scandales inimaginables" (Lib. 3, 1933, p. 457 et 469, lettres au P. Libermann du 22 février et du 23 juillet 1842). L'un tient boutique, l'autre a une vie double... Las de "toute cette racaille de prêtres", Mgr. Collier supplie un ami de Londres de lui envoyer quatre bons ecclésiastiques ; un seul débarque à Port-Louis et se voit aussitôt frappé d'interdit car "il est venu avec une femme, "son épouse", peut-on lire sur la liste des passagers publiée dans les journaux" (MICHEL, J., op. cit., p. 104-105 et 108). À la même époque, dans l'Île-soeur, le Gouverneur se plaint au Ministre du ''défaut de capacité ou de conduite de quelques-uns des ecclésiastiques" (ADR, 47 M I, lettre no 120 du 26 septembre 1842). Quelques années plus tard, la police de Bourbon demande l'aide de celle de Maurice pour retrouver Véron : "ce prêtre assez mal noté, précise l'inspecteur, a pris un passe-port pour votre île (...) on assure qu'il n'est point parti et se cache ici" (ADR, 73 M 6, lettre du 27 septembre 1847 au Commissaire en chef de la police à Maurice). Préteceille remplit ses devoirs mais "ramasse de l'argent" (AM, 2 M I, Notes semestrielles des fonctionnaires et employés du Clergé, 1847). En douze ans, le ministère de Millimaz "a été presque nul, mais il s'est massé des sommes considérables qui vont le mettre à même de vivre en France sans emploi" (AER, Registre de correspondance, 1851-1865, p. 32-33, lettres de Mgr. Desprez au Ministre de la Marine et au Ministre des Cultes, 7 juin 1852). Au moment de l'émancipation, Monnet souhaite "le rappel immédiat de cinq ecclésiastiques de Bourbon", et de cinq autres des Antilles, rappel "urgent pour le bien de la Religion, surtout à cause des circonstances actuelles" (lettre au Ministre de la Marine, Paris, 7 mars 1848, Lib. 10, 1940, p. 379).
[74] Lettre du 7 septembre, in Almanach religieux de l'Île Bourbon..., op. cit., p. 105. Cottineau : "On n'habille presque pas les négresses en sorte que ces malheureuses se prostituent pour un mouchoir, un tablier" (ASE, B 231, 1 I, lettre du 26 novembre, 1818, op. cit.) Warnet : Frédéric Levavasseur - le futur prêtre - qui est alors un de ses jeunes paroissiens de Saint-Denis, témoigne de "sentiments religieux qu'il a conservés comme par miracle, seul au milieu d'une jeunesse dissolue" (ASE, B 231, 1 I, lettre du 16 mars 1829 à Fourdinier).
[75] AM, HA 9, Observations on the Slave Laws, lettre au gouverneur, S.E. l'honorable Sir Charles Colville, 7 août 1828.
[76] AM, HA 9, Observations on the Slave Laws, "Observations sur l'ordre en conseil du 10 mars 1824 (...) clauses 10 et 11". Il est fait référence à l'article 4 des Lettres Patentes de 1723 et à l'article 5 de l'Ordonnance du 6 septembre 1767, concernant l'interdiction de faire travailler la terre, le dimanche, par les esclaves.
[77] MAMET (Mgr J.) , Le diocèse de Port-Louis, The General Printing and Stationery Cy. Ltd., Port-Louis, 1947, p. 171.
[78] ASE, B 231, 1 I, fragment de lettre, s.d. (1818 ?).
[79] ADR, 42 M 14, lettre no 14, du Ministre au Gouverneur de Bourbon, 25 janvier 1822.
[80] ADR, 42 M 18, lettre no 122, du Ministre au Gouverneur de Bourhon, 16 juin 1824, p. 17.
[81] ARD, 45 M 7, Sté dans la lettre no 58, du Gouverneur de Bourbon au Ministre, 7 avril 1824. Quand la messe est dite à Saint-Paul pour les esclaves, on l'accompagne d'une séance de catéchisme. Cottineau procédait déjà ainsi à Sainte-Marie (ASE, B 231, 1 I, fragment de lettre, s.d., op. cit.). Les problèmes de transmission du message chrétien restent analogues à ceux qu'avaient connus les Lazaristes. Au niveau du langage, un progrès va cependant être réalisé par l'emploi plus systématique du créole. Le Bulletin de la Société de Linguistique de Paris (VII, 1888-1892, p. CXXII) présente, sous la signature du Capitaine LARAY, un "Catéchisme en créole de l'Île Maurice en 1828". S'adressant aux nouveaux affranchis de cette île, le P. Laval s'efforce, en 1842, d'utiliser leur "patois" (lettres à divers correspondants, reproduites in Lib. 3, 1933, p. 455-473 et J. MICHEL, Le Père Jacques Laval, Paris, Beauchesne, 1976, op. cit., p. 115-117). La religion n'a plus alors à cautionner l'esclavage mais peut être conçue comme l'apprentissage d'une liberté plus authentique. À Bourbon, comme à Maurice, c'est sans doute ce changement d'optique qui, tout autant qu'un langage plus adapté, permet une meilleure communication. Mais ce n'est que dans les années 1840-1850 que le catéchisme y connaît ce renouveau, par l'action auprès des esclaves promis à la liberté, ou auprès des affranchis de 1848, de frères des Écoles chrétiennes comme Scubilion ou de prêtres comme Levavasseur et Monnet. Un extrait des leçons de catéchisme en créole de ce dernier est donné in Mgr. A.-R. MAUPOINT, Madagascar et ses deux premiers Évêques, t. II, Monseigneur Monnet, Paris, C. Dillet, 1864, p. 52-53. En revanche le Catéchisme à l'usage des esclaves, publié à Bourbon en 1841 est encore formulé en français - en 1973 nous avons consulté dans les AVR un exemplaire de cette brochure, qui semble rarissime (anonyme, Saint-Denis, Lahuppe, 19 p.). En 1842, paraît une traduction en langue créole du petit catéchisme du Saint-Esprit approuvé par la Propagande pour les colonies françaises, par M. GOUX (Paris, Imprim. Vrayet de Surcy, 1842, 72 p.). L'auteur, missionnaire à la Martinique, a réalisé sa traduction dans le créole de cette île. L'effort de "créolisation" de l'apostolat aux Antilles semble donc contemporain de celui des Mascareignes.
[82] ADR, 42 M 17, pièce jointe à la lettre no 268, du Ministre au Gouverneur de Bourbon, 22 octobre 1823.
[83] ADR, 42 M 18, lettre du 16 juin 1824, p. 17, op. cit.
[84] AP, Scritture..., vol. 2 "Détails...", op. cit., fol. 282 v.
[85] AP, Scritture..., vol. 2, fol. 214, 1827.
[86] GISLER (A.), L'esclavage aux Antilles françaises..., op. cit., p. 65.
[87] Mémoire cité par DELABARRE de NANTEUIL, Législation de l'Île Bourbon, op. cit., 1ère édit., 1844, t. 2, p. 92.
[88] Cf. supra, notes 54 et 55.
[89] Les autorités de Bourbon redoutent la contagion émancipatrice : à partir de 1832, tout esclave qui aurait communiqué avec une île anglaise, tout navire britannique dont l'équipage comporterait des esclaves se voient interdire l'accès de la colonie : en 1839, l'interdiction est maintenue pour les Noirs émancipés de Maurice (Arrêtés du 3 avril 1832 et du 10 mi 1839, cf. le Bulletin Officiel de l'Île Bourbon et DELABARRE de NANTEUIL, Législation de l'île Bourbon, op. cit., 1ère édit., 1844, t. 1, p. 126 et t. 2, p. 471 et 482). L'impatience de la liberté semble se manifester plus fortement chez les esclaves : les habitants dénoncent par exemple de nombreux complots, souvent imaginaires, quelquefois réels (cf. la correspondance du Gouverneur au Ministre : sur le complot de Saint-Benoît et sur celui de Saint-André, ADR, 45 M 13, lettre no 170 du 22 mai 1832 et 45 M 15, no 62 du 4 février 1836).
[90] ADR, 174 M I, le Directeur de l'Intérieur, Betting de Lancastel, cite, parmi les inconvénients de la traite illégale, le fait qu'elle introduit "des hommes dont les habitudes sauvages et barbares sont constamment un sujet d'inquiétude dans un pays à esclaves" (lettre au Gouverneur, 11 juin 1828). Analysant le cas des Antilles anglaises, MATHIESON pense que le sort des esclaves a pu s'y améliorer quand a pris fin l'apport annuel "of the savage Africans who had caused the revolts and provided a pretext for all the barbarous laws and punishments" (British Slavery and its abolition, 1823-1838, London, 1926, p. 60).
[91] Le Travail, bihebdomadaire de Saint-Pierre de la Réunion, 3 septembre 1870, p. 4.
[92] "À mon fils. Mes Souvenirs, par Sully-Brunet", manuscrit de vii-411 p., conservé par M. L.J. Camille RICQUEBOURG, un de ses descendants, p. 58-59.
[93] Délibérations et avis du Conseil Spécial..., 96 p. Séance du 26 novembre 1841, p. 34, intervention du baron de Roujoux. Un rédacteur de la Feuille hebdomadaire de l'Île Bourbon, se fondant sur les effets de l'émancipation à Maurice et dans diverses colonies anglaises, approuve vigoureusement les termes d'une brochure de Jollivet, député d'Ille-et-Vilaine : "Les noirs, devenus libres, ne veulent pas continuer la culture, de peur d'être considérés comme esclaves (...). Affranchir les esclaves et conserver le travail, tel est donc le problème à résoudre. La solution (...) doit être préparée longt-temps (sic) à l'avance" (No du 18 septembre 1839, p. 1). Les milieux officiels sont, comme les habitants de Bourbon, attentifs à l'expérience mauricienne : au retour d'une mission dans l'île, Passot, officier d'infanterie de marine, expose que la situation y est ''déplorable''. Sur les 80 ou 90 000 noirs libérés, écrit-il, "on en compte environ encore dix mille sur les habitations mis pas un au travail de la terre. Tous sont occupés comme maçons, charpentiers, charretiers ou manoeuvres. Vingt mille environ sont morts autant de misère que de maladie (...). Mutes les femmes sont livrées au libertinage" (lettre datée M Saint-Denis, 15 février 1843, donnée en annexe de la lettre adressée par le Ministre de la Marine et des Colonies au Ministre des Affaires Étrangères, le 4 juillet 1843. Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Mémoires et Documents, Afrique no 69, Îles de l'océan Indien, I, 1840-1866, 443 fol., fol. 105 v.).
[94] Le Créole, 15 mai 1840, p. I (journal fondé à Saint-Paul en 1839 par E. DAYOT, auteur de Bourbon pittoresque ; il en a assuré .la direction jusqu'à sa vente en 1844 - cf. supra no 62).
[95] Lib. I, 1929, p. 589-690, "L'Oeuvre des Moirs", chapitre où sont cités lettres et documents divers concernant "l'établissement de la pauvre petite Congrégation des missionnaires du Saint-Coeur de Marie". À noter qu'un commentateur -sans doute le P. Cabon, qui a rassemblé les textes publiés dans les volumes "Lib." - précise que la Congrégation "ne tient en rien au courant d'opinion que révèlent les actes du Gouvernement français ; c'est par un motif tout surnaturel que les promoteurs de l'Oeuvre des Noirs entreprirent leur société" (p. 690). Affirmation inutilement tendancieuse puisque, dans une perspective spiritualiste, l'une et l'autre explication peuvent aller de pair. Le souci d'apologétique et d'édification n'est pas absent de ces volumes, dont l'intérêt est immense mais qu'il faut utiliser avec quelque précaution. La consultation des originaux de lettres de missionnaires aux AP et aux ASE montre, par exemple, que certaines "aspérités'' en ont été ''limées'' avant impression dans Lib. (ainsi pour la présentation des premiers contacts -assez froids- de Monnet et de Levavasseur). Cf. aussi les volumes, déjà cités, de MICHEL sur Laval, de MAUPOINT sur Monnet et de LE ROY sur Levavasseur (cf. supra, no 81, 73 et 64).
[96] AP, Scritture..., vol. 3, ''Mémoire de Mr. Levavasseur adressé au préfet apostolique de l'Île Bourbon", 17 novembre 1844, fol. 373 r. Lib. 2, 1931, "Suite du mémoire du P. Tisserant", p. 17, fin de la n. I. ASE, B 232, A I, lettres de Levavasseur à Libermann du 6 mai 1843 et s.d. (novembre ou décembre 1843 ?). ASE, B 232, A III, lettre de Blampin à Libemann, 28 juillet 1851.
[97] AVR, lettre de Monnet à (Charles) Desbassayns, Saint-Paul, 19 décembre 1844.
[98] ASE, B 232, A III, lettre de Blampin à Libemann, s.d. (mai 1844 ?) p. 6 : "Je ne rencontrai presque pas d'opposition, au moins formelle, dans les noirs de Colimaçon (...). Une seule négresse me rebuta. C'est une vieille gardienne, un peu philosophe qui prétend n'avoir besoin ni de prêtre, ni de confession. Elle est d'ailleurs assez bonne et l'on est content de son service". Deux anecdotes semblables sont rapportées par Levavasseur, un esclave malgache, que l'on essaie de convertir riposte, par exemple, en créole : "Moin n'en a mon Bon Dié, laisse à moin" (AP, Scritture..., vol. 3, fol. 397 v.).
[99] APRPR, Journal de la paroisse, p. 2.
[100] Ibid., p. 1-2. Par cette formule, le chroniqueur trahit peut-être lui-même quelque préjugé contre le travail manuel : Monnet n'est pas présenté comme accomplissant toute tâche, mais on le montre réalisant, de façon épisodique, en homme exceptionnel de force et de courage, ce qui fait "plier plusieurs hommes".
[101] AVR, lettre de Monnet à (Charles) Desbassayns, Paris, 15 août 1846.
[102] ANOM, Réunion, C 3 d 36, lettres de Graeb au ministre, du 15 septembre 1847 et du 12 mai 1848. Dans le document daté du 15 septembre, le Gouverneur affirme que les esclaves supposaient que Monnet avait reçu pour mission "non pas de les moraliser mais de prononcer leur libération immédiate". L'affaire Monnet a suscité des réactions passionnées ; de nombreuses traces en subsistent, soit rassemblées (ANOM, Réunion, C 3 d 36), soit dispersées (par ex. : ADR, 47 M 2, no 794, transcription de la lettre du Gouverneur au Ministre, datée du 17 novembre 1847), Monnet lui-même a rédigé une Relation des évènements qui ont eu lieu à Bourbon en Septembre 1847 (Nantes, 1847, 31 p.) ; le texte en a été reproduit aux p.. 161-194 du volume de Mgr. A.-R. MAUPOINT, Madagascar et ses deux premiers évêques, t. II, op. cit., dont les chapitres XI et XII sont consacrés à cette affaire (p. 137-195). Nombreux détails aussi dans la presse locale de septembre 1847, dans Volsy FOCARD, "Un charivari historique" (Bulletin de la Société des Sciences et Arts de l'Île de la Réunion, 1867, p. 120-130), dans D. LAVERDANT, La question coloniale, Paris, Librairie Sociétaire, 1848, 144 p. (p. 5-12, 17-18).
[103] APRPR, Journal de la paroisse, p. 5-6. Dans les mois qui suivent l'émancipation, la peur de, voir un nombre croissant d"affranchis se détourner de l'état d'ouvrier agricole ou de domestique, pousse les notables à traquer tous les prétextes à "oisiveté" : le Conseil municipal de Saint-Denis, dans sa séance du 24 février 1849, décide d'adresser un mémoire au Commissaire Général Sarda Garriga pour lui faire remarquer que l'article 3 de son arrêté du 24 octobre 1848 qui "dispense les femmes mariées de tout engagement de travail" pour favoriser les vertus familiales chez les affranchis, a abouti à un effet contraire ; "les femmes se sont mariées sans doute, mais dans le but de pratiquer l'oisiveté, le recel et le libertinage (...) toujours recherchées par leur rareté (elles) demeurent oisives et indolentes au fond de leurs cases" (Archives municipales de Saint-Denis, I D 9, Registre des procès-verbaux de délibérations du Conseil municipal, 1848-1850, fol. 57 r.v.). Le clergé est poussé à vanter les mérites du labeur : "Les affranchis, attirés vers la Religion, se portent avec ardeur dans les Églises (...). Nous avons recommandé partout de leur apprendre à aimer le travail" (11 septembre 1851, rapport de Mgr. Desprez à MM. les Ministres de la Marine et des Cultes, compte-rendu de la tournée épiscopale de 1851, AER, Registre de correspondance, 1851-1865, p. 5).
[104] AFMR, Livre de la Fondation, p. 102-103, lettre d'Aimée Gaétan Pignolet de Fresnes (C"est à dire Mère Marie Madeleine de la Croix). Les Pères du Saint-Coeur de Marie avaient souhaité qu'une institution analogue à celle qu'ils avaient créée pour les garçons soit organisée pour les filles d'esclaves libérés, "afin d'arracher ces enfants au vice, et de les former au travail et à une vie solidement chrétienne" (APRPR, Journal..., op. cit., p. 5). Sur les Filles de Marie, cf. du P. R. DUSERCLE, C.S.Sp., Histoire d'une Fondation, Port-Louis, The General Printing and Stationery Cy. Ltd., 1949, 392 p.
[105] ADR, V 4, pièce no 4, "Constitutions...", 70 p. (p. 1-2 et 58).
[106] Ibid., Constitution I, p. 2 et Constitution XVII, "Des ouvrages", p. 28).
[107] AER, Registre de correspondance, 1851-1865, p. 200, lettre de Mgr. Desprez au Ministre, 16 octobre 1856.
[108] Ibid. Une étude sociologique de la Congrégation reste à faire ; il n'est pas certain qu'elle sait possible. Il serait intéressant de connaître l'origine ethnique des soeurs et le milieu socio-culturel d'où elles sont issues, d'établir le rôle que ces facteurs peuvent jouer dans l'attribution des responsabilités à l'intérieur de la Congrégation, d'étudier l'évolution des pourcentages depuis le milieu du XIXème siècle. L'ouvrage du P. DUSSERCLE (Histoire d'une Fondation, op cit., montre clairement les préventions soulevées dans la haute société créole par le projet de "fusion du maître avec l'ancien esclave", mais aussi le rôle joué par les grandes familles de l'Île dans le soutien apporté aux Filles de Marie, et dans leur recrutement (première approche par l'arbre généalogique h. t. situé entre les p. 24 et 25, et par l'index, p. 387-392). Autre exemple : deux notes qui accompagnent la copie d'une lettre de Delphine de Villèle, datée de mai 1856, indiquent qu'elle est la "petite fille de Mme Charles Desbassayns et (la) tante de deux religieuses, Filles de Marie" et que se soeur Ombeline sera "plus tard la mère de la très regrettée Mère Marie de Jésus (APRPR, Cahier de 6 fol. contenant le récit consacré à la Vierge Noire, cf. infra, no 113).
[109] AER, Mgr. Desprez, op. cit.
[110] Lettre du 22 septembre et arrêté du 28 octobre, cités dans l'article "Instruction publique", DELABARRE de NANTEUIL, Législation de l'Île de la Réunion, Paris, E. Donnaud, 2ème édit., 1861-1863, t. 3, n. 306-308. Selon une confusion fréquente, les Mères des Écoles Chrétiennes sont désignés ici sous le nom de "frères de la doctrine chrétienne". Depuis longtemps certains notables leur reprochaient le caractère trop théorique de leur enseignement : dans la séance du Conseil municipal de Saint-Denis du 30 janvier 1835, Gaillande souhaite que les Frères inspirent "aux enfans de condition paume le goût d'une profession industrielle ou manuelle et surtout celui des travaux agricoles'' (Archives municipales de Saint-Denis, I D 2, 1834-1835, fol. 81 r.) ; une commission du Conseil Colonial déplore, dans un rapport présenté à la séance du 9 décembre 1843, que "le travail, le travail manuel, surtout, soit qu'il s'applique aux arts ou à l'agriculture, n'entre pour rien dans l'éducation donnée par eux" (ADR, Procès-verbaux du Conseil Colonial, octobre 1843-janvier 1845, p. 82). La hiérarchie religieuse va soutenir l'effort des autorités civiles ; celles-ci en expriment leur satisfaction (ainsi Hamelin, Ministre de la Marine, écrit à l'évêque de la Réunion, le 6 février 1857, pour approuver les termes d'une circulaire "inspirée par les besoins moraux de la Colonie et la nécessité d'introduire des pratiques de travail manuel dans les Écoles" (AER, Registre 1850-1888 - "Courrier départ et arrivée, pièces diverses" - p. 185).
[111] Rapport d'ensemble sur l'état de l'enseignement primaire à l'Île de la Réunion, par VIANT, Inspecteur chargé de l'inspection générale, Saint-Denis, 24 février 1874, p. 4-5 (les rapports de Viant, tous datés de 1874, ont été publiés en un volume, Saint-Denis, Lahuppe, s.d., 184 p. ; outre le Rapport d'ensemble... de 35 p., on y trouve des renseignements sur chaque école primaire, p. 37-134, sur l'instruction secondaire, p. 135-174, et sur divers sujets annexes, p. 175-184).
[113] APRPR, Cahier de 6 fol., récit anonyme, s.l.n.d. ; la copie de la lettre de Delphine de Villèle, écrite en mai 1856, se trouve sous le titre "Pose de la Vierge Noire" aux fol. 4 à 6 v. Une partie du document est citée par C. LAVAUX, La Réunion, Du battant des lames au sommet des montagnes, 2ème édit., La Chapelle-Montligeon, 1975, p. 402-104. L'épisode de la Vierge et de l'esclave marron se retrouve aussi, avec quelques variantes, dans les traditions orales (Programme de recherche, cf. supra, no 63). Des exhortations au labeur et à l'obéissance sont adressées aux affranchis de 1848, avec une particulière éloquence, par le vice-préfet apostolique, le lendemain même du jour de sa prise de fonctions ; après le rappel des textes de l'Écriture qui invitent au travail, l'ecclésiastiques poursuit : Qui osera dire que "La Religion Chrétienne ne regarde pas la paresse comme un vice abominable et un péché grave ?" Aux "domestiques et ouvriers", il recommande "la fidélité, l'activité, la bonne volonté, la soumission", sinon, les avertit-il, "la liberté qui devait faire votre bonheur fera votre malheur", et de féliciter ceux qui n'ont point voulu se séparer de leurs anciens maîtres (...) la Religion et la civilisation placeront à l'envi des couronnes sur leurs têtes" (AER, lettre circulaire du 30 novembre 1849, adressée à tous les curés de l'île, pour lecture à leurs fidèles lors de la messe paroissiale, in Registre de "Correspondance ecclésiastique (sic)", 1823-1849, p. 59-61.)
[114] L'esclavage et le clergé à Bourbon (Aperçu historique)", Bulletin de l'Académie de l'Île de la Réunion, 1938, op. cit., p. 13-19.
[115] "Partie non officielle", article daté de Saint-Denis, 18 janvier 1850, paru dans le no 85, du 19 janvier, p. 1-2. Le texte se termine ainsi : "Nous devons un éclatant hommage à la lettre circulaire de M. le Vice-Préfet apostolique Guéret (elle est citée, supra, no 113), et il nous permettra de joindre humblement notre voix à la sienne, pour dire au clergé local : Voulez-vous que vos instructions soient vraiment profitables à tous ? qu'elles soient moins multipliées, et qu'elles roulent sur l'éternel développement, sur l'éternelle glorification de ce mot unique : le travail".
|

