|
Hubert Gerbeau [1937- ]
Poète et romancier, Agrégé d’histoire et docteur d’État,
professeur d’université, Chercheur au CERSOI depuis 2002.
“Le voyageur”.
Un conte publié dans La corne de Brume, Revue du C.R.A.M., no 2, déc. 2003, pp. 70-84.
- Le Centre de réflexion sur les auteurs méconnus (C.R.A.M.)
- L’auteur
-
- LE VOYAGEUR
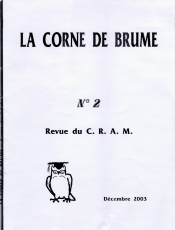
Le Centre de réflexion sur les auteurs méconnus (C.R.A.M.)

Association à vocation internationale, créée en 1988, le C.R.A.M. a pour but de favoriser l'étude d'oeuvres d'auteurs méconnus, français et/ou d'expression française, de la littérature du XXe siècle (mais non exclusivement).
Son action se concrétise par la publication d'un bulletin, la participation à des colloques, la publication de volumes d'hommage, l'aide à la réédition d'œuvres oubliées ou à la publication d'inédits, etc.
Le président du Centre est Robert Jouanny, professeur à Paris IV, le secrétaire général, Bernard Baritaud. Pour toutes informations, s'adresser au siège social du C.R.A.M. : Bernard Baritaud, Appartement 19, 7, rue Bernard de Clairvaux, F-75003 Paris, France.
L’AUTEUR

Hubert Gerbeau est romancier (il a publié, sous un pseudonyme, Swédjana, chez Flammarion, en 1979, et il va publier Noc, au Bretteur, en 2003. Il connaît bien l'océan indien -il a vécu à La Réunion, et longtemps dirigé un centre de recherches sur la région-, mais il a également séjourné aux Antilles et en Afrique. Ses voyages, et sa grande connaissance des relations interethniques, dont il est un spécialiste internationalement reconnu, sont à la source de son inspiration romanesque, « Le voyageur », que son auteur présente comme « un conte pour enfants grandets », est certes un divertissement, mais il s'inscrit dans la ligne des préoccupations de l'écrivain.
“LE VOYAGEUR.”

Il entra dans le wagon du métro à l'instant où celui-ci sortait de la nuit pour entamer son voyage de soleil. Les arbres qui bordaient le boulevard avaient peine à hisser leurs plus hautes branches jusqu'au niveau des rails mais, plusieurs y arrivant, on pouvait avoir l'impression que les cinq ou six wagons glissaient sur un lit de feuilles ; peut-être même, d'avion, pensait-on qu'ils s'envolaient.
Il avait mal au côté depuis que cette pierre lui avait brisé quelque chose. En tournant très fort la tête, il avait aperçu un peu de sang mais n'en savait pas plus. Un enfant avait ri en battant des mains : "Je l'ai eu ! Je l'ai eu !". L'enfant se baissant pour ramasser une autre pierre, il s'était éloigné aussitôt. Il avait même songé à s'envoler mais, stupéfait, il n'y était pas parvenu. En revanche, il marchait, malgré la brûlure. À l'ordinaire, il aimait beaucoup les enfants. Mais depuis cet accident il avait gardé quelque peur. Les jardins publics, son lieu d'élection, lui avaient paru brusquement terre de sauvagerie, de chasse. C'est alors que lui vint l'habitude de prendre le métro, ayant appris d'un sien cousin, vieux voyageur, que des miettes de croissant de pain, de biscuits, de cake, de beignet se nichaient souvent dans le couloir central et à l'aplomb des sièges.
Cette fois, il n'entra pas seul : trois pigeons l'accompagnaient. L'un, imposant, sûr de lui, faisait virevolter sa masse gris-bleu, tout en courbettes, assauts et dérobades. Ces feintes attaques ne l'empêchaient pas de dévorer à bec pressé ce qui s'offrait de miettes. Pendant ce temps, les deux autres, blanc-colombe, minaudaient et jouaient l'esquive, trottant à pas pressés, attentives seulement à ce jeu d'escarpins, et comme indifférentes tant à la nourriture qu'au mâle.
La porte claqua dans son dos. Au premier voyage il avait perdu une plume de la queue. Désormais il s'avançait assez pour échapper au danger. Restaient les pieds, ce n'était pas la moindre affaire avec des hommes et des femmes si lourds. Ce jour-là, quelques voyageurs occupaient les places assises et le couloir était vide. Le bellâtre en profitait pour faire le paon, enflant de vanité tout l'espace libre et redoublant du bec. Sur la pointe des pattes, les péronnelles à leur tour s'étaient mises à picorer. Il avait aperçu un bon quart de biscuit aux raisins, presque sous les pieds d'un enfant. Les intrus avaient déjà si bien fait le ménage que c'était la seule ressource qui lui restât. Il avança claudiquant, penchant la tête d'un air méditatif, sans regarder la nourriture de peur d'attirer l'attention des prédateurs. Par deux fois, l'inconnu lui avait avec les jeux de cou et la détermination d'un bison, interdit l'approche des femelles. Pierre ou âge, le goût des femmes l'avait quitté mais non la faim ; et il craignait que, pour mieux marquer son pouvoir, le mâle lui vola son biscuit, peut-être même le cloua du bec à l'épaule, là où le sang séché devait dire sa faiblesse.
- Regarde, Maman, le pauvre pigeon ! Il est tout blessé
- Il a dû se battre, mon chéri.
- Pourtant il a l'air très gentil. C'est peut-être un chasseur qui... qui...
- Je ne crois pas : ces pigeons ne sont pas bons à manger. Et d'ailleurs on ne tire pas en ville avec un fusil.
Le père, qui avait suivi la conversation, éclata de rire : "Robert ! Robert, imagines-tu Londres sous les amies et les passants visant les oiseaux ?"
- Celui-ci a l'air trop malheureux. Je peux lui donner un peu de mon goûter ?
- Robert... Mais non ! Mais non ! Il faut de J'argent pour acheter le pain et le chocolat, mon fils. Ta mère et moi nous travaillons pour te donner tout ce qu'il faut. Il est défendu de gaspiller, cela fait pleurer le Bon Dieu.
- Le grand ou le petit ?
- Qu'est-ce que tu racontes ? Marina, que raconte ton fils ?
La mère rougit : "Je crois qu'il veut parler de Dieu le père et du petit Jésus".
- Oui, dit Robert, le bébé ou bien l'autre, celui qui était si méchant qu'on l'a flanqué sur la croix ?
- Quoi ? gémit le père. Et retrouvant sa vigueur : "Marina ! Cet enfant dit des sottises. Robert, graine de païen, écoute-moi : il n'était pas méchant, et d'ailleurs le petit et le grand c'étaient la même personne. Il n'y a qu'un seul Dieu.
- C'est difficile, dit Robert, plissant le front. Alors quand on les voit ensemble dans une église, le petit sur sa maman et le vieux sur sa croix, y en a un qui est faux ?
- Qu'est-ce que tu vas inventer à présent ?
Et Robert, s'appliquant, "si tu dis qu'y en a qu'un.
Voyant le père qui gonflait ses joues, signe d'exaspération, l'enfant risquait, avide de conciliation, prêt à toute hypothèse : "Le petit, c'est peut-être un ange, comme quand je suis gentil, ou un diable, comme quand je suis méchant ?
- Ma-ri-na, s'il te plait, il faut éduquer l'enfant dans la religion ou bien je te promets, quand nous rentrons à l'île Maurice, ma mère, de voir le mahométan que nous lui ramenons, elle peut mourir, oui.
- Mais, mon chéri, il est trop petit pour aller au catéchisme. Tu sais bien qu'il n'aura que sept ans à Noël.
L'inévitable s'était produit. Se dandinant comme un dindon, faisant l'important dans les jambes mêmes de l'enfant, le mâle avait saisi le biscuit.
- Pauvre oiseau ! On lui a volé son gâteau, dit Robert.
- Il en trouvera d'autres, répondit, péremptoire, le père, qui ajouta : "Marina, nous descendons à l'arrêt suivant, boutonne bien le manteau de cet étourdi, et surtout qu'il n'enlève pas sa casquette. Vous rentrez tout de suite à la maison, n'est-ce pas ?"
- Bien sur, mon chéri. Tiens, j'aperçois notre vieux voisin, Monsieur Suranjit. Il faudrait le saluer.
- Je vous rejoins plus tard : je dois passer par Blackfriars Road pour remplacer un gardien au dépôt d'archives.
- Mais tu as déjà travaillé toute la nuit dernière
- Il vient de Curepipe comme moi et sa fille est malade. Il n'a besoin que d'une heure ou deux, le temps d'aller à la consultation de l'hôpital.
Robert, casquetté, boutonné, se tenait derrière ses parents.
- Bonne journée, mon garçon, souffla Monsieur Suranjit.
- À vous aussi, Papy Sourany, bonne journée, répondit Robert.
Les pigeons attendaient comme les autres voyageurs l'ouverture des portes. A droite, les péronnelles et l'insolent, enfin calmés, se tenaient à quelques centimètres des jambes du père. Le blessé, malgré sa peur, avait opté pour le voisinage de l'enfant, laissant tout de même entre les talons de celui-ci et son jabot un espace qui pourrait le prémunir contre une éventuelle volte-face et un premier coup de pied.
Robert, dans un souffle, murmura : "Pigeon". Et, du doigt, effrita le bord de sa tartine, si discrètement que ni les trois volatiles, ni ses parents, ne remarquèrent son manège. Avant que le train ne s'arrête, il eut la satisfaction d'entendre le clap-clap, qui indiquait que son message avait été compris. Sur le quai, d'ailleurs, se retournant, il vit que l'affamé avait une miette au bord du bec et que, malgré son aile pendante, il semblait moins misérable.
- À présent je vais à l'India Office Library remplacer mon compatriote, dit le père. Si je tardais trop, mangez le potage sans moi.
- Ciel ! dit la mère, nous n'avons pas dit au-revoir à Monsieur Suranjit.
- Moi, je lui ai dit "bonne journée", dit l'enfant avec satisfaction.
Les adultes se tournèrent vers le dernier wagon qui, déjà, replongeait dans les souterrains et comme ces Japonais dont le père admirait la courtoisie à la télévision, ils se cassèrent en deux, criant d'une même voix en direction de l'asphalte : "Au-revoir, Monsieur Suranjit !" Le pigeon attendait sur le quai, la tête penchée, observant l'enfant. Celui-ci, sournoisement ("Robert, tu es sournois, disait parfois le père, je n'aime pas cela" - "Timide, protestait timidement la mère, il est seulement timide"), donc cet enfant, sournoisement avait conservé entre l'index et le majeur, un objet effilé, croûte à laquelle adhérait encore un bon peu de mie, et l'odeur du chocolat. Feignant de frotter sur le quai le bord de sa chaussure, comme pour se débarrasser de quelque chewing-gum opiniâtre, de quelque relief de crotte, il s'approcha de l'animal et laissa tomber la nourriture.
- C'est pour toi, Pigeon, souffla-t-il.
Pigeon, l'aile pendante, ramassa le pain - sans quitter Robert des yeux.
- Allons, dépêche-toi, cria le père. Ne peux-tu regarder où tu marches ? Qu'as-tu fait avec tes chaussures ?
- À bientôt Pigeon, souffla l'enfant, bye-bye.
Ce qu'il y avait d'épuisant dans la nouvelle organisation de cette vie, c'est que les trains arrivaient toujours devant la gueule ronde, noire, énorme, qui les avalait. Plus il en venait, plus la nuit avait faim : aux heures de pointe, elle engloutissait comme une folle, elle bâfrait à se faire péter le gésier et les portes s'ouvraient, se fermaient, dans un bruit d'abattoir qui laissait Pigeon sans vie. À l'instant de sortir, il ne savait jamais quel risque était le pire : courir, et se faire couper en deux par les panneaux claqueurs, attendre et, par la nuit être avalé entier. Il fallait bien d'ailleurs pactiser avec ses enfants, tous les quais souterrains, petites nuits trouées de lampes, dont on ne savait jamais si elles allaient se perdre dans l'immense gueule ronde ou déboucher sur le soleil. Il y avait trop de couloirs, Pigeon n'arrivait pas à en tenir le compte. Son wagon quitté, il marchait longtemps avant de se décider à prendre un nouveau train. Certains ne lui imposaient qu'un ou deux arrêts de nuit, d'autres beaucoup plus. Yeux clos, terrorisé, il attendait l'engloutissement définitif quand, inopinée, la lueur du soleil revenait battre à ses paupières. Alors, travaillant du bec, un œil sur les miettes, un œil sur la porte, il ne lui restait plus qu'à choisir l'instant de sa fuite. Il avait observé, bien qu'engagé depuis peu de temps dans cette vie voyageuse, qu'il ne revoyait jamais certains compagnons ; d'autres, tels l'importun et les deux péronnelles, lui étaient déjà familiers. Il en concluait que les uns avaient trouvé les voies du retour à la lumière, les autres, victimes d'un mauvais couloir, d'un mauvais train, étaient engloutis pour toujours. "Ah ! soupirait Pigeon, fleurs, abeilles, pain émietté des jardins publics, je vous aimais bien".
Robert et lui se retrouvèrent souvent. L'enfant avait pris l'habitude de dissimuler sous son lit les reliefs qu'il destinait à son ami. Un jour que sa mère l'avait confié à Monsieur Suranjit, Robert éprouva la tentation de partager son secret avec le vieil Indien.
- Papy Sourany, dans cette ville où vous étiez petit garçon, on voyait beaucoup d'animaux ?
- Oui, mon enfant, il y avait des vaches sacrées et des chiens, des chats, beaucoup de rats aussi...
- C'est méchant, les rats.
- Pas plus que les hommes. D'ailleurs, regarde bien le prochain rat que tu croiseras, tu verras comme il me ressemble.
- À moi aussi, il ressemblera ?
- Pas maintenant, mais quand tu seras vieux, peut-être.
- Tu sais, je crois que jamais je serai... serai... comme tu dis. Et... tu les aimais, toi, les rats ?
- À Calcutta, tous les malheureux aimaient les rats, ils étaient leur providence. Les rats ne volaient que les riches, ils devenaient gras et les pauvres pouvaient les manger.
- Et pourquoi ils volaient que les riches ?
- Parce que, mon fils, chez un pauvre, à Calcutta, un rat ne trouvait rien à grignoter, sauf, parfois, un petit, tout petit bébé.
- Ca me fait peur. C'était il y a longtemps ?
- Très longtemps, mon enfant.
- Et il y avait des oiseaux aussi, dans ta ville ?
- Toutes sortes.
- De sacrés oiseaux ?
- Non, seulement les vaches.
- Tes sacrées vaches, c'est comme le sacré cœur ?
- Pas vraiment. Les chrétiens disent qu'il n'y en a qu'un, mais les vaches, rien qu'à Calcutta il y en avait beaucoup.
- Elles avaient des bébés ? Parfois.
- Alors c'étaient des sacrés veaux ?
- Si..., si tu veux.
- Et les poules, les lapins, les... pigeons, on pouvait dire que c'en était aussi ?
- Aussi quoi ?
- Sacrés.
- Dans mon pays, ce n'était pas l'habitude, mais ici, à Londres, tu peux le dire : tous les animaux sont comme nous, l'œil de Dieu s'est posé sur eux, c'est pour cela qu'ils vivent.
Robert dit triomphalement : "j'ai un sacré pigeon, mais c'est un secret, le petit Dieu l'aime beaucoup et moi aussi. Ca te fait plaisir que je te dise mon secret ? Tu ne diras rien ?" Aussitôt l'enfant se tut, effaré, il avait trahi Pigeon et tutoyé Papy Sourany. Machinalement, il rentra la tête dans les épaules, prêt à recevoir les claques paternelles qui puniraient et les vols de nourriture et le manque de savoir-vivre.
- Tes parents t'ont offert un pigeon ? s'enquit doucement Monsieur Suranjit.
- Pas... pas offert, c'est lui, il est venu, il prend le métro avec moi.
- Je pourrais le connaître ?
- Vous... Papy Sourany, s'il vous plait, vous serez gentil avec lui ?
- Je te le promets.
- Alors, regarde, il est contre le mur, il m'attend. Marche doucement. "Tiens, Pigeon, voilà Papy Sourany", ajouta l'enfant, en direction de la masse de plumes grises qui, immobile, attendait l'arrivée de son protecteur.
Pigeon commençait à sentir mauvais. Le creux laissé par la pierre était devenu bosse et pesait, chaud, lourd. Certains jours, le petit garçon ne venait pas et l'oiseau attendait, ventre vide, vainement, la procession des trains. Lui-même avait renoncé à emprunter les wagons, qui revenaient pourtant toujours, dans leur rythme immuable, nez contre queue, passant de la nuit au soleil, du soleil à la nuit. Le bruit, désormais, lui incendiait la tête alors que les rayons solaires, autrefois or et feu, ne lui parvenaient plus que roses, à peine tièdes. Moins de chaud au jour, plus de peur au train, moins de joie au pain : Pigeon se laissait aller. Il aurait pu rester des semaines dans le creux des deux poubelles oubliées, sous cet immeuble désaffecté où il avait trouvé refuge. Mais ne voyait-il pas combien ce tout petit homme avait besoin de lui ? Chaque jour, à l'heure où la lumière rosissait le pan de mur qui surplombait les poubelles, Pigeon savait que le tram de soleil dans lequel Robert était peut-être monté ne tarderait pas à arriver en gare. Il boitait donc vers les rails qu'assiégeaient les hauts arbres, un instant délivré de son recoin puant ; le temps d'une marche et d'un espoir, oiseau des sommets feuillus, repris par une fièvre d'altitude.
- Et ces sacrées vaches, à Calcutta, on les met dans les églises ?
- On peut prier son Dieu dans la rue, au fond de son lit, dans le métro, partout. Les vaches de Calcutta, elles aident à se souvenir de Dieu, on les respecte pour cela et elles vont où la vie les fait aller. Non, on ne les enferme pas dans les églises.
- Et pourquoi les pauvres ils les mangent pas ? C'est meilleur que le rat, non ?
- Elles donnent du lait, si on les tuait, on serait privé de lait. Et puis il y en a beaucoup moins que les pauvres, beaucoup moins que les rats. Il vaut mieux que les plus nombreux s'arrangent ensemble.
- Alors, il y en a plus qu'ici ?
- De rats ?
- De pauvres.
- Beaucoup plus. Ils viennent de la campagne pour trouver du travail, mais ils n'en trouvent pas.
- Moi, j'aimerais bien pas travailler.
- Si on te nourrit, tu peux t'arrêter de travailler mais tu te sens triste, tu crois que tu ne sers plus à rien.
- Alors ces sacrées vaches c'est à cause de leur lait qu'elles servent pas à rien ?
- Le lait et surtout leur vie : toute vie nourrit Dieu, nourrit notre bonheur.
- "Bonheur", papy Sourany, c'est comme être heureux ?
- Tu peux dire cela, oui, mon fils.
- Je voudrais que tout le monde il soye heureux.
- Oui, Robert. Tiens, je vais te raconter quelque chose. J'étais grand à peu près comme toi, j'habitais encore là-bas. Une année, pendant les grosses pluies (on appelait ça notre mousson), ma grand-mère a eu des taches sur les mains. On n'a pas fait attention. Puis les taches ont grandi, c'était une méchante maladie, la lèpre.
- Ta grand-mère, c'était ta mamy ? Tu l'aimais beaucoup ?
- Beaucoup, Robert. J'ai grandi et pourtant elle me faisait de plus en plus peur, elle n'avait plus de doigts, plus de nez. Je crois que tous les enfants du bidonville avaient peur mais ils faisaient comme les grands, Ils restaient gentils avec elle.
- Bidonville, c'était quoi ?
- Un coin de la ville fait rien qu'avec des morceaux de bidons, de cartons, de planches et de chiffons.
- Il faisait trop froid, là-dedans ?
- Non, à Calcutta il fait toujours chaud, mais parfois, tu te souviens, il pleut beaucoup, c'est la... la...
- Mou... Mouton ?
- La mousson, alors l'eau montait très haut dans le bidonville. On en avait jusqu'au ventre si on était vraiment grand, et nous jusqu'à la tête. Il fallait porter les plus petits sur les épaules ou les poser sur les toits, pour les empêcher de se noyer.
- Oui. Et alors ta mamy ?
- Elle est partie dans le creux le plus sale, le plus pauvre du bidonville, là où il y avait d'autres lépreux. C'était à au moins un mile de notre cabane, qui était installée tout contre la montagne d'ordures.
- Les ordures ?
- Celles de Calcutta, c'est là que, chaque fois qu'un camion venait déverser son chargement, nous trouvions quelque chose à manger ou à vendre.
- C'était vraiment dé... dégueulasse. Et ta mamy ?
- Je ne l'ai presque plus vue.
- Tu étais triste ?
- Oui, mais elle, mon garçon, c'était ce que je voulais te dire, elle, je te le jure, elle était gaie. Mes parents m'ont conduit pour la voir quatre fois, peut-être cinq et puis elle est morte. Dès qu'elle m'apercevait elle riait de bonheur et toujours elle me faisait un petit cadeau. "Si tu n'as pas envie de venir, Suranjit, disait-elle, il ne faut pas te déranger".
- "Je veux venir, grand-mère, lui répondais-je, je veux rester avec toi".
- "Plus tard, quand je serai guérie, mon petit", répondait-elle, mais, bien sûr, elle savait qu'elle ne guérirait pas. À cette époque on ne guérissait jamais de la lèpre, surtout si on était pauvre. Elle me disait aussi : "Il faut étudier, Suranjit, peut-être tu pourras aller en Angleterre".
- Et tu as beaucoup étudié ?
- Juste un peu, mais j'ai pu venir ici, à Londres, et j'ai été gardien des archives, là où ton papa travaille maintenant, et j'ai été content de mon travail.
- Papa, lui, n'est pas du tout content, "je suis mal payé, on tire sur moi", tout le temps je l'entends dire ça. C'est vrai que c'est pas gentil de tirer sur lui, même sur les pigeons ici on tire pas, il m'a dit.
- Il veut dire que les chefs abusent un peu mais jamais on le tire avec un fusil, tu peux être sûr.
- Ah ! dit Robert. Et Monsieur Suranjit, ne sachant ce qu'il y avait d'incrédulité, de soulagement ou de déception dans ce "Ah", préféra changer de sujet.
- J'étais content parce qu'il y avait beaucoup de vieux papiers qui venaient de l'Inde, j'aidais à sauver l'histoire de mon pays.
- Bon. Et ta mamy, tu as beaucoup pleuré quand elle est morte ?
- Oui, j'ai pleuré. Et mon père m'a dit : "Ta grand-mère était une dame, une sainte. Il ne faut pas désespérer, elle est maintenant plus heureuse qu'avant".
- "Comment, ai-je répondu, comment, si elle est morte ?"
- "À présent, a dit mon père, elle doit vivre dans le corps d'un jeune prince, ou d'un futur savant, ou bien d'une petite fille qui sera un premier ministre ou une reine. J'ai confiance".
À Calcutta c'était la mousson et à Londres il y eut encore plusieurs et plusieurs, oui, beaucoup de voyages de soleil et de nuit. Pigeon allait très mal. La grosseur lui prenait le dos, le flanc, et Il sentait si mauvais que les gens lui donnaient des coups de pied pour qu'il s'éloigne. Robert, au risque d'arriver en retard à l'école, devait laisser passer plusieurs trains pour arriver à le nourrir. Il allait au bout du quai, là où quelques marches descendaient vers la voie de nuit et où Pigeon, tant le trajet lui déchirait le corps, abandonnant ses poubelles, avait pris le parti de se réfugier. Le soleil ne guidait plus l'oiseau, aussi n'était-ce pas à heure fixe mais à tout instant qu'il se tenait prêt à accueillir l'enfant, sachant combien ce petit homme à la bouche chaude avait besoin de lui. Quand Robert voyageait seul, la rencontre avait lieu. Si le père ou la mère l'accompagnaient, il devait prendre le train à l'heure prescrite, frôlant, à grande vitesse et sans le voir, Pigeon terré, ventre vide, au pied de l'escalier de nuit.
Un matin, Monsieur Suranjit aperçut Robert au bout du quai. Lui aussi laissa passer plusieurs trains, intimidé par le petit garçon. Finalement, il s'approcha de l'enfant qui, assis sur la première marche, tenait l'animal blotti contre lui. Le bec entr'ouvert, Pigeon recueillait les menus débris que l'enfant mâchait à son intention. Le vieil homme s'assit à côté de Robert.
- C'est dangereux, mon petit, de rester là. Si un employé du métro te voit, il va te gronder.
- Bonjour, Papy Sourany, il ne grondera pas. Tu sais, le Monsieur qui balaie le quai est un Mauricien, comme mon papa. Je lui ai montré Pigeon, il est gentil, il a parlé pour moi aux Monsieurs du métro. On me permet, mais seulement la première marche, jamais jusqu'en bas. Ici, c'est pas dangereux.
Pigeon n'avait rien manifesté à l'arrivée du vieil Indien et, tout à coup, comme épuisé, il laissa glisser sa tête sur la poitrine de l'enfant. Celui-ci eut une sorte de hoquet : "Vous... vous croyez qu'il va mourir ?", demanda-t-il en pleurant.
- Tu peux encore l'aider, Robert. Dis-lui que tu l'aimes, très doucement.
- Je t'aime, Pigeon.
- Dis-le lui tout près.
- J'ai peur de lui faire mal.
Le vieux voyageur de Calcutta soutint Pigeon de ses mains parcheminées pour qu'il vienne reposer entre les jambes de l'enfant, dans le nid que formait le manteau. Pigeon s'étant blotti, Robert se pencha vers lui et, bouche contre bec, murmura fébrilement : "Je t'aime, je t'aime, je t'aime ...".
Pigeon eut plusieurs hoquets et poussa un très petit cri, misérable.
Comme il avait cru le voir faire un jour à une mère oiseau, Robert ouvrit la bouche et plaça ses lèvres autour du bec du malade. Avec sa langue, doucement, il essuya le bec ; avec sa salive, doucement offrit à boire. Pigeon but, renversa la tête en arrière et son voyage fut fini.
- Je t'aime, disait encore Robert, je t'aime. Mais il pleurait comme si son amour n'avait plus servi à rien ni à personne.
- Il n'est pas mort, dit Monsieur Suranjit. Il a rejoint l'endroit où toute vie est l'amie de toute vie.
- Toute vie ? demanda le petit garçon.
- Chaque papillon, chaque enfant, chaque oiseau, et même les percepteurs, les adjudants, les dentistes sont nos amis dans cet endroit-là. Ils veulent connaître d'autres maisons, d'autres mamans, alors ils voyagent beaucoup. Parfois, je suis sûr qu'ils reviennent ici, passer un moment avec nous.
- Dans le métro ?
- Bien sûr, et sur les arbres, dans la mer, à l'école.
- Quand je serai mort et que j'irai avec tous ces amis, je pourrai être un pigeon ?
- Tu le pourras sans doute, Robert.
- Et mon pigeon, il pourra être un petit garçon ?
- Je le crois. Ou une petite fille. Tiens, mon enfant regarde celle-ci, comme elle est blonde et douce, avec sa tête
penchée, avec son air un peu triste. Tu as vu ? Elle te regarde. Je me demande si Pigeon, déjà, n'a pas commencé son nouveau voyage.
- Ce n'est pas possible, Papy Sourany : Pigeon était un garçon comme moi.
- Peut-être a-t-il choisi d'être fille, et comme il avait été bon, les dieux ont accepté.
- Le grand ou le petit ?
- Tous ensemble, et nous aussi nous avons été d'accord, n'est-ce pas ?
- Mais nous ne pouvions rien.
- Nous pouvions tout. Nous sommes, chacun, une petite étincelle du grand soleil, un souffle du grand souffle. Et je crois que c'est toi qui as été choisi pour souffler la vie dans le bec de Pigeon.
- Une petite fille... tout de même ! Un garçon, c'est mieux, non ?
- Je ne crois pas, Robert. Tu vois son ventre ?
- Sa robe ? Tu veux dire le ventre, sous sa robe, Papy Sourany ?
- C'est là que vient, que naît, que renaît le monde.
La petite fille blonde commença à danser au bord du quai. Elle faisait face à Robert, le regardant dans les yeux, lui souriant.
Les souterrains parlèrent et un train de nuit en jaillit, roulant vers le soleil. De la main, la petite fille envoya un baiser à Robert et, dès que les portes s'ouvrirent, bondit dans le premier wagon. C'est alors que Monsieur Suranjit et son compagnon virent qu'à la base du cou et sur l'épaule l'enfant blonde portait un pansement.
Hubert Gerbeau
|

