|
[121]
“Faits et méfaits de la
psychothérapie chez l'enfant
victime d'abus sexuel.” [1]
Hubert Van Gijseghem
et Louisiane Gauthier
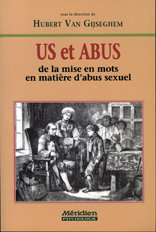
- La réification du traumatisme de l'abus sexuel [122]
- Le sentiment de culpabilité [123]
- L'incitation au parler [125]
- Le refoulement du désir incestueux et la répression de l'inceste agi.... [127]
- Le droit au secret [131]
- Le respect des besoins réels de l'enfant versus la dictature de l'aveu .... [133]
- Qu'en dit la recherche ? [135]
- Conclusion [136]
- Bibliographie [137]
À propos des auteurs
- Louisiane Gauthier, M.Ps., psychologue, Centres Jeunesse de Montréal. Expertise psychojuridique.
- Hubert Van Gijseghem, Ph.D., psychologue, Université de Montréal. Expertise psychojuridique.

L'intervenant en matière d'abus sexuel est souvent poussé par ce principe voulant que l'enfant abusé ou soupçonné de l'être a nécessairement besoin de thérapie. Une référence précipitée fait souvent fi de la question de savoir si l'enfant a réellement été abusé et, le cas échéant, s'il a besoin de traitement. Nombre d'intervenants bien intentionnés font penser au scout qui, de force, amène la vieille dame de l'autre côté d'une rue achalandée sans égard au besoin de la dame en question. L'enfant incestué ou abusé dans un contexte autre que la famille est ainsi référé à quelque thérapeute spécialisé, ou intégré dans des groupes d'enfants abusés, ou dirigé vers des centres spécialisés de traitement d'abus, comme si le fait d'être victime d'abus sexuel constituait un symptôme spécifique ou un diagnostic en soi. Ces jeunes enfants - parfois déjà victimisés par l'abus, parfois victimisés par [122] l'incitation à une fausse allégation - peuvent être maintenant de nouveau heurtés, sinon agressés, cette fois-ci par le devoir implicite, mais le plus souvent explicite, de parler de la chose. Nombre d'intervenants, mus par un désir sincère de réparer l'outrage, donnent dans un acharnement thérapeutique, en partant d'idées préconçues dont les fondements sont aléatoires et non prouvés empiriquement.
Nous discuterons ici de trois de ces idées : premièrement, celle voulant que l'abus sexuel soit un symptôme à traiter en soi ; deuxièmement, celle voulant que l'enfant doive exprimer de la colère envers son abuseur et se décharger de toute trace de culpabilité, elle-même considérée comme une tare insoutenable ; et, finalement, celle selon laquelle la verbalisation de l'inceste ou de l'abus est le seul moyen d'en éliminer les stigmates. Ce dernier principe nous semble d'ailleurs le plus lourd de conséquences pour les enfants victimes d'abus sexuels et d'inceste. Pour bien saisir ces conséquences, nous nous appuyons sur l'hypothèse selon laquelle l'accomplissement de l'inceste ou de son équivalent empêche l'établissement intra-psychique du tabou de l'inceste, arrêtant ainsi l'enfant dans son développement psychique et le posant face à la mort psychologique. Dans ces conditions, l'invitation réitérée et systématique à parler de l'inceste ou de l'abus peut mettre la survie psychique de l'enfant encore plus en danger et le pousser à élaborer des stratégies de survie qu'on prendra pour les effets négatifs de l'abus sexuel alors qu'elles seront en fait les résultats du traitement.
La réification du traumatisme de l'abus sexuel

La première idée préconçue qui nous intéresse ici est celle voulant que l'inceste et l'abus sexuel soient considérés comme un diagnostic ou une entité nosologique en soi, qu'il faut [123] absolument traiter en tant que tel. L'enfant que l'on intègre de gré ou de force dans une thérapie ou, pire, dans un groupe de thérapie reçoit le sceau d'enfant abusé. Ce sceau, éventuellement, marquera son identité de façon indélébile. L'enfant pourra dorénavant le mettre à contribution de multiples façons pathologiques : pour se dévaloriser (le « damaged good »), pour se glorifier (l'exhibitionnisme narcissisant, comme on le voit si souvent dans certains forums où l'on exhibe les fières victimes), ou pour s'immuniser (bouclier protégeant contre toute frustration, contrariété ou exigence normale de l'éducation). Pour cet enfant, être reconnu, être quelqu'un, c'est être abusé ou l'avoir été.
Cette pratique de faire de l'abus sexuel le symptôme à traiter résulte à notre avis en une dangereuse réification du trauma. L'abus sexuel devient le fétiche aussi bien de l'intervenant que de la victime. Souvent, les enfants sont groupés sous le dénominateur commun d'abusés sexuels et sont invités à parler de leurs abus, faits et émotions, séance après séance, soi-disant pour exorciser le trauma. Le fait du groupement en soi sur la seule base des abus constitue déjà une programmation. Certains enfants y trouvent narcissiquement leur compte, d'autres sont pernicieusement pénétrés dans leur intimité psychique, tout comme ils l'ont été dans l'expérience abusive. L'écueil d'un traitement ainsi centré sur une réalité extérieure, dont les contours sont préétablis, est d'occulter la réalité intrapsychique de l'enfant et les besoins particuliers qui en découlent.
Le sentiment de culpabilité

La deuxième idée préconçue qui nous intéresse est celle voulant que, pour guérir, l'enfant doive reconnaître et exprimer la colère qu'il est supposé éprouver envers son abuseur. Cette colère est nourrie ou créée par le thérapeute [124] dans le but d'aider l'enfant à désavouer son abuseur et à se décharger de toute culpabilité face à ce qui lui est arrivé. Cette insistance des intervenants à vouloir déculpabiliser les victimes, symptomatique de leurs sentiments d'horreur et de révolte devant l'abus, peut déposséder l'enfant en l'innocentant en quelque sorte de tout sentiment propre d'identité. En effet, en matière de sentiment humain, le psychothérapeute n'a pas à juger si une personne a raison ou tort d'éprouver tel ou tel sentiment ; sa tâche est plutôt d'aider cette personne à lui donner un sens.
Devant l'abus sexuel, l'intervenant admet d'office que la colère est un sentiment sain alors que la culpabilité est vue comme un sentiment malsain. Pourtant, la culpabilité ressentie par l'enfant et l'entière responsabilité de l'adulte abuseur ne sont pas opposées ; l'une n'annule pas l'autre. La culpabilité de l'enfant, lorsqu'elle existe, n'est pas une question de droit ni même de choix, elle est un état de fait, un écho intérieur qu'on ne peut demander à l'enfant d'assourdir sans l'amener à se nier. Même qu'en se sentant partie prenante de l'abus, donc coupable, l'enfant maintient une partie de son intégrité, conserve le sentiment d'avoir eu une influence sur son destin alors que l'absence réelle de toute culpabilité signe une perte de statut du sujet, repérable par le sentiment d'annihilation, c'est-à-dire par une perte du sentiment d'être. À ce sujet, des cliniciens ont observé que des enfants qui restent avec un sentiment de culpabilité seraient moins perturbés que ceux chez qui on aurait réussi à le faire perdre (Lamb, 1986), si tant est qu'une telle chose soit possible.
On a observé que l'enfant abusé, en traitement individuel ou de groupe, devient souvent de plus en plus perturbé. Pour expliquer cette aggravation, les intervenants ont recours à l'émergence progressive de la colère, occultée jusque-là. Il se peut que cette aggravation soit aussi iatrogène, [125] c'est-à-dire provoquée par le traitement. Selon certains auteurs, le thérapeute fait de l'abus un événement catastrophique alors qu'il ne l'était pas nécessairement auparavant : « L'enfant est forcé d'accepter et d'intérioriser des projections confuses de l'intervenant en regard de ce que celui-ci croit être la scène intrapsychique de l'enfant » (Wakefield & Underwager, 1988, 361).
L'incitation au parler

La troisième idée préconçue est celle voulant que pour guérir, l'enfant doive à tout prix et à répétition parler de ce trauma, c'est-à-dire le mettre en mots, le raconter, le détailler pour, finalement, le mentaliser et guérir. Cela peut certes être souhaitable dans certains cas, mais il est loin d'être sûr que cela soit thérapeutique pour la majorité des enfants victimes d'abus.
Dès 1984, Bagley et Ramsay ont mené des études rétrospectives auprès d'enfants abusés sexuellement. Ils en arrivent à la conclusion que rien ne distingue les enfants qui ont révélé le secret de ceux qui se sont tus. Ces résultats confirment ceux de Finkelhor (1979) selon lesquels le dévoilement ne compte pas parmi les variables qui influent négativement ou positivement sur le développement ultérieur de troubles psychiques. D'autres études rétrospectives majeures en Hollande (Draijer, 1988) parviennent à la même conclusion : l'aveu n'est pas une garantie de séquelles moindres.
Déjà ces recherches mettent sérieusement en doute l'opinion générale - et non moins intuitive - suivant laquelle le dévoilement contient des promesses de salut. Qui plus est, d'autres recherches contredisent carrément ce consensus clinique. Sur la foi de leurs propres investigations, les chercheurs du Tufts New England Médical Center (1984) affirment [126] que les enfants qui maintiennent le secret présentent moins de séquelles que les enfants qui le dévoilent.
Une étude beaucoup plus récente (Sinclair et Gold, 1997), en faisant une recension de l'ensemble des recherches sur cette question et en présentant ses propres données, conclut que le fait de dévoiler ou de ne pas dévoiler un abus n'est pas annonciateur de symptomatologie future.
Le bon sens nous dit que les résultats de ces études peuvent refléter la vérité là où l'abus était un incident unique ou isolé, mais la chose nous apparaît moins compréhensible dans les cas d'abus continus. Sans doute faut-il ici distinguer le dévoilement, c'est-à-dire la confidence pour faire cesser l'abus, des réactions individuelles et institutionnelles en cascade que ce dévoilement entraîne. Il semble que ces réactions puissent devenir, pour l'enfant, ce que nombre d'auteurs appellent une victimisation secondaire, éventuellement pire que la première (Berliner, Blick & Bulkley, 1985 ; Sas, 1986 ; Terr, 1986). C'est là qu'il devient crucial de savoir à qui, à combien de personnes et comment dévoiler un abus pour minimiser cette victimisation secondaire, mais aussi pour assurer l'arrêt d'agir de façon efficace. Seul le dévoilement peut amener l'arrêt d'agir nécessaire à la réparation ultérieure. À défaut de relayer ce dévoilement, l'inaction et le silence de l'adulte deviendraient complicité. On ne peut faire l'économie d'une intervention d'autorité mais seule l'analyse rigoureuse de chacun des cas permet d'établir quelle autorité sera suffisante : l'autorité sociale du directeur de la protection de la jeunesse, l'autorité judiciaire du tribunal de la jeunesse ou l'autorité pénale de la justice criminelle. Toutes les interventions sont porteuses de risques psychiques pour l'enfant, et il est dès lors de mise de les évaluer en fonction de la solution la moins nocive pour lui.
[127]
Les résultats des recherches voulant que le silence davantage que le dévoilement mette l'enfant à l'abri des conséquences fâcheuses, restent néanmoins troublants. Ils nous poussent à avancer une hypothèse susceptible d'expliquer ce phénomène et qui, de ce fait, peut avoir un impact important sur les décisions que l'intervenant aura à prendre quant à l'utilité d'un traitement et, s'il y a lieu, quant à la forme de ce traitement.
Le refoulement du désir incestueux
et la répression de l'inceste agi

La famille où règne le respect du tabou de l'inceste est celle où les membres sont aptes à maintenir la distance intergénérationnelle. Non pas que le désir de transgresser cette distance n'existe pas. Au contraire, qui dit tabou dit désir. Celui-ci existe tant chez l'adulte que chez l'enfant. Toutefois, l'adulte aura à refouler ce désir et il pourra sans doute le faire s'il a réussi à le refouler jadis, comme enfant. Ce désir sera réactivé par celui de son enfant, mais l’interdiction (en somme, l'interdit œdipien) viendra garantir l’étanchéité de son propre refoulement. Or, l'enfant pourra à son tour refouler ce désir à condition qu'il expérimente l'interdit de la transgression et donc la solidité de ce même refoulement chez son parent. Dès que le refoulement, mécanisme inconscient, aura fait son œuvre, le désir se trouvera d'autres exutoires et l'individu sera à l'abri de l'agir. Ce refoulement fondamental donne accès à la distance intergénérationnelle et, par là, à l’individuation et à l'identité.
Qu'arrive-t-il quand il y a eu inceste ? L'interdit a été transgressé, la distance entre les générations n'existe plus et le refoulement des désirs incestueux est rendu caduc. Sur le plan métapsychologique, on ne peut penser réparation ou guérison qu'à condition qu'il y ait une certaine réversibilité [128] de ces situations. L'interdit ainsi que la distance entre les générations doivent être réinstallés et des conditions menant au refoulement devront être créées. Voilà déjà tout un programme. Attardons-nous pour l'instant à ce dernier point, soit la facilitation du refoulement. Comment peut-on espérer réaliser cette tâche si l'enfant est invité à parler et à reparler des gestes qui n'auraient jamais dû avoir lieu ? On pourrait répondre que l'enfant doit d'abord mettre en mots et ainsi mentaliser ce qui n'était pas nommé avant de prétendre au refoulement. En matière d'inceste agi, on confond peut-être refoulement et oubli. Les gestes posés ne seront jamais oubliés bien que « le trauma de l'inceste soit de l'ordre du souvenir impossible » (Bigras et Balasc, 1987, 8). Toutefois, l'oubli étant irréalisable sur le plan de l'économie psychique (les choses ont été), une nouvelle forme de refoulement devient d'autant plus impérative.
Un mot sur le refoulement normal s'impose ici. En voici une définition :
- « Le refoulement est l'opération par laquelle le sujet cherche à repousser ou à maintenir dans l'inconscient des représentations (pensées, images, souvenirs) liées à une pulsion. Le refoulement se produit dans les cas où la satisfaction d'une pulsion - susceptible de procurer par elle-même du plaisir - risquerait de provoquer du déplaisir à l'égard d'autres exigences... Il peut être considéré comme un processus psychique universel en tant qu'il serait à l'origine de la constitution de l'inconscient comme domaine séparé du reste du psychisme » (Laplanche et Pontalis, 1967, 392).
Aulagnier dira que dans le refoulement normal, il s'agit « d'exclure de l'espace du JE certaines représentations pulsionnelles dont la réalisation est incompatible avec des exigences culturelles qu'on ne peut transgresser » (Aulagnier, [129] 1984, 250). Toutefois, si la transgression a eu lieu, un refoulement dit normal deviendra à jamais impossible. La formule « il est interdit de désirer l'interdit », expression du refoulement normal, devient, en effet, inopérante puisqu'on n'en est pas resté au désir. Le réalisme de la chose sexuelle a catapulté l'enfant dans le champ de l'agir et dans l'univers de la perception visuelle ou tactile, occupant ainsi l'espace réservé à l'imagination. Le corps adulte sexué comme objet de la réalité doit se soustraire au désir inconscient de l'enfant. « Ce dont le sujet est désirant, c'est d'un désir et non pas d'un objet », dira encore Aulagnier (1984, 254). Lorsque l'objet parental s'offre le plaisir sexuel de son enfant, il y a captation non seulement de celui-ci dans sa corporéité mais capture de la fonction désirante chez cet enfant et, de ce fait, il y a entrave à l'accès au symbolique.
Comment réparer là où il y a eu transgression ? L'expérience nous montre qu'il est difficile de généraliser. Certains enfants semblent activement rechercher l'aveu. Il faut croire qu'il s'agit là, pour eux, d'un élan autorégulateur. Cet aveu mérite donc d'être recueilli. Mais, et ici nous insistons, cet aveu ne peut se faire que dans l'intimité d'une relation d'un à un. C'est cette intimité qui est susceptible de permettre à l'enfant, une fois l'aveu fait et reçu, de retourner la chose innommable maintenant nommée dans les limbes du secret. Mais, les choses ayant été, on ne peut plus espérer fonder une réparation sur le refoulement dans l'inconscient d'un désir qui a perdu son statut. On doit pourtant redonner à l'enfant une position de sujet et réintroduire chez lui une fonction désirante pour le sortir de l'inféodation. On doit tenter de retrouver le trauma aux confins du préconscient, de façon à s'approcher du refoulement. On peut le faire en misant sur le mécanisme psychique de la répression, c'est-à-dire sur :
[130]
- « cette opération psychique qui tend à faire disparaître de la conscience un contenu déplaisant ou inopportun : idée, affect, etc. [...] La répression s'oppose surtout du point de vue topique au refoulement. Dans celui-ci, l'instance refoulante (le moi), l'opération et son résultat sont inconscients. La répression serait au contraire un mécanisme conscient ; il s'agirait d'une exclusion hors du champ de conscience actuel et non du passage d'un système (préconscient-conscient) à un autre (inconscient). Du point de vue dynamique, les motivations morales jouent dans la répression un rôle prédominant » (Laplanche et Pontalis, 1967, 419).
La répression consiste donc en la possibilité d'abriter, consciemment cette fois, le trauma et les émois qu'il a suscités. Les motivations morales dont on fait état dans la définition citée et qui doivent faciliter la répression trouvent leur représentant dans les instances sociales et judiciaires. C'est au nom de la restauration de l'interdit que l'autorité sociale ou judiciaire prend tout son sens comme conscience tutélaire, comme barrière externe palliant la défaillance intérieure de la non-distance entre les générations. Le rappel ferme et officiel de la nécessité de la distance peut être considéré comme la pierre angulaire du traitement favorisant la répression. Encore faut-il que ce rétablissement des frontières n'ait pas demandé au préalable une mise à nu réductrice et humiliante des acteurs de la scène incestueuse. Une telle mise à nu porte un coup fatal à l'estime de soi et est souvent une caractéristique malheureuse mais quasi inévitable des enquêtes sociales et judiciaires. Cette dépossession abusive, démasquant toute forme d'intimité et sabrant dans ce qui reste de narcissisme, décourage l'effort sinon l'espoir de trouver en soi de nouvelles voies pour accéder de nouveau et, surtout, autrement à un rétablissement [131] des frontières. Si interdire et assurer le maintien de cet interdit sont essentiels, permettre à la victime, après le dévoilement, de se taire, est aussi capital. Le retour au secret pourra servir à la répression et jouer un rôle potentiellement salvateur.
Le droit au secret

On pourrait objecter que favoriser le secret c'est aller à rencontre de tout objectif thérapeutique qui, lui, est bel et bien de dé-secreter, ou si on veut « de sécréter hors de soi ». La psychothérapie est en effet utilisée la plupart du temps pour éviter qu'un matériel psychique ne devienne corps étranger, ou ne s'enkyste. Par la mise en mots ou par la mentalisation, la thérapie est ainsi susceptible de faire échec à la somatisation ou à l’acting out, les deux exutoires tributaires de l'enkystement. On ne peut qu'être d'accord avec ces principes thérapeutiques en général. Et pourtant, dans le cas de l'inceste, le droit au secret nous semble un droit sacré, justement parce que le refoulement normal n'est plus possible. Il faut ici le distinguer du secret sexuel lié aux mystères des origines du silence imposé par l'adulte à l'enfant, silence sur un « trop su », c'est-à-dire à la jouissance furtive du corps réel de l'adulte. Bigras et Balasc (1987) prétendent que le secret de ces femmes (incestuées), c'est de ne pas en avoir. Blévis ajoute : « Il y a du silence mais nul espace de secret. Au contraire, la sexualité s'étale à faire obstacle à la présence du secret. Pas de secret, pas de privé, pas de sexualité » (1987, 31). Le secret, d'ailleurs, n'est pas une plaie. Fedida (1976) disait déjà que le secret et le fait de le garder constituent une protection contre la menace fantasmatique de destruction ou de dissociation. Le secret n'est-il pas le premier organisateur de la conscience, le silencieux témoin d'une existence autonome, sa preuve [132] irréfutable jalousement gardée ? Avoir un secret, c'est se différencier, c'est s'autoriser à posséder quelque chose de personnel, c'est déjà exister de façon autonome par rapport à autrui (Van Gijseghem, 1985a). Aulagnier fait du droit au secret la condition pour pouvoir penser : « Se réserver le droit et la possibilité de créer des pensées, et plus simplement de penser, exige que l'on s'arroge celui de choisir les pensées que l'on communique et celles que l'on garde secrètes : c'est là une condition vitale pour le fonctionnement du JE » (1984, 217). Le secret ne se dit qu'au parfait étranger qui tire sa perfection du fait qu'il disparaît aussitôt et à jamais, sauvegardant ainsi le secret comme secret, et donc comme part inviolable de l'être.
Mais pourquoi le secret est-il souhaitable là où le trauma est inceste, et non souhaitable là où il est, par exemple, morsure de chien ? Ici, nous devons nous pencher sur l'enjeu de l'inceste. À l'occasion d'élaborations théoriques sur les conséquences de l'inceste, Van Gijseghem (1985b, 1998) tente de saisir la puissance du tabou entraînant l'inceste en se référant au lien existant entre celui-ci et la pulsion de mort. Il semble y avoir effectivement dans l'inceste quelque chose de l'ordre de la mort puisqu'il y a abolition de la différenciation d'avec les géniteurs ; il y a retour au lieu corporel de ses origines. En d'autres termes, il y a négation de la temporalité, du moment inaugural de l'enfant, de son identité comme être séparé et complet. On est bel et bien ici dans le domaine de la mort, comme si l'être-enfant n'était pas advenu. L'aveu de l'inceste est en quelque sorte l'aveu de la mort : « Je n'ai pas existé ou j'ai été tué par mon géniteur » ne peut qu'être un aveu auto-annihilant, peu importe les sentiments que l'enfant éprouve pour ce géniteur. Si on compare cet aveu à « J'ai été mordu par un chien », on se rend bien compte qu'on est dans des registres totalement différents, encore une fois peu importe les sentiments que [133] l'enfant entretient dorénavant face au chien, fût-ce la pire phobie.
Dès lors, on peut comprendre que si un enfant doit répéter son aveu aux policiers, aux avocats, aux juges, aux travailleurs sociaux, aux thérapeutes, aux pairs co-abusés, etc. (et cela d'une façon quasi institutionnalisée par l'adulte si bienveillant et si bien-pensant soit-il), il s'approche toujours un peu plus du danger mortel. L'enfant, éventuellement, se défendra contre la mort en réifiant l'inceste lui-même, en se drapant d'une nouvelle identité restitutionnelle : « Je suis l'enfant incestué, je suis l'enfant tué. » Comme mesure de restitution, en effet, il devra y prendre plaisir et narcissiser la chose. C'est là que l'intervenant risque de prendre à tort une mesure défensive de dernier recours pour un besoin sui generis. L'enfant développe une compulsion à parler parce qu'on l'oblige à parler tandis que l'intervenant croit qu'il faut obliger l'enfant à parler parce qu'il décèle (post-facto) une compulsion à parler. Pourtant nous sommes en présence d'une répétition vide, d'un exercice de mémoire plaqué dans un discours compulsif asséché et mortifère.
Le respect des besoins réels de l'enfant
versus la dictature de l'aveu

Après le dévoilement, l'intervenant a intérêt, d'abord et avant tout, à écouter le besoin de l'enfant. Le danger existe en effet que l'intervenant croie a priori connaître cet enfant, non pas comme individu, mais comme spécimen de la catégorie : « enfants incestués ». Cet enfant anonyme mais marqué de l'étiquette « incestué » sera alors soumis à ce que Foucault (1976) appelait la « dictature de l'aveu ». Il n'a pas le choix : il faut qu'il parle ! Il est sans doute vrai, dans certains cas, qu'une thérapie individuelle respectueuse [134] est indiquée. Respectueuse dans le sens qu'on laisse l'enfant tranquille, c'est-à-dire qu'en aucun temps le thérapeute ne doit donner des indications ouvertes ou indirectes ni s'attendre à ce que l'enfant parle « de la chose ». Respectueuse veut dire que le thérapeute, dans son attention fatalement sélective, s'abstient d'interpréter tout matériel psychique dans le sens de l'abus. Nous avons vu cela se produire à répétition puisque le thérapeute, victime de l'effet Rosenthal, verra en tout matériel fantasmatique la trace de l'inceste et se sentira obligé de débusquer cette trace. Pour nous, une démarche thérapeutique respectueuse veut dire que le thérapeute écoute cet enfant sans idée préconçue du matériel psychique qui émergera. Idéalement, le thérapeute ne devrait pas avoir d'information sur la vie de l'enfant autre que ce que cet enfant lui dit durant la cure. S'il ressent le besoin d'avouer, il le fera. Le thérapeute recueillera cet aveu comme tout autre, c'est-à-dire en se faisant contenant étanche. Quelle tristesse de voir défiler devant les tribunaux les présumés thérapeutes, appelés comme témoins pour « valider la réalité d'un abus », qui relatent en détail les aveux que l'enfant croyait confinés à une relation de un à un, dans laquelle il croyait pouvoir avouer son secret tout en le réenterrant aussitôt, sauvegardant ainsi son intégrité. Le secret tenu et contenu par le thérapeute n'est-il pas le meilleur témoignage de la réalisation d'une intimité possible ? Le thérapeute doit être à l'abri du processus d'enquête de façon à préserver sa fonction soignante.
Et qu'en est-il du contenant étanche dans le contexte de ces inquiétantes thérapies de groupe pour enfants incestués ? On n'est plus en thérapie ici, on est dans la coercition où tout être doit exposer sa nudité aux autres. Obligatoirement d'ailleurs car, si ce n'est pas par le thème proposé, la pression du groupe fera qu'on n'aura pas le choix. Dans ce groupe, il y a toujours déjà des enfants qui ont réifié le [135] trauma, qui l'exposent narcissiquement et, avec la naïve complicité du thérapeute, exercent ainsi la dictature du parler. Que peut-on espérer d'autre dans ce cas-là que ce que tant d'auteurs appellent très justement une victimisation secondaire.
Qu'en dit la recherche ?

La recherche évaluative des thérapies individuelles ou de groupe auprès des enfants abusés tend à confirmer nos inquiétudes.
O'Donohue et Elliott (1992), à partir d'un survol de onze études évaluatives, concluent qu'il n'y a pas de preuves permettant de prétendre qu'il existe des interventions efficaces avec l'enfant abusé. Finkelhor et Berliner (1995) ont fait leur propre recension, cette fois sur vingt-sept études évaluatives. Ils en viennent à la même conclusion. Tourigny (1997) quant à lui a effectué une recension très approfondie de quarante-deux études évaluatives sur des interventions faites avec des enfants abusés sexuellement. Même si un nombre d'évaluations semblent indiquer une amélioration chez Certains enfants, principalement sur le plan des conduites, on observe aussi des effets carrément négatifs chez bon nombre d'entre eux. Cela est particulièrement évident lorsqu'il s'agit de programmes de traitement intégré (thérapie individuelle, de groupe et familiale).
Tourigny remarque que, sur dix études portant sur des thérapies individuelles, une seule rapporte des effets négatifs. Sur dix-huit études portant sur des thérapies de groupe, six d'entre elles rapportent des effets négatifs. Mais, sur treize études évaluant des programmes de thérapie (toujours destinés aux enfants abusés sexuellement), pas moins de neuf études rapportent des effets négatifs. La majorité des recherches insistent sur la nécessité d'étudier et de documenter [136] davantage les effets des thérapies spécialisées avant de penser à une implantation tous azimuts, compte tenu des objectifs précis que ces dernières visent.
Conclusion

Tout comme l'appendicite requiert l'ablation de l'appendice, le consensus social actuel veut que, pour guérir, l'enfant incestué ou abusé dans un contexte extrafamilial, exorcise, sinon excise, le trauma en en parlant à tout prix. Peu d'intervenants mettent en doute cette affirmation. Nos propres observations ainsi que la recherche empirique sur cette question nous portent à dénoncer cette pratique, puisqu'elle nous semble appliquée d'une façon trop généralisée, sans égard aux réels besoins d'un enfant donné. L'inceste, à travers les civilisations et à l'échelle de l'humanité, est sous le coup d'un refoulement fondamental. Son interdit rappelle la nécessité de la différenciation entre les générations et de la mise à distance psychologique des origines. Les corps familiers doivent devenir, psychiquement parlant, des corps étrangers. S'il y a eu transgression, tout doit être mis en œuvre pour favoriser l'opération de la répression, pour retourner l'événement au secret afin de le confiner dans le souvenir en zone interdite là où il peut redevenir « interdit de désirer l'interdit ». Un moratoire, une forme de latence pourrait permettre à d'autres considérations, l'école, l'activité culturelle, l'amitié, de meubler le vide laissé par l'effervescence pulsionnelle afin que l'enfant puisse passer à autre chose. C'est ainsi que l'enfant pourra éventuellement retrouver sa capacité désirante, donc créatrice. Il est de notre avis que, pour nombre d'enfants, la réparation passe par la couverture (action de couvrir) plutôt que par l'exposition de la blessure.
[137]
Bibliographie

Aulagnier, P. (1984). L'apprenti-historien et le maître-sorcier. Paris : Presses Universitaires de France.
Bagley, C. & Ramsay, R. (1985). Disrupted childhood and vulnerability to sexual assault : long term sequels with implications for counselling. Paper presented at the Conference on Counselling in the Sexual Abuse Survivor, Winnipeg, Canada.
Berliner, L., Blick, L., & Bulkley, J. (1985). Expert testimony on the dynamics of intra-family child sexual abuse and principles of child development. In J. Bulkley (Ed.), Child sexual Abuse and the Law. (p. 166-183). Washington D.C. : American Bar Association.
Bigras, J., & Balasc, C. (1987). De quelques préliminaires à l'endroit de ce qui se joue dans l'inceste père-fille. Séminaire présenté à la Société psychanalytique de Montréal. Octobre.
Blévis, M. (1987). Un inceste peut en cacher un autre. Patio-Psychanalyse, 7, 27-38.
Draijer, N. (1988). Een lege plek in mijn geheugen. Seksueel mis-bruik van meisjes door verwanten. (Un vide dans mes souvenirs. Les filles abusées sexuellement à l'intérieur de la famille). Den Haag : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Fedida, P. (1976). L'exhibition et le secret de l'enveloppe vide. Nouvelle revue de psychanalyse, 14, 275-280.
Finkelhor, D. (1979). Sexually victimized children. New York : Free Press.
Finkelhor, D. & Berliner, L. (1995). Research on the treatment of sexually abused children : A review and recommendations. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 1408-1423.
Foucault, M. (1976). Histoire de la sexualité. Vol. 1 : La volonté de savoir. Paris : Gallimard.
[138]
Lamb, S. (1986). Treating sexually abused children : Issues of blame and responsability. American Journal of Orthopsychiatry, 56, 303-307.
Laplanche, J. & Pontalis, J.B. (1967). Vocabulaire de la psychanalyse. Paris : Presses Universitaires de France.
O'Donohue, W. & Elliott, A. (1992). Treatment of the sexually abused child : A review. Journal ofClinical Child Psychology, 21, 218-228.
Sas, L. (1986). Sexual abuse child witnesses in court. Highlights, 9 (suppl.), 8-9.
Sinclair, B. & Gold, S. (1997). The psychological impact of withholding disclosure of child sexual abuse. Violence and Victims, 12, 137-145.
Terr, L. (1986). The child psychiatrist and the child witness : Traveling companions by necessity, if not by design. Journal of American Academy of Child Psychiatry, 25, 462-472.
Tourigny, M. (1997). Efficacité des interventions pour enfants abusés sexuellement : une recension des écrits. Revue canadienne de psycho-éducation, 26, 39-69.
Tufts New England Médical Center (1984). Sexually exploited children : service and research project. Final report for the office of juvenile justice and delinquency prevention. Washington, D.C. : U.S. Dept of Justice.
Van Gijseghem, H. (1985a). La Quête de l'objet. Montréal : Hurtubise HMH.
Van Gijseghem, H. (1985b). Autre regard sur les conséquences de l'inceste père-fille. Revue canadienne de psycho-éducation, 14, 138-145.
Van Gijseghem, H. (1998). Le passage à l'acte incestueux et ses conséquences. In F. Millaud (Éd.), Le passage à l'acte. (p. 149-162). Paris : Masson.
Wakefield, H. & Underwager, R. (1988). Accusations of Child sexual Abuse. Springfield : Thomas.
[1] II s'agit ici d'une version modifiée et mise à jour d'un texte publié dans Santé mentale au Québec (1992). Le texte initial a été repris dans le collectif « Incestes », sous la direction de Dana Castro. Le présent texte intègre surtout les données de la recherche récente.
|

