[25]
LES TIERS.
Tome 3. Pratiques sociales.
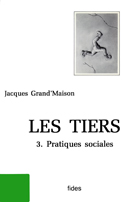 INTRODUCTION INTRODUCTION
Des seuils critiques à franchir
- La figure dominante du salarié qui a marqué la période de croissance d'après guerre vole en éclats. Au travailleur régulier et permanent succède une multitude de nouveaux visages : temps partiels, temporaires, surnuméraires, travailleuses et travailleurs « au noir », ménagères involontaires, chômeuses et chômeurs, assistés sociaux, sans statut de toutes sortes... mi-étudiants, mi-travailleurs et mi-chômeurs. De New York à Londres, de Milan à Bruxelles, de Paris à Montréal, les formes d'exclusion du marché de l'emploi, bien que changeantes et variées, s'apparentent. Au coeur du capitalisme avancé, ce sont aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de personnes qui se retrouvent sur des voies de la marginalisation [1].
Les statistiques sont accablantes, mais nous sommes si habitués à cette froide mathématique qu'elle n'a pas plus d'effet de conscience qu'un sondage d'opinions. 30 ou 40% de chômeurs chez les jeunes ou 15% d'indécis avant la prochaine élection, cela fait partie du jeu de la [26] politique-spectacle et des media du jour. Banalisation des enjeux, marketing, téléthon-festival de charité. L'image se substitue au réel. Quelques émois un peu plus humains attirent l'attention un moment de manchette, comme ce fut le cas lorsqu'on a fait peser sur l'ensemble des assistés sociaux un soupçon de fraude systématique, vite oublié dans l'engouement de la Coupe Stanley ou du spectacle de l'idole « à la magie rose ». Les vrais problèmes humains ne font pas le poids avec les derniers résultats de la « loto ». Et dire que l'on parle de la fin des rêves ! On souhaiterait un peu plus d'attention au pays réel, et surtout au sort de ceux qui y vivent à grande peine.
Dans cette nouvelle normalité du plus beau galbe, d'une juvénilité prolongée, d'une liberté sans contrainte, d'une autonomie sans attaches, d'une sécurité d'emploi et d'investissement sans perte ni partage, tout écart de la copie conforme apparaît comme une faillite monumentale. On comprend que les tiers déclassés s'isolent, se cachent, se fassent anonymes tellement ils se sentent en contradiction avec cette inaccessible normalité qui s'impose encore malgré un contexte socio-économique qui exige de toutes autres priorités... des solidarités, des partages, des investissements, des générosités, des chantiers, et disons les mots bannis, des sacrifices coûteux, des efforts collectifs, des engagements désintéressés, bref des comportements et des pratiques qui vont à l'encontre de toutes ces thérapies interminables du « moi » serinées sur toutes les ondes. Alors que le vocabulaire du nombril prolifère, celui de l'altruisme perd toutes ses lettres de noblesse et d'humanité. On moque la dite « idéologie communautaire ». La « solidarité » serait un slogan vide pour les pancartes de manifs syndicales ou autres. Et la « générosité » fait partie des nouveaux tabous et interdits. Bien sûr, il reste les droits, mais leur impact dépend de votre force de [27] frappe ou de chantage. Les restrictions budgétaires se tournent vers les catégories de citoyens les plus faibles, après avoir reculé devant ceux qui criaient le plus fort, devant les états majors corporatistes et financiers capables d'imposer leurs intérêts maximaux.
J'ai suivi l'évolution récente de ce fort contingent de la population que constituent les petits salariés du secteur privé. En quelques années, j'ai vu bien des familles passer de double salaire à un seul, puis à l'assurance-chômage, puis au bien-être social ( !). Ce monde modeste, fier de gagner sa vie, souvent très sain dans sa façon de vivre, dans sa gestion budgétaire, a perdu le fruit de plusieurs décennies de travail acharné, d'épargne rigoureuse, sans compter une dignité qui n'a cessé de m'étonner depuis le début de mon engagement social et pastoral, il y a déjà trente ans. Dans mon milieu, semblable à tant d'autres de la société, c'est ce monde anonyme, éreinté qui s'additionne aux assistés sociaux et aux jeunes en chômage ; c'est ce monde qui entoure silencieusement des institutions publiques susceptibles de les servir. Le personnel de celles-ci occupe tous les créneaux des revendications les plus raffinées, des avantages les plus progressistes, en plus de la sécurité absolue d'emploi. Je l'avoue, ce drame que j'ai sous les yeux quotidiennement m'obsède. Et je me retrouve dans ce sentiment d'impuissance que décrit si justement M. Lessard.
- Je devais continuellement rencontrer des travailleurs et des travailleuses laissés pour compte dans la crise, discuter avec des jeunes sans emploi, chercher avec des représentants des groupes populaires ou sociaux des voies possibles de ripostes communes... Je tentais avec une imagination romantique, de faire apparaître quelques lueurs d'espoir là où il n'y avait plus d'étincelle, d'ouvrir des perspectives de luttes là où tout était bloqué, de faire émerger des solidarités inédites qui [28] devaient dépasser les cadres plutôt étroits de la scène habituelle des conflits sociaux. Il me semblait devenir l'expert des défis impossibles, le dernier intellectuel organique du « jusqu'auboutisme », le copain sympathique des causes perdues...
- Ce qu'il y avait de plus dérangeant pour briser cette fausse impression de solitude salvatrice, c'était le dénuement, la générosité et l'intelligence de ces travailleurs face à des réalités qu'ils n'avaient jamais imaginé devoir affronter un jour. Il fallait assister, lors d'une assemblée générale, à l'annonce de la fermeture d'entreprise pour réaliser à quel point était grand le désarroi. Il fallait aussi, trois mois, six mois, un an, deux ans après une fermeture, assister à une autre assemblée du même syndicat qui persistait à exister toujours, où les uns et les autres se racontaient, avouaient après quelques hésitations leur difficulté à trouver un emploi et, s'ils en avaient un, décrivaient avec malaise et indignation les conditions souvent misérables dans lesquelles ils devaient l'exécuter. Au sein même de ces assemblées qui avaient d'ailleurs perdu le caractère protocolaire d'antan, il fallait aussi entendre le refus de la fatalité, le souci de s'organiser et d'imaginer des solidarités nouvelles qui devaient dépasser tout ce que ces syndiqués avaient pu imaginer dans les luttes éclatantes qu'ils avaient dû mener antérieurement. Enfin, lorsque tout semblait piégé, les stratèges épuisés, à bout de souffle et d'idées, souvent une voix surgie de quelque part dans la salle, timide, éteinte, troublée, tellement loin de la façon coutumière de dire les choses, pouvait pour des mois encore faire démarrer la lutte et refaire le plein d'espoir... (pp. 10-11).
Les statistiques sur la « crise » ne disent pas grand-chose sans ces visages humains qui la vivent le plus durement. Et je crains les grands discours idéologiques et politiques qui ne les ont pas fréquentés vraiment. Je veux bien qu'on marque les limites des pratiques locales, partielles, émergentes de ces regroupements fragiles de [29] tiers, de ces micro-projets dont on parle ici et là dans le Tiers-Monde. Je reconnais l'amplitude politique des défis. Je sais la tentation en haut lieu de renvoyer l'ascenseur à la base sociale, aux « dynamismes locaux ». Je ne rêve pas d'une troisième voie qu'une certaine critique reçue et facile flaire dans ces efforts précaires et ces pratiques d'émergence. Je n'ai pas en poche un grand projet collectif qui tiendrait lieu d'alternative, de nouveau modèle de société, sinon de théorie sociale inédite. Je voudrais préciser simplement un ensemble de pratiques qui m'apparaissent pertinentes. Des pratiques qui ne concernent pas que les tiers, et qui peuvent s'exercer aussi dans beaucoup de nos institutions.
Mon pari des tiers c'est de faire entrer dans le débat politique des enjeux humains irréductibles qui invitent au meilleur de nous-mêmes et nous empêchent de gommer les vrais problèmes, les choix à faire, les priorités, les objectifs, et disons ces autres mots tabous, les exigences morales incontournables. Je le répète : on ne trouvera pas ici un programme de parti, une idéologie du genre « Small is beautiful ». Je suis trop préoccupé du nécessaire génie des ensembles pour ne miser que sur les « dynamises locaux ». À ce chapitre, je tiens à souligner une autre de mes obsessions.
L'inefficacité collective
Je m'inquiète depuis un bon moment de ce que je pense être une question cruciale pour notre présent et notre avenir. Une question sans cesse refoulée, contournée, noyée, niée. Une question souvent abordée à partir des causes extérieures à nous-mêmes. Il s'agit de notre « inefficacité collective ». À chaque fois que j'en parle, je reçois une bordée d'invectives, sinon d'objections. [30] On s'empresse de me donner des exemples authentiques de réussites indéniables : Hydro-Québec, le Mouvement Desjardins, la Régie des Rentes du Québec, Provigo, Bombardier, Lavalin, SNC, etc. Et je me sens malvenu d'évoquer à mon tour les Olympiques, Sidbec et tant d'autres faillites. En surface, il semble y avoir équilibre entre les actifs et les passifs. Nos endettements « publics » ne seraient pas plus lourds que ceux de nos voisins (ce qui est à discuter : 60 milliards seulement pour le Québec !). Et puis n'y a-t-il pas eu cette preuve irréfutable de notre créativité collective au cours des années 60 au démarrage de la Révolution tranquille ? Mais que s'est-il passé depuis ?
La mise en marche des nouvelles structures était à peine amorcée qu'on les remettait en cause dans des combats manichéens, des arrêts répétés de la machine, des débats dogmatiques et idéologiques qui n'avaient rien à envier de nos vieux mythes dénoncés au cours des années 50. Bien sûr, il y a eu une suite de crises mondiales qui nous ont atteints gravement. Mais il est des terrains où les problèmes dépendent davantage de nous-mêmes, tels nos institutions publiques. Je parle ici comme francophone. Qui ose dire publiquement que les hôpitaux anglophones du Québec sont organisés et fonctionnent d'une façon plus efficace que les hôpitaux francophones, et cela dans le même régime de base ? On allèguera cinquante-six raisons, sauf celle de notre inefficacité collective et de nos propres défauts en ce domaine. Même silence à propos de l'école et des autres institutions publiques. Par exemple, les dépenses administratives courantes de nos commissions scolaires québécoises équivalent à la moitié des dépenses globales au Canada à ce chapitre. Dans le même contexte de comparaison, les écarts de coût par étudiant, par lit d'hôpital nous interrogent sur notre efficacité collective. À chaque fois que le problème est soulevé, chacune des parties concernées [31] en attribue la faute aux autres, ou tout simplement noie la question dans des considérations souvent étrangères au problème lui-même. Dans la mesure où il y a là un problème de société qui nous concerne tous, nous ne pouvons plus le contourner.
Ce que Freud a dit du discours « occultant » dans la psychologie individuelle est aussi vrai dans les discours idéologiques. « Quand quelqu'un redoute le contact avec la réalité, les mots sont interposés comme un rideau pour séparer celui qui parle aussi bien de son milieu que de son propre corps. » Cela me semble encore plus évident dans les discours collectifs. Marx n'a pas parlé sans raison de fausse conscience idéologique. Et le philosophe Bachelard n'a pas tort de dire que l'intelligence du concret est plus exigeante que celle de l'abstrait. Quand, à ce défi, s'ajoute une tournure manichéenne de l'esprit, on s'éloigne encore plus du réel. Tout cela invite ànous distancer un peu plus du discours et à regarder de plus près nos pratiques. Voyez comment on interprète les résultats des sondages d'opinion... comme s'ils étaient le portrait exact du réel. Or, on sait pourtant qu'il y a souvent un fort écart entre ce que les gens disent, ce qu'ils pensent vraiment et surtout ce qu'ils font réellement. Pendant que nous discourons, d'autres construisent et occupent le terrain. Voyez la tournure de nos débats sans fin dans le sillage du plus pur manichéisme.
On discute abstraitement de social-démocratie et de post-social-démocratie, de l'État-business versus l'État-providence, de marché versus bureaucratie, de capitalisme versus socialisme, de virage à droite ou de néo-libéralisme, de privatisation-panacée, d'idéologie communautaire, de volonté politique. Un peu tout le monde s'en prend à l'État, mais personne ne veut concrètement qu'il se retire du champ précis où il soutient financièrement [32] ou autrement tel ou tel champ d'intérêt particulier. Est-il une seule coupure budgétaire qui n'ait soulevé un tollé. On est en général contre l'État, mais en particulier, on attend tout de lui. Je ne connais pas de discours plus contradictoire et schizoïde. L'échec des tentatives néo-libérales des partis au pouvoir en témoignent, mais ce sont les mêmes discours qui continuent autour d'étiquettes idéologiques dont on ne sait plus très bien le contenu. Oh ! je sais qu'il est facile de discréditer à peu près n'importe quel discours non seulement avec le sur-équipement critique qu'on s'est donné, mais aussi dans un contexte éclaté qui défie les explications et les stratégies les plus sophistiquées.
Les constats se neutralisent. D'une part, l'échec de l'État-providence avec ses lourdeurs bureaucratiques et sa culture de la dépendance ; d'autre part, l'inhumanité de l'État-business qui n'aurait d'autre but que la rentabilité dans un cadre de marché, celui-ci définissant les orientations et les pratiques d'institutions qui ne pourront jamais être rentables. De temps en temps percent des diagnostics qui éclairent un peu la situation. Dans la cacophonie des débats sur le libre-échange avec les États-Unis, J.-P. L'Allier, par exemple, tient ces propos sensés : « Seuls les pays les plus forts peuvent se développer en s'appuyant essentiellement sur leurs entreprises privées car leurs entreprises privées sont aussi, presque par définition, les plus puissantes sur la scène internationale. Elles font la loi... Plus les pays sont petits, plus les entités collectives sont dépendantes sur le plan économique, plus elles doivent se constituer en elles-mêmes des moyens de protection et de développement social et culturel que la simple application des règles du marché ne leur donnerait pas ».
Mais nous savons bien aussi qu'il nous faut une économie dynamique capable de faire sa place dans l'économie internationale. La critique de l'économie des autres a trop souvent servi d'alibi pour masquer nos [33] passifs en ce domaine. Et la critique idéologique du virage technologique a d'étranges résonances dans une société qui commence à peine à s'y mettre. J'ai déjà souligné les transferts inconscients de ce qu'il y a de plus régressif dans notre héritage religieux, tels ces deux attitudes aussi fausses l'une que l'autre de considérer la technologie tantôt comme un tabou, tantôt comme un moyen magique.
Bon gré malgré, nous sommes obligés de travailler sur plusieurs fronts à la fois : une scolarisation plus poussée, des besoins sociaux accentués par la récession, une forte relance économique, une organisation étatique plus efficace. Y a-t-il place pour des choix ? Sans doute pas dans ces tâches essentielles, Faut-il se replier sur des considérations plutôt d'ordre éthique ? Remises en cause de styles de vie, de consommation, de pratiques de travail qui vont à l'encontre d'objectifs et d'investissements collectifs coûteux en argent, en énergie, en dévouement désintéressé. Ce genre d'approche est jugé « plate vertu ». Peu importe la vérité des constats qu'il porte. Par exemple, peut-on vouloir en même temps les derniers gadgets de la consommation nord-américaine et les meilleures politiques sociales au monde ? Plaider une société plus solidaire par la diminution des heures de travail pour la création d'emplois nouveaux, mais sans la moindre perte de salaire et de bénéfices sociaux de tous ordres, y compris une prime d'enrichissement collectif, comme le voudrait le syndicalisme du secteur public, au grand scandale des travailleurs du secteur privé qui trouvent ce discours aberrant économiquement ou autrement. La plupart des plaidoyers sur le plein emploi taisent systématiquement les factures à payer, les sacrifices à faire, les énergies à déployer... suffiraient une volonté politique des gouvernements et la mise à contribution obligée des grandes entreprises. Trêve de moralité, puisque celle-ci semble hors du réel, sinon [34] irréaliste. Pourtant on ne s'en prive pas pour stigmatiser ses ennemis idéologiques ou autres, et cela dans la plus pure veine manichéenne.
Reste entier le problème que j'ai soulevé plus haut, à savoir notre inefficacité collective. Dans l'ouvrage précédent j'ai montré comment le comportement manichéen peut être inhibiteur de l'action. Je voudrais le rappeler ici succinctement. C'est une conviction que je tire de mes trente ans d'engagement dans des projets sociaux.
Purs, sans compromis, mais stériles
Les « purs » exerçaient au milieu de nous la noble fonction critique qui les drapait de vertu, de bonne conscience et d'idéal irréfutable. La moindre initiative leur apparaissait piégée, susceptible de récupération. Présents aux luttes d'opposition et de contestation, ils disparaissaient au moment de la mise en marche des chantiers, ou bien ils devenaient des saboteurs qui faisaient constamment renaître des conflits, toujours au nom d'une pureté qui les légitimait.
Le compromis, même entre pairs d'un même projet, devenait, à leurs yeux, le signe d'un réformisme pire que le statu quo. Celui-ci étant plus net, plus facile à pourfendre, ils pouvaient ainsi maintenir intact leur parti pris absolu et leur idéal inentamé. Ils n'ont jamais compris que la vie est faite de transactions quotidiennes marquées par des choix, des compromis, des essais, des risques, des reprises.
Le mot de Jouhandeau me revient à l'esprit quand je songe à la pureté manichéenne de ces militances [35] idéologiques, dogmatiques ou sectaires : « Placé entre l'abject et le sublime, on ne vit que dévorant ou dévoré », sans ce relais du compromis qui accompagne le savoir-faire. Ainsi, on s'installe sur les plus hauts créneaux pour juger tout le monde et son père, avec de grandes idées qu'on n'a jamais éprouvées soi-même dans la moindre entreprise. Les militants purs, à la limite, savent faire dérailler le train, mais ne comptez pas sur eux pour en faire un. Ils ressemblent à ces intellectuels au coeur pur qui ne se salissent jamais les mains. Plutôt la démission que la compromission. Ce réflexe qui est leur marque de commerce est trop fréquent pour ne pas y voir un signe assez évident de leur angoisse, de leur peur, de leur refus face aux risques et aux limites de toute entreprise humaine.
Finitude de la vie, de l'homme, de l'histoire, voilà ce que les purs ne supportent pas. Mais ces pèlerins de l'absolu ne sont-ils pas plus nobles que nous ? Ne nous forcent-ils pas à un incessant dépassement ? Ne nous délivrent-ils pas des tentations de composer avec les injustices, ou de les accepter avec résignation ? Bref, un rôle nécessaire, sinon utile, et parfois prophétique. Je suis prêt à le reconnaître, mais avec une réserve très importante : quand on est absolu, on a peine à jouer un rôle parmi d'autres. Le complexe de l'absolu s'enferme le plus souvent dans une totalité fermée, figée, irréfragable, irrécusable. Ceux qui ont voulu faire de cette terre un paradis, en ont fait un enfer, disait Lord Acton. Et Dubos d'ajouter : les utopies formulées d'une façon trop définitive deviennent vite une prison. Ce qui ne l'empêchait pas d'ajouter que l'espèce humaine a le pouvoir de changer le cours de son évolution sociale, et d'y voir la clef de voûte de son caractère unique parmi les autres espèces animales (Choisir d'être humain, Denoël, 1977, p. 166-167).
[36]
Cette dernière remarque me permet de souligner que mon plaidoyer pour le compromis s'inscrit dans une volonté de changement, dans une dynamique d'action, et non dans une logique de mort, sinon de résignation. Je me sens en connivence avec cette nouvelle conscience qui surgit à la fin de ce siècle, nouvelle conscience réfractaire à tous ces absolus religieux, idéologiques, politiques ou autres qui ont été à la source d'une escalade incroyable de violence, d'exclusion, de génocide, de domination, même dans le cas des révolutions les plus généreuses. Bernanos disait, il y a cinquante ans : « Si les choses continuent de la sorte, nous aurons à la fin du XXe siècle, une majorité de dictatures et une poignée de démocraties qui se suicident ». Quelle prophétie !
La démocratie ne peut vivre et grandir sans une volonté de compromis. Voyez sa dérive, chez nous, particulièrement dans les luttes de pouvoir et d'intérêts qui disputent le gâteau publie, les ressources communes. The sky is the limit. Je devrais dire l'absence de mesure, de proportion, de limite. Les compromis ne sont, le plus souvent, que stratégiques, hypothétiques pour emporter la caisse, en attendant le pouvoir unique et absolu.
La gauche ne fait pas ce qu'elle dit, la droite ne dit pas ce qu'elle fait. Mais chacune joue les purs. Nous allons vers ce genre de polarisation absurde, qui par la Loi, qui par le Droit, qui par le Pouvoir, qui par l'Avoir. Ces élites qui se battent entre elles visent toutes une position de « monopole absolu » (Illich) qui permet de faire chanter toute une population impuissante. Une démocratie ne peut accepter cette situation de chantage, qu'elle vienne d'un monopole financier, d'un monopole politique, d'un monopole professionnel ou syndical.
[37]
La génération qui nous suit va nous monter un terrible procès :
- Vous avez fait de la politique votre seule industrie nationale ; vous avez fait des institutions publiques des foires d'empoigne, paralysées par des combats inextricables et sans issue ; vous avez fait de l'État une locomotive tellement compliquée que plus personne n'arrive à la diriger ; vous avez fait de vos idéologies, de vos intérêts des absolus qui s'excluent les uns les autres...
Depuis un bon moment, nous vivons une sorte d'usure psychique à la fois personnelle et collective qui n'est pas étrangère à ces culs-de-sac répétitifs qui sont en train de nous épuiser. Un petit peuple comme le nôtre, une société aussi fragile, une communauté de destin aussi précaire devraient, il me semble, nous amener a mettre d'abord en valeur les dynamismes là où ils se trouvent. Sur ce fond positif les combats inévitables seraient plus sains. Nous saurions mieux distinguer ce qui fait avancer les choses et ce qui nous stérilise, nous neutralise, nous décourage.
Nous arrivons à un seuil-critique qui peut être bénéfique. La crise nous ramène les deux pieds sur terre, dans le pays réel... face à nos limites. Il faut repartir de là pour foncer dans l'avenir. Depuis trop longtemps, le mythe d'Antée guide nos comportements individuels et collectifs. Évocation, ici, de cette fable grecque qui raconte comment le héros Antée perdait de sa force quand ses deux pieds étaient détachés de la terre. Bien sûr, nous n'éviterons pas de rudes combats ; mais ceux-ci ne mèneront nulle part s'ils refusent de s'inscrire dans les transactions toujours limitées du pays réel. Une logique de vivant appelle une pratique de compromis, de choix, d'échanges, de réciprocités. [38] Confucius, il y a longtemps déjà, associait civilisation et capacité de transactions sociales.
La pureté idéologique, l'absolu dogmatique ont en commun l'absence de distance sur eux-mêmes, l'aveuglement, le complexe du système étanche. On me dira que peu de gens sont dogmatiques aujourd'hui. Ne nous fions pas trop aux discours tenus. Ce sont les pratiques qui sont devenues intransigeantes, inflexibles, catégoriques, irrévocables, péremptoires, Tout et tout de suite. J'admets que la tolérance ne doit pas justifier l'intolérable. Mais il faut reconnaître que ceux qui s'imposent, ceux qui crient le plus fort, ne sont pas ceux qui vivent des situations intolérables, mais plutôt les plus gâtés par le système. Les classes pauvres ne jouent pas le tout ou rien ; elles réclament un espace vital de dignité et de liberté, de responsabilité et d'influence, et surtout une solidarité du pain, et non ce nec plus ultra de la nouvelle classe qui n'en a jamais assez.
Il faut ici une bonne dose d'histoire non pour restaurer le passé, mais pour re-saisir cette économie humaine qui a fait émerger cultures, sociétés et civilisations. Je pense à l'ouvrage classique de l'anthropologue Marcel Mauss : Essai sur le don. Il a montré comment cette émergence est toujours apparue, sous diverses formes, dans un système de réciprocités, bâti autour de trois transactions principales : donner, recevoir, rendre, et cela dans une pratique de compromis. J'ai sous les yeux une étude éclairante qui analyse la déstructuration de la communauté esquimaude du Groenland. Le système de sécurité sociale du gouvernement danois a rendu inutile, obsolescent le système de réciprocité longuement tissé au cours des siècles par cette communauté humaine (ce qui est différent de la convivialité dont parle Illich d'une façon un peu trop abstraite). Le système de réciprocités, en l'occurrence, marquait à la [39] fois la culture, la personnalité et la cohésion sociale de cet ensemble humain. C'est cette étoffe qui a été déchirée et qui n'a pas été remplacée.
Pareil exemple appelle une pratique inverse qui ne sépare pas le recevoir et le faire, le donner et le rendre. Voyez comment certains progressistes ont développé unilatéralement des revendications autour du droit de recevoir, et aussi unilatéralement, des solidarités d'opposition. D'où un renforcement de la dépendance, sans compter l'illusion que l'action se résume à la contestation. Une libération sans création quoi ! Une dénonciation qui n'annonce rien. Une lutte sans chantier. Rappelons Saint-Exupéry : « Si tu veux unir les hommes, fais leur construire une tour, si tu veux qu'ils se battent entre eux, donne leur du pain ». Et Dostoïevsky ajouterait ici : « Ils te suivront comme un troupeau docile qui vient manger dans ta main ».
Cette pratique de réciprocité, redisons-le, ne peut se déployer sans compromis. Celui-ci nous empêche d'identifier pareille pratique à une société monolithique de consensus. Il implique plutôt à la fois pluralisme, débat, conflit, accommodement, etc. Chaque individu, chaque groupe doit être en mesure de pouvoir donner, recevoir, faire, rendre... échanger de plain-pied.
Je ne viens pas de définir la seule bonne pratique sociale, mais une pratique qui a eu cours dans l'histoire, et qui a contribué à façonner des sociétés, des étoffes sociales et culturelles. Si on la juge non pertinente pour nos sociétés modernes, qu'on retienne au moins l'interrogation qu'elle suscite sur l'état de nos rapports humains et quotidiens dans cette société dite de communication où de nombreux citoyens crient leur solitude. Celle-ci peut être une dynamique chez le bien portant, bien loti et déjà bien inscrit dans le réseau de la société de [40] services qui le sert ! Mais qu'en est-il de tous ceux qui n'ont pas de choix, de possibilités de rechange, qui ne peuvent vivre sans de forts appoints communautaires ?
Les familles pauvres n'ont pas les ressources financières ou autres pour se payer les aménagements coûteux que les gens mieux nantis peuvent se permettre pour régler leurs problèmes d'autonomie personnelle érigée en absolu. Il arrive souvent qu'un solide tissu socio-affectif soit le seul appui des familles pauvres, qu'un réseau d'entraide soit le seul ancrage humain d'individus démunis, chômeurs ou malades. Y voir une mode ou une lubie ou une idéologie d'intervenant social, sous prétexte de grandes solutions politiques a inventer, c'est ignorer l'abc de la réalité présente. À toutes les semaines, dans l'hôpital de malades chroniques que je fréquente, je rencontre trop de tragiques solitudes pour croire que les grandes solutions structurelles suffisent.
Je ne puis opposer la nécessité de solides politiques sociales et ces humbles pratiques d'humanité qu'elles ne peuvent créer d'elles-mêmes. Sans ces pratiques, les institutions seront de plus en plus froides, sèches, anonymes et hyper-sectorialisées. En pareil cas, refuser même l'idée de communauté de travail tient de la barbarie. Qu'on me permette d'insister. En combien de domaines n'avons nous pas multiplié les changements de structures, de techniques, de programmes, sans procéder à un examen sérieux des pratiques courantes qui s'y déroulaient. Pourtant, c'est bien à ce niveau que la vie se passe. « Where the action is ». En éducation, en organisation du travail, en politiques sociales, on a joué, discuté, débattu une enfilade de scénarios structurels. Il y a eu, par exemple, cinq scénarios structurels différents pour encadrer les négociations collectives des fronts communs du secteur publie. Voyez les résultats. Qui a payé le plus chèrement la note ?
[41]
En éducation, toute une génération a servi de cobaye. Ce qu'un jeune a bien stigmatisé dans ces remarques :
- Moi, j'ai toujours été à l'essai : depuis mon enfance toutes les nouveautés me sont passées dessus sans qu'aucune n'ait eu le temps de mûrir. Pendant mon enfance, mes parents ont adopté, une après l'autre, toutes les théories psychologiques à la mode. À l'école, de la maternelle à l'université, d'année en année, c'était toujours un nouveau programme qu'on expérimentait. J'ai vécu en laboratoire... dans des gares de triage.
Et voici qu'aujourd'hui ces jeunes sortis de familles brisées, coincés entre deux ménages et sans perspectives stables d'emploi, sans grand poids démographique et électoral, vivent un profond désarroi. Peut-on espérer une volonté politique lucide, courageuse et efficace si les pratiques sociales quotidiennes sont inconsistantes, sans profondeur humaine, morale, spirituelle ? On ne sait même plus quel mot employer pour les qualifier, tellement toute considération de cet ordre est ridiculisée par une critique cynique. Il ne faudrait plus parler de valeurs, d'éthique, de communauté, de milieu de vie, de réseau d'entraide, de solidarité, de générosité, de dévouement, d'équipe de travail. Tout cela est moralisateur, rétro, de droite, et tributaire d'un humanisme éculé. Mais ces experts en critique idéologique ont-ils des pratiques à proposer au-delà de leur propre discours sur les discours des autres ?
Cela dit, je ne veux récuser en rien l'importance de la sphère politique. Mais même là, je ne crois pas qu'on puisse éviter de jouer des cartes pragmatiques : nous avons besoin d'un État et d'institutions publiques capables de politiques judicieuses et fécondes, d'un secteur privé et d'entreprises dynamiques, d'initiatives communautaires et coopératives, de réseaux d'entraide et d'entrepreneurship, [42] de marginaux créateurs. On me dira que c'est une évidence ! Je n'en suis pas sûr, à voir les débats manichéens qui occupent la scène idéologique et les débats sur toutes les ondes. Quelle ironie de voir l'État si souvent obligé de défendre l'intérêt général contre les citoyens et les groupes institués qui de mille et une façon minent toute tentative de règle minimale nécessaire à la viabilité de la société elle-même. Bien sûr, l'État ne peut être un substitut de société. Encore faut-il se demander pourquoi et comment il l'est devenu ? Se pourrait-il que ce soit parce qu'il n'y a plus de médiation autre que les forces corporatistes dans une a-société d'individus. On comprend alors que l'État soit un substitut de société tout autant dans des régimes libéraux que dans des régimes socialistes. Dans un tel contexte, il est stupide de rejeter d'un revers de main des pratiques sociales qui tentent de jeter des passerelles d'échanges, de collaboration, de chantiers communs dans un même milieu. Les conflits peuvent alors avoir un sens créateur parce qu'ils s'inscrivent dans une pratique de vivant, dans un courant chaud et dynamique.
Sans fortes bases sociales, sans milieux solidaires et entreprenants, sans assises communautaires, l'État devient inévitablement un substitut de société pour combler ce vide de médiations entre lui et les individus atomisés ; et les institutions publiques ne sont que des superstructures enroulées sur elles-mêmes. On ne peut le déplorer et moquer en même temps, comme des idéologies naïves et des utopies farfelues, les efforts de concertation, les expériences communautaires, les regroupements de milieu ou de région, comme s'ils étaient la négation des grands combats politiques à mener.
C'est le sort actuel des tiers qui fonde ma conviction têtue de la nécessité de mettre en oeuvre des pratiques sociales qui assurent cette base humaine minimale [43] pour leur libération et leur promotion. C'est une tâche parmi d'autres qui ne remplace pas celles des partis, des syndicats, de l'industrie, des Églises et des gouvernements. Mais au sein même de nos grandes institutions, on rencontre des problèmes semblables. Quand la majorité des assemblées syndicales régulières ont peine à avoir le quorum, quand de toutes parts on se plaint de la crise d'appartenance, du décrochage institutionnel et du repli sur la vie privée, il faut se demander si les ressorts sociaux les plus vitaux ne se sont pas affaissés. C'est faire preuve d'un cynisme de luxe que de ridiculiser tout effort qui cherche à retisser des liens plus solides et des rapports sociaux plus solidaires et plus constructifs. La vieille méfiance manichéenne qui « idéologise » tout et rien a trop empoisonné notre vie collective. Il faut réagir résolument et effectivement.
Je sais que nous partons de loin. Mais les temps difficiles sont en train de nous faire mûrir. Plusieurs réagissent devant la morosité qui a suivi les grandes désillusions des années 80. Il y a des re-commencements plus réalistes, plus prometteurs, des nouvelles pratiques en émergence, des nouvelles motivations. Certes, ce sont des jeunes pousses encore bien fragiles. Raison de plus pour les cultiver avec soin et discernement. Ce sont ces pratiques existantes et possibles que je veux explorer dans cet ouvrage.
[1] M. LESSARD, Les Vagabonds du Rêve. Montréal, Boréal, 1986, p. 9.
|

