|
Jacques HAMEL
sociologue, département de sociologie, Université de Montréal
“La sociologie doit-elle changer
afin de pouvoir étudier les sociétés
en continuel changement ?”
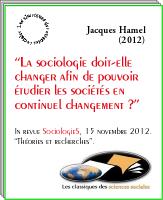 Un article publié dans la revue SociologieS, 15 novembre 2012. “Théories et recherches.” Un article publié dans la revue SociologieS, 15 novembre 2012. “Théories et recherches.”
- Résumés
- Introduction
-
- La société postmoderne à l’épreuve du changement constant
- La théorie sociologique sujette au changement
- Les paradoxes de la sociologie des associations ou de l’acteur-réseau
- Les ratés de la sociologie des associations sur le plan épistémologique
- L’explication du changement en sociologie, un exemple
-
- En matière de conclusion
- Bibliographie
Résumés

- Français
Cet article n’a pas pour objet la sociologie du changement. Il aborde un tout autre sujet, celui du renouveau de la théorie sociologique requis à tous égards pour certains afin de pouvoir expliquer les sociétés aujourd’hui en continuel changement ou en perpétuelle mutation. En effet, la société devenue « liquide », changeant à la vitesse de l’éclair sous les flux incessants du capital et de l’information, rendrait caducs le social et son explication à la lumière de configurations stables produites dans cette intention en vertu de la théorie sociologique. Qu’en est-il exactement ? On verra, au fil de cet article, que les théories destinées à « refaire la sociologie » se bornent à bien des égards à concevoir le social ou le collectif sous les traits du changement sans toutefois être capables de l’expliquer.
- English
Must sociology change for learning constantly changing societies ?
The purpose of this article is not social change. It covers a different topic : the renewal of sociological theory. This renewal is required now in order to explain the constantly changing societies. Society become "liquid" cancels the social and the social theories developed to explain in the light of stable structures. What is it exactly ? We will see here that the theories for "remaking sociology" merely consider the social in the face of change without being able to explain it.
- Español
¿Debe cambiar la sociología para poder analizar una sociedad en continuo cambio?
Este artículo no trata de la sociología de los cambios sociales. Aborda otro tema, el de la renovación de la teoría sociológica, necesidad absoluta para algunos que piensan que es el camino para explicar los continuos cambios en la sociedad. En efecto, una sociedad « líquida », que cambia constantemente con la velocidad de una centella bajo los flujos incesantes del capital y de las fuentes de información podrían hacer caducar lo social y su explicación, es decir la voluntad de explicar lo social analizando las estructuras estables. ¿Que es lo que está sucediente actualmente? En este artículo se expone que las teorías que intentan « reconstruir » la sociología se limitan a menudo de interpretar los cambios sociales sin ser capable de explicarlos.
Mots-clés : changement social, collectif, épistémologie
Introduction

Il est de bon ton de nos jours de vouloir refaire la sociologie au motif que les théories avancées en son nom résistent difficilement au changement à l’œuvre dans les sociétés actuelles. En effet, celles-ci semblent être soumises d’office aux pressions et aux flux qui mettent en cause la représentation du social en termes de « structure » ou de « détermination » sociales. Les théories sociologiques fondées sur cette conception, inspirée notamment du structuralisme, devraient donc être reléguées aux oubliettes. Le changement activé par les développements fulgurants de la science et de la technique, comme par la mobilité des personnes, du capital et des savoirs, aurait raison de cette optique théorique propre à prêter au social une configuration stable apparemment artificieuse.
Qu’en est-il véritablement ? Cet article cherche à y voir clair en envisageant les considérations récemment développées sur le sujet par les auteurs, français et anglo-saxons, qui s’emploient à concevoir à nouveaux frais l’objet et les notions de la sociologie qu’illustre par exemple la théorie de Pierre Bourdieu en voie de désuétude sous le coup des changements continuels dont la société est aujourd’hui le théâtre. Le sujet sera également envisagé sur le plan épistémologique afin de faire preuve de nuances en la matière. Sur ce registre, on le verra, il apparaît requis de rendre le changement « amorphe », le « figer » au moyen de la théorie afin de pouvoir l’expliquer sous l’optique sociologique, par exemple. Cette obligation, à laquelle les sociologues doivent se plier de bonne grâce, vient fragiliser les entreprises, comme celle proposée par Bruno Latour, destinées à refaire la sociologie en voulant qu’elle se borne à décrire les connexions qui donnent sa forme collective au jeu propre à lier les individus, les objets et les entités non humaines qui gravitent communément dans la même orbite.
La société postmoderne à l’épreuve du changement constant

Il n’est point besoin de le démontrer : le changement s’opère de nos jours à la vitesse de l’éclair dans les sociétés dites postmodernes infléchies par les développements incessants des connaissances nées de la science et de la technique qui, répercutées par les nouvelles technologies que représente le Web, font tache d’huile et contribuent à donner peau neuve à la société. Sur cette base, la vie individuelle et collective se manifeste sous le mode propre à les rendre « naturellement flexibles et adaptables, qualités essentielles pour survivre et prospérer dans un environnement qui change vite » (Castells, 2001, p. 9). En effet, principalement impulsé par cette « force productive » surgie de l’innovation scientifique et technique, le changement s’opère sans relâche et tend à outrepasser le territoire national, l’autorité et les droits placés sous la gouverne des États nationaux (Sassen, 2006) et, s’étendant à l’échelle de la planète, donne corps à la mondialisation sous les traits des mouvements migratoires, des flux d’information et de nouvelles conceptions du temps et de l’espace (Ury, 2007 et 2005) en voie de refaçonner le social. Les frontières nationales, les cultures ancestrales et les institutions sociales – comme la religion, la famille et la classe sociale – fléchissent sous sa pression, accentuant du coup la labilité de la vie collective et individuelle. En effet, à leur échelle, les individus, libérés de leurs tutelles, deviennent eux-mêmes responsables de leurs itinéraires biographiques sujets toutefois à « des conditions qui changent en moins de temps qu’il n’en faut pour se figer en habitudes et en routines (Bauman, 2006, p. 7). La vie sociale devient « liquide » ou, en d’autres termes, ne parvient plus à prendre un corps solide tant le changement observable aux niveaux individuel et collectif vient éroder les modes de vie et les sociétés desquels les individus se ressentaient jadis solidaires en faisant naître chez eux le sentiment de sécurité ontologique qu’Anthony Giddens (1994, p. 98) conçoit comme « la confiance des êtres humains dans la continuité de leur propre identité et dans la constance des environnements d’actions sociaux et matériels ». En d’autres termes, le changement continuellement à l’œuvre menace la constance et la continuité propres à donner à la vie individuelle et collective sa forme stable associable au social appréhendé comme objet de la sociologie.
La théorie sociologique sujette au changement

Bref, on l’a compris, la vie des sociétés et des individus devient censément fluide, voire liquide, et par conséquent il convient en sociologie de les concevoir en théorie sous le signe du changement rapide et incessant. La sociologie doit à cet effet prendre un nouveau visage afin de pouvoir expliquer les changements auxquels sont sujettes les sociétés d’aujourd’hui et qui, aux yeux d’Alain Touraine, contribuent à la « fin du social ». En effet, selon lui, les changements à l’œuvre, de diverses natures, techniques comme éthiques, forment de nos jours des « forces » pas forcément « sociales » comme l’ont été jadis la famille, les classes sociales, l’État national, les acteurs sociaux comme les syndicats et le mouvement ouvrier ou féministe. Il note à ce sujet que, de nos jours, la « vie sociale est envahie par des forces non sociales que sont l’intérêt, la violence et la peur et, de l’autre, par des acteurs dont les objectifs sont la liberté personnelle ou l’appartenance à une communauté héritée, objectifs qui ne sont pas, eux non plus, proprement “sociaux” » (Touraine, 2005, p. 11). Les forces sociales se relâchent ou, plus exactement, se muent en pressions, d’une autre nature, susceptibles d’amener les individus à vouloir se concevoir sous leur propre gouverne, de sorte que « l’unité de leurs conduites n’est plus imposée par la particularité d’une culture ou d’une société, mais par la construction de chacun comme sujet, porteur de droits universels en même temps qu’être particulier » (Touraine, 2007, p. 19). Selon Alain Touraine, on est donc fondé à penser que les individus et les groupes sont certes sujets à des forces extérieures à eux, capables d’infléchir leurs actions et leurs pensées, mais également responsables de pouvoirs, délibérément acquis et exploités, susceptibles de leur octroyer des droits à eux-mêmes et à autrui pour évoluer ensemble sous le signe de l’esprit démocratique.
Sur la lancée, il convient, selon Bruno Latour, de créer une « conception beaucoup plus large du social » (Latour, 2006, p. 14) en l’envisageant autrement qu’en termes de « forces » comme chez Alain Touraine. En effet, la notion de force ne manque pas de suggérer l’idée de « faits » tangibles ou de « choses » extérieures aux individus et qui s’imposent à eux à leur insu. Le social se voit ainsi réifié et, sur le coup, conçu théoriquement sous les traits de figures stables comme celles de pouvoir, de lien, de structure ou de détermination propres à se manifester en un corps concret pouvant être considéré sur le plan de l’analyse comme facteur de la société. La société se conçoit et s’explique dans cette voie à l’image de forces magnétiques qui, bien qu’invisibles, se manifestent d’office dans l’espace et dans la plupart des matériaux et leur donnent corps « solide ».
Il va de soi que les individus se lient les uns aux autres sans pression externe de cette nature, susceptible de donner à leurs interactions une forme stable contraire à leur nature changeante. Selon Bruno Latour, il vaut donc mieux les représenter en théorie sous les traits de « connexions » ou de « médiations » capables d’en concevoir la nature fluide révélée par les changements incessants dont sont témoin les sociétés actuelles. En effet, ceux-ci, incessants et rapides, viennent ainsi montrer la nécessité de concevoir théoriquement la société sous ce chef. Les sociétés d’hier et d’aujourd’hui se forment au gré des connexions labiles que les changements continuellement à l’œuvre de nos jours obligent à reconnaître et à concevoir ainsi sur le plan théorique. L’anthropologie symétrique chère à Bruno Latour (1991) trouve son droit dans cette voie puisque toutes les sociétés peuvent être envisagées sur un pied d’égalité du fait qu’elles sont mues par le changement formé au fil des connexions, changement qui toutefois, de nos jours, se manifeste avec plus d’éclat en raison de sa rapidité et de son ampleur.
Sous cette optique, conçu théoriquement en termes de connexions, le social doit s’élargir aux entités non humaines comme la nature, les animaux ou les objets puisque, liées aux humains, elles entrent dans la « liste des ingrédients » (Latour, 2006, p. 71) qui donnent une forme collective à ce que sont et font les individus par-delà leur propre personne. Le « social », faute pour l’instant d’un meilleur terme, forme ainsi des « réseaux » propres à créer – par « traduction » – des mélanges entre entités de genres différents, hybrides de nature et de culture, sans cesse changeants à l’image des transformers présents dans les films de science-fiction ou des cyborgs mis en exergue par les chefs de file de certains courants postmodernes (Haraway, 1990).
Voilà pourquoi Bruno Latour, non sans audace, propose de remplacer social par collectif du fait que, on vient de le voir, des entités non humaines entrent dans la composition de la vie commune des êtres humains et contribuent à l’infléchir. Par « collectif », il entend une manière de réunir des humains et des non-humains dans un réseau de relations spécifiques, par contraste avec la notion de société qui ne s’applique en droit qu’à l’ensemble des sujets humains, détachés de ce fait du tissu des rapports qu’ils entretiennent avec le monde des non-humains : la nature, les animaux et les objets inanimés, par exemple. Le changement mû en médecine par les biotechnologies crée des « interférences irisées » (Latour, 2004, p. 4) entre nature biologique et objets techniques propres à donner à la vie humaine et sociale un nouveau visage formé par la fusion de la culture et de la nature.
L’anthropologie symétrique trouve à nouveau sa raison d’être puisqu’on est en droit de penser que les ingrédients non humains ont ici une valeur égale aux éléments humains dans la formation des connexions qui donnent sa forme au collectif. Sur cette base, la sociologie prend pour objet le flux des « médiateurs susceptibles de générer des associations qui peuvent être tracées » (Latour, 2006, p. 156) pour donner son visage au collectif composé d’humains, de lieux et d’objets animés ou non. Un professeur écrivant sur son ordinateur portable à l’université s’explique par le réseau buissonnant des relations entre lui et son appareil, étendues à celles qui ont été nouées pour produire celui-ci et, dans la foulée, les associations qu’a fait naître la construction de son bureau entre l’architecte et les employés qui ont vu à la réalisation de son devis, auxquelles il faut certainement ajouter l’écheveau des médiations entre ces derniers et les matériaux et les objets qu’ils ont mobilisés ou utilisés pour donner forme à l’endroit, lequel devant être considéré par rapport aux autres bureaux et ceux qui y évoluent, incluant les plantes vertes qui peuvent les décorer.
Sous cette optique, le collectif ne trouve jamais une forme stable du fait que ce qui le compose, comme on vient de le décrire, change continuellement et rapidement sous le coup des développements incessants des objets techniques, comme l’ordinateur utilisé par le professeur, de la mobilité des personnels qui gravitent autour de lui et des rénovations apportées à son bureau en raison aujourd’hui de la piètre qualité des matériaux de construction. La théorie des associations trouve ici sa pertinence puisque, sous ce chef, l’objet de la sociologie a pour trait des connexions pouvant être saisies par les « traces qu’elles laissent lorsqu’une nouvelle association se crée entre des éléments qui ne sont aucunement “sociaux” par eux-mêmes » (Latour, 2007, p. 17).
Outre la conception de l’objet, la sociologie doit également définir à nouveaux frais les concepts qui lui donnent corps en cherchant à filtrer leur teneur censément déterministe jugée obsolète [1] pour expliquer des sociétés ou, plus exactement, des collectifs fondés sur des connexions entre médiateurs susceptibles de changer sans cesse. La sociologie basée sur des déterminations expliquerait à la lumière de « forces capables de stabiliser ces relations dans le temps et dans l’espace » (Latour, 2007, p. 94) qui pourtant ne cessent de changer. Ces forces, responsables de la stabilisation des relations sociales, sont donc conçues sous la forme propre à les constituer comme « chose tangible » alors que leurs mutations continuelles requièrent au contraire de les envisager comme des fluides assimilables à « un mouvement, un déplacement, une transformation, une traduction » (Latour, 2007, p. 93) sans fin puisque, on le devine, les réseaux nés des médiations ou des associations ne revêtent en rien une forme substantielle et sont créés de toutes pièces par les chercheurs désireux de retracer le mouvement changeant des agents – humains et non humains – qui, en vertu de leur association momentanée, donne figure au collectif. Sous cette perspective, il s’agit donc de « déployer ces agents en tant que réseaux de médiation » (Latour, 2007, p. 197) qui par conséquent correspondent à la méthode bien plus qu’à l’objet que celle-ci permet de décrire, objet ne pouvant être associé à une « chose tangible », mais à un mouvement continu qui rend impossible la conception du collectif sous les traits d’une réalité substantielle. Cette perspective permet donc d’échapper au fétichisme – cette tendance à vouloir incarner et déifier le social sous les traits de forces réelles – pour adopter le faitichisme (Latour, 2009) en vertu duquel le réseau changeant des associations correspond à un fait qui, décrit sous forme d’un compte-rendu ouvert à la discussion, s’impose si cette description ne suscite nulle controverse dans les rangs des chercheurs comme de tout un chacun en mesure de constater sur cette base que le collectif ne cesse de changer.
Les paradoxes de la sociologie des associations ou de l’acteur-réseau

La sociologie des associations, conçue comme théorie de l’acteur-réseau, s’établit toutefois sous le signe du paradoxe qui vient fragiliser, voire contredire, la conception que Bruno Latour se fait de l’objet de la sociologie dans l’intention de la refaire. En effet, on l’a vu, la sociologie prend pour objet les « médiateurs susceptibles de générer des associations qui peuvent néanmoins être tracées » sous forme de flux dont le World Wide Web illustre la labilité propre à décrire ce qui, dans son esprit, correspond aux configurations circonstanciées du collectif. Or, sur cette base, force est de constater ici que, contrairement à ce qu’affirme notre auteur, les flux responsables des associations se stabilisent dans des formes singulières de pratiques ou de dispositifs institués qui orchestrent la manière dont se forment les configurations du collectif qui, paradoxalement, peuvent être tracées sous forme d’associations ou de réseaux parfaitement discernables. La navigation sur Wikipédia pour acquérir des informations s’établit certes au fil de connexions arborescentes qui, dans la foulée, engendrent néanmoins des habitudes ou des pratiques qui les « traduisent » sous des formes stables.
La théorie reste donc ici muette sur la force – faute d’un meilleur terme – en vertu de laquelle les flux se fixent de manière à pouvoir être tracés sous forme d’assemblages, pour ne pas dire d’associations, parfaitement discernables sans quoi ils resteraient purement évanescents et rendraient dérisoires l’entreprise destinée à en saisir le changement afin de l’expliquer sur le plan théorique. Si les flux ne sont, chez Bruno Latour, nullement activés par des forces perçues comme causes susceptibles de produire des effets, il n’en demeure pas moins qu’un agent les anime sous forme d’acteurs-réseaux, ce qui, force est de le constater, reste le point aveugle de sa théorie. Son entreprise se limite par conséquent à identifier les médiateurs, humains et non humains, qui « entrent dans la danse » pour composer le collectif toujours sujet au changement comme on peut l’imaginer sans peine dans cette voie largement inspirée de la tradition deleuzienne des « virtualités actualisées » opposées aux « potentialités réalisées » (Deleuze, 1968, pp. 269-285).
Il manque de surcroît chez Bruno Latour une théorie générale de la stabilisation des collectifs (Descola, 2011, p. 71) qui, brillant pas son absence, l’amène à concevoir le collectif – par préférence à société ou social – sous les seuls traits du changement sans même vouloir, ni pouvoir l’expliquer. Il se borne en somme à le décrire sans parvenir à le représenter de manière à en rendre raison sur le plan théorique. En effet, sous ce chef, les mutations observables du collectif s’expliquent en se bornant à décrire la nouvelle configuration des connexions que forment les associations circonstanciées entre humains et non humains, par exemple. La théorie propre à expliquer le changement fait ici cruellement défaut. Bruno Latour se contente à cet égard d’affirmer qu’il suffit de le décrire pour pouvoir le comprendre, mais force est d’admettre que la théorie des associations tourne court du fait qu’elle n’est d’aucun secours pour faire comprendre ce qui donne acte au changement à la lumière de connaissances produites précisément dans cette intention. Elle se borne à le décrire sous la forme de comptes-rendus écrits sans discontinuité afin de le retracer en détail dans le cadre de l’entreprise titanesque que montre l’exemple précédemment cité du professeur écrivant sur son portable dans son bureau à l’université. Dans cette perspective, « expliquer, c’est décrire » sous l’égide d’une « méthode essentiellement négative [qui] ne dit rien sur la forme de ce qu’elle permet de décrire » (Latour, 2006, p. 207).
Les ratés de la sociologie des associations sur le plan épistémologique

Or, sur ce plan, on le constate, la théorie que propose Bruno Latour afin de refaire la sociologie se limite à décrire le changement sans chercher véritablement à l’expliquer par-delà le changement observable des connexions entre « ingrédients » qui forment le collectif. L’explication se formule en termes proprement tautologiques en faisant l’impasse sur les conditions en vertu desquelles se produit le changement susceptible de donner au collectif sa nouvelle configuration. L’entreprise destinée à refaire la sociologie tourne court en proposant une vision aussi simpliste de l’explication.
Si tant est qu’on veuille la concevoir sous un autre chef, la sociologie peut à notre sens être considérée comme une connaissance par objet et par concept que Gilles-Gaston Granger associe à la science. En bref, selon cet éminent épistémologue, la science cherche à transposer la « réalité » – toute réalité – sous la forme d’un objet ouvert à la manipulation susceptible de l’expliquer au moyen de concepts capables d’en produire une représentation grâce à laquelle il devient alors possible d’en avoir « un contact précis et pénétrant » (Granger, 1986, p. 120) du fait qu’elle se forme sous le mode de l’abstraction.
Cette caractérisation de la science vient singulièrement nuancer la manière dont se conçoit l’objet dans l’orbite scientifique. En effet, objet correspond ici non pas à une chose tangible comme des forces, mais à une image accolée à la réalité afin de pouvoir la « manipuler » dans l’intention de l’expliquer. En d’autres termes, le social doit être dans cette perspective rendu provisoirement inerte – sans nulle volonté de le réifier – afin de pouvoir le concevoir sous forme d’un objet susceptible d’être manipulé grâce à la théorie fondée sur les concepts et les méthodes utiles pour l’expliquer au sens qu’a ce terme en épistémologie : rendre raison au moyen d’une image d’une autre nature que ce qu’on cherche à connaître.
Sous ce chef, on le devine, l’explication ne se fonde nullement sur des forces responsables du changement explicable en termes de cause à effet auxquelles on associe indûment la science. La notion de « forces » suggère strictement une image, ou mieux une représentation, capable de faire comprendre les propriétés qu’on associe par exemple aux relations sociales. Elle se révèle propice et féconde pour en rendre raison sans du coup penser que ces forces sont la cause des changements que manifeste la variation de leurs configurations.
Le terme forces fait donc ici office de concept doté délibérément de charges épistémologiques et opératoires en vertu desquelles se représente l’objet qu’on cherche à connaître et il devient dès lors possible d’expliquer sur ce registre expressément produit dans cette intention. Le mot ne désigne donc pas une force réelle qui, sous-jacente aux relations sociales, les expliquerait sous le mode de la causalité mise au jour grâce à la théorie sociologique élaborée afin de comprendre le changement à l’œuvre dans la société. Bref, en sa qualité de concept, force vient ainsi dédoubler le changement, c’est-à-dire en transposer la fluidité en une représentation ouverte à la manipulation formelle requise pour pouvoir l’envisager sous une forme stable susceptible de l’expliquer. Sous cette perspective, on le constate, la théorie « appréhende des objets en construisant des formes dans un langage et non directement sur des données sensibles » (Granger, 1967, p. 13). Il ne saurait donc y avoir en ce sens « aucune confusion possible entre la qualité immédiate de l’objet et la qualité pensée et manipulée comme forme » (Granger, 1988, p. 120) propice à en rendre compte.
Il reste à savoir si la sociologie peut se concevoir sous ce chef que l’épistémologie associe à la science vue positivement comme un travail voué délibérément à produire une représentation capable d’expliquer sur cette base, distincte de l’objet qu’on cherche à connaître.
L’explication du changement en sociologie, un exemple

À cet égard, avec un brin de provocation, la théorie de Pierre Bourdieu, celle à laquelle s’oppose en catimini Bruno Latour, peut être citée en exemple afin de montrer comment se conçoit exactement l’explication du changement sous l’égide de la sociologie conçue comme connaissance par objet et par concept.
Si réfractaire qu’il ait été à l’« épistémologisme », Pierre Bourdieu s’est pourtant évertué à concevoir la sociologie sous ce chef en développant sa propre théorie. En effet, lui mieux que quiconque a voulu donner à la sociologie son objet propre en ayant soin de le déterminer exactement et de manière à ce qu’il soit ouvert aux manipulations capables d’en rendre raison sous l’optique de la théorie. Dans cette voie, la sociologie prend pour objet les « relations dans lesquelles s’insèrent les individus » au fil de leur trajectoire biographique, relations qui, sous leurs traits plus ou moins stables, forment des institutions « extérieures » aux individus eux-mêmes et par conséquent largement indépendantes de leurs conscience et volonté.
Sous cette optique, force est d’admettre que tout individu s’insère dès sa naissance dans la relation parents – enfants qui, sur le coup, crée – par-delà leurs conscience et volonté – des « déterminations » dont les propriétés font que, par exemple, le père et la mère détiennent l’autorité à laquelle doivent se soumettre sans rechigner leurs rejetons. Ces « contraintes », à l’image des forces du champ magnétique, s’imposent aux individus en présence et forment dans leur corps et dans leur esprit des dispositions que Pierre Bourdieu conçoit en théorie comme l’habitus responsable à bien des égards de la mobilisation des ressources et pouvoirs dont ils sont dotés et que notre auteur associe au capital. Le social se représente sur cette base comme la combinaison du capital et de l’habitus propice à l’élaboration d’une espèce d’analysis situs en vertu de laquelle « les agents sociaux, et aussi les choses en tant qu’elles sont appropriées par eux, donc constituées comme propriétés, sont situés en un lieu de l’espace social, lieu distinct et distinctif qui peut être caractérisé par la position relative qu’il occupe par rapport à d’autres lieux (au-dessus, au-dessous, entre, etc.) et par la distance dite parfois “respectueuse” : e longinquo reverentia) qui le sépare d’eux » (Bourdieu, 1997, p. 161). L’analysis situs tend sous cette forme à les doter « d’une gravité spécifique capable de s’imposer à tous les objets et les agents » (Bourdieu, 1992, p. 24) qui s’insèrent dans le jeu social dorénavant conçu comme configuration de relations objectives – que Pierre Bourdieu nomme champ – « que l’on ne peut ni montrer, ni toucher du doigt mais qu’il faut conquérir, construire et valider par le travail scientifique » (Bourdieu, 1994, p. 9).
L’explication en sociologie se conçoit donc sous le signe de cette géométrie sociale fondée sur les propriétés des « relations dans lesquelles s’insèrent les individus » qui, pour Pierre Bourdieu, correspondent à l’objet même de cette discipline. Sous cette optique, on le devine, la théorie sociologique doit et peut rendre raison des changements susceptibles de se produire dans le jeu social du fait qu’il se trouve représenté sous la forme de l’équation
Capital - habitus - position - champ
génératrice de la géométrie sociale responsable de l’explication conçue schématiquement par des graphiques, comme le suivant, associés de mauvaise foi à la théorie de haute voltige propre à réifier le changement en société sous les traits d’une géométrie sociale encline à concevoir la pratique sociale en termes de positions sociales mues par des forces largement indépendantes de la volonté et de la conscience individuelles.
Figure : Espace des positions sociales et espace des styles de vie

Source : Bourdieu P., La Distinction : critique sociale du jugement, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979.
Sous ce jour, Pierre Bourdieu n’induit toutefois jamais que la géométrie sociale telle qu’il la conçoit cherche à décrire le social en voie de changement, celle-ci visant plutôt à représenter le changement afin de pouvoir l’expliquer à la lumière de ce qu’est pour lui l’objet de la sociologie et des concepts requis à cette fin. Dans cette perspective, le social doit être rendu provisoirement amorphe afin de pouvoir le concevoir sous forme d’un objet susceptible d’être manipulé grâce à la théorie fondée sur les concepts et les méthodes utiles pour l’expliquer au sens qu’a ce terme en épistémologie : rendre raison au moyen d’une image d’une autre nature que ce qu’on cherche à connaître.
De ce fait, on s’en doute, Pierre Bourdieu se méfiait des sociologues enclins à affirmer tous azimuts que la « société est en continuelle mutation », qu’elle « change sans cesse » (Carles, 2001) et s’explique par le changement sur la base d’un raisonnement proprement tautologique dont la « théorie » de Bruno Latour offre l’illustration éloquente. En effet, on veut bien admettre que les sociétés évoluent à présent au rythme de flux générateurs de changement, il n’en demeure pas moins que, sous l’optique sociologique, ces flux doivent être représentés afin de pouvoir les expliquer en théorie. Sur ce registre, celui de la théorie, le changement doit forcément être envisagé sous une figure ou une structure « stable » utile pour en connaître les secrets ressorts sans du coup concevoir le social comme « force » ou comme « chose » indépendantes des individus et contraires au changement.
En matière de conclusion

Force est de constater pour conclure que, tout compte fait, la théorie sociologique qu’incarne par exemple Pierre Bourdieu supporte l’épreuve du changement à laquelle doit de nos jours se conformer la sociologie afin de pouvoir rendre raison des sociétés « liquides » continuellement sujettes aux mutations des institutions sociales (comme la religion, la famille ou les classes sociales), aux développements fulgurants de la science et de la technique et à la mobilité des individus, du capital et des savoirs responsables notamment de l’éclatement des États-nations et de l’érosion des frontières et des cultures nationales.
La sociologie supporte l’épreuve du changement du fait que dans le meilleur des cas, elle se manifeste sous la forme d’une théorie capable de la concevoir comme connaissance par objet et par concept susceptible d’expliquer les mutations de la société autrement qu’en se bornant à affirmer que les « sociétés changent sans cesse », mais en cherchant à représenter le changement à l’œuvre en leur sein afin de pouvoir le comprendre par-delà le rythme en vertu duquel la vie sociale évolue de nos jours.
Bibliographie

Bauman Z. (2006), La Vie liquide, Paris, Éditions Jacqueline Chambon.
Bourdieu P. (1997), Méditations pascaliennes, Paris, Éditions du Seuil.
Bourdieu P. (1994), Raisons pratiques, Paris, Éditions du Seuil.
Bourdieu P. (avec Loïc Wacquant) (1992), Réponses, Paris, Éditions du Seuil.
Carles P. (2001), La Sociologie est un sport de combat, Paris, Studio Buena Vista.
Castells M. (2001), La Galaxie Internet, Paris, Éditions Fayard.
Deleuze G. (1968), Différence et répétition, Paris, Presses Universitaires de France. DOI : 10.3917/puf.deleu.2011.01
Descola P. (2011), L’Écologie des autres. L’anthropologie et la question de la nature, Paris, Éditions Quae.
Giddens A. (1994), Les Conséquences de la modernité, Paris, Éditions L’Harmattan.
Granger, G.-G. (1988), Pour la connaissance philosophique, Paris, Éditions Odile Jacob.
Granger G.-G. (1986), « Pour une épistémologie du travail scientifique », dans Hamburger J. (dir.), La Philosophie des sciences aujourd’hui, Paris, Éditions Gauthier-Villars, pp. 111-122.
Granger G.-G. (1967), Pensée formelle et sciences de l’Homme, Paris, Éditions Aubier.
Haraway D. J. (1990), Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, Londres, Routledge, trad. franç. dans Manifeste cyborg, Paris, Éditions Exils, 2007.
Latour B. (2009), Sur la Culture moderne des dieux faitiches, Paris, Éditions La Découverte.
Latour B. (2007), « Une sociologie sans objet ? Remarques sur l’interobjectivité », dans Debary O. & L. Turgeon (dir.), Objets et mémoires, Paris-Québec, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme et Presses de l’Université Laval, pp. 37-57.
Latour B. (2006), Changer de société – Refaire de la sociologie, Paris, Éditions La Découverte.
Latour B. (2004), « Le rappel de la modernité – approches anthropologiques », ethnographiques.org [en ligne], no 6, novembre 2004. URL : http://www.ethnographiques.org/2004/Latour
Latour B. (1991), Nous n’avons jamais été moderne. Essai d’anthropologie symétrique, Paris, Éditions La Découverte. DOI : 10.1016/S1240-1307(97)86232-2
Passeron J.-C. (1993), « Anthropologie et sociologie », Raison présente, no 108, pp. 1-34.
Sassen S. (2006), Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages, Princeton, Princeton University Press.
Touraine A. (2007), Penser autrement, Paris, Éditions Fayard.
Touraine A. (2005), Un nouveau paradigme. Pour comprendre le monde d’aujourd’hui, Paris, Éditions Fayard.
Ury J. (2007), Sociologie des mobilités. Une nouvelle approche pour la sociologie ?, Paris, Éditions Armand Colin.
Ury J. (2005), « Mobilities, Networks and Communities », dans Sales A. & M. Fournier (dir.), Knowledge, Communication & Creativity, Londres, Sage Publications, pp. 67-76.
Référence électronique
Jacques Hamel, « La sociologie doit-elle changer afin de pouvoir étudier les sociétés en continuel changement ? », SociologieS [En ligne], Théories et recherches, mis en ligne le 15 novembre 2012, consulté le 18 octobre 2017. URL : http://sociologies.revues.org/4143
Auteur
Jacques Hamel
Département de sociologie, Université de Montréal, QC., Canada - [email protected]
Articles du même auteur
Everett C. Hughes et la rencontre de deux mondes [Texte intégral] Présentation de la réédition en français de l’ouvrage Rencontre de deux mondes. La crise de l’industrialisation du Canada français. Paru dans SociologieS, Découvertes / Redécouvertes, Everett C. Hughes
Marcel Rioux, sociologue critique [Texte intégral] Paru dans SociologieS, Découvertes / Redécouvertes, Marcel Rioux
De l’utilité de la réflexion sur l’utilité de la sociologie [Texte intégral] Paru dans SociologieS, Débats, La situation actuelle de la sociologie
Dialogue avec Howard Becker : comment parler de la société ? [Texte intégral] Discussion de l’ouvrage de Howard Becker Comment parler de la société ? Artistes, écrivains, chercheurs et représentations sociales, Paris, Éditions La Découverte, 2010
Paru dans SociologieS, Grands résumés, Comment parler de la société ? Artistes, écrivains, chercheurs et représentations sociales
Décrire, comprendre et expliquer [Texte intégral] Réflexions et illustrations en sociologie. Paru dans SociologieS, Théories et recherches
[1] Par parenthèses, du fait qu’aujourd’hui les individus se conçoivent comme sujets capables de déterminer de leur propre chef ce qu’ils sont et ce qu’ils font en raison des processus d’individualisation à l’œuvre dans les sociétés fondées sur la réflexivité qui, chez Anthony Giddens, correspond à la capacité acquise par eux de « penser en termes sociologiques » faisant que les changements associés à la modernité se révèlent à cet égard « profondément et intrinsèquement sociologiques » (Giddens, 1994, p. 49).
|

