[37]
Denise Helly *
Anthropologue, Professeure chercheure titulaire,
Institut national de la recherche scientifique
Centre : Urbanisation, Culture et Société
“La question linguistique
et le statut des allophones
et des anglophones au Québec.”
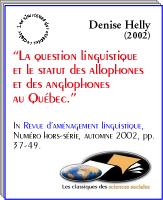 In Revue d’aménagement linguistique, no Hors-série, Automne 2002, pp. 37-49. In Revue d’aménagement linguistique, no Hors-série, Automne 2002, pp. 37-49.
Résumé
La loi 101 visait à franciser la société civile au Québec et non simplement à faire du français la langue des instances publiques et gouvernementales ; elle avait pour but de transformer les rapports entre le français et l’anglais dans les domaines de la langue d’enseignement, des transactions commerciales et des milieux de travail. Cet objectif a été atteint selon les multiples études sur la connaissance et l’usage du français par les anglophones et les allophones de la province, notamment par les nouvelles générations de descendants d’immigrants socialisés au Québec. L’enquête du Conseil de la langue française (Béland, 1999) sur leur usage du français dans les sphères autres que la sphère privée confirme ce constat : 77% des immigrés parlent le français dans la sphère publique.
Les objectifs de la loi 101 impliquaient une double dissociation. Une dissociation entre une culture particulière et l’État, lequel devait se construire comme État des résidents du territoire québécois ; une dissociation entre langue et toute référence culturelle particulière qui impliquait une définition du français comme outil de communication ne se référant à aucune des cultures particulières canadiennes-françaises, passées ou présentes. On ne saurait en effet penser que la société québécoise n’ait secrété qu’une forme culturelle au fil de son histoire et de l’époque contemporaine, et qu’il n’existe qu’une manière d’être Québécois.
_______________________
[38]
Ces dissociations ne semblent pas acquises si Ton considère les débats qui resurgissent périodiquement à propos de la « menace » linguistique immigrée à Montréal, soit les transferts vers l’anglais par les immigrés, le vote « ethnique » sur la question de la souveraineté politique du Québec, et l’usage de leur langue maternelle par les anglophones et les allophones.
De ces trois arguments, le premier est inopérant pour une raison connue et relevant d’une myopie sociologique contrairement à ses prétentions scientifiques. La concentration des populations allophones à Montréal ne peut fonder un constat défavorable à l’évolution démolinguistique dans cette ville quand ne sont pas pris en compte les liens économiques étroits entre les différentes régions de l’aire métropolitaine. Ces liens, en dépit de l’étalement urbain et de la hausse du nombre de francophones dans les banlieues nord et sud, génèrent une forte présence de la main-d’œuvre francophone dans la municipalité de Montréal, fait favorable à l’usage du français dans le monde du travail et dans la sphère publique.
La concentration de l’immigration à Montréal, sur laquelle repose cet argument, tient à des raisons économiques et sociales. L’absence historique de noyau immigré en dehors de Montréal qu’ont produite et reproduisent le non-recrutement d’immigrés dans les administrations publiques de tous niveaux, une faible acceptation sociale des immigrés en région si ce n’est pour obtenir une main-d’œuvre peu coûteuse, des marchés de l’emploi réduits en région, ainsi que des programmes inefficaces de dispersion de l’immigration en dehors de Montréal ne facilitent pas une distribution des immigrés dans l’ensemble du Québec. Les autorités politiques québécoises ont néanmoins admis durant les années 1990 deux faits pouvant faciliter la dispersion de l’immigration et sa francisation : le choix de quelques régions économiquement dynamiques, notamment Québec, Sherbrooke et la Montérégie ainsi que l’implantation de noyaux minimaux de 50 à 100 personnes d’un même groupe ethnoculturel dans chaque zone d’établissement afin de faciliter la vie sociale des nouveaux arrivés.
Aussi, si la concentration de l’immigration à Montréal est considérée par certains comme un fait nocif à la francisation de la société civile québécoise, faut-il débattre des conditions sociales et économiques qui la génèrent plutôt que lancer un anathème sur les immigrés montréalais, ou encore demander une réduction draconienne de l’immigration ou une sélection d’immigrés francophones uniquement. L’immigration est une nécessité démographique et, moindrement, économique, incontournable pour le Québec dans le contexte nord-américain, et les bassins de flux migratoires francophones dans le monde sont plus que limités. On ne peut pas plus souhaiter une solution autoritaire comme limiter le droit de libre circulation des immigrés durant leurs premières années d’installation au Québec, ni insister sur des aspects de la loi 101 sans effets notables sur la francisation de la société provinciale. Toute discussion sur les dérogations à la loi 101 et le millimétrage des panneaux commerciaux est à ce titre futile, et une discussion sur la langue de travail est plus utile et plus difficile vu l’exportation d’une large part de la production québécoise vers des marchés nord-américains et internationaux.
[39]
Ne pas tenir compte des contextes locaux et internationaux de l’immigration et de la francisation au Québec sert un propos : refuser un statut d’égaux aux allophones et anglophones, immigrés et natifs. Ce propos est présent dans les deux autres arguments cités ci-dessus. Considérer un vote contre la souveraineté comme illégitime est antidémocratique et révèle une définition de ce qu’est un Québécois. Quand il est dit que le vote référendaire des allophones et des anglophones est « ethnique », on ne peut que remarquer que les votes fédéraliste et sécessionniste de descendants de Canadiens français ne recueillent jamais cette qualification, comme si la société provinciale était composée d’individus aux origines légitimes et d’autres aux origines impures, à tout jamais étrangères. Le Québec serait donc essentiellement canadien-français.
Quant à l’interprétation de l’usage d’une langue maternelle autre que le français dans la sphère privée [1] comme une indifférence, sinon une hostilité à l’égard non seulement de la primauté du français voulue par la loi 101, mais aussi de la « culture franco-québécoise », elle dénote un non-respect du droit à la vie privée, ignore les fondements sociologiques et psychologiques de cet usage et ostracisé une pratique privée non suivie par le groupe majoritaire. Ce faisant, ce groupe est érigé en seul détenteur de la définition de ce qu’est un Québécois et cette tentative d’imposer une forme culturelle du Québec comme seule réelle et légitime convoie le même propos de refuser un statut d’égal aux personnes d’autres origines. En fait, elle réifie une identification québécoise à des fins politiques. Sur ce point, il faut rappeler que la loi 101 n’avait nullement pour but de faire de la langue parlée à la maison un indicateur d’acceptation de la francophonie au Québec. Par ailleurs, il semblerait que le multilinguisme fonctionnel immigré constituerait un atout culturel et économique à exploiter et à laisser fleurir plutôt qu’à condamner.
Cette volonté de réduire le Québec à l’une de ses expressions culturelles constitue l’écueil principal du débat sur la francisation des dits ethniques. S’identifier comme Québécois peut pourtant prendre des formes différentes.
Il existe en système démocratique plusieurs manières d’être lié à une société ou de développer un sens d’appartenance à l’égard de celle-ci. Schématiquement parlant, quatre principaux types de lien sont possibles et peuvent se combiner le plus souvent :
- a) le lien citoyen, juridico-politique, souvent encore considéré comme le fondement premier du lien collectif en système démocratique moderne. Etre lié à une société signifie dans ce cas participer de l’État, instance de représentation de tous et instance de protection de l’égalité des droits politiques et des libertés de chacun, et chaque État peut être jugé selon les particularités de ses régimes politique, juridique et judiciaire ;
- b) le lien civil ou l’appréciation de la nature des relations sociales et de la qualité de vie au sein d’une société civile [2]. Ces caractéristiques, propres à chaque société, sont en partie codifiées par l’action étatique et législative, mais elles dépendent aussi de [40] situations, d’attitudes et de comportements façonnés par l’histoire de la constitution de la société civile et des rapports en son sein entre les catégories sociales, que celles-ci soient culturelles, linguistiques ou socioéconomiques. Concernant par exemple les minorités immigrées, tous les pays de l’OCDE détiennent une législation antidiscriminatoire, mais le racisme et la xénophobie y montrent une teneur et des expressions fort différentes au sein des sociétés civiles de ces pays [3] ;
- c) le lien étatique ou la valorisation d’un État en raison de ses politiques économique, de l’emploi, scolaire, sociale, fiscale, internationale, culturelle, etc., des politiques elles aussi toujours particulières ;
- d) le lien national au sens conceptuel du terme de nation, soit une communauté d’histoire, de langue et de culture.
Qu’en est-il des formes du lien sociétal au Québec ?
Selon une enquête réalisée auprès de résidents montréalais d’ascendance canadienne-française ou immigrés de six pays différents, les figures suivantes du lien au Québec apparaissent. On peut voir dans le Québec un peuple francophone, culturellement composite, dominé par des intérêts économiques anglo-saxons et assujetti par un État canadien ne le représentant pas, et l’on est attaché à sa libération par la construction d’un État souverain, francophone, plus apte à adopter des politiques soucieuses d’égalité sociale et politique. Les liens citoyen et étatique, comme expressions d’un peuple québécois libre de ses décisions, enracinent dans ce cas un fort sens d’appartenance au Québec. On peut voir dans le Québec un groupe ethnoculturel, canadien-français, propriétaire du territoire de son implantation historique, mais menacé depuis trois siècles par des étrangers de langue et de culture, et souhaiter la constitution d’un État indépendant défendant uniquement les intérêts de ce groupe « originel ». Toute notion d’un peuple souverain, incluant des personnes aux héritages historiques différents et aux cultures diverses est absente de cette conception, comme toute notion de rapports de force économiques à l’échelle nord-américaine et canadienne. Le lien premier est national, le lien étatique québécois à créer devant servir un séparatisme culturel favorable à la nation canadienne-française et transformer la société civile à l’image de celle-ci. Un fort sens d’appartenance à la nation québécoise, en fait canadienne-française, est développé. On peut encore voir dans le Québec une société régionale se particularisant par une cohabitation séculaire d’intérêts anglo-saxons et canadiens-français, une cohabitation souvent conflictuelle mais ayant permis au fil du temps des acquis, tels un système d’auto-gouvernement, le système parlementaire, l’idée de deux peuples fondateurs, des politiques sociales généreuses, l’intégration dans le [41] marché nord-américain et la possibilité d’imposer le français comme langue officielle. Dans ce cas, trois liens se renforcent pour créer là encore un fort sens d’appartenance au Québec, les liens citoyen et étatique à un État fédéral conçu comme bi-national et le lien à une nation canadienne-française partageant son territoire avec des minorités, dont au premier rang une minorité canadienne-anglaise. On peut encore et uniquement voir dans le Québec une société civile aux différences évidentes et plaisantes à vivre, comme un cosmopolitisme pacifique, un libéralisme des mœurs et un bilinguisme fonctionnel utile en un temps de commerce transnational, société civile dotée d’une forte autonomie administrative au sein d’un ensemble pan-canadien qui l’assure de politiques multiculturalistes, sociales et économiques distinctes de celles des États-Unis. On peut aussi développer la même représentation du Québec comme une société civile particulière au Canada et en Amérique du Nord, mais voir dans cette particularité, notamment dans la différence linguistique, un héritage peu utile et à laisser s’éteindre, tout en respectant la loi 101 au nom du principe de la loi de la majorité politique. Dans ces deux derniers cas, le lien premier au Québec est essentiellement civil, les liens étatique et citoyen sont valorisés mais canadiens, et l’on se dit Québécois au titre de la qualité de citoyen canadien. Enfin, on peut considérer tout lien avec le Québec impossible en raison du statut socioéconomique que l’on connaît ou du racisme que l’on subit de la part du groupe blanc majoritaire dans la province (Helly et van Schendel, 2001).
Si l’on excepte la dernière forme selon laquelle toute idée de lien au Québec est illusoire et démagogique, ces formes de lien au Québec admettent, toutes, la légitimité de la loi 101 d’ériger la langue du groupe linguistique majoritaire en langue de tous. Elles admettent, toutes également, la légitimité de la notion de société distincte québécoise, sinon l’avant-dernière qui y voit un fait non significatif. Deux objets de litige principaux les opposent en fait et ce ne sont ni la législation linguistique ni le caractère distinctif de la société québécoise, mais l’avenir de l’espace économique réduit que constitue le Québec, et le partage du pouvoir politique entre groupe majoritaire canadien-français et groupes d’autres origines. C’est à partir de ces deux questions que sont débattues la loi 101 et la question de l’indépendance, et l’abrogation de la loi 101 n’est jamais envisagée dans la mesure où un bilinguisme fonctionnel anglais-français demeure et permet l’accès à des marchés étrangers.
Débattre de la valeur des formes de lien que développent les personnes à la société où elles vivent est une lutte politique attendue en démocratie, au Québec comme ailleurs. Ce n’est qu’une des facettes des conflits sur la hiérarchie sociale et la distribution du pouvoir politique. Cette lutte doit respecter deux principes : le respect de la loi de la majorité politique et des libertés fondamentales, lesquelles incluent en l’occurrence le droit à la vie privée et à des choix culturels personnels, dans la mesure où ce droit ne porte pas atteinte à des droits d’autrui. Vouloir imposer une forme du lien à une société au nom d’une implantation historique et de pratiques culturelles privées d’un groupe majoritaire correspond à un projet exclusionniste et constitue une tentative d’hégémonie culturelle anti-démocratique, de surcroît inopérante, à une époque de controverses sur les droits des groupes minoritaires et de valorisation des connaissances linguistiques dans toute économie d’exportation. Par ailleurs, aucun devoir [42] d’appartenance à une société ne peut être requis ; le droit à l’indifférence en la matière demeure, dans la mesure où sont respectés les deux principes mentionnés ci-dessus.
De plus, la tension inévitable en démocratie entre majorité et minorités, ainsi qu’entre nation et citoyenneté, doit toujours être tenue en compte, et la qualité de citoyen sans cesse distinguée de la qualité de national. Ce dilemme est historique dans les systèmes politiques modernes, et ne peut être ignoré en une période de fortes migrations internationales et de différenciation des valeurs et des comportements individuels. Aussi toute affirmation de la possibilité d’un choix politique définitif entre une définition ethnique ou civique de la nation est-elle irréaliste et contre-productive. Elle ignore la dynamique, sociologique et idéologique, propre à une société démocratique moderne ; elle participe de l’idée illusoire d’un discours et d’une décision politiques justes et équitables à tout jamais, comme si un idéal démocratique existait en dehors de ses manifestations concrètes et des revendications qu’il génère, et comme si la nécessité incessante de contrecarrer toute forme de domination politique, culturelle, économique pouvait être annulée. Elle ignore que le conflit de pouvoir est constitutif d’une société démocratique et que les luttes sociales modèlent une société.
L’État moderne se caractérise depuis sa fondation par une tension inhérente entre un fondement culturel, particulier, et un fondement universaliste, et l’idée de similitudes d’expérience (institutions, nation, religion, langue) des membres d’une société constitue un complément de sa définition vu l’abstraction de l’identité politique qu’il crée, et vu sa formation sur un territoire particulier (Freitag, 1981 ; Schnapper, 1994 ; Harp, 1998 ; Bourque, Duchastel et Pineault, 1999). L’État moderne exerce toujours sa souveraineté en intégrant la population d’un territoire donné et en s’affirmant comme « sujet historique dans un ordre mondial fondé sur des relations entre nations-unités politiques » (Schnapper, 1994 : 28), fait qu’il doit expliquer faute de fondements a-historiques, religieux par exemple, ou pouvant relever de la violence pure. Il doit toujours créer un discours sur son inscription dans ce territoire et sur les raisons du rassemblement de la population qui participe à l’espace affirmé commun. L’État moderne est fortement aidé dans cette œuvre par un processus décrit par Gellner (1983). Le mode d’implantation particulier du capitalisme et de l’État dans chaque pays expose les personnes à une relative similitude de socialisation et d’expérience, et produit l’idée d’appartenance à une entité territorialisée, une société étatisée distincte.
Ces trois réalités, l’idée de communalité territoriale et sociétale, la contrainte pour un État moderne de s’inscrire sur la scène internationale comme entité aux intérêts propres et l’institution de politiques publiques toujours particulières en raison des héritages sociaux et politiques de chaque pays se trouvent en tension constante avec le principe de rationalité abstraite de l’État et son idée régulatrice à visée universelle. Les idées de citoyenneté, de territoire, de communalité et de particularité sociétales en deviennent liées et la question fondamentale est dès lors : « Comment préserver l’universalisme en reconnaissant la légitimité d’une solidarité propre aux citoyens partageant un même espace public et un même imaginaire commun en évitant que le nous ne dégénère en un renfermement ethnique ? », comme écrit Birnbaum (1997 : 33). En d’autres termes, comment éviter que le lien à une nation recouvre les autres formes possibles de communalité créées par l’expérience présente de vivre au sein d’une même société [43] et/ou sous l’égide d’un même État ? Le lien national met en avant l’idée d’une communalité restreinte, soit une expérience historique se traduisant par le partage d’une généalogie, de qualités personnelles, d’usages, d’une langue, de héros, de productions savantes et populaires, d’institutions et, dans certains cas, d’un territoire [4]. Et c’est dans ces derniers cas que le risque de recouvrement de la société est le plus aigu.
Toute opposition nette et absolue entre nation ethnique et nation civique ne permet pas de répondre à la question de Birnbaum. La distinction entre nationalismes dits civiques, jugés positivement, français, britannique, néerlandais, grec, suisse, canadien, américain, et nationalismes dits romantiques et ethnoculturels, asiatiques, allemand et d’États de l’Europe centrale et de l’Est (Seton-Watson, 1965 ; Kohn, 1944 ; Brubaker, 1989 ; Ignatieff, 1994) est sociologiquement non fondée. La réelle distinction entre ces nationalismes est une distinction entre régimes démocratiques et régimes autoritaires.
La réponse à la question soulevée par Birnbaum implique au premier chef une analyse sociologique des interprétations de la communalité sociétale selon le système politique, l’époque et les rapports de force à l’œuvre au sein de chaque société. Il faut examiner comment tout discours parlant de communalité transforme ces rapports de force et génère éventuellement une ou plusieurs formes nouvelles de domination ou en annule d’autres existantes.
Dans le cas des discours nationalistes passés, nombre d’historiens, dont Hroch (1985, 1995), ont montré comment au XIXe siècle des membres de leur profession et des écrivains ont expliqué et rehaussé l’image d’une communalité linguistique pour appuyer la création d’États indépendants en Europe centrale. Des minorités accédèrent à la souveraineté politique, d’autres furent délivrées de la tutelle impériale mais devinrent assujetties aux premières. Des historiens ont également montré comment, durant la première moitié du XIXe siècle, les bureaucraties d’État en Europe occidentale ont superposé culture, ethnie et État moderne, certes selon des formes différentes, et promu une équivalence entre institutions publiques, intérêts nationaux et territoire au nom d’impératifs économiques, puis divulgué, à partir des années 1860-1870, une équivalence entre des qualités individuelles [5], une langue, une histoire séculaire, des liens du sang et un territoire (Hobsbawm, 1983, 1990 [6]), au nom cette fois d’impératifs économiques et militaires. Une équivalence qu’à leur tour des écrivains et des historiens [44] ont romancée (Agulhon, 1989 ; Nora, 1992 ; Colley, 1992 ; Thiesse, 1999) et que servit la généralisation des institutions scolaires publiques (Green, 1990 ; Harp, 1998 ; Heathorn, 2000). Citoyenneté et nationalité en devinrent à l’époque nettement superposées ; un bon citoyen fut défini comme un national patriote et les « grands nationalismes [7] » fleurirent.
Cette évolution historique n’a rien d’inéluctable et permet un premier constat, empirique et de simple réalisme politique. Les « grands nationalismes » des années 1870-1914 purent s’affirmer grâce à la multiplication des classes moyennes générée par l’urbanisation et une mobilité sociale les servant, et grâce à la concession de droits sociaux et politiques aux « classes populaires » (droit de vote universel aux hommes et leur intégration à la vie politique, accès à la scolarisation et à une mobilité sociale, premières formes de protection au travail et sociale, droits syndicaux, hausse des revenus). Ce ralliement de la majorité des populations leur permit de réprimer les résistances et contestations régionales, linguistiques, religieuses et politiques que suscitèrent l’expansion du capitalisme à la fin du siècle dernier et l’affirmation de patriotismes nationaux guerriers de 1870 à 1914.
Par contre, toute idéologie prétendant superposer société et nation, ou encore État et nation, est actuellement condamnée à générer force conflits. Les revendications noires et féministes à partir des années 1940, nationalitaires et ethniques à partir des années 1960, ont démontré les effets inégalitaires produits par toute philosophie politique affirmant l’égalité de tous et ignorant les dynamiques sociales engendrées par le racisme, le sexisme et l’ethnocentrisme. Elles ont révélé que les inégalités créées par ces dynamiques avaient un caractère systémique, non aléatoire, s’inscrivaient dans la structure des occupations et des postes politiques et ne paraissaient pas devoir s’effacer au fil d’une évolution positive des mentalités. Elles n’ont cependant que peu souvent mis en cause les effets de l’affirmation d’une communalité sociétale ancrée dans une histoire et une culture nationales. Ce fut à partir des années 1980 que le droit d’exprimer sans préjudice social des héritages et orientations culturels minoritaires devint partie intégrante du paysage politique occidental. La nature discriminatoire de tout discours prétendant imposer une définition du national fut désormais dénoncée et ses effets, un accès limité, sinon nul, des non-nationaux à des emplois et au corps des élus, un déni de reconnaissance comme membres à part entière de la nation, une érosion de leurs langues et cultures et leur effacement ou statut second dans la narration historique, furent mis au jour. Dès lors, un discours national toujours producteur d’exclusions sociales, économiques et politiques, vu ses fondements ethnocentriques, ne peut que s’attirer des répliques cinglantes. Une transformation sociopolitique est survenue.
Ce constat empirique a des fondements sociologiques.
Les expériences communes aux membres d’une société, socialisation par l’école, usage d’une ou de plusieurs langues majoritaires, modes de relation avec les services publics et les institutions politiques, exposition aux médias, aux politiques publiques et à un [45] environnement physique, ne créent jamais une totale homogénéisation culturelle. Différence de places et de statuts sociaux au premier chef, mais aussi différence de trajectoires personnelles interviennent et il ne se crée pas pour tous un sens de communalité nationale ou sociétale mais, quand ce sens est présent, il peut s’ancrer différemment, comme l’illustre à sa faible échelle l’enquête citée ci-dessus.
L’idée de culture dominante et de ses limites rend en partie compte de cette dynamique. Selon Williams (1973, 1980), une culture dominante est l’ensemble des interprétations, rarement explicitées et plutôt tenues pour acquises, qui régissent les relations quotidiennes entre les personnes dans les principaux aspects de leur vie sociale. Néanmoins, cette culture n’est jamais hégémonique, car les rapports de pouvoir qu’elle crée révèlent toujours des contradictions entre les préceptes idéaux et la réalité sociale. D’autres interprétations de cette réalité en sont créées, qui contestent la légitimité de toute culture dominante (Roseberry, 1989 ; Thomas, 1994) et ouvrent un espace au conflit. Dans un système moderne, les idées d’égalité et de libertés fondamentales sont les représentations qui créent un tel espace (Rancière, 1981,1995 ; Scott, 1985 [8]). Depuis la fondation des démocraties, l’égalité des droits a été l’objet de contestations portant entre autres sur l’accès au vote des hommes non propriétaires et des femmes, la liberté d’expression, des conditions de travail et de rémunération décentes, et une protection sociale étatique.
En sus, les marges de contestation ouvertes permettent des formes multiples de mise en cause de la hiérarchie sociale et des préceptes démocratiques. Il peut, par exemple, exister plusieurs majorités culturelles [9] au sein d’une société, chacune ancrée à un référent propre (culture historique, langue, religion, orientation sexuelle, genre, race, origine nationale) et autant d’interprétations des conditions de l’inégalité en découlent.
Ce faisant, deux conclusions s’imposent, encore plus évidentes depuis un demi-siècle.
Tout d’abord, comme l’a écrit Berlin (1959) il y a effectivement presque un demi-siècle, le désaccord au sujet de normes communes au sein de chaque société et d’une forme primordiale à celle-ci est constant et inéluctable ; il est impossible de définir de la même manière ce qui est commun et bon pour vivre dans une société donnée. L’idéologie politique moderne tente de résoudre ce dilemme par les idées d’universalisme des droits et de tolérance, mais elle ne peut éviter les conflits incessants que soulève l’application concrète de ces idées. Aussi, les définitions du lien à une société et le droit à la dissidence, qu’elle soit politique ou culturelle, sont-ils à négocier sans cesse et au cas par cas.
Ensuite, pour qu’une forme de lien s’affirme, il faut soit que les forces de contestation des inégalités soient annihilées ou tenues en compte par des négociations, soit que les rapports de domination fassent consensus. Le lien citoyen dont le caractère universaliste est si souvent mis en avant, n’a en fait jamais cessé d’être contesté (Rancière, 1981 ; Okin, 1979 ; Pateman, 1988 ; Young, 1989, 1990, 2000) et redéfini dans [46] l’histoire, passée et récente (Helly, 1999, 2000) des sociétés modernes. À l’inverse, toute définition du droit à l’établissement dans une société est ancrée dans le déni d’un droit, la libre circulation à l’échelle internationale, qui se perpétue en raison d’un large consensus des citoyens. L’admission de réfugiés a souvent illustré ce fait et l’illustre encore.
Comme toute autre forme de culture qui se veut ou est dominante, le lien national est partial et inégalitaire quand il tente de s’imposer ou réussit à s’imposer comme seul lien sociétal légitime. Ce type de lien n’est, en effet, qu’une interprétation de l’histoire et du présent, une « sélection de traditions » (Williams, 1961 : 50-59), et il convoie une hostilité à l’égard des déviances refusant le conformisme qu’il érige en norme. Par son irrespect de deux postulats normatifs modernes, l’égalité des droits et l’égalité des chances, quand bien même correspondrait-il à la loi de la majorité politique, il suppose des mesures d’exclusion pour assurer la suprématie de sa définition du lien à une société. Il ne laisse guère d’espace à des négociations avec les groupes ethnoculturels ne relevant pas de sa tradition et il rend aussi totalement factice la neutralité culturelle de l’État moderne, déjà fort instable (Young, 1990 ; Kymlicka, 1995). Aussi l’idée de son imposition à l’échelle d’une société ne peut-elle être portée que par des courants peu enclins à respecter et encore moins à élargir les acquis démocratiques. On peut dès lors comprendre pourquoi les historiens attachés aux notions de nationalismes ethnique et civique n’ont en fait parlé que de régimes autoritaires et de régimes plus démocratiques et pourquoi ce sont des mouvements conservateurs et souvent de droite ou d’extrême-droite qui portent le discours national.
Si ces constats empirique et sociologique délégitiment l’idée de lien national en montrant sa dynamique exclusionniste, ils ne sauraient en réduire le droit d’expression sur la scène publique. Les débats sur la forme du lien à une société sont, avons-nous dit, inévitables et constitutifs d’un régime démocratique vu l’abstraction et le formalisme du principe citoyen et des postulats libertaires et égalitaires. La question est donc de toujours s’assurer que cette idée, comme toute autre idée de la communalité sociétale se voulant hégémonique, ne vienne envahir la scène publique et servir les propos de certaines catégories sociales, par ailleurs légitimes s’ils donnaient lieu à des formes plus égalitaires de définition du lien sociétal pour atteindre leurs objectifs, que ceux-ci soient l’obtention d’une mobilité sociale, l’accès au pouvoir politique ou, au contraire, la tentative d’endiguer une descension sociale ou politique.
Des enquêtes illustrent cependant un fait actuel. Le sens de communalité sociétale demeure prégnant dans de larges fractions des populations occidentales et il s’enracine moins dans des expériences culturelles et historiques dites communes que dans des intérêts très spécifiques. Ces enquêtes montrent (Perrineau, 1994 ; Mayer, 1997 ; Duchesne, 1997 ; Bréchon et coll., 2000 ; Helly et van Schendel, 2001) combien l’attachement à une société est sous-tendu par l’image de spécificités culturelles et historiques (qualités d’une population établie de longue date sur un territoire, patrimoines savant et populaire), mais fait de plus en plus place à l’invocation de spécificités autres, telles que les politiques sociales, culturelles et économiques d’un État, le régime politique et la place d’un pays sur la scène internationale. Le lien étatique apparaît désormais plus fort que le lien national dans le contexte de la mondialisation [47] financière et économique, de la multiplication des instances de régulation internationale et de la prépondérance américaine. Il reste à observer comment cette valorisation du lien étatique, qui semblerait devenir une représentation majoritaire, peut servir les préceptes égalitaires et libertaires, générer des antagonismes nouveaux et exiger de nouvelles transformations sociales, locales ou internationales. Des formes de la contestation contre la mondialisation attestent de ces nouveaux enjeux et espaces de conflit.
Quel intérêt ont ces quelques réflexions pour le débat sur le statut des allophones au Québec ? Elles montrent qu’une société est construite par des rapports de pouvoir et comprend toujours de ce fait plusieurs définitions du lien sociétal, sans cesse en conflit entre elles. Un conflit qu’on doit tenter de résoudre par des avancées démocratiques et égalitaires, qui, certes, créeront elles-mêmes le plus souvent de nouveaux conflits. L’égalité est un précepte, non une réalité atteignable une fois pour toutes, comme si l’histoire avait une fin et comme si la philosophie politique pouvait trouver une solution définitive. Elles montrent aussi combien il est utile de préciser les termes ou concepts pour clarifier les enjeux et les dynamiques sociales et parler de « peuple » comme collectivité politique souveraine au fondement d’un État, de « nation » comme collectivité de mémoire et d’histoire dites communes, et de « société » comme structure des rapports sociaux, organisation des relations sociales et variance d’interprétations de l’ordre social. La notion de « nation civique » joue à superposer démocratie et nation sans voir et résoudre la tension entre les deux. De plus, la précision du vocabulaire introduit une autre clarté dans le débat nationaliste au Québec dont fait partie intégrante le débat sur les dits allophones. L’indépendance québécoise vise-t-elle la conquête du pouvoir politique en vue de disposer de tout levier décisionnel et de poser des questions centrales à toute société actuelle : redistribution, inégalités sociales, environnement, équité, participation démocratique élargie, réduction d’un pouvoir trop centralisé ? Vise-t-elle le sauvetage ou la délivrance d’une nation linguistique et culturelle opprimée depuis des lustres et menacée par l’anglais international et des chevaux de Troie que seraient les immigrés et leurs descendants, les Canadiens anglais de la province, les Canadiens français fédéralistes ? Et dans ce cas que reste-t-il de la nation ?
Références
AGULHON, M. (1989). Marianne au pouvoir. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1880 à 1914, Paris, Flammarion.
BÉLAND, Paul (1999). Le français, langue d’usage public au Québec en 1997, Québec, Conseil de la langue française.
Berlin, Isaïah (1959/1992). Le Bois tordu de l’humanité, Paris, Albin Michel.
BIRNBAUM, Pierre (1997). « Introduction : Dimensions du nationalisme », dans : P. Birnbaum (dir). Sociologie des nationalismes, Paris, PUF, p. 37-54.
Bourque, Gilles, Jules DUCHASTEL et Éric PINEAULT (1999). « L’incorporation de la citoyenneté », dans : Sociologie et Sociétés, vol. XXXI, n° 2, p. 41-64.
BRÉCHON, Pierre, Annie LAURENT et Pascal PERRINEAU (2000) (dirs). Les cultures politiques des Français, Paris, Presses de Science Po.
[48]
BRUBAKER, W.R. (1989) (dir.). Immigration and the Politics of Citizenship in Europe and North America, Lanham, German Marshall Fund of the United States and the University Press of America.
CARR, Edward Hallett (1945). Nationalism and After, Londres, MacMillan.
COLLEY, Linda (1992). Britons : Forging the Nation, 1707-1837, New Haven, Conn., Yale University Press.
DUCHESNE, Sophie (1997). Citoyenneté à la française, Paris, Presses de Sciences Po.
FREITAG, Michel (1981). « Théorie marxiste et réalité nationale. Autopsie d’un malentendu », dans : Pluriel, n° 26.
GELLNER, Ernest (1983). Nations and Nationalism, Oxford, Blackwell.
Green, Andy (1990). Education and State Formation. The Rise of Education Systems in England, France and the U.S.A., Londres, St Martin’s Press.
Harp, Stephen L. (1998). Learning to be Loyal : Primary Schooling as Nation Building in Alsace and Lorraine, 1850-1940, DeKalb, Northern Illinois University Press.
HEATHORN, Stephen (2000). For Home, Country, and Race. Constructing Gender, Class, and Englishness in the Elementary School, 1880-1914, Toronto, University of Toronto Press.
Helly, Denise (1997). « Les transformations de l’idée de nation », dans : Gérard Bouchard et Yvan Lamonde (dirs), La nation dans tous ses états, Paris, L’Harmattan, p. 311-336.
HELLY, Denise (1999). « Une injonction : Appartenir, participer. Le retour de la cohésion sociale et du citoyen », dans : Lien social et politiques, n° 41, p. 35-46.
HELLY, Denise (2000). « La nouvelle citoyenneté, active et responsable », dans : Yves Boisvert, Jacques Hamel et Marc Molgat (dirs). Vivre la citoyenneté. Identité, appartenance et participation, Montréal, Liber, p. 119-134.
HELLY, Denise (2002). « Minorités ethniques et nationales : les débats sur le pluralisme culturel », dans : L’Année sociologique, vol. 52, n° 1, p. 147-181.
Helly, Denise et Nicolas VAN Schendel (2001). Appartenir au Québec. Citoyenneté, nation et société civile. Enquête à Montréal, 1995, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval/Les éditions de l’IQRC, coll. « Culture et société ».
HOBSBAWM, Eric J. (1983). « Mass producing traditions : Europe, 1870-1914 », dans : Eric Hobsbawm et Terence Ranger (dirs). Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, p. 263-307.
HOBSBAWM, Eric J. (1990). Nations and Nationalism Since 1780. Program, Myth, Reality, Cambridge, Cambridge University Press.
Hroch, Miroslav (1985). The Social Preconditions of National Ravivai in Europe : A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups Among the Smaller European Nations, New York, Cambridge University Press.
HROCH, Miroslav (1995). « De l’ethnicité à la nation. Un chemin oublié vers la modernité », dans : Anthropologie et sociétés, vol. 19, n° 3, p. 71-86.
IGNATIEFF, Michael (1994). Blood and Belonging. Journeys into the New Nationalism, Londres, Vintage.
Kohn, Hans (1945/1967), The Idea of Nationalism. A Study in its Origins and Background, New York, Macmillan Co., 735 p.
Kymlicka, Will (1995). Multicultural Citiqenship : A Liberal Theory of Minority Groups, Oxford, Clarendon Press.
Mayer, Nonna (1997). « Le sentiment national en France », dans : Pierre Birnbaum (dir.). Sociologie des nationalismes, Paris, PUF, p. 273-294.
[49]
Nora, Pierre (1992) (dir.). Les Lieux de mémoire. Les Frances (3 tomes), Paris, Gallimard, tome 3.
Okin, Susan (1979). Women in Western Political Thought, Princeton, N. J., Princeton University Press.
PATEMAN, Carole (1988). The Sexual Contract. Stanford, University of California Press.
PERRINEAU, Pascal (1994) (dir.). L'engagement politique : déclin ou mutation ?, Paris, Presses de Sciences Po.
RANCIÈRE, Jacques (1981). La Nuit des prolétaires, Paris, Fayard.
RANCIÈRE, Jacques (1995J. La Mésentente. Philosophie et politique, Paris, Galilée.
ROSEBERRY, William (1989). Anthropologies and Histories. Essays in Culture, History and Political Economy, New Brunswick, N. J., Rutgers University Press.
SAÏD, Edward (1978). Orientalism, New York, Panthéon.
SCHNAPPER, Dominique (1994). La communauté des citoyens, Paris, Gallimard.
SCOTT, James C. (1985). Weapons of the Weak : Everyday Forms of Peasant Resistance, New Haven, Yale University Press.
SETON-WATSON, Hugh (1965). Nationalism : Old and New, Sydney, Sydney University Press.
THIESSE, Anne-Marie (1999J. La Création des identités nationales. Europe XVIII-XXe siècle, Paris, Le Seuil.
THOMAS, Nicholas (1994). Colonialism’s Culture : Anthropology, Travel, and Government, Princeton, Princeton University Press.
WILLIAMS, Raymond (1961). The Long Revolution, New York, Columbia University Press.
WILLIAMS, Raymond (1973). The Country and the City, Londres, Chatto and Windus.
WILLIAMS, Raymond (1980). Problems in Materialism and Culture : Selected Essays, Londres, Verso.
YOUNG, Marion Iris (1989). « Polity and Group Différence : A Critique of the Ideal of Universal Citizenship », dans : Ethics, janvier, p. 250-274.
YOUNG, Marion Iris (1990). Justice and the Politics of Difference, Princeton, N. J., Princeton University Press.
YOUNG, Marion Iris (2000). Inclusion and Democracy, Oxford, Oxford University Press.
* Denise Helly est professeure titulaire à l’Institut national de recherche scientifique. Centre Urbanisation, culture et société, à Montréal.
[1] Au recensement de 1996, environ 50% des immigrés parlaient leur langue maternelle à la maison.
[2] Ce fondement du lien collectif n’est guère abordé par les sociologues ou politologues, alors qu’il est de plus en plus déterminant vu l’importance accordée par les personnes au mode de vie, aux relations sociales, aux processus identitaires et à la qualité de vie.
[3] Exemples de traits composant le lien civil au sein de la société montréalaise d’après des personnes d’origine canadienne-française et immigrées (Helly et van Schendel, 2001) : faible fréquence d’actes discriminatoires ou offensants à l’égard des minorités (femmes, immigrés, minorités culturelles et religieuses), respect réel de la liberté d’action individuelle et des droits de chacun, inégalités sociales point trop accentuées bien qu’en croissance, faible ségrégation sociorésidentielle et absence de ghettos économiques ou ethniques, bilinguisme, présence de multiples cultures et de produits culturels étrangers, libéralisme des mœurs, qualité de vie matérielle (environnement peu pollué, vert, et coût raisonnable de rimmobilier), tissu urbain unique en Amérique du Nord juxtaposant à une distance proche un centre-ville dynamique et des quartiers résidentiels.
[4] Nombre de nations sont dispersées territorialement.
[5] Plusieurs facteurs jouèrent leur rôle dans cette idéologie des qualités particulières nationales : l’urbanisation et l’industrialisation qui s’accéléraient et provoquaient des craintes de désordres sociaux et de « dégénération sociale », idée centrale au XIXe siècle ; la divulgation du darwinisme social qui présentait la supériorité de certains individus et groupes comme la raison de leur permanence et de leur influence ; la supériorité économique et militaire de l’Allemagne expliquée à l’époque par deux faits : des traits propres aux Allemands et la scolarisation des classes laborieuses.
[6] Résumé de cette évolution et des évolutions ultérieures (Helly, 1997). La notion moderne de nation est inventée au XVIIe siècle par les partisans d’une démocratisation du système monarchique britannique. Elle signifie l’ensemble des personnes tout autant aptes à une décision politique que le roi, en fait, à l’époque, les aristocrates anglais. Par la suite, la Révolution française parle de nation universelle au sens de peuple souverain et jamais de nation culturelle. Puis, selon les intérêts des grandes puissances de l’heure et leurs opposants et alliés, le terme de nation prend une coloration linguistique (Principe des Nationalités, 1830), économiste (A. Smith et ses suivants) et historico-culturelle (Empires russe, austro-hongrois, japonais), pour perdre son aura et son attrait à la suite de la Deuxième Guerre mondiale.
[7] Expression créée pour les opposer aux nationalismes minoritaires, objets de débats actuels sur la valeur du nationalisme (Helly, 2002).
[8] Said (1978) fait la même démonstration à propos des idéologies coloniales occidentales.
[9] Le terme majorité culturelle ou charter group est plus souvent utilisé que culture dominante pour rendre évidente l’existence de plusieurs formes de domination culturelle au sein d’une société.
|

