|
Yannick Jaffré
“La description en actes.
Que décrit-on, comment, pour qui ?”
Un texte publié dans Pratiques de la description, Enquête 3, pp. 55-73. Paris : Éditions de l’EHESS, 2003.
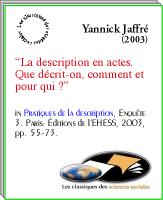 Introduction Introduction
-
- Ce qui est décrit
-
- Décrire des objets
Décrire des conduites et des relations
- Décrire des rites
- Décrire des sentiments
-
- “Ce qui”, mais aussi “pour qui” on décrit
- La description comme éthique ?
Introduction

Dans son acception la plus courante, l’activité de description est présentée comme consistant à établir un rapport direct avec le monde. Décrire, c’est dire les choses telles qu’elles sont, en se gardant bien “d’en rajouter” avec ses propres idées ou ses sentiments. Ainsi envisagée, cette activité s’oppose à d’autres, plus “subjectives”, et supposées plus complexes, comme imaginer ou interpréter. Pour ne prendre qu’un exemple banal, la progression pédagogique des rédactions scolaires témoigne de cette conception d’une graduation, allant du “vu” au “ressenti”. Aux premiers sujets demandant aux enfants de “décrire une scène”, succèdent ceux, supposés plus difficiles, consistant “à commenter un événement, ou à évoquer ses sentiments”. Mais, en fait, dès le début tout est compliqué, puisque pour cette bonne cause, on se surprend à décrire des situations imaginaires, à “croquer” des défauts, accentuant le trait pour caricaturer des personnages parfois fictifs ; ou en toute bonne foi, à argumenter ses erreurs. Bref, on découvre que l’on dépeint des référents qui ne sont pas forcément des “choses”, et à l’innocence première, où décrire correspondait à rester quasiment sidéré et bouche bée face à un réel qu’il suffisait de dupliquer par des mots, succède les affres des rapports liant un sujet, ses signes, et le monde.
Entre ces trois termes, les pièges ne manquent pas. Ils vont des ruses qu’utilisent les mots, pour leurrer le lecteur en créant des effets de réel, laissant croire “que le discours est en lui-même parfaitement transparent, autant dire inexistant, et que nous avons affaire à du vécu brut” [1] ; jusqu’à la multiplicité des manières de décrire et de percevoir un objet. Ainsi que le souligne Austin : “Lorsqu’on voit quelque chose, il peut non seulement y avoir différentes façons de dire ce qu’on voit, mais la chose peut être aussi vue de différentes façons, être vue diversement” [2]. Entre le signe et le référent les relations sont donc ambiguës et suspectes, et l’on se surprend parfois, à regretter d’être passé de la lecture des livres enfantins, aux quelques pages cartonnées, comme “J’aime les animaux dans le pré”[3], où - paradis de l’enfance - chaque chose est à une place, garantie par la redondance du texte et de l’image, à l’enfer de l’interprétation infinie de “Ceci n’est pas une pipe”[4], qui pourtant en est une, mais cependant…
Le domaine anthropologique n’est pas épargné par cette suspicion. Pour ce qui concerne le recueil des informations, il est maintenant acquis, que les assertions proposées par nos interlocuteurs ne peuvent être traitées comme de simples contenus objectifs, mais doivent être rapportées aux positions et possibilités d’énonciation des acteurs. Plus encore, sous l’apparente scientificité des travaux ethnographiques, sont débusquées les traces d’une rhétorique de la persuasion ayant pour but de produire, de la “vraisemblance [5]”, à défaut de vérité. Une nouvelle fois, une volonté d’objectivité, cette fois spécifique aux recherches en sciences sociales, est donc contrariée par l’impossibilité d’échapper au langage et aux dimensions subjectives de l’observation : “toutes les descriptions ethnographiques sont artisanales, ce sont des descriptions du descripteur, pas celles du décrit.” (ibid.). Autrement dit, le monde ne parle pas tout seul, il faut, pour en tirer quelque enseignement, lui porter prudemment attention.
Pourtant, face au réel qui se dérobe, les esquives sont nombreuses. Les littéraires, vont du mime déictique des pièces de Ponge, aux gloses allusives de Leiris, jusqu’au clavier bien tempéré des exercices de style de Queneau. Les premiers tentent d’enserrer le réel dans le style, le dernier fait vaciller l’objectivité d’une description, sous la succession d’une multitude de points de vue. A l’opposé, et pour tenter de boucler cette épineuse question, disons que le discours des sciences “dures”, requiert d’autres procédures, mais que sous diverses formes, elles consistent globalement, à coups de tables de hasard, ou de protocoles “en double aveugle”, à réduire la fonction de l’expérimentateur au rôle d’un simple déclencheur d’opérations qu’il est supposé, dès lors, se borner à observer.
Tout cela est bien complexe, et à l’issue de cette brève présentation, nous voici, avouons-le, “gros Jean comme devant” ; confrontés à une activité cognitive qui semble impossible, mais que chacun réalise cependant quotidiennement ; confrontés aussi à un de ces discrets bégaiements de l’histoire des idées, puisque déjà, en ses Essais (II XII), le soulignait Montaigne, “la plupart des occasions de trouble du monde sont grammairiennes”.
Mais faisons le point. Nul, y compris l’anthropologue, n’a un accès direct - non médiatisé par des mots et des contextes - au réel. Cependant, le chercheur qui se réclame des sciences sociales a une manière particulière de décrire ce qu’il observe. Certes, il ne peut espérer produire un discours identique à son référent. Par contre il tente d’instaurer, pour un lecteur, entre les choses observées et ce qu’il en dit, un certain rapport de similitude [6], que l’on peut tenter de qualifier. C’est pourquoi, plutôt que de recenser les multiples apories qui minent tout travail ayant comme projet de rendre compte du réel, il nous a semblé judicieux de prendre au plus court.
Tout d’abord, grâce à quelques textes, constituant plus un aperçu des difficultés qu’un impossible corpus exhaustif, nous nous interrogerons sur ce qui se pratique, et est habituellement rangé sous la rubrique des descriptions. Quels sont, à défaut de strictes règles, les “tours de mains” qu’utilisent des chercheurs pour construire des rapports d’homologie entre ce qui est observé et son commentaire. Chemin faisant, les thèmes d’observation étant divers, nous tenterons aussi de comprendre en quoi ce que l’on décrit, influe sur la forme et la complexité du travail anthropologique. Pour le dire plus précisément, nous étudierons, bien trivialement - ou classiquement ? -, comment certains ont décrit des objets, des conduites relationnelles, des rites, et enfin des sensations et des sentiments. Enfin, dans un second temps, nous tenterons de mettre en lumière quelques discrets agencements susceptibles d’expliquer le choix des modes descriptifs utilisés.
Ce qui est décrit
Décrire des objets

Au plus simple de l’observation anthropologique des objets se trouvent des guides [7], sortes de “check list de l’altérité”, que nous utilisons parfois pour ne pas oublier de voir. Les uns sont généraux et proposent de multiples entrées allant de l’anatomie à des questionnaires linguistiques [8]. D’autres, thématiques, envisagent, par exemple, les pratiques alimentaires[9], distinguant le quotidien du cérémoniel, s’attachant à préciser les modes de cuisson, de conservation, l’identité des commensaux, etc. Enfin, certains de ces manuels engagent à poursuivre la simple observation par des questions portant sur les besoins résolus par l’usage d’un objet ou d’une technique spécifique.
En amont donc ces utiles pense-bêtes ; en aval, divers textes d’anthropologues faisant état des observations qu’ils ont faites lors de leurs enquêtes.
Un premier ensemble de travaux, appartenant notamment au domaine de l’archéologie [10], tente de “s’en tenir au fait” et d’établir un rapport non narratif à l’objet. Deux procédures complémentaires sont pour cela requises. La première consiste à isoler l’objet, à le, mais aussi à se déprendre de ses éventuelles connotations sociales et esthétiques. Strictement, à l’objectiver. La seconde opération revient à définir les “choses” recueillies, selon leurs formes et leurs compositions matérielles, usant pour cela d’un vocabulaire dont la précision et la fixité permettent des les distinguer ou de les regrouper en fonction des variations observées.
Un second ensemble de textes, tente, au contraire des premiers, de situer ces divers témoignages matériels dans leur contexte social. Quelques exemples soustraient d’un ouvrage fort bien documenté portant sur une population du centre du Tchad [11], se prêtent à la mesure des difficultés rencontrées ; et si dans sa préface, l’auteur souhaite au lecteur de “découvrir comment le monde de l’autre le conduit jusqu’à lui-même”, ce voyage n’est pas sans détours.
Le principal est linguistique. En effet, et pour ne prendre qu’une illustration simple, ce qui dans nos guides se nommait “toit” est, après enquête, remplacé, sous la plume du chercheur par des termes, signifiant en langue Kùlààl, “tête ou poitrine de la maison”. Bref, par ce premier écart descriptif, ce qui était inscrit dans la langue de l’ethnographe est maintenant noté dans celle de ses interlocuteurs. La description ostensive est devenue une nomination du point de vue de l’autre. Mais il ne s’agit cependant pas d’une simple traduction : “nommer n’est pas seulement indiquer ; c’est identifier un objet comme appartenant à une espèce d’objet. Un acte d’identification implique que la chose dont on parle soit située dans une catégorie” [12]. Autrement dit, ces objets, autrement qualifiés par des termes vernaculaires, deviennent autonomes du questionnement initial, et échappent ainsi à leur monosémique première indexation, pour s’ouvrir à d’autres catégorisations et séries sémantiques [13]. Les noms accordés par les populations autochtones à leurs lieux d’habitation, permettent alors de comprendre les raisons de leurs choix, pour définir des aires d’activités ou orienter les corps selon l’âge et le sexe, durant le sommeil. Ces mises en relation, ne se limitent bien évidemment pas à ces aspects symboliques, et d’autres pistes restent ouvertes. Qu’il nous suffise, à propos de ce même exemple, de suggérer de possibles liens avec l’identité des bâtisseurs (sexuation des pratiques, existence ou non de castes, etc.), ou d’engager à faire l’historique des emprunts technologiques, etc. Au long de l’enquête, de proche en proche, de questions posées en réponses accordées, la liste initiale s’étoffe donc pour devenir un arbre sémantique aux multiples ramifications [14].
Certes, tout n’est pas décrit. L’anthropologue ne voit que ce qu’il interroge, ou s’accorde le droit de savoir ; et l’on montrerait aisément que ce qui notamment blesse sa pudeur - elle aussi pourtant culturellement codée - est fréquemment “oublié”. Latrines, pratiques défécatoires [15], jeux amoureux [16], pour être au centre de la vie sont pourtant souvent tus. De même, l’objet est plus souvent exhibé comme une nature morte, que sensiblement approché en fonction de ce qu’il conjoint d’affectif et d’utile, comme “prolongement de l’homme, son nécessaire équipage, (…) la façon dont l’homme et la femme impliquent les objets dans leur mode de vie au point de composer avec eux un espace qui les représente et qui les signifie, et dont la moindre spoliation entraîne du tragique” [17].
Pour l’anthropologue, décrire n’est donc ni tout voir, ni tout nommer, ni tout relier. Son discours se situe cependant à l’inverse des pratiques communes, où décrire consiste très largement à “ramener à soi”, et où connaître signifie avant tout reconnaître [18]. À cet égard, la description ethnographique se présente sous les auspices d’un dessaisissement et d’une errance organisée. Si le signe désigne un objet, il le signifie aussi d’une manière différente selon les contextes gestuels et culturels dans lesquels il s’insère. C’est pour cela que l’ethnographe ne décrit correctement que ce qui lui échappe, pour prendre sens du point de vue de l’autre interrogé ; et s’il décrit des objets, c’est avant tout parce qu’ils témoignent dans leur humilité, plus que des choses dans leur trompeuse évidence matérielle, des écarts entre sa propre vision et celles de ses interlocuteurs.
Décrire des conduites et des relations

Outre cette prégnante matérialité, le monde est aussi, heureusement, l’occasion de rencontres avec quelques semblables. Pour tenter de recenser les outils dont dispose l’anthropologue pour les décrire, nous poursuivrons nos réflexions par ce qu’il y a de plus simple, et nous porterons maintenant nos interrogations vers une conduite fort courante, gratifiante lorsqu’elle n’est pas négligée : celle des salutations. Trois auteurs, Sartre, Zahan et Goffman, certes forts différents, mais tous ayant abordé cette question, bien que de diverses manières, nous serviront successivement de guides.
Le monde romanesque du premier est au plus proche de notre sujet. A la limite de l’hallucination, le réel y est décrit dans une matérialité pré-catégorielle, étrange et brutale, que ne masque plus son habituelle et rassurante nomination. “Les choses se sont délivrées de leurs noms. Elles sont là, grotesques, têtues, géantes et ça paraît imbécile de les appeler des banquettes ou de dire quoi que ce soit sur elles : je suis au milieu des Choses, les innommables. Seul, sans mots, sans défenses, elles m’environnent, sous moi, derrière moi, au-dessus de moi” [19] (Sartre, 1938 : 177). Cette corrosion des évidences ne s'applique pas qu’aux choses matérielles, mais confère aussi aux rapports interhumains, et à toute rencontre avec un autre, une inquiétante étrangeté. Il en est ainsi d’une banale salutation : “Je voyais un visage inconnu, à peine un visage. Et puis il y avait sa main, comme un gros vers blanc, dans ma main. Je l’ai lâché aussitôt et le bras est retombé mollement” (ibid ). Si l’on nous autorise à confondre l’auteur et son personnage, les caractéristiques de cette rencontre sont évidentes. Elle est décrite selon le point de vue d’un des interlocuteurs, comme un affect suscité par une sensation corporelle.
Autre expérience, géographiquement plus exotique, dans un des chapitres d’un ouvrage, consacré au verbe chez les Bambara [20], Zahan s’applique à dépeindre les salutations, souhaits et insultes tels que “les Bambara l’entendent”. Nous ne prendrons pas en compte ici le contenu des connaissances produites, mais nous nous attacherons, par contre, à comprendre comment cet auteur procède pour mener à bien la description de ces échanges langagiers. Les quelques opérations lui permettant de constituer un savoir sur les conceptions locales des bonnes mœurs sont aisément observables. La première consiste à produire un sujet humain homogène - ici le bambara [21] - dont l’étude à justement pour but de permettre de comprendre les raisons de la conduite. La seconde s’attache à noter dans la langue locale, et selon divers contextes, les expressions utilisées par les locuteurs indigènes. Reste enfin à expliciter le sens des termes retenus, et à en déduire une sorte de raison téléologique, spécifique de cette population : “les salutations sont des procédés de prise de contact, destinés donner à l’entente sa première impulsion” (ibid.). Décrire signifie donc ici, construire et dévoiler, à partir d’indices discrets, un ensemble de significations telles qu’un autre les a vécues. Les comportements observables sont des traces manifestes qui témoignent d’un sens latent, et d’une intentionnalité collective à découvrir. La description est déjà une interprétation.
Le dernier contexte de notre voyage bien policé, est celui, nord-américain, où Goffman s’attache à décrire diverses interactions “banales” [22]. Autre continent, il s’agit aussi d’un autre regard puisqu’à la “profondeur” herméneutique de l’étude précédente, succède la description plane, et quasi cinématographique, de séquences où alternent les acteurs et les modalités de leurs rencontres. Les salutations y sont exposées comme “des moments où les individus s’apprêtent à apprécier une augmentation de leur accès mutuel”, “des parenthèses rituelles”, “des signes de ponctuations en quelque sorte”. Décrire signifie ici, observer et rendre compte des modifications obtenues dans une pratique, grâce à des variations contextuelles raisonnées [23].
Expérience fort modeste, cette banale expression de politesse a cependant suscité trois différents modes de description. Le premier correspond à une implication subjective, et consiste à mettre en corrélation des sensations avec des situations vécues par le descripteur, sujet conscient ou clivé selon que l’on adopte, ou pas, une perspective freudienne. Les deux autres approches s’attachent au contraire, à construire un agencement ayant comme fonction de libérer l’observation et le commentaire, du point de vue de l’ethnographe. Pour le premier d’entre eux, l’observation ouvre à un travail de sémantique, où la conduite est décrite en fonction de son enchâssement dans un ensemble de significations qui lui confère un sens. Pour l’autre, à l’inverse, les multiples interactions de la vie quotidienne se présentent comme un dispositif expérimental, in vivo, où à la manière des phonologistes opposant des paires minimales afin d’en repérer les éléments signifiants, le savoir se construit par croisement des situations - salutations surprises, rencontres inopinées, etc. - et des statuts des intervenants. Foin d’une réflexion sur une supposée identité intrinsèque ou “profondeur” des acteurs ; la description conduit, et se limite volontairement, à observer une régulation des conduites selon les contextes et les positions sociales de ceux qui y interviennent.
Décrire des rites

En d’autres temps, Saint-Simon fût habile à décrire quelques rites de “la société de cour”. Mais il le fît à sa manière, au gré de ce qui le toucha. C’est ainsi, par exemple, qu’il a dépeint la levée du conseil ou le lever du roi, à propos du mariage du duc de Chartres ou des mésaventures du comte de Tessé à qui, par malice, on souffla de se couvrir d’un chapeau gris, alors que cela n’était plus prisé par le roi [24]. Si l’on néglige – crime de “lèse-duc” - l’élégance de la forme, ces textes peuvent aisément se présenter comme une sorte de paradigme des formes les plus courantes des pratiques descriptives. Vécu comme une évidence quotidienne, le rite y est relaté d’un unique point de vue et de ce fait partiellement dépeint selon les hasards de la présence de l’observateur, souvent, de plus, uniquement lorsqu’un événement le révèle en en perturbant l’ordinaire ordonnancement. Quelques siècles plus tard, l’anthropologie compliqua cela de multiples manières.
Décrire des sentiments

Vient le plus délicat, puisque comme chacun le sait, les sentiments reposent près du cœur, autrement dit, différemment des thèmes précédemment abordés, loin d’un possible regard scrutateur. Dès lors, privé d’un référent objectif externe, la question se pose de savoir sur quel matériau fonder l’observation de sentiments qui ne se présentent jamais que comme des signifiés - supports d’éventuels développements connotatifs - susceptibles de provoquer diverses réactions sémantiques et/ou comportementales, devant à leur tour être éclaircies selon leurs propres signifiés [25]. En ce domaine, le signe et le référent vont parfois jusqu’à se confondre, au point que l’on puisse se demander si certains sentiments seraient éprouvés s’ils n’étaient préalablement nommés. Mais globalement, deux écueils sont ici évidents. Le premier consiste à “ramener à soi”, et à interpréter tout dire et conduite en fonction de ses propres catégories. Nombre d’interprétations anachroniques et/ou abusives, trouvent ici leur origine [26]. Le second serait de prôner un relativisme radical, figeant l’autre dans une étrangeté absolue. Bref, faute d’une attestable commune mesure, lorsque l’on décrit ce que l’autre est supposé éprouver, on ne sait jamais si ce que l’on découvre est ce qu’abusivement on lui prête, ou ce qu’à tort, on lui refuse.
C’est pour cela que brosser un tableau - même esquisser une ébauche… -, des sentiments vécus, engage à une réflexion sur une subjectivité et une intériorité qui ne peuvent se dire qu’à mi-mots, s’évoquer, ou être surprises au fil des actes quotidiens. Cette labilité du référent incite à penser la description sous la forme d’une confrontation, susceptible cependant, de s’effectuer selon diverses modalités.
Une première s’appuie essentiellement sur des techniques de recension. Il peut alors s’agir de s’engager dans l’inventaire de l’outillage mental d’une société, grâce à une sorte d’analyse ethnolinguistique appliquée à des corpus précisément définis, permettant d’accéder “à l’intériorité du sujet qui n’est pas irrémédiablement fermé à l’étude scientifique (…), car nos pulsions ne se réalisent qu’en empruntant des formes caractéristiques d’une culture précise ; nos sentiments ne nous sont perceptibles qu’en s’enfermant dans les mots, les images que cette culture nous offre” [27]. Moins “frontalement”, le même but peut être poursuivi en utilisant d’autres sources ayant en commun de se présenter comme des traces objectives des sentiments ressentis [28] : iconographiques, par exemple, pour comprendre les mutations des sensibilités face à la mort [29], ou bibliographiques pour décrire le mouvement de laïcisation du monde, au sein de la culture classique du XVIIIe siècle [30].
Une seconde, assez proche de la précédente, mais privilégiant la synchronie parce que résultant d’une confrontation entre des langages du présent, consiste, faute de mieux, en un tâtonnement et un ajustement réciproque des catégories de l’ethnographe à celles des populations qu’il décrit. Le modèle de ce travail est, bien évidemment, l’encyclopédie bilingue, ou les multiples entrées et renvois dans les langues vernaculaires, en viennent à constituer une sorte de dialogue ouvert avec les catégories de l’interprète. À l’évidence, ces ouvrages ne peuvent, et ne souhaitent pas, fournir de strictes définitions, “on les consulte, on les parcourt (…), en insistant sur ce que chaque culture inclut de diversités et contradictions” [31]. D’un mot à un autre, la jonction entre un signe et un autre supposé lui correspondre est toujours incomplète et différée ; la recherche d’un sens renvoyée à d’autres termes. De ce fait, plus que de fournir un strict savoir, le but de ce travail descriptif consiste à manifester et localiser les concordances, et les “décalages” affectifs, existant entre les catégories psychologiques de diverses sociétés.
Une autre manière d’aborder cette question, consiste à la limiter à l’étude des normes de conduite, telles qu’elles transparaissent dans un ensemble de pratiques sociales organisant les liens sociaux - l’héritage, l’alliance, l’initiation, etc. -, afin de dégager de leur juxtaposition, une perspective particulière, un “enchaînement syntagmatique original”[32]. Par exemple, dans une société où l’initiation et le mariage “construisent et maintiennent la cohésion de la société” autour “d’un verbe fondé dans le temps et l’espace”, “le mensonge mène à une impasse insupportable en mélangeant des termes, au lieu de respecter leur distinction, préalable aux vrais rapports”. De ce fait, “le menteur démasqué se sent aussitôt marginal…” (ibid. : 246). Autrement dit, dans ce type d’agencement argumentatif, quelques descriptions de comportements sociaux supposés fondamentaux, se présentent comme une sorte de base descriptive générale, à partir de laquelle l’ethnologue peut construire divers raisonnements inductifs. Les observations recueillies, préférentiellement lors du déroulement de cérémonies majeures – présentées comme fondatrices des identités - sont constituées comme une sorte de catalogue de référence, à partir duquel il devient possible d’inférer les sentiments vécus par les populations, en de multiples et plus modestes circonstances [33].
Enfin, une dernière possibilité consiste à rechercher quelques “bases objectives” où se fondent, et trouvent origine, les sentiments. Un exemple récent, de cette volonté d’initier une description et une confrontation en fonction de quelques invariants de conduite, nous est fourni par la tentative philosophique de Jullien [34]. Cette démarche vise à construire un réseau problématique entre la Chine et l’Europe, et ce faisant, tente de comparer des conceptions morales provenant de ces deux continents, à partir d’éléments de comparaison stables, non soumis à une préalable interprétation. L’observation s’attache à démontrer que de l’Est à l’Ouest du monde, des penseurs aussi différents que Mencius et Rousseau, se sont trouvés confronté à de mêmes réactions impératives comme “ne pas supporter de voir souffrir”. Cette injonction “qui nous porte sans réflexion au secours de ceux que nous voyons souffrir”, peut alors être décrite comme une “vertu d’autant plus universelle” qu’elle précède justement “l’usage de toute réflexion” (ibid. : 29). Cette “connivence instaurée vis-à-vis d’une autre existence” (ibid. : 13), contient dès lors, l’universalité d’un principe : Pour tout homme, il y a “quelque chose qu’il ne supporte pas qu’il arrive aux autres”. Ce sentiment d’insupportable éclaire non seulement ce que des collectivités pensent “mais également ce à partir de quoi elles pensent - leurs partis pris implicites et tous leurs silences” (souligné par l’auteur, ibid. : 26). Dans ce dernier agencement, décrire consiste à trouver, sous divers argumentaires éthiques, des réactions spontanées, “indices invariants de notre morale” (ibid. : 49). A fonder une analyse comparative sur la description de percepts purs, permettant ainsi d’instaurer un dialogue problématique entre divers systèmes culturels [35].
Bien sûr, nous avons ici séparé ce qui est souvent lié, et tout texte élaboré se présente comme une matriochka dont le corps dissimule de multiples figurines. Par exemple, l’analyse des sentiments recoure à l’étude des objets avec ses procédures idoines… Mais résumons nous. Chacun s’accorde sur le fait que l’ethnographie, tout comme “l’histoire est description et que le nombre des descriptions possibles d’un même événement est indéfini” [36]. Certes, selon celui qui décrit, son appartenance à une époque et une société, son âge, son sexe, sa sagacité, ses connaissances et méconnaissances, etc., les actions perçues et considérées comme distinctes et signifiantes diffèrent considérablement. Bref, pour le dire simplement, dans ce domaine comme en bien d’autres, “chacun voit midi à sa porte théorique”, et notre bref parcours n’arrange rien à l’affaire. Il est en effet révélateur des multiples postures que regroupe une vaste notion comme celle de la description. En fait, l’assemblage hétérogène - voire hétéroclite - qui se dégage de nos quelques lectures, se présente plus comme un regroupement de procédures vicariantes que comme un ensemble organisé de méthodes. Cependant, pour tenter de nuancer cette vision par trop péjorative, quelques points peuvent être soulignés.
Le premier concerne globalement les caractéristiques de ces modes de description. Nos brèves lectures, bien qu’elles ne puissent prétendre à une quelconque exhaustivité, soulignent qu’ils sont limités en nombre : désignation et nomination pour les objets matériels ; implication subjective, extraction sémantique ou mise en série pour les conduites ; comptage et variation diachronique, approximation et confrontation “fondamentale” pour les sentiments. Ensuite, bien qu’utilisés selon des façons artisanales plus que selon les canons d’une régularité disciplinaire abstraite et préétablie, ils le sont avec constance ; constituant ainsi, bien que non formalisés, un corpus de tours de main adaptés aux variations des situations rencontrées
“Ce qui”, mais aussi “pour qui” on décrit

Mais, prolongeons ces questions, et puisque de proche en proche, une réflexion sur les procédures de description en est venue à déboucher sur le large paysage du dialogue problématique entre divers systèmes culturels, tentons, une nouvelle fois, de faire le point grâce à quelques “banalités fondamentales” : Voir est un automatisme ; imaginer une activité solitaire, mais cependant honnête ; décrire, par contre, engage un autre. On ne décrit pas pour soi, mais pour quelqu’un, ce que l’on a vu ailleurs ou autrement, là où son interlocuteur était absent ou moins perspicace. Dès lors, puisque la description est une trace de l’homme dans la langue, un vouloir transmettre sur un fond de négativité, la seule interrogation sur ce qui est décrit s’avère insuffisante. Il devient nécessaire de comprendre les liens complexes que tout texte anthropologique instaure entre un lecteur - ou interlocuteur absent que tout auteur anticipe et auquel tout texte s’adresse – et ce que ce même texte propose comme modalité de description de l’altérité [37].
Cette question, sans doute parce qu’elle unit intimement des postures intellectuelles et “existentielles”, liées notamment à la fin de l’époque coloniale, incite parfois à prendre des positions extrêmes, allant des plus grandes réserves - “L’arrivée de peuples autrefois colonisés ou isolés sur la scène de l’économie globale, de la politique internationale et de la culture mondiale ne permet plus guère à l’anthropologue de se présenter comme le tribun de ce qu’on n’entend pas, le révélateur de ce qu’on ne voit pas, le décrypteur de ce qu’on conçoit mal” [38] – à la critique la plus radicale : “Ce qui est devenu irréductiblement curieux, n’est plus l’autre mais la description culturelle elle-même”[39].D’autres s’en tiennent à l’opinion contraire, se réjouissant que la rigueur scientifique de l’outil anthropologique prévale sur l’origine du chercheur : “Il y a une vingtaine d’années, on entendait parfois dire que lorsque les Africains par exemple apporteraient leur contribution à l’ethnologie de l’Afrique, notre vision de celle-ci en serait renouvelée. Il n’en a rien été et c’est heureux. (…) Ce n’est là qu’une question de méthode” [40].
Sans vouloir, à tous crins, ménager et la chèvre et le chou, peut-être pouvons-nous progresser en nuançant ces opinions apparemment contrastées.
Tout d’abord, ce serait à tort que l’on “homogénéiserait”, pour critiquer ou valoriser, ce que notre travail a tenté de distinguer sous la vaste rubrique de la description. On confondrait ainsi certaines procédures descriptives avec l’ensemble des modalités du rapport à l’autre, risquant alors de jeter la discipline anthropologique, avec l’eau du bain d’une nécessaire réflexion sur les implicites des pratiques d’observation et d’interprétation. En effet, selon le mode descriptif utilisé, notamment pour caractériser des relations, le contenu des observations, et parfois, les conclusions, portées sur les liens entre les acteurs et leurs conduites, peuvent sensiblement différer. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, suivant que l’ethnologue choisit de “dévoiler” le sens d’une pratique ou d’en souligner la trame interactive, la place accordée, et la compétence reconnue, aux acteurs seront bien différentes. Dans le premier cas – celui dont traite, par exemple, le texte de Zahan - le commentaire fournit “aux pratiques quotidiennes l’écrin d’une narrativité”, pour des acteurs qui “sont finalement les locataires et non les propriétaires de leur propre savoir faire” [41]. Dans l’autre cas – texte de Goffman - on admet au contraire implicitement une certaine compétence cognitive et sociale à des acteurs capables de réagir à diverses situations, de les orienter selon leurs intérêts, voire de les modifier [42]. Enfin, pour ce qui concerne les procédures de description des sentiments, elles se situent d’emblée dans un espace de dialogue, comme autant d’indispensables “détours” où l’autre et soi-même ne peuvent se penser que réciproquement.
C’est ainsi que ce “filage” que nous avons proposé, d’une notion de description, trop souvent massivement utilisée, présente – tout moins l’espérons-nous - un second intérêt. Il souligne, en effet, que le choix des procédures descriptives n’est pas uniquement régi par des contraintes “techniques”. Il correspond aussi, aux articulations diverses - et souvent encore selon la tentation ethnologique “du grand partage” [43] – de trois données fondamentales : les “contextes socio-géographiques” choisis comme terrains, les méthodes de description utilisées, et ce point obscur du travail de l’ethnologue, qu’est l’organisation d’un texte ayant toujours la forme d’une adresse à un lecteur. Reste alors à faire l’histoire des formes de nouaisons de ces termes, où rien ne semble être dû au hasard. En effet, la description par explicitation d’un sens des conduites semble souvent réservée à des populations “exotiques” - lorsque l’ethnographe sait qu’il décrit dans un cadre où la distance culturelle est maximale entre l’objet décrit et le lecteur qu’il anticipe -, alors que les descriptions sous forme de séries raisonnées sont le plus souvent utilisées dans des situations où la distance est minimale entre le chercheur, celui qu’il décrit, et celui à qui il s’adresse [44]. Pour le dire autrement, la description par l’analyse des interactions se borne à souligner ce que parfois le lecteur n’était pas sans savoir - puisque ce sont ses propres conduites qu’il découvre au long de sa lecture -, mais ne pouvait réunir au sein d’une syntaxe globale ayant valeur d’interprétation. Dans le second cas, la description par attribution d’un sens à une conduite se présente comme la révélation d’une vérité sur un autre, à laquelle seuls l’ethnographe et son lecteur auront accès.
Une telle hypothèse demanderait sans doute à être, à son tour, nuancée. La valider nécessiterait, de plus, d’autres lectures, et d’autres développements. Soulignons simplement, puisqu’il est temps de conclure, qu’initié sous les auspices de la grammaire, notre texte se clôt par une réflexion sur “la politique du terrain”.
La description comme éthique ?

Dans le domaine anthropologique, la description ne peut donc être naïvement comprise comme une activité antéprédicative, sorte de “réduction” phénoménologique permettant d’accéder à une réalité naturelle des choses ou des sociétés. Elle est, au contraire, contrainte par ses objets d’étude, construite selon diverses méthodologies allant d’un “empirisme irréductible” à de prudents tâtonnements psychologiques, et s’avère discrètement régie par l’histoire des lieux, des lectures et des disciplines. Mais, pour être complexe, l’utilité de ce moment ethnographique, qui, entre la découverte du terrain et le choix des axes interprétatifs, bride l’impatience de conclure, n’en est pas moins indispensable.
Tout d’abord, parce que l’activité de description s’accorde globalement avec une vigilance, pour que des “traditions de lectures” ne viennent s’interposer entre nous et ce que nous observons. Elle exprime ainsi une des tensions fondatrices de notre discipline, entre une sourde intertextualité qui toujours oriente – et parfois égare - nos hypothèses initiales, et cette sorte de résistance interne du terrain que, faute de mieux, on nommera la matérialité initiale des faits. Ce moment de suspens méthodique empêche ainsi des “retraductions intentionnelles [45]”, consistant à se donner d’avance, plus ou moins volontairement une conclusion, et à n’utiliser ses matériaux qu’afin d’en justifier la vraisemblance.
Fort simplement, elle constitue ainsi un bon “marqueur” d’honnêteté et de rigueur professionnelles. Mais se faisant, cette pratique de la description, “sorte de “propre” des langages supérieurs, dans la mesure, apparemment paradoxale, où elle n’est justifiée par aucune finalité d’action ou de communication” [46], déborde de sa stricte définition technique. Elle correspond aussi à une modalité relationnelle, un effort, une tentative de suspendre le jugement. Même fragile, cette interprétation retenue apparaît alors comme une ouverture et une politesse envers l’autre, ses objets, rencontres, rites et sentiments. Une manière de lui permettre de n’être pas simplement une rapide réponse à nos questions ; une sorte d’éthique, modeste mais intransigeante, de l’anthropologie.
[1] Todorov T., Présentation à Littérature et réalité (Barthes R., Bersani L., Hamon Ph., Riffaterre M., Watt I.), Paris, Seuil, 1982
[2] Austin J.-L., Le langage de la perception, Paris, Armand Collin, 1971. Soulignons, qu’il serait possible de rendre l’affaire encore plus complexe en intégrant dans ces raisonnements sur le rapport au réel, la question de la physiologie des organes des sens - “la persistance des images rétiniennes oblige à tenir pour fondu et inséparable ce qui pourtant relève de la pure succession“ - ou la construction du “vrai“ par la technique, comme par exemple, par l’imagerie médicale radiographique. Nous renvoyons sur ces points à Dagognet F. (Les outils de la réflexion, Synthélabo, Les Empêcheurs de penser en rond, 1999)
[3] Cresswell R., Les animaux sont dans le pré, Paris, Pestalozzi-Verlag, 1997
[4] Foucault M., Ceci n’est pas une pipe, Paris, Scholies Fata Morgana, 1973
[5] En fait cette notion utilisée par Geertz C. – Ici et Là-bas, Paris, Métailié, 1996 (pour trad. fr.) - est proche de celle communément utilisée par les sémioticiens sous le nom de “signifiance“ : “Dans le langage quotidien, les mots semblent reliés verticalement, chacun à la réalité qu’il prétend représenter, chacun collé sur son contenu comme une étiquette sur un bocal, formant chacun une unité sémantique distincte. Mais en littérature, l’unité de signification, c’est le texte lui-même. Les effets que les mots, en tant qu’éléments d’un réseau fini, produisent les uns sur les autres substituent à la relation sémantique verticale une relation latérale (…). La signifiance, c’est à dire le conflit avec la référentialité apparente, est produite et régie par les propriétés du texte…(Riffaterre, L’illusion référentielle, dans Littérature et réalité (Barthes R., Bersani L., Hamon Ph., Riffaterre M., Watt I.), Paris, Seuil, 1982, 91-118). Soulignons, que si l’on voulait poursuivre dans cette veine sémiotique et chercher quelques contre-exemples à la thèse de Geertz, on pourrait en utilisant, par exemple, la distinction faite par Genette (Fiction et diction, Paris, Seuil, 1991) entre des “récits fictionnels“ et des “récits factuels“, montrer que de nombreux indices textuels caractérisant la fiction – notamment l’accès direct à la subjectivité des personnages - sont quasiment absents des textes anthropologiques s’attachant à décrire des faits.
[6] En géométrie, deux figures peuvent ne pas être identiques, mais être semblables dans leurs propriétés, dès lors que l’on a conservé les mêmes grandeurs.
[7] Il s’agit déjà donc d’un construit et non d’un simple étalage d’objets, courant le risque du ridicule dès lors qu’il se borne à une brutale accumulation exotique. Ce travers est par exemple, mis en relief par le peintre Boltanski lorsqu’il parodie nos musées ethnographiques en exposant dans des vitrines, des peignes industriels déjà utilisés. Nous ne traiterons pas ici de ces questions liées en grande partie à une parodie, sur le mode des “regards croisés“, des musées d’ethnologie.
[8] Bouqiaux L. & Thomas M.C., Enquête et description des langues à tradition orale (2 Vol), Paris, SELAF, 1976.
[9] Raybaut P., Guide d’étude d’anthropologie de l’alimentation, Nice, Centre Universitaire Méditerranéen, 1977.
[10] Un exemple, concernant la descriptions de poteries, peut suffire à illustrer notre propos : “Les caractéristiques utilisées pour définir leurs types sont : la décoration, la lèvre et la forme (…). Les caractéristiques des différents types sont : Lèvres arrondies, parfois munies d’une rainure, lèvres arrondies, le plus souvent évasées, etc. (Bedaux R. M. & Lange A.G., Tellem, Reconnaissance archéologique d’une culture de l’Ouest Africain au Moyen Age : la poterie, J. des Africanistes, 53, 1-2, 1983, 5-59).
[11] Pairault C ., Boum-Le-Grand Village d’Iro, Paris, Institut d’ethnologie, 1966.
[12] (Strauss A. Miroirs et masques, Paris, Métailié, 1992).
[13] Ce travail de déprise des “évidences“ est ainsi présenté par Geertz C. (Savoir local, savoir global, Paris, PUF, 1986) : “Traduire ici ne veut pas dire une simple refonte de la façon dont les autres présentent les choses afin de les présenter en termes qui sont les nôtres (c’est ainsi que les choses se perdent), mais une démonstration de la logique de leur présentation, selon nos propres manières de nous exprimer…“. Sur les difficultés d’un tel travail nous renvoyons à la critique des implicites des descripteurs de la parenté dans ce questionnaire princeps qu’est le Notes and queries on anthropology édité par le Royal Anthropological Institute de 1874 à 1964 (Meillassoux C., Parler Parenté, L’Homme, 153, Janvier/Mars 2000, 153-164).
[14] Les modalités concrètes du recueil de ces termes sont précisées trente années plus tard, par le même auteur : “Pour continuer avec ma stratégie d’attention flottante, je pourrais dire que mes journées se passaient à ouvrir les yeux sur ce qui m’entourait. D’emblée, c’est tout ce que je pouvais faire, puisque les oreilles je les ouvrais de mon mieux, mais sans rien comprendre. Je m’étais dit que le meilleur était de partir du plus apparent, du plus manifeste de la vie quotidienne, de ce qui ne tire pas à conséquence, ne risque ni de froisser, ni de sembler indiscret. Quitte d’ailleurs à me tromper ; tombé en arrêt devant une potière qui cuisait les récipients modelés par elle, j’ai vite compris par ses cris et gestes que je risquais de porter le mauvais œil, de faire éclater les poteries, et que je devais déguerpir.“ (Pairault, Retour au pays Iro, Chronique d’un village du Tchad, Paris, Karthala, 1994). Comme quoi, c’est dans l’interaction, même humoristique que surgissent des hypothèses, et s’organisent des catégorisations émiques.
[15] Epelboin A. remarque : “Alors que l’anthropologue, en “partant sur le terrain“, se voit forcé de quitter ses lieux d’aisance, de bouleverser ses habitudes, ses rythmes quotidiens, il ne l’écrit pas et s’il en parle, c’est de façon anecdotique : il ne traite pas ce sujet, il l’oblitère, tant pour lui-même que pour les autres.“ (Selles et urines chez les Fulbe Bande du Sénégal Oriental, Cah. ORSTOM, Ser. Scie. Hum., vol. XVIII, n°4, 1981-1982, 515-530).
[16] À notre connaissance, dans le domaine africain, Etienne P. est un des rares ethnologue à avoir aussi précisément abordé la question des pratiques sexuelles, allant “après une enquête sommaire, se faire décrire, outre le décubitus dorsal, trois autres positions dont deux portent un nom spécifique.“ (Les interdictions de mariage chez les Baoulé, Abidjan, doc. ronéotypé, ORSTOM, 1972).
[17] Farge A., Le cours ordinaire des choses, Paris, Seuil, 1994.
[18] Il suffit pour s’en convaincre de considérer le tourisme qui n’est très largement qu’une manière de retrouver en “vrai“ ce que l’on avait connu en photo, avant d’y faire soi-même sa photo, etc. Ainsi que le souligne Augé M. : “Le non-lieu, c’est l’espace des autres sans les autres, l’espace constitué en spectacle lui-même déjà pris dans les mots et les stéréotypes qui le commentent par avance dans le langage convenu du folklore, du pittoresque ou de l’érudition.“ (Non-lieux, Paris, Seuil, 1992).
[19] Sartre J.-P., La nausée, Paris, Gallimard, 1938.
[20] Zahan D., La dialectique du verbe chez les bambara, Paris-La Haye, Mouton & Co, 1963.
[21] Pour une critique globale de ces procédures d’homogénéisation et de caractérisation voir notamment Bensa A. (De la micro-histoire vers une anthropologie critique, dans Jeux d’échelle, la micro-analyse à l’expérience, Revel J. (ed.), Paris, Hautes Etudes Gallimard-Le Seuil, 1996, 37-70).
[22] Goffman E., La mise en scène de la vie quotidienne (2 Vol.), Paris, Ed. de Minuit, 1973.
[23] Bien évidemment ce type d’analyse soulignant que les significations ne prééxistent pas aux objets mais se construisent au sein d’interactions entre divers acteurs se retrouve dans de nombreux travaux des chercheurs de l’Ecole de Chicago. Pour une présentation synthétique cf. Chapoulie J.-M. (Préface à Outsiders, Etudes de sociologie de la déviance, Becker H. S., Paris, Métailié, 1985, 9-22).
[24] Saint-Simon, Mémoires I & II, Paris Gallimard 1990).
[25] C’est présenter ainsi le squelette de ce que, avec plus de chair, soulignait Elias “ les plaisirs organisés par la société sont l’incarnation des normes affectives dans le cadre desquelles se tiennent tous les conditionnements pour différents qu’ils soient sur le plan individuel ; quiconque quitte le cadre des normes sociales passe pour anormal“ (La civilisation des mœurs, Paris, Calman-Levy, 1973 (pour tr. fr.).
[26] Olivier de Sardan : “Le réel des autres“, Cahiers d’Etudes Africaines 113 (XXIX-1), 127-135.
[27] C’est ainsi que Flandrin J.-L. définit les hypothèses de son analyse des variations du vocabulaire amoureux dans un corpus de “vingt-deux mille titres courts pour 1961 et treize mille titres longs pour le XVIe siècle.“ (Le sexe et l’Occident, Paris, Seuil, 1981)
[28] Cette question a été longuement discutée par Furet F. : “L’historien des mentalités qui cherche à atteindre des niveaux de comportement moyens, ne peut se contenter de cette littérature traditionnelle du témoignage historique, qui est inévitablement subjective, non représentative, ambiguë. Il lui faut se tourner vers les comportements eux-mêmes, c’est-à-dire vers les signes objectifs de ces comportements. (…) Mais l’interprétation de ces résultats ne présente pas le même degré de certitude que les résultats eux-mêmes. L’interprétation, c’est au fond l’analyse des mécanismes (objectifs et subjectifs) par lesquels une probabilité de comportement collectif – celle-là même qu’à révélée le traitement des données – s’incarne dans des conduites individuelles à une époque donnée… (De l’histoire-récit à l’histoire-problème, dans L’atelier de l’histoire, Paris, Flammarion, 1982, 73-90).
[29] Comme l’illustrent les travaux de Vovelle M. et notamment : Iconographie et histoire des mentalités, dans Idéologies et mentalités, Paris, Gallimard, 1982, 59-87
[30] Nous faisons ici, une nouvelle fois, allusion à Furet F. : La “librairie“ au XVIIIe siècle, dans L’atelier de l’histoire, Paris Flammarion, 1982, 129-163
[31] Olivier de Sardan J.-P., Concepts et Conceptions songhay-zarma, Paris, Nubia, 1982
[32] Pairault C., op. cit., 1966 : 299
[33] Certes bien globalement, cette approche correspond aussi à celle, lexicale et psycho-esthétique de Geertz C., soulignant l’aspect référentiel et paradigmatique de la scène et du théâtre pour comprendre l’être au monde balinais (Savoir local, savoir global, Paris, PUF, 1986).
[34] Fonder la morale. Dialogue de Mencius avec un philosophe des Lumières, Paris, Grasset, 1995.
[35] Pour une discussion autour des rapports entre “pertinence du sens“ et “pertinence de l’expressivité“, nous renvoyons à Empsom W., Assertions dans les mots, in Sémantique de la poésie, Todorov T., Empson W., Cohen J., Hartman G., Rigolot F., Paris Ed. du Seuil, 1979, 27-83.
[36] Veyne P., Comment on écrit l’histoire, Paris, Seuil, 1971.
[37] Cette tension, entre un “lecteur “virtuel“ et “l’objet de la description“, est notamment présente dans les préfaces des textes. (Cf. Jaffré, Les révélations liminaires, petite anthropologie des préfaces, à paraître).
[38] (Geertz, Savoir local, savoir local, Paris, PUF, 1996).
[39] Clifford J. (Writing Cultures : The poetics and Politics of ethnography, Berkeley, Calif, 1986), cité par Geertz op. cit.
[40] Augé M., Le sens des autres. Actualité de l’anthropologie, Paris, Fayard, 1994.
[41] (de Certeau M., L’invention du quotidien, Paris, UGE, 1980). Soulignons qu’un tel modèle de raisonnement autrefois “innocemment“ utilisé, suscite maintenant un certain embarras de la part de l’ethnologue qui l’emploie. Ainsi Héritier (Masculin/féminin, La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 1996) : “Le système de sens ainsi reconstruit par l’observateur à partir d’éléments du discours et de pratiques, est nécessairement imparfait, au sens où il ne peut être totalement bouclé sur lui-même. Pour les acteurs, en effet, il est rarement, sinon jamais, donné comme tel, sous forme d’une analyse construite (…)“.
[42] En témoignent les “applications“ de ces positions anthropologiques dans le domaine de la thérapeutique psychologique, où les dysfonctionnements familiaux sont étudiés à partir des “processus interactionnels“ que l’acteur peut modifier. Cf. Watzawick P. & Weakland J. (eds.), Sur l’interaction, Palo Alto 1965-1974 Une nouvelle approche thérapeutique, Paris, Seuil, 1977. C’est aussi ici, bien évidemment, évoquer les compétences d’un acteur, participant actif poursuivant des stratégies que Long N. décrit sous le terme d’“agency“(Demythologizing planned intervention : an actor perspective, Long N. & Douwe van der Ploeg J., Sociologia Ruralis, 1989, Vol. XXIX – 3/4, 227-249.
[43] Lenclud G., Le grand partage ou la tentation ethnologique, dans Vers une ethnologie du présent, (Althabe G., Fabre D., Lenclud G. (dir.), Ed. Maison des Sciences de l’Homme, 1992, 9-37).
[44] Pour le dire encore plus explicitement, est-ce un hasard si les méthodes de description par variations séquentielles ou par segmentations territoriales proviennent avant tout de l’Ecole de Chicago, lorsque des américains décrivaient des américains pour des américains, alors que des travaux plus “symbolisants“ régissent bien des études africanistes pour des lecteurs “du Nord“ ? Soulignons aussi fort prosaïquement que l’observation d’interactions nécessite une bonne maîtrise des codes et de la langue, alors que sous l’interprétation “heuristique“ des conduites se dissimule souvent la présence du traducteur local ou de l’interprète privilégié, etc. Les compétences de l’anthropologue influent aussi sur le choix de la méthode.
[45] Nous empruntons ce terme à Bollack J., Sens et contre-sens, comment lit-on ?, Ed. La passe du vent, 2000.
[46] Barthes R., L’effet de réel, dans Littérature et réalité (Barthes R., Bersani L., Hamon Ph., Riffaterre M., Watt I.), Paris, Seuil, 1982, 81-91).
|

