[191]
Interventions économiques
pour une alternative sociale
No 7
THÉORIE ÉCONOMIQUE
“Le recours au concept
de « paradigme » dans l’analyse
de la pensée économique.”
Maurice LAGUEUX

Suite à la parution de l’ouvrage de Thomas Kuhn, “The structure of scientific revolutions” en 1962, il est devenu courant chez un certain nombre d’économistes notamment parmi le courant dit radical aux États-Unis, de recourir au concept de paradigme pour présenter la théorie marxiste, voir lui redonner ses lettres de noblesse dans les milieux universitaires. A côté d'autres paradigmes, il y aurait le paradigme marxiste. Un paradigme tout aussi valable pour ne pas dire plus, que les autres. Toute la question évidemment, est de savoir s’il est possible de présenter la théorie marxiste simplement en termes de paradigme et surtout de ramener le projet révolutionnaire qui est le sien à un débat entre approches théoriques alternatives. Le texte que nous vous proposons dans la rubrique théorie de ce numéro essaye de faire un peu le point sur la question et sur les débats qui l’ont entourée.
[192]
On notera que cet article sera publié à l’automne chez Hurtubise H.M.H., dans le cadre d’un recueil de textes portant sur un certain nombre de débats tant philosophiques qu’économiques qui ont pu alimenter la pensée critique de gauche au cours des deux dernières décennies. Une version plus ou moins élaborée du présent texte a également été présentée par l’auteur à quelques reprises, notamment lors d’un séminaire de l’Association d’Économie Politique. (31 Janvier 1980).
*
* *
Thomas Kuhn, on le sait, a fait appel à la notion de “paradigme” pour mettre en évidence certains traits de l’évolution des sciences naturelles, mais n’a jamais été amené à appliquer cette notion à l’étude de l’évolution des sciences sociales. Pourtant, depuis la parution en 1962 de Structure of Scientific Revolutions [1], on ne compte plus les théoriciens des sciences sociales qui ont eu recours aux concepts de “paradigme”, de “science normale”, de “puzzle-solving” et aux autres concepts de Kuhn, pour rendre compte de ce qu’ils estimaient être des traits tout à fait caractéristiques du développement de leur discipline respective. On serait même tenté de dire que l’étrange fascination exercée par la pensée de Kuhn, dans bien des milieux voués à l’étude des phénomènes sociaux, pourrait tenir largement à l’impression — assez mal fondée, on le verra — qu’en permettant une sorte d’infiltration des sciences naturelles par une problématique quasi-sociologique des crises et des révolutions scientifiques, cette approche offrait aux disciplines dédaignées par une épistémologie positiviste trop sévère l’occasion inespérée de revendiquer, pour elles-mêmes, le type de scientificité apparemment moins inaccessible auquel ces sciences naturelles se seraient trouvées réduites.
Or parmi les sciences sociales auxquelles on pouvait être tenté d’appliquer ces concepts pour en renouveler l’épistémologie, l’économie occupait une place, en un sens, assez particulière. Tout en prenant pour objet le secteur de l’univers social où s’ancrent infailliblement les conflits idéologiques les plus rebelles à l’analyse objective, cette discipline a apparemment réussi, mieux que toute autre science sociale, à se donner à tout le moins les allures d’une science exacte.
[193]
Cet état de choses s’explique, en bonne part semble-t-il, par le fait que le caractère significativement mesurable de son objet donnait prise assez naturellement à l’application de techniques mathématiques hautement sophistiquées. Quoi qu’il en soit, en effet, de la question de savoir ce qui, dans les travaux formalisés des économistes, constitue une contribution importante et ce qui constitue un exercice brillant mais futile, il est certain que des grandeurs économiques immédiates et pourtant significatives comme le prix de telle ou telle marchandise ou encore le taux d’intérêt imposé sur tel type de prêt à tel moment, sont, pour l’économiste, des données relativement exactes et aisément comparables entre elles, contrairement aux données plutôt vagues (taux de frustration, degré de cohésion sociale, etc.) que le sociologue s’efforce de dégager, pour cerner avec un début de précision les réalités sociales dont il entend rendre compte.
C’est largement pour cela, sans doute, qu’au niveau même de la construction des modèles explicatifs et pas seulement à celui du traitement des données empiriques, les économistes se sont engagés résolument sur la voie de la formalisation avec une frénésie que ne pouvaient partager les théoriciens d’aucune autre science sociale. Pour le sociologue qui construit un modèle théorique visant à rendre compte des réalités sociales évoquées ci-dessus, il serait gênant et même ridicule de se livrer à des acrobaties mathématiques à partir de grandeurs dont il reconnaît volontiers le caractère hautement artificiel et subjectif. Par contre son collègue économiste, n’ayant pas, en apparence, à justifier les grandeurs numériques reconnues socialement aux réalités économiques qui l’intéressent avant tout (prix, coûts, salaires, taux d’intérêt et de profit, etc.), ne se trouve pas incité à la même retenue et voit s’ouvrir devant lui le vaste champ des manipulations mathématiques. C’est pourquoi, sans doute, depuis Cournot et Walras, les théoriciens de l’économie ont poursuivi sans relâche le processus de formalisation de leurs modèles théoriques, s’inscrivant avec assurance sur une voie ouverte par les physiciens, qui, eux, n’ont jamais vu leur attitude formalisante sérieusement contestée.
Toutefois cette confortable avance en matière de formalisation, prise par l’économie à l’égard des autres sciences [194] sociales, n’enlève rien au fait que les grandeurs soumises à ce traitement formel renvoient bien moins à des entités théoriques du type de celles que les physiciens ont été amenés à construire qu’aux expressions numériques monétaires socialement associées, en économie capitaliste, aux innombrables rapports d’échange qui assurent, à de multiples niveaux, la cohésion de ce mode de production [2]. Dès lors, c’est la signification même de cette avance qui sera remise en cause, chaque fois que les critiques de cette approche formalisée s’efforceront de montrer que ces rapports d’échange peuvent être considérés, en dernier ressort, comme l’expression de rapports de force qui, malgré la forme policée que la théorie leur prête, demeurent le lieu où s’affrontent des évaluations subjectives et des intérêts de classes, aussi peu adaptés aux mesures exactes que les données sociologiques les plus difficilement définissables.
Or, la plupart des économistes préoccupés par le statut de leur discipline ont néanmoins mis résolument l’accent sur le côté positivement mesurable des réalités économiques et, de ce fait, ont recommandé, à des degrés divers, de soumettre les théories invoquées pour en rendre compte au même type de formalisation et de vérification que celui qui a assuré le succès des sciences physiques. C’est pourquoi ces économistes ont spontanément reconnu dans l’épistémologie positiviste, étroitement associée au développement même de ces sciences, l’expression la plus satisfaisante du statut épistémologique des diverses théories économiques dont ils se sont faits les défenseurs. Il serait même assez facile de montrer que de Fritz Machlup [3] à Joan Robinson, les théoriciens modernes des tendances les plus diverses de cette économie positive ont trouvé chez Karl Popper la forme la plus séduisante de cette épistémologie “positiviste”, qui sait prendre ses distances à l’égard des naïvetés empiristes encore plus insoutenables en économie qu’en physique, mais qui sait par ailleurs donner tout leur sens aux procédures permettant de tester des hypothèses selon des règles éprouvées, applicables de préférence à des théories formalisées.
Dans ces conditions, la moindre mise en cause du “positivisme” poppérien ne pouvait que trouver une oreille sympathique chez ces économistes dits radicaux qui, avec une vigueur de plus en plus grande, proclamaient que l’économie [195] officielle ne faisait que masquer sous une formalisation intempestive les conflits d’intérêts qui constituaient, à leurs yeux, l’élément essentiel de la vie économique réelle. Toute contestation du positivisme était accueillie par eux avec une sorte de sympathie, mais celle amorcée par Kuhn, qui faisait mieux encore en mettant l’accent sur les crises de la science et les révolutions scientifiques, devait convaincre d’emblée la plupart des économistes radicaux. La crise de la science économique officielle n’avait-elle pas été annoncée par eux depuis fort longtemps, même si, jusque-là, on avait eu plutôt tendance à les considérer comme des Cassandre plus ennuyeux qu’inquiétants ? Or, justement vers la fin des années 60, où ils découvraient chez Kuhn la signification épistémologique des crises scientifiques, quelques indices semblaient vouloir donner une certaine vraisemblance au jugement qu’ils portaient sur l’économie : c’était, en effet, l’époque où commençait à être mis en cause l’idéal de croissance continue, auquel la science officielle s’était passablement associée ; c’était l’époque où, pour la première fois, se faisait sentir en Occident les manifestations de ce phénomène de stagflation que l’économie dominante allait avoir tant de mal à expliquer ; c’était l’époque enfin où, sur un plan plus théorique, les économistes néo-ricardiens, issus de Cambridge, contestaient avec vigueur les fondements théoriques de l’approche néoclassique. La crise de la science officielle était donc à l’ordre du jour pour ces milieux radicaux et le fait qu’elle soit présentée par Kuhn comme le prélude à une révolution scientifique ouvrait des perspectives inattendues à ceux que leurs convictions politiques avaient habitués à voir, dans les crises sociales et économiques, le prélude à une révolution non pas théorique, cette fois, mais socio-politique.
Aussi, dans ces milieux sensibles aux transformations révolutionnaires de caractère socio-politique, la thèse de Kuhn qui devait avant tout retenir l’attention était celle qui présentait toute révolution scientifique non point comme le résultat d’une batterie de tests menés avec grand renfort de techniques statistiques, mais plutôt comme une option quasi-axiologique, comme une réorientation philosophique largement explicable par des phénomènes sociologiques et institutionnels. Car — et c’est là sans doute la contribution la plus significative de Kuhn aux yeux des économistes radicaux [196] — la révolution scientifique, dont son livre faisait la théorie, en était une qui permettait de passer d’un paradigme à un autre un peu comme la révolution sociale devait permettre de passer d’un mode de production à un autre. Les paradigmes avaient un peu tendance à être perçus par eux comme des modes de pensée, globaux commandant toutes les manifestations de la vie théorique, un peu, oserais-je dire, comme les modes de production commanderaient toutes les manifestations de la vie sociale. Ainsi, tout comme le droit de propriété privé des moyens de production et l’ensemble de la morale bourgeoise peuvent être considérés comme partie intégrante du mode de production capitaliste, dont le socialisme n’aurait que faire, une certaine attitude tatillonne à l’égard des données empiriques et une certaine tendance à valoriser les diverses techniques de vérification pouvaient être considérées comme parties intégrantes du “paradigme néo-classique”, dont un “paradigme radical” n’aurait que faire.
Peut-on parler d’un “paradigme radical”... ?
Les économistes radicaux, à n’en pas douter, ont été enthousiasmés par une perspective de ce genre ; c’est pourquoi ils ont consacré, outre divers articles publiés ça et là, le numéro complet de juillet 1971 de Review of Radical Political Economics, à tirer toutes les conséquences de cette lecture un tantinet marxiste de Kuhn. À vrai dire, l’enjeu attaché à cette interprétation méritait bien une telle attention : l’immense service que leur rendait un Kuhn ainsi interprété était rien moins que la légitimation de leur entreprise comme entreprise scientifique. En effet, dans une façon de voir plus traditionnelle, il aurait fallu — sous peine de se voir brutalement rejeté de la communauté scientifique — se plier aux exigences de la “science normale” et se contenter de proposer des hypothèses théoriques plus hardies devant être soumises à des vérifications rarement concluantes, alors que l’objectif pour eux était plutôt de mettre en cause cette conception de la science, renforcée plutôt qu’ébranlée par une telle démarche. La nouvelle façon de voir, au contraire, [197] impliquait un déplacement, de la compétition entre hypothèses au sein d’un même cadre théorique à la compétition globale entre paradigmes, compétition que les batteries de tests seraient impuissantes à résoudre, au grand désarroi des économistes traditionnels.
Dans ces conditions, on comprendra que la littérature récente sur les paradigmes en économie se soit cristallisée autour de la polarité constituée par l’opposition d’un “paradigme néo-classique” (ou “paradigme bourgeois” comme certains aiment dire) et d’un “paradigme radical” (ce dernier étant souvent, mais pas toujours, associé à un paradigme dit “marxiste”). Cette polarité pourtant devait vite faire apparaître une profonde ambiguïté dans cette façon de voir : en effet, si la mise en relief des traits décisifs de l’un de ces deux prétendus paradigmes pouvait s’avérer assez simple, il était manifestement plus difficile de bien cerner le second. En effet, on pouvait assez facilement montrer que l’économie dominante dite néo-classique pouvait, à maints égards, être rapprochée de ce que Kuhn appelle un paradigme, soit une façon pour une communauté scientifique relativement homogène de pratiquer une activité scientifique en partageant des définitions, des modèles, des valeurs et surtout des façons de résoudre les problèmes, c’est-à-dire de s’adonner à la pratique du “puzzle-solving” qui caractérise, selon Kuhn, son fonctionnement normal. Tous ces traits peuvent être assez aisément identifiés dans la tradition néo-classique, encore qu’on peut se demander si d’importantes différences (concernant le rôle de la vérification et l’universalité des lois) entre sciences économiques et sciences naturelles ne rendent pas plus problématique que prévu l’application de la notion de paradigme à l’approche partagée par l’ensemble des économistes néo-classiques. C’est, en tout cas, ce que reconnaît G.E. Peabody dans son article d’introduction [4] au numéro mentionné plus haut de Review of Radical Political Economics, même s’il recommandait avec conviction l’utilisation de la notion de paradigme pour rendre compte du conflit opposant néoclassiques et radicaux.
Quoi qu’il en soit du caractère paradigmatique ou pas de l’économie néo-classique, c’est la définition de l’autre paradigme, le paradigme dit “radical”, qui devait surtout s’avérer difficile. S’il est en effet indubitable qu’une communauté [198] d’économistes radicaux est parvenue à se structurer de façon de plus en plus nette, au cours des deux dernières décennies, et que les membres de cette communauté se sont trouvés reliés assez étroitement par des convictions politiques et même épistémologiques assez définies, s’il n’est pas moins certain que, grâce à un réseau de publications de plus en plus efficace en anglais, en français et en d’autres langues occidentales, ces convictions ont pu faire l’objet de discussions critiques de plus en plus articulées, il demeure vrai qu’il serait bien difficile de trouver dans ce milieu théorique en effervescence l’équivalent de ce que Kuhn appelle une “pratique de la science normale”.
Sans doute que les avis là-dessus ne se rejoignent pas tous, mais le constat d’une déficience sur ce plan est difficile à éviter. C’est ainsi que Robert Solow, le plus néoclassique peut-être des économistes néo-classiques, répondait à John Curley, convaincu de la pertinence de l’opposition des deux paradigmes, que s’il y avait bien un “paradigme néo-classique”, on ne pouvait parler de “paradigme radical” : “It is more a matter of posture and rhetoric than a scientific framework at all”, car, poursuivait-il plus loin, “there is little evidence that radical political economics is capable of generating a line of normal science, or even it wants to [5]”. On ne n’étonnera guère de voir les choses présentées autrement par Paul Sweezy, l’un des pères de l’économie radicale d’ailleurs indissociable chez lui de l’économie marxiste, mais ce que Sweezy voulait avant tout expliquer, c’était justement le faible développement de la science normale au sein du “paradigme radical” qui aurait été fortement ralenti par les exclusions dont les défenseurs de cette approche ont pu être victimes, tant en régime socialiste qu’en régime capitaliste : “In these circumstances”, soutient-il, “what is perhaps remarkable is that so much rather than so little has been accomplished [6]”.
Pourtant un paradigme, défini essentiellement par une pratique, peut difficilement être jugé sur la base de ce qu’il aurait dû être dans le contexte social encore hypothétique qui aurait pu éventuellement le rendre possible. Aussi, [199] paraît-il plus juste de reconnaître que, malgré le discours parfois trompeur de certains de ses défenseurs, qui ont facilement tendance à emprunter le langage à coloration hautement scientifique des économistes néo-classiques auprès desquels ils ont été formés, l’économie radicale n’est pas parvenue à développer et n’a peut-être pas cherché vraiment à développer une pratique de la science normale, pour la bonne raison qu’elle y aurait sans doute vue s’émousser l’inspiration critique qui la soutient essentiellement. Aux yeux de nombre de ses adeptes, qui se méfient vivement de tout ce qui paraît apparenté à la tradition néo-classique, le fait même d’accepter un fonctionnement scientifique de même type serait une concession qui permettrait une récupération par la science officielle d’un radicalisme par là assagi. Certains d’entre eux, comme l’indique Peabody lui- même en évaluant une autre contribution du numéro spécial qu’il présente, mettent carrément en cause “the utility of the usual normal science route to understanding” [7]. Issue sans doute de la crainte de voir leur entreprise récupérée par l’économie dominante, comme le furent bien des travaux critiques développés dans un langage plus scrupuleusement académique, cette méfiance systématique des économistes radicaux leur ouvre grande la voie de la critique, mais leur ferme, du même coup, celle que devrait emprunter une éventuelle pratique de la “science normale”.
Comment alors donner quelque consistance au paradigme radical ? Une réponse revient à peu près dans tous les textes des économistes radicaux, qui nous oriente non point vers la méthode et les procédures, mais vers les postulats et le champ d’application : alors que le paradigme néoclassique suppose que les relations entre les hommes reposent sur une forme de rationalité qui débouche finalement sur une certaine harmonie, le paradigme radical mettrait l’accent avant tout sur les conflits entre des classes guidées par des intérêts irréductiblement opposés. “Are individuals utility maximizers acting in isolation in a free market, or are they members of a class whose common class interests are defined by that class’s conflicts with other classes in society ?” [8] Voilà comment Peabody formule ce critère, qui était déjà celui de Sweezy [9] et de Gurley [10], et qui sera repris, dans une analyse qui se rattache davantage à la tradition continentale, par Michel De Vroey. [11]
[200]
Le paradigme radical serait donc défini moins par une façon de procéder, dans la pratique de la science, que par une façon de voir l’objet même de cette science. Sans doute, Kuhn a-t-il souvent associé paradigmes et visions du monde, mais cette relative imprécision dans la définition des paradigmes a suscité, on le sait, les principaux reproches faits à son ouvrage, reproches auxquels il s’est attaché à répondre dans le fameux “postscript” ajouté à la seconde édition de celui-ci. Il distinguait alors entre deux sens à donner au mot paradigme, l’un général et finalement assez peu original, auquel il préférait réserver désormais le nom de “matrice disciplinaire”, désignant l’ensemble de ce qui est susceptible d’être partagé par une communauté scientifique, l’autre, qu’il propose de désigner par le nom d’“exemplars”, constituant à ses yeux “the most novel and least understood aspect of this book” [12]. Ces “exemplars”, explique-t-il, ce sont les façons de résoudre les problèmes qui, dans une communauté scientifique, sont littéralement inculquées aux membres (via, en particulier, les exercices proposés par les manuels) avec la diffusion de la science normale.
Il est significatif que Peabody, qui, au début de son texte, examine avec attention les thèses de Kuhn et cette distinction du ‘postscript’ en particulier, souligne que les économistes radicaux, traitant cette question dans le numéro spécial, s’en sont tenus au premier des deux sens distingués par Kuhn [13]. Le sens de la notion de paradigme qui est véritablement original, et qui renvoie à la notion de science normale, ne sera tout simplement pas retenu. Celui qui le sera, c’est celui qui renvoie assez vaguement à l’ensemble des idées partagées par une communauté scientifique et, dans le cas qui nous intéresse, à l’ensemble des postulats et des valeurs acceptés par cette communauté. Or, ce sens n’a rien de très original, car on savait, bien avant Kuhn, que diverses communautés scientifiques se sont affrontées dans divers contextes au nom de postulats et de valeurs opposées. Le mérite de Kuhn serait certes assez mince, s’il n’avait consisté qu’à forger le terme équivoque et, de son propre aveu, “inapproprié” [14] de “paradigme” pour désigner ces façons collectives de voir les choses.
En s’en tenant à ce premier sens, on pourrait, sans trop forcer les choses, dénicher en physique un paradigme disons [201] spiritualiste, qui désignerait la philosophie naturelle de ceux qui, au XIXe siècle en particulier, se sont opposés à la démarche jugée trop matérialiste d’une physique brutalement indifférente aux valeurs spirituelles. On pourrait alors, sur cette base, suggérer qu’entre la physique matérialiste classique et la physique “spiritualiste”, le choix serait d’ordre axiologique et la décision scientifique virtuellement impossible, mais ce serait là, bien entendu, trahir la pensée de Kuhn qui s’est vivement défendu dans le “postcript” contre toute interprétation relativiste ou subjectiviste qu’on voudrait prêter à son œuvre. Si le ‘postscript’ nous apprend quelque chose, c’est que sa contribution est ailleurs et qu’elle tient essentiellement au deuxième sens du mot paradigme. Ce concept, en effet, est intéressant et novateur dans la mesure où il permet de mettre en lumière, selon Kuhn, la véritable nature des “révolutions scientifiques”, mais aussi, et du même souffle comme l’auteur le suggère, celle du ‘‘progrès scientifique” [15].
Si l’on a pu être tenté d’appliquer cette théorie du progrès scientifique à l’antinomie irréductible entre façons diamétralement opposées de concevoir l’activité scientifique, c’est sans doute que Kuhn s’est intéressé prioritairement à ces moments de l’histoire d’une science où une révolution théorique s’affirme, en bouleversant les cadres habituels à l’intérieur desquels les hommes de science parviennent à communiquer. Seulement, les ruptures de communication qui s’ensuivent n’ont lieu, selon lui, qu’entre des groupes de théoriciens qui s’attaquent grosso modo au même champ théorique, selon des approches reliées par de nombreux points communs : “except in a small if all-important, area of expérience even their neural programming must be very nearly the same for they share a history, except the immédiate past” [16]. C’est justement l’importance de ces éléments communs qui justifiera l’idée d’une sorte de traduction d’une théorie dans l’autre, traduction qui serait pour Kuhn l’instrument d’une conversion possible — et à plus ou moins long terme probable — à l’une d’entre elles.
D’ailleurs l’exemple le plus volontiers utilisé pour illustrer cette idée d’un changement de paradigme est celui du passage progressif de la physique newtonienne à la physique einsteinienne. Malgré l’évidence d’une crise de la physique, au début du siècle, et malgré l’impact non négligeable des [202] facteurs psycho-sociologiques qui ont contribué à orienter peu à peu vers le nouveau paradigme les jeunes physiciens, moins marqués que leurs aînés par le triomphalisme de la physique du XIXe siècle, il est inutile d’insister sur l’importance du terrain commun que les “einsteiniens” partageaient avec les “newtoniens”. D’autre part, il est bien connu que l’ensemble des résultats auxquels la physique de Newton était parvenue ont pu être traduits dans le langage propre au nouveau paradigme, même si plusieurs esprits sont restés ou restent encore attachés à l’ancienne formulation toujours valable, on le sait, pour le cas particulier de l’ordre de grandeur caractéristique de notre vie quotidienne, où elle constitue une approximation plus que satisfaisante. On voit aisément, par cet exemple, qu’une telle perception de l’évolution de l’histoire de la physique ne condamnait nullement celle-ci à fluctuer, sans espoir de progrès, au gré des processus sociologiques qui valideraient telle ou telle façon de concevoir l’activité scientifique. Kuhn, on s’en convaincra rapidement, n’est en rien le champion d’une sorte de relativisme fondé sur l’incommunicabilité entre diverses écoles de pensée, relativisme dont les sceptiques grecs au demeurant avaient, depuis fort longtemps, exploré à peu près toutes les facettes.
Aussi à moins de pouvoir identifier un paradigme qui partagerait un large terrain commun avec le prétendu “paradigme néo-classique”, tout en s’en écartant par quelque dimension décisive sans que, pour autant, puisse être rejetée par principe la possibilité d’une traduction de l’un à l’autre — situation que veulent justement dénoncer comme insuffisamment radicale les principaux adeptes d’un paradigme radical — on ne voit pas ce que l’on gagne à emprunter à Kuhn un langage dont tout l’intérêt est de rendre compte des révolutions scientifiques d’un tout autre ordre, qui ont apparemment eu cours périodiquement et à différents niveaux dans les sciences naturelles [17].
Vaut-il mieux parler d’un “paradigme marxiste” ?
Avant toutefois de tirer cette conclusion négative sur la pertinence de l’application des concepts de Kuhn à l’analyse de la critique bien réelle (et souvent fondée) que l’économie radicale poursuit à l’égard de l’économie néo-classique, il convient de se demander si, plutôt que de définir négativement le paradigme contestataire, il n’y a pas lieu de le [203] définir positivement, comme celui qui est caractérisé par l’effort collectif, poursuivi par nombre d’économistes depuis un siècle, pour tirer parti des instruments théoriques que Karl Marx aurait profondément transformés et rendus aptes à permettre l’analyse véritablement scientifique de phénomènes que l’économie traditionnelle n’aborderait que de façon trop superficielle. Le Capital en effet a souvent été perçu comme le modèle théorique d’un vaste projet scientifique dont le programme devait être réalisé peu à peu par des générations de marxistes. Or, si la philosophie “radicale” du conflit social et de la lutte des classes était bien au coeur de ce projet, celui-ci n’en partageait pas moins avec l’économie conventionnelle la prétention d’expliquer scientifiquement des phénomènes économiques fondamentaux comme le niveau des salaires ou des profits — et cela, à l’aide de modèles reposant sur quelques postulats familiers à chacun comme la libre concurrence ou la maximation des profits. Aussi, s’il nous a paru vain de parler d’un “paradigme radical” qui aurait été défini essentiellement par la critique radicale qu’il adressait à un éventuel “paradigme néo-classique”, peut-être serait-il éclairant par ailleurs de parler de la compétition entre deux paradigmes visant à rendre compte, sur des bases différentes, de phénomènes analogues, soit un “paradigme marxiste” et un autre paradigme que l’on continuera d’identifier comme “néoclassique”. Tous les marxistes, dont plusieurs se veulent critiques avant tout sur le plan théorique, ne seraient pas prêts à voir les choses ainsi ; mais ceux — et ils sont nombreux — qui défendent l’idée d’une “économie politique marxiste” seraient sans doute assez à l’aise dans une telle perspective.
Présentée de cette façon cependant, cette compétition nous oblige à remonter le cours d’une longue histoire, puisque le premier livre du Capital, on le sait, est paru avant même que soient publiés les premiers travaux des auteurs marginalistes qui sont à l’origine du “paradigme néo-classique”. Qui plus est, dans la mesure même où l’on met en relief l’aspect analytique plutôt que l’aspect critique de la pensée de Marx, on sera tenté de situer celle-ci dans le prolongement de l’approche “classique”, illustrée surtout par l’analyse économique de David Ricardo. Or, s’il en est ainsi, ce serait plutôt l’économie marginaliste (ou néoclassique) qui serait apparue dans l’histoire comme un [204] nouveau paradigme tendant à se substituer au vieux paradigme classique, que Marx aurait profondément renouvelé, sans doute, mais néanmoins conservé pour l’essentiel.
Si l’on s’efforce maintenant d’identifier le lieu précis où s’est amorcé cette rupture de communication, cette restructuration théorique fondamentale, qui a opposé le “paradigme marginaliste” au “paradigme classico-marxiste”, on reconnaîtra aisément, avec la plupart des historiens de la pensée économique, qu’il se situe au niveau de la théorie de la valeur, qui constitue, pour l’une et l’autre approche, la base de toute la théorie, mais qui repose respectivement sur des postulats fort différents. Aussi, ne s’étonnera-t-on pas de ce que, bien avant la publication de l’ouvrage de Kuhn, les défenseurs de la thèse marginaliste aient opposé volontiers la théorie “moderne” (c’est-à-dire marginaliste) de la valeur à la théorie classico-marxiste de la valeur-travail, comme si ces deux théories relevaient de deux “paradigmes” dont le plus ancien devait rapidement s’estomper au profit du plus moderne. C’est ainsi en tout cas que Maurice Dobb, l’un des plus remarquables économistes marxistes du XXe siècle, décrivait dès 1937 ce qu’il dénonçait déjà comme l’un des clichés favoris de la pensée économique dominante :
- The modern theory of value, product in the main of the final decades of the nineteenth century, divides the economics of today from that of a century ago much as Newton s principles divided the work of his successors from pre-Newtonians physics. [18]
Dobb entendait bien s’inscrire en faux contre cette analogie, mais c’était pour relever le défi sur le terrain proposé par l’adversaire. Il reconnaît d’abord l’ampleur du succès apparent de ce que, vingt-cinq ans plus tard, on aurait été tenté d’appeler le “paradigme marginaliste” en y voyant l’ancêtre du “paradigme néo-classique” ; et il le fait en des termes qui ne peuvent que nous surprendre par leurs accents étonnamment kuhniens :
- A rival value theory was to rise and with remarkably little resistance to conquer the field. This was the utility-theory, which seems to hâve germinated simultaneously in several minds, being enunciated alike by Jevons in this country and by Menger and Wieser and Böhm-Bawerk of the Austrian School. The new theory had the attraction of ingenuity and elegance as well as of novelty... [19]
Pour lui, en défendant une telle théorie, Böhm-Bawerk entendait apporter une réponse plus satisfaisante à une [205] question déjà posée par les classiques et par Marx en particulier :
- While he is sparing, almost niggardly, in paying tribute to Marx even for formulating the question accurately, there is every indication that he framed his theory directly to provide a substitute answer to the questions which Marx had posed. [20]
Dobb poursuit en rappelant encore l’étonnante rapidité avec laquelle la “communauté scientifique”, si l’on ose dire, s’est tournée vers la nouvelle théorie :
- The new principle was finding a receptivity to its acceptance such as very few ideas of similar novelty can ever have met. [21]
Une fois reconnu cet état de choses, Dobb s’est efforcé contre vents et marées, de montrer que ce que l’on aurait pu appeler le nouveau paradigme (fondé sur l’utilité) pouvait néanmoins s’avérer bien inférieur à l’ancien (fondé sur le coût de production et le travail en particulier) pour qui veut vraiment rendre compte des phénomènes économiques [22]. Quoi qu’il en soit de la valeur des arguments proposés par Dobb dans cette critique des marginalistes, il faut reconnaître que pour qu’il y ait un sens à situer le débat sur ce terrain et à présenter, somme toute, les choses comme une compétition entre paradigmes, il fallait associer étroitement, comme Dobb l’a fait, l’approche marxiste à l’approche ricardienne. Or, comme bien des auteurs marxistes modernes l’auront vu, l’évocation d’un front uni ricardiano- marxiste, déployé sur un terrain tenu par Ricardo et revendiqué par les marginalistes, suffisait à dissoudre l’originalité de Marx dans la problématique ricardienne où le concept central est moins celui de valeur-travail que celui de difficulté de production [23].
Sans doute, pourrait-on légitimement s’intéresser à une lecture kuhnienne du débat, fort actuel aujourd’hui, entre les classiques et les néo-classiques ; mais il ne semble pas qu’on puisse en attendre beaucoup plus qu’un enrichissement du vocabulaire auquel on a eu recours pour décrire ce que traditionnellement l’on a appelé la “révolution marginaliste” [24]. Quoi qu’il en soit, puisque l’application des concepts de Kuhn qui semble avoir suscité un véritable débat en économie concerne essentiellement l’existence d’un éventuel paradigme “radical” ou “marxiste”, c’est à l’examen de cette seule question que nous allons nous en tenir ici.
[206]
Aussi, pour redonner à l’approche marxiste toute l’originalité qu’elle perdait dans une association trop étroite à l’approche ricardienne, demandons-nous plutôt si la théorie proprement marxiste de la valeur ne pourrait constituer la base d’un paradigme autonome, pouvant entrer en compétition, tant avec le paradigme classique à l’égard duquel Marx a su, n’en déplaise à Dobb, prendre ses distances, qu’avec le paradigme néo-classique auquel s’en prennent les marxistes d’aujourd’hui. Il semble en effet que les débats modernes autour de la théorie marxiste de la valeur-travail se sont orientés selon cet axe plutôt que selon celui suggéré par Dobb, et cela pour une double raison : d’une part, parce que Dobb surestimait la rupture entre Ricardo et les néoclassiques et d’autre part, parce qu’il sous-estimait la distance entre Ricardo et Marx.
Si grande que paraisse en effet la distance entre classiques et néo-classiques et si vive qu’ait été l’opposition de Jevons et des premiers marginalistes à toute théorie de la valeur fondée sur les coûts de production, il faut admettre que, sous l’influence de divers économistes postérieurs et en particulier d’Alfred Marshall, la théorie proprement néoclassique des prix a tôt fait d’intégrer une théorie des coûts de production qu’elle associait à la thèse de Ricardo [25]. Cette dernière s’en trouvait, il est vrai, profondément modifiée ; mais les coûts de production, transformés subrepticement en coûts des facteurs de production, n’en doivent pas moins être considérés comme l’une des composantes essentielles de la théorie néo-classique des prix et plus particulièrement des prix à long terme. Aussi, paraît-il assez difficile de suivre Dobb quand il voit dans l’importance accordée aux coûts (“cost-principle”) [26], la base d’une opposition irréductible entre classiques et néo-classiques. Samuelson lui-même [27], dont nul ne suspecterait l’orthodoxie néoclassique, n’hésite pas, dans le sillage de Leontief, à recourir à une théorie des prix fondée avant tout sur le coût des input (tenant compte des input en travail), c’est-à-dire à une théorie explicitement apparentée à celle de Ricardo.
D’autre part, Maurice Dobb, dont on sait qu’il était à fois défenseur héroïque de Marx et co-éditeur des œuvres de Ricardo, a manifestement tendance à atténuer la distance entre ces deux théoriciens. Il est vrai que Marx a beaucoup emprunté à Ricardo et que c’est sur un tout autre [207] plan que sur celui de la théorie de la valeur qu’il situait le fossé qui le séparait des économistes classiques ; mais c’est, pour une large part, parce qu’il croyait pouvoir, dans le livre III du Capital, apporter une solution satisfaisante au fameux problème de la transformation, qui consistait à concilier les prix de production ricardiens et l’analyse proprement marxiste de la valeur-travail développée dans le livre I du Capital.
Aussi, face à ce qu’on aurait pu appeler le paradigme classique dominé par l’école de Ricardo, l’approche nouvelle que Marx proposait dans le livre I aurait pu être considérée à assez bon droit comme l’expression d’un paradigme nouveau : Marx s’inscrivait juste assez profondément dans la tradition ricardienne pour que l’on puisse parler d’une compétition réelle entre les deux paradigmes et même pour que soit possible la traduction au sens évoqué par Kuhn de l’un dans l’autre. On pourrait même dire que l’histoire du débat sur la transformation des valeurs en prix serait l’histoire de cette tentative de traduction.
Toutefois, il se trouve que la solution proposée par Marx à ce problème de la transformation — solution qui devait en quelque sorte intégrer à l’analyse proprement marxiste l’essentiel de la théorie ricardienne des prix de production et les conséquences théoriques qui en découlaient — s’est avérée décevante et erronée, malgré l’éclat avec lequel Engels en avait annoncé la publication posthume. Sans doute une solution satisfaisante a depuis été apportée à ce problème, à partir de l’intervention décisive de Bortkiewicz en 1907 [28], mais, si l’on était tenté d’y voir la clef de la traduction d’un paradigme dans l’autre, il faudrait parler, à l’inverse de ce qui était visé à l’origine du débat, d’une intégration de l’approche marxiste à l’approche ricardienne, ainsi que l’a bien montré Gilles Dostaler, dans son analyse historique de ce débat [29], dont la conclusion rejoignait là-dessus celle de divers auteurs tout aussi sympathiques à Marx.
Il est vrai qu’il y a d’autres auteurs marxistes, comme Ernest Mandel [30] ou — pour des raisons un peu plus subtiles — Pierre Salama [31], qui néanmoins se sentiraient apparemment à l’aise au sein d’un “paradigme” pour lequel la théorie de la valeur-travail permettrait seule de rendre vraiment [208] compte des prix. Si toutefois l’on était sérieusement tenté d’opposer de ce fait un “paradigme axé sur la valeur” à un “paradigme axé directement sur les prix de production”, on serait forcé d’interpréter la longue histoire du débat sur la transformation comme celle du glissement progressif de plusieurs théoriciens de la question, parmi les plus remarquables, d’un “paradigme déclinant” fondé sur la valeur-travail vers un “paradigme” fondé sur les prix de production, qui serait de ce fait en plein essor. L’un des exemples les plus représentatifs d’un tel glissement serait l’évolution spectaculaire de l’économiste marxiste Ronald Meek, auteur en 1956 d’une tentative de justification d’une interprétation franchement marxiste de la transformation de la valeur et défenseur en 1973 d’une interprétation néo- ricardienne des prix de production à légère coloration marxiste, interprétation à propos de laquelle il pouvait lui- même porter le jugement suivant : “In all this, it is true, the Marxian ‘labour theory of value’ as such is pushed into the background” [32].
C’est ainsi, pourrait-on être tenté de penser, que, selon Kuhn, les théories insatisfaisantes ne sont habituellement pas condamnées sans recours, mais qu’elles sont peu à peu reléguées à l’arrière-scène d’où on peut toujours les tirer pour montrer qu’elles sont parfaitement valables dans certaines circonstances particulières et qu’elles constituent d’ailleurs une approximation souvent utile.
On ne saurait donc s’étonner de ce désintérêt progressif à l’égard de la théorie de la valeur-travail, conçue comme instrument de la détermination des prix, car les économistes, marxistes ou pas, qui se sont intéressés au problème de la transformation, ont, pour la plupart, reconnu assez rapidement qu’il est parfaitement possible de déterminer, sans recourir le moindrement aux valeurs-travail, les prix de production qui prévalent théoriquement dans une société capitaliste. Ils ont montré, chacun à leur façon, que toute théorie visant à fonder significativement ces prix sur un calcul des valeurs-travail n’aurait de sens que dans certaines conditions bien particulières, qu’un économiste attentif à la démarche de Marx comme Morishima [33] est parvenu à déterminer avec une remarquable précision. Comme Ricardo lui-même l’avait indiqué sans équivoque [34], dans la situation qui prévaut normalement, le calcul en quantité de travail ne [209] saurait fournir qu’une “approximation” dont le calcul en prix de production dégagerait la formule exacte. Une telle approximation n’aurait alors d’autre avantage que celui de ne faire appel qu’aux mathématiques les plus rudimentaires, comme Samuelson le souligne avec condescendance.
Bref, l’abandon du calcul en valeur au profit du calcul en prix n’aurait été, pour ceux qui auraient vu là une véritable “compétition”, que l’abandon de la formule approximative pour la formule exacte et du cas particulier pour le cas général. Si donc l’on devait interpréter cette compétition, inaugurée par Engels, comme une compétition entre paradigmes rivaux, il paraît évident qu’elle aurait débouché sur des résultats diamétralement opposés à ceux qu’attendaient les plus fervents défenseurs de l’application des concepts de Kuhn à l’économie.
*
* *
Toutefois, pour nombre de penseurs marxistes contemporains qui refusent de situer la théorie de Marx sur le même plan que celle de Ricardo et mettent au centre de la théorie de la valeur-travail les notions de travail abstrait et de fétichisme de la marchandise, il aura été bien artificiel et vain de parcourir ce long détour pour tenter de prêter au prétendu “paradigme radical” une consistance qui lui aurait peut-être donné l’allure d’un paradigme au sens de Kuhn, mais non pas sans lui enlever du même coup ce qui aurait pu en faire le paradigme de l’avenir. Pourquoi, diraient-ils, vouloir réduire la pensée de Marx à ce qu’il y a de ricardien en elle et qui débouche sur un cul-de-sac, alors que l’inspiration critique originale qui la sous-tend demeure sa contribution la plus essentielle et la plus décisive ? Cependant les marxistes qui auront adopté cette façon de voir auront, du même coup, refusé de faire de l’approche qualitative et critique qu’ils défendent une version améliorée de l’économie politique : ils auront donc renoncé a fortiori à invoquer une théorie de l’évolution interne des sciences pour rendre compte de ce qu’ils ne se résignent pas à considérer [210] comme un discours scientifique au même titre que les autres. Si l’analyse ci-dessus nous a appris quelque chose, c’est qu’une démarche authentiquement radicale et critique à l’égard de la science ne peut trouver, fût-ce dans une théorie des révolutions scientifiques, la caution qui, en lui conférant la dignité de paradigme, l’investirait provisoirement du type de légitimité qu’elle tend à mettre en cause.
Considérée comme une contribution positive à l’analyse économique, la pensée de Marx peut certes être présentée comme une révolution théorique importante face à une économie classique qui stagnait depuis quelque temps ; mais ses éléments les plus intéressants sur le plan théorique ont été depuis longtemps, encore que de façon indirecte et presqu’inconsciente, récupérés par l’élément le plus dynamique de la pensée dominante aujourd’hui : s’il y a eu un paradigme marxiste, c’est dans un passé déjà lointain qu’il a connu une heure de gloire que ses adversaires, il est vrai, ont tout fait pour dénigrer. Considéré comme une inspiration critique par contre, le marxisme a connu, au cours des récentes années, un regain de vitalité qui lui permet de jeter désormais sur l’économie néo-classique dominante le regard critique incisif que Marx portait sur l’économie classique. Les économistes radicaux sont peut-être alors les authentiques dépositaires de cette tradition, et sans doute ont-ils raison de voir dans le traitement discret et policé des conflits sociaux proposé par l’économie dominante le talon d’Achille de celle-ci ; mais il est absurde alors de chercher à enfermer cette dénonciation dans un langage emprunté à Kuhn, lequel, en la traitant comme une analyse scientifique liée à un ensemble de règles, en manifeste l’insuffisance et en inhibe le pouvoir critique.
On ne peut bien sûr rejeter a priori, de ce fait, toute application valable de la pensée de Kuhn dans les sciences économiques : elle pourrait par exemple, comme le suggère Coats [35], contribuer, moyennant quelques adaptations qui s’imposent, à mettre en relief certains traits importants de ce que l’histoire de la pensée économique désigne souvent comme la révolution keynésienne. Toutefois, il paraît clair qu’elle ne constitue en rien un instrument adéquat pour poursuivre l’analyse à laquelle on a été surtout tenté de la [211] faire servir, soit celle des crises et des débats théoriques particulièrement importants et percutants qui sont propres aux sciences sociales, parce qu’ils sont liés aux dimensions idéologiques rencontrées de front par celles-ci. C’est donc vers d’autres instruments théoriques qu’il faudra se tourner pour rendre compte de ces aspects plus troubles de l’histoire de ces sciences, en repoussant une fois de plus la tentation, souvent dénoncée par les auteurs marxistes et radicaux, d’emprunter aux sciences naturelles des théories et des concepts qui, pour les praticiens des sciences sociales, ont toujours quelque chose de faussement rassurant.
 Maurice Lagueux Maurice Lagueux
*
* *
[212]
*
* *
[213]
Abonnements.
L’importance des abonnements pour la stabilité financière d’une revue n’est plus à souligner. $ 12.00 pour un abonnement annuel de trois numéros, ou si vous le pouvez, un abonnement de soutien de $15.00, ce n’est pas beaucoup mais, vous nous apportez plus qu’une simple contribution financière ; vous contribuez de la sorte, à la réalisation de la revue et de ses objectifs.
- Notre adresse :
- Interventions
- 3553 St-Urbain,
- Local 320, Montréal, H2X 2N6.
[214]
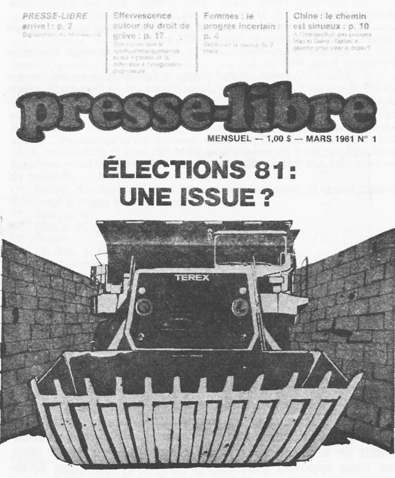
[1] KUHN, Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions, second édition enlarged, Chicago : University of Chicago Press, 1970. xii/210 p. Les notes renvoient à cette seconde édition anglaise incluant le “Postscipt” de 1969 (pp. 174- 210). Traduction française (de la 2e édition) : La structure des révolutions scientifiques, Paris : Flammarion, 1972. 246 p. (Nouvelle Bibliothèque scientifique).
[2] Pour une discussion du problème épistémologique posé par ce fait, on lira la remarquable analyse présentée in CARTELIER, Jean. “Valeur ou enrichissement : Le dilemme de l’économie politique”, Accès, (mars 1979), pp. 25-52.
[3] MACHLUP, Fritz. “The problem of Vérification in Economies”, Southern Economic Journal, vol. XXII, no 1 (july 1955) pp. 4-5.
[4] PEABODY, Gerald E. “Scientific Paradigms and Economies : an introduction”, Review of Radical Political Economics, vol. III, no 2 (july 1971) p. 5.
[5] Voir p. 64 de la discussion qui suit le texte de Gurley in GURLEY, John G. "The State of Political Economies”, American Economies Review (Papers and Proceedings), vol. LXI, no 2 (may 1971), pp. 53-62. Suivi des commentaires de R. Solow (pp. 63-65), de R. Heilbroner (pp. 65-67) et de H. Reicken (pp. 67-68).
[6] SWEEZY, Paul M. “Toward a Critique of Economics”, Review of Radical Political Economics, vol. III, no 2 (july 1971) pp. 64-65.
[7] PEABODY, Gerald E. art. cité, p. 10.
[8] Ibid., p. 9 ; cf. aussi pp. 11, 12 et 14.
[9] SWEEZY, Paul M. art. cité. p. 63.
[10] GURLEY, John G. texte cité, pp. 54-55.
[11] DE VROEY, Michel. “Une explication sociologique de la prédominance du paradigme néo-classique dans la science économique”, Economies et Sociétés, Cahiers de l’ISEA, tome VI, no 8 (août 1972) série HS, no 14, pp. 1676-1677.
[12] KUHN, Thomas S. op. cit., p. 187 (“postscript” de 1969).
[13] PEABODY, Gerald E. art. cité p. 15, note 3.
[14] KUHN, Thomas S. op. cit., p. 182, (“postscript” de 1969).
[17] Dans l’un des rares passages où il fait une discrète allusion aux sciences sociales (op. cit., pp. 178-179), Kuhn, il est vrai, est amené à concéder que, même dans la période pré-paradigmatique, où s’affrontent typiquement des écoles de pensée irréductibles, les membres de chacune de ces écoles partagent quelque chose qui ressemble à un paradigme (et qu’on pourrait à la rigueur appeler “paradigme” dans un autre sens du mot). Toutefois il faut bien convenir qu’à propos des paradigmes pris en ce sens, Kuhn ne semble pas devoir ni vouloir nous apprendre quoi que ce soit qui puisse nous éclairer sur l’évolution des conflits entre ces écoles de pensée. Dans un bref passage d’un texte (MERTON, Robert K. “The Sociology of Science. An Episodic Memoir”, pp. 3-141 in MERTON, Robert K. and GASTON Jerry, eds. The Sociology of Science in Europe. Carbondale : Southern Illinois University Press et London : Feffer and Simons, 1977. 383 p., cf. pp. 107- 109) porté à l’attention de l’auteur après la rédaction de ces pages, Robert Merton constate que la tendance a été grande à prêter abusivement à Kuhn une orientation soit subjectiviste, soit révolutionnaire au sens politique du mot. À l’appui de cette thèse, il cite d’ailleurs un passage de SAMUELSON (“The ‘Transformation’ from Marxian ‘Values’ to Competitive ‘Prices’ : A Process of Rejection and Replacement”, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 67, no 1 (sept. 1970), pp. 423-425) : “I knew that in the social sciences the Kuhn paradigm about paradigms would be rampantly misused. This prediction has, alas, been abundantly fulfilled”.
[18] DOBB, Maurice H. Political Economy and Capitalism, 2nd édition, London : Routledge & Kegan Paul, 1940, viii/357 cf : pp. 1-2.
[23] Voir à ce sujet BENETTI, Carlo et CARTELIER, Jean. “Mesure invariable des valeurs et théorie ricardienne de la marchandise” pp. 137-167 in BENETTI et alia, Marx et l'économie politique. Essais sur les “Théories sur la plus-value”, Grenoble : Presses universitaires et Paris : François Maspero, 1977. 211 p.
[24] Les timides suggestions de Gordon “The Contribution of the History of Economic Thought to the Understanding of Economic Theory, Economic History and the History of Economic Policy”. American Economie Review, vol. 55, no 2 (may 1965), p. 124, qui incidemment paraît être le premier à avoir importé le langage de Kuhn en économie, et de Coats “Is there a ‘structure of scientific revolutions’ in economics ?”, Kyklos, vol. 22 (1969), p. 294, ne paraissent pas, compte-tenu des réserves dont elles sont assorties, devoir nous permettre d’espérer beaucoup plus sur ce plan.
[25] Voir en particulier l’appendice I des Principles of Economics de Marshall ; on ne peut cependant parler, comme Marshall, d’une intégration pure et simple de la thèse de Ricardo à la théorie néo-classique : voir à ce sujet BENETTI, Carlo. Valeur et répartition, 2e éd., Grenoble : Presses universitaires et Paris : François Maspero, 1975, p. 92.
[26] Cf. DOBB, Maurice H., op. cit., p. 30.
[27] Voir SAMUELSON, Paul A. art. cité, pp. 423-425 et SAMUELSON, Paul A. “Understanding the Marxian Notion of Exploitation : A Summary of the So-Called Transformation Problem Between Marxian Values and Compétitive Prices”, Journal of Economic Literature, vol. IX, no 2 (june 1971), pp. 399-431.
[28] Cf. BORTKIEWICZ, Ladislaus von. “Zur Berichtigung der grundlegenden theoretischen Konstruktion von Marx im dritten Band des Kapital” ; traduction anglaise in SWEEZY (1949) : “On the correction of Marx’s Fundamental Theoretical Construction in the Third Volume of Capital”, pp. 197-221.
[29] Cf. DOSTALER, Gilles. Valeur et prix, histoire d’un débat, Grenoble : Presses universitaires, Paris : François Maspero et Montréal : Presses de l’Université du Québec, 1978. 180p.
[30] Cf. MANDEL, Ernest. Traité d’économie marxiste, Paris : Union générale d’éditions, 1962, tome 4.
[31] Cf. SALAMA, Pierre, Sur la valeur, éléments pour une critique, Paris : François Maspero, 1975. 254 p. (petite coll. Maspero no 158).
[32] Cf. MEEK, Ronald L., Studies in the Labour Theory of Value, second édition, London : Laurence et Wishart, 1973, p. xlii.
[33] Cf. MORISHIMA, Michio. Marx's Economics, Cambridge : Cambridge University Press, 1973, ch. 7.
[34] Cf. RICARDO, David. On the Principles of Political Economy and Taxation in The Works and Correspondence of David Ricardo, ed. by Piero Sraffa, volume I, Cambridge : Cambridge University Press, 1951. ch. 1, sect VI.
[35] COATS, A.W., art. cité, pp. 293-294.
|

