[219]
Roberto Moguelez
“Hegel et le Québec.”
Un texte publié dans le livre sous la direction de Mikhaël ELBAZ, Andrée Fortin et Guy Laforest, LES FRONTIÈRES DE L'IDENTITÉ. Modernité et postmodernité au Québec, pp. 219-230. Québec: Les Presses de l’Université Laval; Paris: L'Harmattan, 1996, 384 pp.
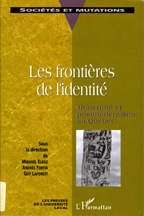
L’ère de l'individu : voilà en quelques mots seulement la façon dont on a caractérisé la modernité [1]. Double phénomène ou, plutôt, phénomène à deux faces, car, d'une part, c'est dans la modernité que les liens qui attachaient les individus les uns aux autres dans des groupements organiques ayant une existence propre se détendent, se fragilisent, voire se rompent, laissant ainsi libres les individus et que, d'autre part, et corrélativement, l'idée ou l'idéologie se forme de l'individu comme centre et/ou source des intérêts, voire des valeurs, mettant ainsi un terme aux vieux privilèges des corps supra-individuels, communautaires. La contemporanéité semble aller plus loin encore dans ce détachement des individus et leur promotion, car elle les voit élevés au rang d'unique réalité dans la mesure même où les individus ne sont plus que des sujets mais aussi des objets d'eux-mêmes : Narcisse, pour qui toute réalité s'épuise dans l'autocontemplation.
Ère du vide ? Ou ère, enfin, de la liberté ? Tout semble tourner autour de cette alternative simple : ou bien cette promotion, voire cet engendrement de l'individu – appelons-le l'« individualisme » –, augure sinon comporte la perte de toute authentique signification dans l'absence même de toute transcendance, ou bien, au contraire, cet individualisme a le sens d'une libération de l'individu, il signifie la fin de l'assujettissement à des normes, à des traditions, à des représentations, à des hiérarchies qui s'imposent sur les individus et les briment.
Puisqu'il n'y a, en apparence, que cette alternative simple, on n'en conclut qu'à deux pronostics, d'ailleurs contraires seulement en apparence : la hantise de l'anomie (l'horreur du vide) reconduira l'individu de l'individualisme [220] vers les identifications communautaires. Ou bien : l'individu contemporain, pleinement individualisé, c'est-à-dire autonomisé, n'aura plus à répondre de l'établissement d'une communauté, il lui suffira d'un espace (social) : aux rapports d'appartenance se substitueront de plus en plus des purs rapports contractuels.
Ce sont ces pronostics qui déchiffrent les symptômes. Les pourfendeurs de l'individualisme émancipateur crient, justement, au contractualisme de l'individualisme, coupable de penser les individus dans l'abstraction, puisqu'il les dépouille de leurs appartenances sociales naturelles – ethniques, linguistiques, religieuses. À quoi rétorquent les défenseurs de l'individualisme émancipateur en signalant du doigt les horreurs non du vide, mais de ces tentatives de le remplir avec les « intégrismes » et les « purifications ethniques ».
En cette triste fin de siècle, les événements semblent bel et bien donner raison aux uns et aux autres. On pourrait même fixer la position dans la conjoncture par rapport à ces deux axes : ou bien on se trouve engagé dans le paramètre de l'égoïsme, du narcissisme, de la décomposition ou de l'affaiblissement communautaire, bref entre le confort et l'indifférence, ou bien on se trouve dans la reconquête héroïque des particularismes, bref dans l'exaltation tribale ou religieuse.
Mais c'est surtout dans les moments de tristesse qu'il faut, comme le dirait Hegel, appréhender le sensible, l'événementiel, à partir du non-sensible, du non-événementiel, du raisonnable. Car ce raisonnable n'est pas ce qui est – bien que ce qui est, le soit pour des raisons –, mais plutôt ce qui doit être – en raison, c'est-à-dire pour la raison. Dans cette voie, Hegel n'est pas seulement à reprendre comme source d'inspiration philosophique ou méthodologique, mais aussi, et pour le problème qui m'occupe ici, comme source décisive de connaissance. Car Hegel est celui qui a découvert et exploré dans toute la profondeur de ses incidences ce rapport entre individualité, particularité et universalité qui se pose pour la première fois dans la modernité, mais dont la problématique n'a certainement pas trouvé encore la voie de sa résolution concrète.
C'est notamment dans les Principes de la philosophie du droit que Hegel examine ce rapport. Dans ce qui suit, je ne m'attacherai qu'à ses propositions les plus importantes à l'égard de cette problématique. J'essaierai, ensuite, d'en extraire les enseignements qu'elles contiennent pour envisager la question cruciale formulée au début de cet exposé. Deux remarques s'imposent, cependant, avant de commencer cet examen. Je dois dire, d'abord, qu'il n'y sera pas question d'une reprise évaluative, encore moins critique de la philosophie hégélienne, ni même de la perspective philosophique générale développée dans les Principes de la philosophie du droit. Et non pas que j'y adhère intégralement et que je ne les trouve pas, comme tant d'autres, susceptibles de critique, mais parce que ce n'est ni dans les intentions ni dans les possibilités de ce texte de mener à bien une telle reprise évaluative. Mon seul intérêt ici porte sur [221] la manière dont Hegel nous permet de penser l'articulation de l'individuel, du particulier et de l'universel.
Je m'empresse de signaler, ensuite, qu'il pourra paraître surprenant, à cause évidemment du titre de cet article, qu'aucune référence explicite ne soit faite au Québec. Ce manque de référence explicite ne paraîtra pourtant surprenant qu'à ceux qui, justement, ont besoin de références explicites. Bien que la question que je traite ici dépasse, et de loin, la conjoncture québécoise, puisqu'elle s'inscrit, d'emblée, dans une considération philosophique de la modernité, c'est la pensée de la conjoncture québécoise qui l'a inspirée et, donc, la traverse d'un bout à l'autre. Car, d'une part, la société québécoise est engagée, et ceci d'une manière de plus en plus approfondie, dans la dynamique d'une société dont l'individualisme trouve dans le marché ses racines et son impulsion et que, d'autre part, et malgré la nature de plus en plus cosmopolite de sa composition sociale, elle demeure attachée, voire prisonnière d'une identification de type ethnique.
INDIVIDUALITÉ, PARTICULARITÉ
ET UNIVERSALITÉ CHEZ HEGEL
Le premier paragraphe (182) de la deuxième section des Principes de la philosophie du droit situe dans « la personne concrète qui, en tant que particulière, est à elle-même son propre but » l'un des principes de la société civile (Hegel, 1975 : 215). Cet égoïsme qui domine alors la sphère de la société civile découle de la personne concrète en tant qu'elle se laisse déterminer, à ce stade de l'analyse, comme « ensemble de besoins », « mélange de nécessité naturelle et de volonté arbitraire » (ibid.). Or, parce que la personne concrète est ensemble de besoins, et que les besoins ne peuvent pas être satisfaits sans entrer en relation avec les autres, il en résulte pourtant un « système de dépendance réciproque » (ibid.) [2]. D'un autre côté, parce que la personne concrète est mélange de nécessité naturelle et de volonté arbitraire, et que la contingence marque alors la satisfaction des besoins, « la société civile offre tout à la fois le spectacle de la débauche, de la misère et de la corruption, aussi physique que morale » (ibid. : 246).
Pourtant, c'est dans cette société civile que se posent, pour la première fois, les conditions de réalisation du principe de la personnalité autonome, de la liberté subjective, de la particularité de la personne concrète, et ceci, dans la mesure même où la personne devient réellement, en tant qu'être particulier, son propre but. Ce qui veut dire que puisque c'est dans la modernité qu'émerge la société civile, c'est dans la modernité qu'émerge l'individu en tant que personnalité autonome [3]. On devrait même dire que c'est cette double et corrélative émergence de l'individu en tant qu'individualité et de la société civile qui définit, chez Hegel, la modernité.
La constitution de l'individu comme individualité a supposé ou entraîné l'arrachement de l'individu à ces groupements organiques particuliers dont [222] l'individu faisait partie justement à titre d'organe subordonné à la particularité du groupement, telle, par exemple, la famille [4]. Non pas, certes, que, pour Hegel, ces groupements organiques, et en particulier la famille, disparaissent avec l'émergence et le développement de la société civile, mais ils s'y trouvent subsumés et, davantage, dorénavant engagés dans une relation de dépendance par rapport à la société civile [5].
Or, qu'est-ce qui peut faire dès lors non pas la cohésion matérielle ou économique de la société civile – puisque cette cohésion est assurée par le « système des besoins », c'est-à-dire par la dépendance mutuelle qu'instaure le travail en vue de la satisfaction réciproque des besoins –, mais la cohésion spirituelle et, plus précisément encore, éthique de la communauté ? La réponse de Hegel est bien connue : c'est l'État.
Si cette réponse de Hegel est bien connue, il s'en faut de beaucoup qu'elle ait été toujours bien comprise. Dans une bonne partie de la philosophie contemporaine, c'est justement une certaine interprétation de cette réponse qui voue Hegel aux gémonies en tant que figure annonciatrice du totalitarisme d'État moderne. Or, c'est dans le lien dialectique indissoluble entre individu et État, c'est-à-dire, pour Hegel, entre singularité et universalité, entre liberté subjective et volonté substantielle générale, donc aux antipodes d'un totalitarisme d'État, que se trouve le sens de la réponse de Hegel [6]. C'est cette réponse qu'il est crucial d'examiner. Disons-le d'un mot, quitte à y revenir pour la saisir en profondeur : pour Hegel, seule l'instance de l'État peut, dans une société fondée sur le principe de l'autonomie des individus, de la liberté subjective, être l'instance productrice d'universalité. D'un autre point de vue, et corrélativement, seul un État voué à la production d'universalité peut garantir la réalisation du principe de l'autonomie des individus, de leur liberté subjective.
HEGEL ET LES ANTINOMIES DE LA MODERNITÉ
Hegel offre une réponse aux antinomies de la modernité postulées par la réflexion philosophique et sociologique contemporaine en pratiquant une double réduction qui n'a strictement rien d'un réductionnisme, bien au contraire, qui permet de saisir les phénomènes dans la richesse et la complexité de leurs déterminations. Cette double réduction consiste, pour l'essentiel, d'une part à montrer la nécessité de la contradiction qui caractérise l'antinomie, d'autre part à situer historiquement cette nécessité, autrement dit à la penser comme moment d'un processus. L’intérêt de cette méthode qui est, bien entendu, celle de la dialectique est qu'elle ne se borne pas à la compréhension des phénomènes, mais trace les voies raisonnables – au sens de « fondées en raison » – de leur dépassement et, par là, de la résolution des antinomies.
À la suite d'une telle réduction dialectique, l'affirmation du principe de la personnalité autonome, de la liberté subjective, de l'affirmation de la particularité de l'individu concret, c'est-à-dire de son individualité, apparaît, d'une [223] part, comme un moment historique et, en tant que tel, soumis à des conditions sociales précises [7] , d'autre part, comme principe qui ne peut s'affirmer en tant que tel qu'en opposition à ce qui le nie, à savoir celui de la particularité du groupement. La contradiction entre individualité et particularité qui caractérise l'antinomie individu/communauté apparaît ainsi, à ce stade premier de l'analyse, comme contradiction nécessaire, appréhendée comme logiquement nécessaire par la raison mais aussi constatée historiquement, c'est-à-dire dans son existence sensible. Car tant et aussi longtemps que l'individu demeure soumis aux déterminations de la particularité de son groupement – la famille d'abord, mais aussi, bien entendu, de tous ces groupements particularistes auxquels il appartient : le village, la tribu, le clan, etc. –, il ne peut ni logiquement ni sensiblement développer sa propre particularité, acquérir ou construire son individualité, devenir personnalité autonome, être subjectivement libre.
La société civile fournira les conditions économiques de cette émancipation de l'individu en tant qu'elle se constitue comme espace social régi, ou qui tend à être régi, par la seule dynamique des besoins individuels et du travail individuel nécessaire pour les satisfaire. Le concept hégélien de la société civile se confond alors avec celui du marché élaboré par l'économie politique classique – et notamment par Adam Smith – et suppose, donc, l'égoïsme des individus [8]. Mais à la différence de l'économie politique classique, et il s'agit d'une différence essentielle, cet égoïsme est saisi par Hegel comme étant, à son tour, un moment dans le processus de constitution de l'individualité des individus et non pas une donnée anthropologique. C'est dans l'examen de ce processus historique qu'apparaît, chez Hegel, la figure de l'État.
En effet, si, afin de devenir lui-même ou de se constituer en tant que tel, l'individu doit faire de lui-même son propre et exclusif but, et ceci, comme nous venons de le voir, en s'arrachant aux déterminations particularistes des groupements auxquels il appartient, il ne peut le faire que dans le cadre de, et grâce à l'existence d'une instance qui admet son individualité, ou mieux encore, qui ne peut trouver sa détermination que dans l'admission de l'individualité et de la particularité. Or, une telle admission n'est concevable que dans une instance universalisante. Cette instance, pour Hegel, c'est l'État – et l'État moderne, plus exactement :
- Dans l'État [moderne], écrit Hegel, tout se ramène à l'unité de l'universalité et de la particularité. Dans les États antiques, le but subjectif ne faisait qu'un avec le vouloir de l'État ; à notre époque moderne, par contre, nous exigeons une vue personnelle, un vouloir et une conscience propres à l'individu.
- Les anciens n'avaient rien de tout cela au sens moderne : pour eux, la volonté de l'État était l'instance ultime. Tandis que dans le despotisme asiatique, l'individu n'a aucune intériorité, aucune justification en lui-même, dans le monde moderne, l'homme exige que sa vie intérieure soit prise en considération [9] (Hegel, 1975 : 266).
[224]
Si, donc, d'une part, l'individualité ou la particularité ne peuvent être reconnues que par l'universalité, d'autre part, c'est cette universalité qui garantit réellement l'existence de l'individualité et de la particularité [10]. L'État totalitaire, despotique – dans les termes de Hegel –, n'est pas l'État qui se définit comme instance productrice d'universalité, mais, bien au contraire, celui qui demeure dans le particularisme, qui généralise des déterminations particulières en les imposant à tous.
Si, négativement, l'État se définit par opposition au particulier comme instance productrice de l'universel, positivement, cette production de l'universel consiste dans la reconnaissance et l'admission de l'individualité ou de la particularité, plus exactement encore, elle consiste dans la production de la personne comme universel. Hegel utilise une très belle formule pour exprimer cette idée – qu'il hérite, d'ailleurs, de Kant :
- C'est grâce à la culture, à la pensée comme conscience de l'individu sous la forme de l'universel, que je suis conçu comme personne universelle, notion dans laquelle tous sont identiques. L’homme vaut (comme personne) parce qu'il est un homme et non parce qu'il est juif, catholique, protestant, allemand, italien, etc. Cette conscience, pour laquelle la pensée vaut, est d'une importance infinie (Hegel, 1975 : 230).
Mais un État qui conçoit l'individu comme universel ne peut pas ne pas correspondre à des individus qui se conçoivent eux-mêmes comme des personnes universelles et qui conçoivent ainsi les autres individus comme des personnes universelles. Si « [...] le moment de la différenciation qui aboutit à l'être de la conscience de soi, existant pour soi et résidant en soi » est le premier moment dans le développement de la société civile, le deuxième moment est, en effet, celui « [...] de la forme de l'universalité, qui est dans la culture, et de la forme de la pensée par laquelle l'Esprit devient objectif et réel comme totalité organique dans les lois et les institutions, c'est-à-dire dans la volonté pensée » (ibid. : 257).
LES DÉRIVES DE L’INDIVIDUALISME
La réflexion hégélienne sur les rapports entre individualité, particularité et universalité, sur le mode d'émergence de l'individualité au sein de la particularité, enfin, sur la forme concrète d'une universalité dans laquelle l'individualité puisse être reconnue comme telle et trouver les conditions de son épanouissement, cette réflexion permet aussi de penser aux dérives possibles de l'individualisme et, par la suite, à la forme de la solution des problèmes qu'elles soulèvent.
Deux dérives s'avèrent, en effet, logiquement possibles. La première consiste à figer le moment premier du processus d'engendrement de l'individualité, à savoir, et reprenant les termes de Hegel, celui dans lequel la personne concrète est à elle-même son propre but et se laisse déterminer comme pur ensemble de besoins et mélange de nécessité naturelle et de volonté arbitraire.
[225]
Cette dérive de l'individualisme exacerbe non pas exactement l'individualité mais une forme d'individualité, d'ailleurs première ou élémentaire : celle d'une monade purement subjective parce que réglée sur des besoins seulement intérieurement déterminés, et assujettie, c'est-à-dire non libre parce que soumise à une nécessité naturelle, à savoir celle de ses besoins – à laquelle elle peut seulement opposer l'arbitraire d'une volonté [11]. Corrélativement, cette dérive fige l'espace des rapports entre les individus dans (et comme) un espace à strictement parler purement économique parce que régi par leurs seuls besoins subjectifs et naturels et par un comportement dès lors seulement compétitif soumis à une rationalité purement instrumentale. Bref, nous avons ici une dérive qui substitue le marché à la socialité, ou qui à tout le moins tend à le faire, réduisant ainsi les rapports sociaux à des rapports extérieurs, soit parce qu'ils opposent des individus-monades, soit parce qu'ils instaurent entre ces individus-monades des relations purement contractuelles.
La naïveté, si l'on peut parler ainsi, d'une telle dérive individualiste est de croire que le rejet de tout particularisme, c'est-à-dire le refus de toute détermination qui ne soit pas purement individuelle est une condition suffisante de l'épanouissement de l'individualité. En d'autres termes, la naïveté de cet individualisme est de croire à l'autonomie d'une telle subjectivité, car c'est, justement, lorsque cet individu se croit le plus subjectivement autonome, et pense que ses besoins ne sont que ses purs besoins, et sa volonté non pas autre chose que sa volonté propre, que cet individu devient le plus subjectivement manipulé, ses besoins étant entièrement fabriqués, et sa volonté ne lui appartenant qu'en apparence parce que répondant en fait à un conditionnement quasi behavioriste. C'est que cet individu se fige subjectivement dans un moment qui ne correspond plus à celui de la société civile qui l'a vu naître [12]. Pour le dire d'un mot : cette dérive est, typiquement, celle de l'illusion de liberté et d'autonomie du consommateur moderne.
La deuxième dérive de l'individualisme consiste, elle, à vouloir revenir au moment préalable d'assujettissement à la particularité. Il s'agit bel et bien d'une dérive de l'individualisme parce que cette subordination à la particularité n'est plus un « fait » mais, plutôt, un « programme ». En effet, l'individualisation de l'individu, si elle s'est réellement accomplie, a supposé l'arrachement de l'individu aux groupements particuliers auxquels il était soumis et desquels il recevait ses déterminations, c'est-à-dire l'essentiel de son identité. Cesser de se saisir comme pure individualité exige alors un activisme particulariste : au lieu que la particularité définisse l'individu, c'est dorénavant à l'individu que revient de définir la particularité afin de la reconstituer, voire de la refaire.
Deux sortes de naïvetés accompagnent alors ce processus, aux conséquences autrement graves que celles de la dérive d'un individualisme exacerbé. La première consiste à croire que la particularité vit d'elle-même, dans son essence propre, immuable ou, sinon, toujours identifiable dans la séquence de ses avatars, de sorte que l'individu n'a qu'à la reprendre, la faire sienne. L'ethnie comme essence immuable, transhistorique, par exemple. La deuxième [226] naïveté, nullement indépendante de la première, consiste à croire que la particularité ne nous a, en fait, jamais quitté, qu'elle est en deçà de notre individualité, que nous n'avons donc qu'à l'assumer pour être nous-même(s), mieux, pour revenir à nous-même(s). La souche ethnique, par exemple, c'est-à-dire ce qui est là même sinon surtout quand tout le reste peut être coupé.
La gravité des conséquences de ces naïvetés est transparente surtout dans le cas des particularismes de type ethnique. Que l'on cherche l'essence de l'ethnie dans le territoire, dans la langue, dans la religion ou dans la combinaison abstraite des qualités qui produirait quelque chose comme l'« esprit du peuple » (le Volkgeist des romantiques allemands du XIXe siècle et des national-socialistes du XXe siècle), le résultat de l'activisme particulariste est, certes, une unité du groupe, mais fondée sur l'exclusion. Dans la logique de cet activisme, plus le groupe est ethniquement homogène, plus son unité est garantie. D'où, à la limite, l'élimination de l'hétérogène, la « purification » du particulier. D'un autre côté, la reconnaissance en nous-mêmes de ce qui ne nous aurait jamais quittés suppose l'idée d'une « authenticité » redevable du temps, authenticité dont nous ne sommes pas responsables, mais qui dorénavant fonde tous les droits – et, du même coup, à la limite, prive de tous ces droits ceux qui n'ont pas cette « authenticité », ceux qui ne sont pas, comme on dit, « de souche ».
Ce sont ces deux dérives de l'individualisme qui marquent cette fin de siècle, ici dans la substitution du marché à la socialité, là dans l'activisme de plus en plus meurtrier des particularismes ethniques et/ou religieux. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas à un épanouissement de l'individualité que l'on assiste mais, au contraire, à la disparition de l'individualité, ici dans la programmation et la manipulation des individus, là dans le repli de l'individu sur le groupement particulariste. Certes, on peut interpréter ce repli comme la revanche de la socialité face, justement, à la tentative de substituer le marché à la socialité. Le vide de la pure subjectivité, de l'individualisme exacerbé, appellerait, pour être comblé, l'identification au groupement particulariste, la participation à une intersubjectivité remplie de significations [13].
Il se peut que cette interprétation soit plausible. La question serait alors de savoir si ce repli sur le groupement particulariste constitue la bonne réponse aux problèmes suscités par la dérive d'un individualisme exacerbé. Si nous pensons que la grande conquête de la modernité a été l'émergence de l'idée de l'individu en tant qu'être autonome, en tant qu'individualité, le repli sur le groupement particulariste ne peut nullement constituer une réponse à la dérive de l'individualisme exacerbé, car au vide de l'individu, il n'offre que le sens d'un groupement particulariste, c'est-à-dire une intersubjectivité restreinte et, d'ailleurs, par là, effectivement exclusive et potentiellement meurtrière.
Mais, y a-t-il une autre réponse possible à cette dérive ? À la lumière de la conceptualisation hégélienne du problème, une autre réponse apparaît non seulement comme possible, mais comme nécessaire à l'épanouissement réel et effectif de l'individualité, réponse qui, d'autre part, loin de conspirer contre [227] les particularismes, constitue la condition même de leur possibilité. Je me suis déjà référé à cette réponse : seul l'État, en tant qu'instance productrice d'universalité, peut, dans la reconnaissance et l'admission de la singularité et de la particularité, constituer la condition de l'épanouissement autant de l'individualité des individus que de la particularité des groupes particularistes.
L’ÉTAT ET L’UNIVERSEL CHEZ HEGEL
Pourtant, si l'État peut et doit constituer cette condition, il s'en faut de beaucoup pour qu'il le soit en fait. Deux dérives de l'État sont possibles qui, d'autre part, se trouvent directement liées aux dérives possibles de l'individualisme. Dans la dérive de l'individualisme exacerbé, la substitution du marché à la socialité, la réduction de la socialité aux rapports purement compétitifs ou contractuels typiques de l'homo œconomicus ne fait pas disparaître l'État, au contraire, même l'État continue plus que jamais à jouer le rôle fondamental que l'émergence du marché généralisé lui a octroyé, à savoir celui de préserver la société de toutes les irrégularités et de tous les désordres découlant, justement, d'une société de marché généralisé, bref de maintenir les activités de tous dans les limites d'une concurrence pacifique. Mais, par là, l'État demeure subordonné au marché, il ne produit que l'universalité requise par la logique du marché [14].
À la deuxième dérive de l'individualisme, celle qui voit l'individu abandonner ou subordonner son individualité à la particularité du groupe, correspond un État qui élève à l'universalité la détermination particulariste du groupe. Dans ce cas, l'État coïncide avec l'ethnie, ou avec la religion, ou avec une tout autre détermination particulariste de sorte qu'il ne constitue que sous une forme perverse une instance productrice d'universalité. En effet, nous l'avons vu, la seule forme authentique de l'universalité est celle qui fait de chaque individu, donc de tous les individus, une valeur absolue et, en partant, de chaque individualité – et non pas de chaque particularité – une valeur absolue. L’universalisation d'une particularité dont l'État ethnique ou l'État religieux constitue l'illustration la plus éclatante comporte, dans sa logique intrinsèque, une dynamique d'exclusion dans le meilleur des cas, d'imposition terroriste de la particularité dominante sur l'individu dans le pire des cas.
Lorsque l'État devient réellement l'instance productrice d'universalité, subordonne-t-il sous cette universalité toute individualité et toute particularité ? Ce n'est nullement le cas dans la pensée hégélienne de l'État. D'une part, on vient de le voir, l'universalité produite par l'État est celle de la valeur absolue de l'individualité, d'autre part, et dans l'extension de cette idée, c'est parce que l'État produit l'universel comme fondement de la socialité que les particularismes peuvent effectivement se développer. Hegel écrit à cet égard :
- Le point de vue abstrait sur le devoir néglige et bannit l'intérêt particulier considéré comme un moment inessentiel, voire indigne. La perspective concrète, l'Idée, montre, au contraire, que le moment de la [228] particularité est tout aussi essentiel, que sa satisfaction est absolument nécessaire.
- [...] L'État est l'unique condition qui permet à la particularité d'accéder au bonheur et de réaliser ses fins (Hegel, 1975 : 266).
Il s'ensuit, ou il devrait s'ensuivre, que toutes les individualités et toutes les particularités ne font pas, en principe, objet de la même considération, autrement dit l'État ne peut pas être indifférent à la situation propre à chaque individualité et à chaque particularité : la valeur absolue de l'individualité, qui comporte l'égalité formelle des individus, exige, précisément, de ne pas considérer les individus comme étant pratiquement égaux. En ce sens, Hegel se trouve aux antipodes d'un libéralisme formaliste.
Mais, pourrait-on objecter, une société peut-elle fonder son unité dans la simple reconnaissance universelle de la valeur absolue de l'individualité et, subséquemment, des particularités ? Encore une fois, Hegel nous oblige à dialectiser la réponse à une telle question. « Un peuple n'est pas d'emblée un État », signale Hegel (1975 : 337) et, d'ailleurs, on ne peut pas forcer un peuple à être ce qu'il n'est pas prêt à être :
- Car on ne fabrique pas une constitution, écrit Hegel ; il faut qu'interviennent le travail des siècles, l'Idée et la conscience du rationnel, telles qu'elles se sont développées chez un peuple [15] (ibid. : 337).
S'ouvre ici toute une dialectique entre l'être et le devoir être qui n'est, certes, pas simple, mais dont les enjeux sont plus décisifs que jamais. Si, d'une part, un peuple n'accède pas à l'universel par décret, s'il n'arrive pas par la seule détermination de la volonté de quelqu'un à surmonter les déterminations de son particularisme, d'autre part, il n'accédera pas à la reconnaissance de la valeur absolue de l'individualité si un travail ne se fait pas sur et dans sa conscience, si l'Idée et la conscience du rationnel ne se développent pas. Quelle tâche politique incombe aux intellectuels sinon celle définie par ce travail ? La réflexion peut bel et bien montrer qu'une communauté fonde son être sur des déterminations particularistes, mais la question cruciale est de savoir sur quel genre de déterminations doit-elle fonder son devoir être. C'est dans cette tension qu'instaure l'Idée qu'une communauté trouve son destin et construit ainsi son histoire.
Sommes-nous déjà en mesure d'atteindre ce développement de la conscience du rationnel ? Pouvons-nous donc surmonter autant la dérive de l'individualisme exacerbé de la société de marché que celle de l'universalité perverse des particularismes ethniques et/ou religieux ? Cette question ne peut trouver une réponse que dans le résultat de ce travail sur et dans la conscience, donc dans ce travail même. Dans un cas comme dans l'autre, du seul fait d'assumer cette tâche, nous serions patriotes au sens hégélien du terme, car le patriotisme n'est que cette « disposition de l'esprit qui, dans les circonstances ordinaires et le cours de la vie quotidienne, est habituée à considérer la vie en commun comme but et comme fondement essentiel » (ibid. : 269).
[230]
RÉFÉRENCES
Habermas, J. (1978), L'espace public, Paris : Payot.
Hegel, G.W.F. (1975), Principes de la philosophie du droit (traduction et notes de R. Derathé), Paris : Vrin.
Macpherson, C.B. (1971), La théorie politique de l'individualisme possessif, Paris : Gallimard.
Renaut, A. (1989), L'ère de l'individu, Paris : Gallimard.
Ruby, C. (1991), L'individu saisi par l'État, Paris : Éditions du Félin.
Fin du texte
Notice biographique
[370]
- ROBERTO MIGUELEZ
Roberto Miguelez est professeur titulaire au Département de sociologie et professeur attaché au Département de philosophie de l'Université d'Ottawa, responsable du Centre de recherche en philosophie politique et sociale de cette université et directeur de la revue philosophique Carrefour. Auteur de plusieurs articles et ouvrages dans le domaine de la théorie, l'épistémologie et la philosophie sociales et politiques, il vient de publier L'analyse des formations sociales (1992) et L'émergence de la sociologie (1993).
[1] Je fais évidemment référence au titre de l'ouvrage d'Alain Renaut (1989).
[2] Le « système des besoins » comporte, pour Hegel, la médiation du besoin et la satisfaction par le travail (1975 : 219). D'autre part, « par les besoins et le travail des autres, la satisfaction est soumise à la condition de la réciprocité » (ibid. : 222). Mais, et nous y reviendrons, c'est plutôt le modèle du marché suggéré par Adam Smith qui se trouve derrière le concept hégélien de société civile et, donc, la dimension de l'échange plutôt que celle du travail.
[3] Dans la remarque au par. 185, Hegel s'arrête sur les moments historiques du processus de développement autonome de la particularité. Le principe de la personnalité autonome et infinie en soi de l'individu ou principe de la liberté subjective, même s'il apparaît pour Hegel dans la religion chrétienne, ne se réalise pourtant pleinement que dans la modernité.
[4] « La société civile arrache cependant l'individu à cette union familiale, en disperse les membres et les reconnaît comme personnes autonomes. » « L'individu est ainsi devenu le fils de la société civile » (Hegel, 1975 : 248-249).
[5] « [La société civile] réduit l'existence de toute la famille à une existence dépendante d'elle, c'est-à-dire de sa contingence » (Hegel, 1975 : 249). C'est pourquoi, d'ailleurs, pour Hegel, il revient à la société civile d'exercer un contrôle et une influence sur l'éducation des enfants.
[6] En ce sens, mon analyse partage une perspective hégélienne comme celle développée récemment par Ruby (1991).
[7] Conditions sociales au sens large du terme, c'est-à-dire en y incluant des conditions juridiques.
[8] Il suppose, en fait, l'homo œconomicus de l'économie politique classique, et l'on sait que dans la conception anthropologique de l'économie politique classique, l'être humain se définit comme égoïste dans la mesure où il ne cherche que son bonheur personnel, et rationnel – mais d'une rationalité « instrumentale » –, dans la mesure où il n'emploie sa raison que pour maximiser ses gains et minimiser ses pertes, c'est-à-dire que dans un pur calcul économique. Le bonheur hédoniste et le rationalisme instrumental constituent, d'ailleurs, deux principes fondamentaux de la théorie libérale depuis Hobbes jusqu'à Bentham en passant, bien entendu, par les économistes.
[9] Encore : « Que le but de l'État soit l'intérêt universel en tant que tel et le maintien des intérêts particuliers en tant que ceux-ci trouvent leur substance dans cet intérêt universel, cela constitue 1. Sa réalité abstraite ou sa substantialité [...] » (Hegel, 1975 : 270).
[10] Si nous acceptons l'interprétation de Hobbes proposée par Macpherson, ce serait Hobbes qui aurait vu pour la première fois en toute clarté la nécessité d'un État « universalisant » lors de l'émergence d'un espace social défini par la loi de la concurrence des individus – une société de marché généralisé – ou, d'un point de vue symétrique, par la seule présence d'individus égoïstes et rationnels en compétition. Car ce n'est pas seulement que « La Compétition, la Défiance et la Gloire [...] sont des facteurs à l'œuvre dans toutes les sociétés civiles de l'époque et qui les détruiraient [...] si aucun pouvoir commun n'existait », c'est que ce pouvoir ne trouve sa justification – et sa nécessité – que dans la préservation d'un espace de compétition (réglé) et, donc, dans la reconnaissance et la préservation de l'individualité (Macpherson, 1971 : 35 sq.).
[11] Depuis Kant, il est devenu clair que l'autonomie n'a rien à voir avec la subordination à des tendances naturelles, aussi volontaire soit-elle, encore moins aux besoins naturels, mais, bien au contraire, que cette subordination représente une forme particulièrement aiguë d'assujettissement.
[12] Pour l'analyse d'une telle société civile, et en particulier des transformations substantielles qui s'opèrent au sein de la sphère publique bourgeoise à l'ère de la publicité manipulée, demeure fondamental l'ouvrage de Habermas (1978).
[13] Bien entendu, de nos jours, ce n'est pas la famille qui peut satisfaire à cette condition. Par contre, les particularismes ethniques et religieux, surtout lorsqu'ils font de l'ethnie ou de la religion le critère décisif, sinon suffisant, de la nation, apparaissent immédiatement – et véritablement – remplis de significations.
[14] Hegel fait référence à une conception de l'État dans laquelle nous pouvons voir exprimée cette dérive de l'État moderne :
« À la pensée qui conçoit l'État comme quelque chose de rationnel en soi, s'oppose un autre point de vue. C'est celui qui ne considère pas les éléments extérieurs de sa manifestation, c'est-à-dire les éléments contingents du dénuement, du manque de sécurité, de la violence, de la richesse, etc., comme des éléments du développement historique, mais les prend pour la substance même de l'État. Ici encore, c'est toujours la singularité des individus qui constitue le principe de la connaissance » (1975 : 260 ; je souligne).
[15] Et encore : « Napoléon voulut donner a priori une constitution à l'Espagne : le résultat fut catastrophique » (Hegel, 1975 : 287).
|

