|
Professeure de philosophie au Cégep de Sainte-Foy
doctorante en philosophie à l’Université Laval
“Le Québec moderne:
un portrait en quatre tableaux”.
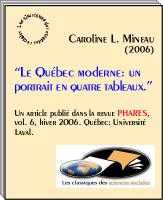 Un article publié dans la revue électronique PHARES, vol. 6, hiver 2006. Québec : Université Laval. Un article publié dans la revue électronique PHARES, vol. 6, hiver 2006. Québec : Université Laval.
- Introduction
-
- Le rapport à l’idéal
- Le rapport à l’autre
- Le rapport aux éléments
- Le rapport à l’histoire
Introduction

Lorsqu’un étranger arrive au Québec pour la première fois, il est d’abord frappé par la largueur des rues, l’espacement entre les maisons, la taille des réfrigérateurs, les autobus jaunes. Il se croirait dans un film américain, mais les gens autour de lui parlent une autre langue... Il remarque ensuite toutes les croix, les statues, les rues Saint-ceci, les écoles Sainte-cela. Il entre dans une église ; elle est vide. Il entre dans une école ; elle a été transformée en centre récréatif pour l’âge d’or. Il retourne chez lui, et pour peu qu’il habite dans l’Ouest canadien, à Barcelone ou à Édimbourg, il trouve presque autant de jeunes Québécois qu’il en avait rencontrés au Québec. Quelle époque ! Quel peuple ! se dit-il, puis il retourne à ses affaires.
On sent toutefois que la situation est bien différente lorsqu’on veut parler soi-même de ce qui nous entoure. L’idée qu’il est difficile de dresser un portrait de son temps parce qu’on se trouve immergé dans le modèle qu’on se donne n’étonne personne ; peindre son époque, c’est après tout faire son autoportrait. D’une part, on est aux prises avec le problème du manque de recul, de telle sorte qu’il est difficile de poser un regard neutre sur le sujet. C’est pour cette raison que les artistes, ceux qui n’ont pas été contaminés par la mode de l’objectivité, parviennent parfois mieux que les intellectuels à peindre un tableau qui soit suffisamment ressemblant pour que le public s’y reconnaisse. D’autre part, on se trouve confronté au fait que la réalité forme un panorama de trois cent soixante degrés autour de nous. Pour peu qu’on change d’angle, on change de paysage. Et nul, malgré les miracles de la génétique, ne possède des yeux derrière la tête.
Il faut pourtant donner le premier coup de pinceau. C’est pourquoi nous posons l’hypothèse suivante en guise de point de départ : notre époque, en ce qu’elle s’inscrit dans la modernité, se caractérise de manière générale par le fait que les cadres de référence, « ce en vertu de quoi nous donnons un sens à nos vies [1] », sont devenus problématiques, que rien de ce qui pouvait autrefois passer pour une évidence religieuse ou morale ne va plus de soi et que nous sommes constamment en train d’essayer de nous positionner par rapport à certains critères que nous nous donnons. S’agit-il d’un changement pour le meilleur ou pour le pire ? Les théoriciens de la modernité ne s’entendent pas sur ce point, certains criant au progrès de la liberté, d’autres au scandale du relativisme. Aussi, pour répondre à cette question, nous ferons appel à quatre films, quatre points de vue à la fois discordants et complémentaires, pour tenter de dresser un portrait panoramique si ce n’est de notre époque en tant que telle, du moins de la manière dont elle est perçue par certains des artistes qui ont contribué à l’essor du septième art au Québec ces dernières années. Par cette voie, qui se veut des plus subjectives, nous espérons rendre compte de la manière dont la réalité moderne est perçue par des gens à qui la modernité importe parce qu’elle définit les perspectives du monde dans lequel ils évoluent. Peut-être pourrons-nous, grâce à cette approche, compenser les difficultés liées à l’autoportrait par un avantage : celui rattaché au point de vue du sujet en train de vivre avec d’autres le phénomène qu’il cherche à comprendre, point de vue privilégié en ce qu’il sort de la subjectivité individuelle pour ouvrir la possibilité du dialogue.
Le rapport à l’idéal

En rejetant les conceptions transcendantes du bien, comme celle de la théorie de Platon ou celle de la religion chrétienne, pour adopter une conception immanente de la morale, les modernes ont eu l’impression de cesser de négliger la vie sur terre au profit de la vie au ciel, la vie matérielle au profit de la vie spirituelle. On remarque pourtant que plusieurs, loin de cesser d’adorer un idéal et de tendre vers lui, ont simplement changé la nature de celui-ci. Ils en ont fait un idéal humain, un idéal de vie, et de ce fait, leur relation à celui-ci s’est altérée. Le film Québec-Montréal [2] illustre bien les conséquences de cette transformation, les poussant même jusqu’à la parodie.
Rupture d’un couple, chicane entre amis au sujet d’une femme dont ils sont tous trois amoureux, échec d’un flirt entre collègues de travail, autant de clichés des relations hommes-femmes qui sont abordés dans ce road-movie entre la capitale et la métropole. Résultat : aucun des personnages ne parviendra à destination en compagnie de celui ou de ceux avec qui il était parti. Chacun se retrouvera isolé, déçu, pris entre deux lieux. Mais sous le nez des protagonistes, qui doivent faire face à la triste réalité de l’échec de leurs relations, passe le couple parfait, qui mène la vie parfaite dans sa voiture parfaite.
Ce couple apparaît comme le sommet de l’image kitsch. Couleurs pastelles, rythme ralenti, la jeune femme blonde et délicate, le jeune homme brun et costaud, leurs sourires excessifs, leur décapotable d’un style rappelant celui des années cinquante, tous les éléments visuels concordent pour que le spectateur comprenne qu’ils se trouvent dans une réalité différente de celle des autres personnages. Ils sont « la passion », ce à quoi tout le monde aspire, et leur perfection écrase les gens ordinaires de son poids, les met face à leur médiocrité. Alors que les autres situations montrent l’échec avant, pendant et après le couple, ils représentent l’amour accompli, possédé, fixe. Leur silence heureux, opposé aux échanges orageux des personnages qui évoluent dans le monde réel, semble suggérer que le dialogue, qui devrait servir à rapprocher les gens, ne fait que les éloigner en attisant l’incompréhension chronique, l’incompatibilité systématique des attentes. Ils exercent la force d’attraction d’un idéal en ce qu’ils présentent aux autres une image du bonheur qui permet de juger de la qualité de leur propre vie amoureuse, mais cet idéal humain s’avère encore plus inaccessible qu’un idéal divin ou cosmologique parce que détaché de la réalité pragmatique de la condition humaine, sans pourtant être de nature différente. S’ils fascinent les personnages, quelque chose les discrédite auprès du spectateur : ils ont l’air faits en plastique. Ils sont la chimère hollywoodienne par excellence, chimère par définition hors d’atteinte, purement imaginaire.
Un seul personnage semble insensible à leur pouvoir d’attraction : celui qui répond à son téléphone cellulaire par « Michel Gauvin, Mike Gauvin », l’homme qui parle deux langues, mais ne dit la vérité à personne, le père de famille marié et heureux qui passe tout le trajet à organiser ses des rencontres avec ses diverses maîtresses montréalaises. Sa morale s’articule autour de deux maximes que l’on pourrait formuler ainsi : « Il y en a qui divorcent pour des riens, moi je veux divorcer pour quelque chose » et « Le mérite de parvenir à coordonner ma vie pour qu’aucune de mes femmes-satellites ne s’aperçoive de l’existence des autres est plus grand que celui de l’homme qui reste fidèle à une seule femme. » Autrement dit, Mike Gauvin est un fataliste-rationaliste-instrumental. Il croit assez aux statistiques pour considérer que son mariage heureux finira fatalement comme les autres et il valorise la raison instrumentale à un degré plus élevé que la tempérance et la fidélité aux engagements. Aussi incohérente que soit cette position morale (car comment les statistiques pourraient-elles agir à la manière d’une destinée ?), aussi choquante que soit sa manière de se servir des autres, Mike Gauvin est pourtant celui qui parvient à tirer son épingle du jeu. La clé de l’énigme se trouve au niveau symbolique : il est le seul personnage à profiter de la route, à s’arrêter en chemin pour manger un cornet de crème glacée plutôt que de sacrifier le plaisir du voyage pour parvenir plus rapidement à destination [3].
Le film semble suggérer qu’il faut renoncer à l’idéal, à l’image parfaite de « la passion », pour parvenir à quelque chose. En cela, on peut penser qu’il libère d’un certain asservissement à un modèle contraignant et irréaliste de la vie à deux, mais il ne met rien à la place de l’idole déchue. La question de savoir si l’influence néfaste de l’idéal n’est pas plutôt due au contenu qu’on lui donne, au fait que les gens visent « la passion » aux couleurs hollywoodiennes au lieu de chercher, par exemple, « l’engagement » ou « la confiance », n’est pas abordée, peut-être pour suggérer que personne, parmi la jeune génération, n’a en tête de modèle plus consistant vers lequel orienter sa vie. Le spectateur, face à un vide que le film ne remplit pas, reste donc avec un malaise : cette renonciation a un prix, celui des relations sans réserve avec autrui. Renoncer à une image irréaliste du bonheur, c’est se libérer d’une contrainte, mais renoncer à tout idéal, c’est transformer la difficulté des rapports humains de qualité en une réalité inévitable. Autrement dit, être réaliste, au sens que semble donner Québec-Montréal à cette attitude, c’est renoncer à se reconnaître responsable de l’échec ou de la réussite de ses relations avec autrui. Le réalisme, ainsi conçu, est vécu comme un fatalisme.
Le rapport à l’autre

Mais se résigner à entretenir des relations sans idéal avec autrui ne vient pas diminuer le besoin qu’on a des autres. Au contraire, celui-ci peut devenir maladif, comme c’est le cas pour le personnage principal de Un crabe dans la tête [4]. Alex, un photographe sous-marin de trente et un ans, s’est sauvé vers l’Océan Indien le lendemain de son mariage. À son retour à Montréal, il voudrait à la fois éviter sa femme, séduire Marie, une journaliste opiniâtre qu’il rencontre chez son meilleur ami, et consoler celui-ci de sa déception amoureuse alors que c’est lui-même qui a couché avec sa copine lors d’un moment de détresse. Il est, en d’autres termes, l’exemple parfait, transposé au XXIe siècle, de l’homme aliéné par son amour-propre que décrit Rousseau dans sa critique de la société :
- Quand je vois chacun de nous sans cesse occupé de l’opinion publique étendre pour ainsi dire son existence tout autour de lui sans en réserver presque rien dans son propre cœur, je crois voir un petit insecte former de sa substance une grande toile par laquelle seule il paraît sensible tandis qu’on le croirait mort dans son trou. La vanité de l’homme est la toile d’araignée qu’il tend sur tout ce qui l’environne [5].
En voulant plaire à tout le monde, Alex s’agite, s’affole et se prend dans sa propre toile. Il est le rejeton caricatural de cette génération à qui l’on a ouvert toutes les portes en disant : tu n’as pas à exercer le métier de ton père si tu n’en a pas envie, tu n’as pas à rester sur ta terre natale si tu veux aller voir ailleurs, tu n’as pas à te marier si tu préfères rester sans attaches. Bercée par l’idée que tout est possible, cette génération tend à oublier que la réalité mortelle de l’existence humaine force à faire des choix. Le résultat se voit dans la vie d’Alex : il a besoin qu’on l’aime, mais comme il ne sait pas sur quelles bases, il les confond toutes. Il sait que choisir, c’est renoncer, mais on ne lui a pas appris que renoncer, c’est investir dans ce qu’on a choisi et courir la chance d’en recueillir les fruits. Parce qu’il ne veut rien perdre des possibilités qui s’offrent à lui, Alex tend sa toile espérant y accrocher tout le monde. S’il devient la victime de son piège, c’est que les exigences de chacun sont incompatibles entre elles. La bouche d’Alex ne dit « non » à personne, sa vie le dit pour lui ; quand la pression devient trop forte, il s’envole vers un autre océan. Ironiquement, cet homme qui a tant besoin des autres est celui qui se retrouve seul, entre deux eaux, dans le silence, silence qui d’ailleurs le fascine. Il envie l’état paisible du cadavre d’un enfant qu’il rencontre dans une épave de navire, lui qui sans cesse remue dans tous les sens. L’appétit de reconnaissance d’Alex, constamment déçu en raison de son caractère excessif, devient désir de mort. Le mort, après tout, n’a besoin de personne.
Par ailleurs, à force de toujours courir après les autres, Alex perd contact avec lui-même. L’incompatibilité entre son besoin d’être aimé par tout le monde et les exigences de la réalité des relations humaines devient le crabe dans la tête du plongeur, cette paire de pinces qui vient couper le courant dans son cerveau, rompre la connexion qu’il a avec lui-même lorsque tout devient trop compliqué. En cherchant à devenir quelqu’un en plaisant à tout le monde, Alex n’est plus personne.
Le film ne se termine pourtant pas sur la catastrophe à laquelle on pouvait s’attendre, car au moment où il n’a plus rien à perdre, Alex finit par assumer la responsabilité de ses actes. Ce faisant, il reprend contact avec lui-même, mais alors se produit une coupure dans la trame de l’intrigue. La scène suivant celle où il avoue tout ce qu’il a fait nous transporte au cœur de l’hiver. On voit Alex en habit d’homme-grenouille avancer vers un trou dans la glace. Il s’apprête à plonger, mais quelque chose le démange sous le bonnet de sa combinaison. Il l’enlève et trouve un crabe, qu’il jette à l’eau. On entend alors une musique folle et joyeuse, et l’image se met à vibrer, à danser. Alex a réussi à faire sortir ce qui l’agitait inutilement de l’intérieur. Au milieu du monde qui bouge, il est maintenant plus stable, mais tout cela se passe dans un désert de neige coupé du monde réel des relations à autrui, avec seulement un étroit sentier pour y retourner. Parce que la solution du problème est exprimée par le biais du langage symbolique, c’est au spectateur de refaire le pont entre le désert de neige et son propre monde.
Le rapport aux éléments

C’est également la voie des symboles qu’adopte Manon Briand, dans la Turbulence des fluides [6], bien que ce soit pour exprimer une vision de la réalité radicalement différente de celle d’André Turpin. Contre l’appétit de tranquillité d’Alex, elle clame que les trois éléments essentiels à la vie sont le désir, le désordre et le danger. Son héroïne, Alice, une sismologue qui s’est enfuie au Japon à la suite d’une déception amoureuse, est envoyée par son employeur japonais à Baie-Comeau, où elle est née, afin d’enquêter sur un phénomène étrange : la marée, depuis plusieurs jours, s’est arrêtée et l’on craint fort que ce soit un le signe précurseur d’un tremblement de terre.
Voyageuse comme Alex, Alice pense au contraire qu’elle n’a besoin de personne et c’est ironiquement vers cette femme rationnelle et froide que se tourneront les gens superstitieux de Baie-Comeau pour essayer de comprendre ce qui leur échappe. Ce personnage, joué par Pascale Bussières, célèbre pour son petit « air baveux », se demande : « Pourquoi le monde me content-ils tous leurs problèmes ? Est-ce que j’ai l’air d’une psychologue ? – Non, de répondre un vieil homme, vous avez l’air de vous en foutre. » Et graduellement, la femme de carrière, détachée et exilée de par sa propre volonté, se laissera atteindre et attendrir.
Immergée dans un bassin de symboles féminins, la mer-mère, le cycle lunaire, et imprégnée par le climat de sensualité qui émane de la chaleur de l’air, Alice va prendre contact avec ses racines, avec ce qu’elle est comme femme, avec cet homme, Marc Vandal, un veuf lui aussi endurci. Par un étrange renversement de la croyance populaire qui veut que les éléments influencent les émotions humaines, c’est l’énergie sexuelle de ces deux personnages réunis qui déclenchera le tremblement de terre qui rendra aux éléments leur cours normal. Il fallait, pour que le monde continue de tourner, qu’Alice se réconcilie avec sa naissance et que Marc accepte la mort de sa femme, dont le corps a enfin été retrouvé. C’est en assumant les deux extrêmes du cycle de la vie qu’on peut vivre le temps intermédiaire. Par une sorte de spiritualisation des éléments de la nature, Manon Briand suggère sa solution au malaise qui émane de nos modes de vie blindés par nos réflexes de protection : la force se trouve dans l’acceptation du devenir et de la fragilité, dans la confiance en le un cycle qui donne un sens à la vie et à la souffrance, dans le fait d’accepter de planter ses racines quelque part et avec quelqu’un.
Le rapport à l’histoire

C’est une autre forme d’enracinement que suggère Denys Arcand dans Les invasions barbares [7]. Plutôt que de spiritualiser les éléments naturels pour en faire le symbole d’un ordre dans lequel l’humain peut s’inscrire, il donne un sens au non-sens de l’histoire, celle de l’humanité et celle de l’individu. Dans l’optique de montrer une continuité dans la succession des époques et des générations, le film Les invasions barbares est d’autant plus complexe et complet qu’il montre le contact non seulement entre le passé et le présent, mais entre deux clans qui cohabitent dans le même monde : les « socialistes voluptueux [8] » de la génération des baby-boomers instruits qui ont pris une part active à la Révolution tranquille, et leurs enfants, les « capitalistes ambitieux et puritains », qui se cherchent eux-mêmes dans ce monde hérité de leurs parents.
Parce que « l’intelligence est un phénomène collectif intermittent » et qu’en 1950, « tout le monde était con, même à Athènes », les intellectuels universitaires qui sont nés au Québec dans ces années-là arriveront certes à la cinquantaine avec le sentiment de n’avoir rien fait de grand, mais ils se seront au moins tournés, dans leur jeunesse, vers la politique, pour se donner une fin noble à atteindre, et vers le plaisir, recherché pour lui-même et en tant que libération des interdits religieux. Ils se rappellent avec une pointe d’ironie qu’ils ont été, selon le dernier auteur qu’ils avaient lu, séparatistes, indépendantistes, souverainistes, souverainistes-associationnistes, existentialistes, anticolonialistes, marxistes, marxistes-léninistes, trotskistes, maoïstes, structuralistes, situationnistes, féministes, déconstructivistes, bref, qu’ils ont adoré tous les « ismes », sauf le crétinisme. Ils rient de leur naïveté, mais ils savent une chose avec le recul : ils ont aimé la vie.
C’est à la fois cet appétit de vivre combiné avec l’impression qu’il a tout raté qui torturent Rémy lorsqu’il doit faire face à la mort : malgré ses lectures, malgré tout ce qu’il a fait, il se sent aussi démuni qu’au jour de sa naissance. Cet homme, qui a passé sa jeunesse à se libérer de la religion qu’on lui avait inculquée dans son enfance, ne reviendra pas en arrière, mais il enviera la religieuse de l’hôpital pour la confiance que lui donne sa foi. C’est finalement par le biais de ses proches qu’il trouvera assez de réconfort pour rendre l’âme avec courage : « J’ai eu beaucoup de plaisir à vivre cette modeste vie en votre compagnie, mes chers amis, et ce sont vos sourires que j’emporte avec moi. » Celui qui a négligé son mariage et sa vie familiale au nom de la révolution sexuelle va mourir entouré d’amis qui l’aiment, de son ex-femme qui l’appellera l’homme de sa vie, de ses enfants qui reconnaîtront lui devoir la force qu’ils ont. Celui qui a contribué au fait que les églises se sont vidées en quelques mois en 1966 parviendra, sans Dieu, à mourir en paix.
Mais qu’en est-il de cette génération née après la mort de Dieu, après tous les « ismes », après que les ordinateurs aient remplacé les livres ? Le tableau, au premier abord, semble assez sombre. Le monde construit par les baby-boomers, symbolisé par l’hôpital surchargé de patients où se déroule une bonne partie du scénario, est le produit d’un idéal socialiste, mais où tout s’achète et où chacun est anonyme. Aussi n’est-il pas surprenant que le plus confortable des rejetons de la jeune génération soit Sébastien, le fils de Rémy, devenu millionnaire. Il a fui vers Londres pour y faire sa vie et devenir, loin des siens, le « jeune homme parfait » avec la « carrière parfaite » et la « fiancée parfaite ». Il semble avoir tout réussi, mais son père le considère pourtant comme le « prince des barbares » ; ils sont trop différents l’un de l’autre.
La fille de Rémy, Sylvaine, s’est elle aussi exilée. Devenue opératrice de voiliers, c’est au milieu des flots qu’elle a l’impression d’avoir trouve trouvé « sa place ». Elle ne cherchait donc pas un lieu, un sol pour y prendre racine, mais plutôt le sentiment que sa vie correspond à ce qu’elle est, qu’elle vaut la peine d’être vécue. Elle s’identifie au mouvement du bateau sans ancre, à la fragilité du marin qui respire le vent avec délice et sait que la mort l’attend peut-être par-delà une vague. Son père l’appelle une ratée, mais il s’attendrit en pensant à elle et Sylvaine sait qu’au fond, elle lui ressemble.
Nathalie, la fille de Diane, une amie de Rémy, a comme Sylvaine le sentiment que sa mort est proche, mais sans connaître la quiétude du marin. Cette héroïnomane, qui travaille comme correctrice pour Boréal, est bien la seule de la jeune génération à ne pas avoir quitté le pays, mais elle s’évade dans la drogue pour oublier qu’elle est imparfaite. De par son contact avec les livres, elle se rapproche un peu de Rémy et des amis de celui-ci, mais elle ne ressent ni leur gaieté, ni leur amour pour la vie. Cette jeune femme, qui a vu la révolution sexuelle à travers les yeux d’une enfant devant qui paradaient les amants de sa mère, ne peut pas partager leur insouciance. Étrange renversement des rôles que celui qui résulte de la négation des valeurs ancestrales...
Les baby-boomers, qui se sont battus pour faire éclater les cadres de référence traditionnels, utilisent, malgré leur incroyance, un langage religieux pour parler des choses les plus profanes. Leur monde, à tort ou à raison, est sacralisé par l’expérience, même reniée, qu’ils ont eue de la religion. La liberté dont ils jouissent maintenant a pour eux le parfum de la victoire. Elle a, autrement dit, un sens. Au contraire, pour leurs enfants, qui n’ont jamais eu peur de l’Enfer, la débauche et le bon vin n’ont pas la même saveur : ils sont, à divers degrés, puritains parce qu’ils n’ont pas de raison d’être voluptueux. Née dans un monde déjà désenchanté, soit la nouvelle génération trouve sa sagesse dans la lucidité, dans le courage de faire face à cet univers dénué de sens, soit elle ne se pose pas de question. Même en étant contemporain de celui où vivent présentement leurs parents, le monde de la génération X est foncièrement différent du leur.
Il peut donc paraître étrange de proposer que c’est plutôt vers les ressemblances entre les époques que pointent Les invasions barbares ; il semble pourtant que ce soit le cas. Quelques remarques éparses dans les dialogues à propos de l’histoire de l’humanité rendent cette hypothèse crédible et suggèrent qu’on peut transférer ce raisonnement pour expliquer l’importance de l’histoire familiale dans la constitution de l’identité d’une personne. De fait, on voit un reportage télévisé où un expert suggère que le phénomène des invasions barbares ayant détruit l’Empire romain est peut-être en train de se répéter dans le cas de l’Empire américain. Les termes « invasion » et « barbare » sont pourtant employés à plusieurs sauces au cours du film : l’invasion, pour le policier, c’est le fait que les réseaux de drogues de Montréal soient incontrôlables parce que si l’on arrête les Iraniens qui sont à la tête, ils seront remplacés par des Irakiens, des Libanais ou des Turcs. Le barbare, pour l’intellectuel socialiste, c’est le capitaliste qui n’a jamais lu un livre de sa vie. Une invasion barbare est donc ce qui vient de l’extérieur pour détruire l’intérieur tel qu’on le connaît, mais il faut comprendre l’extérieur non seulement en un sens spatial, mais également comme ce qui est différent de soi. Le déclin d’un empire, en ce second sens, est l’engendrement d’un nouveau monde à la fois en rupture avec l’ancien et tributaire de celui-ci. On pourrait presque dire que cela se produit chaque fois qu’une nouvelle génération prend la place d’une autre.
Cette même conception de l’histoire comme une série de récurrences se manifeste par la réponse que fait Rémy à la religieuse qui se plaint, comme la plupart des gens, que le XXe siècle a été le plus horrible de tous. Il lui dit que lorsqu’on se rappelle, par exemple, le massacre des Amérindiens lors de la conquête des Amériques, on voit que c’est l’histoire de l’humanité qui est une suite d’horreurs, pas spécialement celle du XXe siècle. Cette vision de l’histoire est cohérente avec la désacralisation du monde : quand on perd la notion de salut, il faut perdre celle d’apocalypse. Nos crimes récents n’annoncent pas la fin du monde parce que ceux de nos ancêtres n’ont rien fait d’autre que de créer le monde dans lequel nous vivons. Le réconfort de la contingence se trouve dans l’espoir d’impunité.
Parallèlement, la nouvelle génération n’est pas meilleure ou pire que celle qui l’a précédée. Nathalie, en entrant dans l’ancien appartement de Rémy, comprendra que comme sa mère, elle est attirée par les livres. Sébastien, en embrassant Nathalie, soupçonnera qu’il a hérité de l’amour de son père pour les femmes. Sylvaine, de son voilier, dira à Rémy qu’il lui a transmis sa solidité et son appétit pour la vie. Par-delà les ruptures, il y a la continuité. Reconnaître le « prince des barbares » comme son fils, c’est accepter qu’il y a de soi-même dans cet autre. Se reconnaître dans son père, c’est accepter comme sienne l’imperfection de celui-ci, imperfection qui est tout le contraire d’une fatalité parce que c’est ce qui lui faisait aimer la vie. « C’est toujours comme ça. C’est la vie », dit Pierre, un ami de Rémy, qui vient de se quereller avec la femme qui, malgré tout, fait de lui le plus heureux des hommes. Vivre sa vie, c’est l’aimer avec son imperfection.
* * *
On pourra nous reprocher d’avoir fait une présentation trop sommaire, voire trop biaisée, des films que nous avons abordés, reproche auquel nous répondrons en rappelant qu’il le fallait bien, puisque que notre objectif était de dresser un portrait une esquisse de notre époque et que nul peintre n’a un regard vraiment neutre sur son sujet, surtout lorsqu’il s’agit de faire son autoportrait. Mais en choisissant ces quatre films comme matière première, nous avons voulu suggérer que bien que les visions du monde de ces cinéastes soient à plusieurs égards discordantes, elles se rejoignent sur un point : le besoin pour l’homme de se positionner par rapport à un repère, de définir son identité et ses objectifs en relation à quelque chose d’autre que ses préférences individuelles, que ce soit un idéal humanisé, une autre personne, l’ordre de la nature ou l’histoire [9] [9]. En cela, ces quatre films sont autant de tentatives de réponse à la menace de relativisme qui plane sur la modernité.
Certaines des solutions proposées sont plus spécifiquement modernes que d’autres. En effet, l’idée de responsabiliser ses rapports à l’autre pour reprendre contact avec soi-même, véhiculée par Un crabe dans la tête, ou la proposition de Québec-Montréal selon laquelle il faut renoncer à poursuivre un idéal pour arriver à quelque chose, s’inscrivent toutes deux dans le mouvement général de la pensée moderne, dont la tendance morale dominante fait de l’homme la source et le critère du bien. Il semble toutefois que l’idée que l’homme doive accepter de participer à l’ordre de la nature, que l’on trouve dans La turbulence des fluides, se rapproche davantage d’une conception cosmologique de l’univers, donc d’un type d’explication pré-moderne, ou peut-être, en ce que la conformité à cet ordre est à conquérir, post-moderne. Étrangement, alors que les deux premiers films se terminent sur un isolement des personnages principaux et laissent le spectateur un peu perplexe, le troisième se clôt sur l’épisode heureux de la réunion d’un couple. Est-ce à dire que la solution la plus satisfaisante au malaise de la modernité se trouve à l’extérieur de celle-ci ?
Il faudrait, pour trancher la question, savoir si l’éclatement des cadres de références traditionnels a permis de conserver la saveur et la beauté des choses. Puisque l’homme moderne a, comme son prédécesseur, besoin de sens, mais que rien ne lui prouvera jamais sans l’ombre d’un doute qu’il l’a trouvé, il lui faut aimer la quête pour elle-même. C’est ce que semblent suggérer Les invasions barbares. Parce que ce film ne fait aucune promesse, il nous rejoint en tant que modernes épris de doute et de recherche, mais parce qu’il rattache l’individu à ceux qui sont nés avant, avec et après lui, par des rapports de responsabilité, il parvient à dissiper le sentiment de vaine et morne solitude qui ternit parfois la quête de sens de l’homme moderne.
[1] Charles Taylor, Les sources du moi, trad. Charlotte Melançon, Montréal, Boréal, 1998, p. 33.
[2] Québec-Montréal, réalisé par Ricardo Trogi, 2002.
[3] Ce symbole alimentaire se retrouve également dans la mise en situation où trois amis sont amoureux de la même femme : celle-ci, qui couche avec chacun des trois, a donné à l’un d’eux un morceau de tarte pour qu’il le partage avec les autres et celui qui mange de la tarte sans rechigner qu’elle est trop petite pour trois est le même qui, on le découvre à la fin lorsque les cartes sont mises sur table, a des chances de développer une relation plus durable avec cette femme.
[4] Un crabe dans la tête, réalisé par André Turpin, 2001.
[5] Jean-Jacques Rousseau, « Sixième lettre morale », œuvres complètes, IV, Gallimard, 1969, p. 1112.
[6] La turbulence des fluides, réalisé par Manon Briand, 2002.
[7] Le film Les invasions barbares, réalisé par Denys Arcand, 2003, est la suite du film Le déclin de l’empire américain, 1986, mais nous le traitons ici indépendamment de ce dernier.
[8] Les passages entre guillemets sont des citations du film.
[9] Sur la théorie morale qui a inspiré et alimenté cette réflexion, voir l’ouvrage Les sources du moi de Charles Taylor, auquel nous avons déjà fait référence, de même que Charles Taylor, Grandeur et misère de la modernité, trad. Charlotte Melançon, Montréal, Bellarmin, 1992.
|

