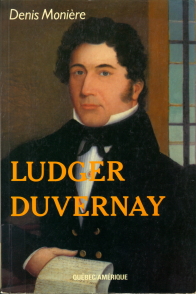
Dans toutes les sociétés occidentales, la presse a joué, depuis la Révolution française, un rôle déterminant dans l'évolution intellectuelle des peuples. La liberté de la presse fondée sur le droit à la libre opinion fut une des conquêtes essentielles du Siècle des lumières et des révolutions française et américaine. Ainsi, aux États-Unis, le premier amendement à la Constitution, adopté en 1789, garantissait la liberté de la presse. Le journal, en assurant la libre circulation des informations et des idées, donnait vie à la démocratie politique. Qu'aurait été le droit de vote sans l'information et le débat indispensables à toute décision dans les affaires publiques ?
L'ancien régime avait établi sa pérennité sur la violence et sur le contrôle des esprits. L'alliance du sabre et du goupillon garantissait le maintien de l'ordre établi. La tradition et la religion définissaient les droits et les devoirs des individus et les enfermaient dans une hiérarchie sociale immuable où chacun devait rester à sa place et respecter l'autorité établie. Cet ordre social était prétendument d'essence divine ce qui le rendait incontestable. L'Église avait donc le monopole de la vérité et utilisait l'idéologie religieuse pour légitimer l'autorité du pouvoir monarchique. L'État monarchique avait à son tour un pouvoir absolu sur la société et exerçait une surveillance étroite de la presse, réprimant brutalement toute velléité de critique de l'ordre établi.
Mais cette structure sociale traditionnelle fut ébranlée et transformée par le mouvement des idées au Siècle des lumières. En Angleterre et en France, au XVIIIe siècle, les philosophes mirent en question cette commune façon de penser l'ordre social au nom de la raison et de la liberté individuelle.
Les philosophes affirmaient que, par nature, chaque être humain avait en lui les lumières nécessaires pour juger le bien et le mal et pour décider de son destin. Chacun pouvait exercer son libre arbitre et en conséquence chaque individu devait être libre de faire ce qu'il jugeait utile à son bonheur. Il n'avait plus à obéir aveuglément à l'ancienne autorité ; il pouvait discuter et faire valoir son point de vue et ses propres intérêts. Dès lors, l'autorité était ramenée du ciel sur la terre et du souverain au peuple qui avait le droit de se diriger lui-même. Il lui revenait de faire les lois régissant la vie en société en désignant ses propres représentants. À l'inverse, le gouvernement avait des comptes à rendre aux élus du peuple ; il ne pouvait plus imposer sa loi de façon arbitraire. Tels étaient les fondements philosophiques du libéralisme et de la démocratie parlementaire qui s'était plus ou moins bien institutionnalisée en France, en Angleterre et aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle.
L'exercice de ces nouveaux droits du citoyen supposait la libre circulation des idées de sorte que de nombreux journaux virent le jour dans la foulée de la Révolution française. Une presse libre permettait aux citoyens de connaître et de contrôler l'action des gouvernants et de la sorte de faire valoir leurs intérêts et leurs droits. La presse devait éclairer le peuple dans ses choix politiques. Mais une presse libre supposait aussi la scolarisation du peuple car pour survivre les journaux avaient besoin de lecteurs. Ainsi, par un enchaînement inéluctable, la conquête de la démocratie politique allait provoquer partout où elle s'établissait une lutte pour le pouvoir entre les anciennes et les nouvelles élites et entraîner une profonde mutation des institutions sociales.
Cette révolution des esprits et des institutions était déjà en marche chez nos voisins du Sud depuis 1776. Elle avait conduit les Américains à leur indépendance. Par effet de contagion, elle se répandait aussi au Canada où toutefois l'oppression coloniale exercée sur la majorité canadienne empêchait le pouvoir britannique d'instaurer les réformes démocratiques. Depuis la Conquête, le Canada était gouverné par une oligarchie militaire qui, pour maintenir l'autorité de la Couronne britannique en Amérique du Nord, avait été obligée de s'assurer la collaboration des conquis en leur concédant par l'Acte de Québec, en 1774, des droits religieux et le maintien du régime seigneurial.
Mais la Révolution américaine avait provoqué l'arrivée massive de Loyalistes qui réclamaient au nom de leur fidélité à la Couronne les droits politiques qu'ils avaient dans les États du Sud. Cet afflux de colons anglais mettait les autorités coloniales devant un dilemme insoluble. Comment reconnaître des droits politiques aux nouveaux arrivants anglais qui étaient très minoritaires dans l'ensemble de la population sans les accorder en même temps à la majorité francophone ? Ne pas le faire aurait provoqué la révolte de la majorité, mais concéder des droits constitutionnels indistinctement à l'ensemble de la population aurait signifié concéder le pouvoir à la majorité francophone. Londres allait expérimenter au Bas-Canada une politique qui deviendrait plus tard le fleuron de sa stratégie impérialiste : diviser pour régner. George Pardmore soutient que la politique coloniale de l'Angleterre en Afrique « a tiré ses origines de la lutte qui s'est engagée entre les colons blancs du Canada et la Couronne britannique au dix-neuvième siècle [1]. » Si les Canadiens n'ont pas réussi à faire leur propre histoire, ils ont contribué à leur insu à l'histoire mondiale.
L'Acte constitutionnel de 1791 divisait la colonie en deux provinces : le Haut-Canada peuplé d'anglophones et le Bas-Canada peuplé majoritairement par des francophones. Londres reconnaissait à ses sujets le droit de vote ainsi que le droit de constituer une assemblée représentative mais n'admettait pas le principe de la responsabilité gouvernementale. Ce système hybride permettait à l'assemblée législative de lever des impôts mais elle n'avait pas le droit de contrôler le pouvoir exécutif puisque le gouvernement n'était pas élu mais nommé par Londres. Ainsi, on avait un régime politique démocratique à la base et autocratique au sommet, chaque niveau de pouvoir dans la province du Bas-Canada étant différencié par l'appartenance ethnique, ce qui préservait la suprématie des anglophones. On avait, en procédant d'une façon aussi discriminatoire, établi la dynamique du conflit qui allait déchirer le Bas-Canada durant la première moitié du XIXe siècle et déterminer le destin de Ludger Duvernay qui sera un des plus fervents défenseurs de l'idéal démocratique.
À la naissance de Ludger Duvernay, en 1799, la conscience démocratique est encore embryonnaire au Bas-Canada faute de liberté politique et d'institutions démocratiques. La société canadienne manque alors de cadres. Le système scolaire est presque inexistant. Avec la Conquête, les Jésuites ont été forcés de retourner en France. Les Sulpiciens entretiennent tant bien que mal quelques écoles à Montréal, où l'enseignement de la philosophie ne reprendra qu'en 1790. Mais entre Montréal et Québec, il n'y a aucun collège. C'est en 1803 seulement que s'établira, à Nicolet, le premier collège classique. Cet exemple sera par la suite suivi par les villages de Saint-Denis et de Saint-Hyacinthe. Ailleurs, on trouve quelques écoles primaires qui enseignent la lecture, l'écriture et quelques rudiments de calcul [2].
Depuis 1760, les élites sont coupées de l'influence culturelle de l'ancienne mère patrie. Les nouvelles idées de liberté individuelle, de souveraineté du peuple, de séparation des pouvoirs n'ont pénétré qu'au compte-gouttes au Canada et le plus souvent, elles nous arrivaient dans la langue de Shakespeare car le conquérant interdisait l'entrée au pays des livres français. Les échos de la Révolution française parviendront sur les rives du Saint-Laurent mais ils seront dissipés par les interventions du clergé qui prêche la soumission et la fidélité à la monarchie britannique. L'Église n'entendait pas laisser se développer la contestation de son autorité et de ses privilèges. Fernand Ouellet décrit ainsi l'état d'esprit du clergé :
- Le clergé catholique est attaché à l'absolutisme monarchique, à la théorie de la monarchie de droit divin, et perçoit la société comme une hiérarchie qui part du roi, passe par les élites : l'aristocratie, le clergé et les dirigeants politiques et qui s'achève dans le peuple. Les rapports sociaux sont déterminés par les principes d'autorité et d'obéissance [3].
L'Église se méfie des institutions parlementaires et elle est prête à tous les expédients pour enrayer l'expansion des idées libérales. Elle prêche la loyauté absolue à la monarchie britannique et cherche à convaincre les Canadiens des bienfaits de la Conquête qu'elle s'évertue à présenter comme un don du ciel.
Elle mena donc une intense campagne de propagande contre la Révolution française et contre la France, cette fille indigne de l'Église parce qu'elle venait d'abolir la monarchie et de séparer l'Église de l'État. Mgr Plessis, en 1799, à la suite de la défaite française d'Aboukir, déclare sans vergogne en chaire : « Réjouissons-nous... Tout ce qui affaiblit la France, tend à l'éloigner de nous. Tout ce qui l'éloigne assure nos vies, notre liberté, notre repos, nos propriétés, notre culte, notre bonheur [4]. » Les autorités anglaises se réjouissent de ces déclarations de loyauté du clergé, car elles craignent que les idées démocratiques contaminent les Français du Canada qui pourraient imiter leurs voisins du Sud.
Mais la Révolution française aura un effet inattendu car même si elle consacrait la rupture de l'élite cléricale avec la France, elle allait ironiquement rehausser le niveau de la culture française au Canada car une cinquantaine de prêtres réfractaires chassés par la révolution viendront s'établir ici apportant avec eux livres et objets d'art qui augmenteront notre patrimoine culturel. Cet afflux de sang neuf permettra la création d'écoles et de collèges qui formeront une nouvelle classe de professionnels qui défendront à leur tour les idéaux démocratiques.
Contrairement à ce qu'affirment les thuriféraires de la domination anglaise, la Conquête ne nous a pas apporté les libertés civiles. Tout comme sous le Régime français, après la Conquête, le pouvoir est toujours contrôlé par une aristocratie militaire qui assure sa domination en obtenant la collaboration subordonnée du clergé et des seigneurs qui, en échange de leur soumission et de celle du peuple, avaient obtenu certains privilèges.
Sous le Régime anglais, la reconnaissance des libertés civiles sera toujours conditionnée par les impératifs stratégiques de la métropole. Seuls des naïfs associent la domination et la générosité. Ainsi, la liberté de presse n'était pas au programme des conquérants et, avant 1791, il n'était pas permis de publier au Canada les simples nouvelles du jour sans la permission du gouverneur. Le premier journal qui fut créé à Québec le 21 juin 1764 par William Brown, La Gazette de Québec, servait à rendre publiques les décisions du gouverneur.
Fleury Mesplet, qui vint au Canada lors de l'invasion américaine fonda le premier journal de langue française, La Gazette littéraire de Montréal, qui parut pour la première fois, le 3 juin 1778. Mesplet annonçait dans son prospectus de lancement qu'il publierait tous les communiqués qu'on lui enverrait à la condition « qu'il n'y soit fait aucune mention de la religion, du gouvernement, ou des nouvelles touchant les affaires présentes, à moins qu'il ne fût autorisé par le gouvernement [5]. » Mais en dépit de cette prudence, le gouverneur Carleton ordonna la cessation de publication et le menaça d'expulsion. Le pouvoir colonial ne tolérait pas la liberté d'opinion. Mesplet reviendra toutefois à la charge en 1785 en lançant la Gazette de Montréal, un hebdomadaire bilingue qui survivra jusqu'à nos jours, le bilinguisme en moins. Le journal de cette époque était imprimé sur une seule feuille ; sa publication était irrégulière et son existence souvent éphémère car les lecteurs se faisaient rares.
Si on fait exception de la tentative avortée de La Gazette littéraire de Mesplet, on peut dire que le premier vrai journal de langue française a été lancé par Pierre Bédard le 22 novembre 1806 et qu'il s'appelait Le Canadien. Ce journal fut créé pour combattre la Clique du Château et promouvoir un gouvernement représentatif. Les marchands anglais en 1805 s'étaient donné un organe d'expression ayant pour nom The Mercury. Ce journal, fondé par Thomas Gary, préconisait dans son numéro du 27 octobre 1806 l'anglicisation forcée du Bas-Canada : « Cette province est déjà beaucoup trop française pour une colonie anglaise. La défranciser autant que possible, si je peux me servir de cette expression, doit être notre premier but. » Il méprisait ouvertement la Chambre d'assemblée parce qu'elle était en majorité composée de Canadiens. Gary écrivait ce qui suit à la suite de la première parution du Canadien :
- Que reste-t-il à faire ? Retirer ces privilèges qui sont représentés comme trop rares mais qui sont en réalité trop nombreux, et dont les conquis se réjouissent trop librement et prendre les mesures pour que l'administration des affaires publiques se fasse en anglais, par des Anglais, ou par des hommes ayant des principes anglais. Ce serait le premier pas et le plus efficace vers l'anglicisation de la province [6].
Le Canadien exprimait la conscience nationale naissante chez les Canadiens. Dans son prospectus de lancement, le journal se définissait lui-même comme l'organe des députés canadiens et leur relais auprès de la population :
- Il y a déjà longtemps que des personnes qui aiment leur pays et leur gouvernement regrettent en secret que le trésor rare que nous possédons dans notre constitution demeure si longtemps caché, faute de l'usage de la liberté de la presse, dont l'office est de répandre la lumière sur toutes ses parties. Ce droit qu'a un peuple... d'exprimer librement ses sentiments sur tous les actes politiques de son gouvernement, est ce qui en fait son principal ressort [7].
Le journalisme canadien servira à exprimer les sentiments populaires envers l'administration coloniale et à diffuser dans le peuple les déclarations et les décisions des membres de la Chambre d'assemblée. L'information était vitale au combat contre l'oppression nationale.
Le droit constitutionnel anglais attribuait le pouvoir de faire les lois à trois institutions complémentaires : la Couronne, la Chambre des lords et la Chambre des communes. Le régime britannique reconnaissait ainsi au peuple le pouvoir de participer à la législation par le biais d'une chambre élective. Mais ce principe ne valait pas pour les territoires conquis, qui étaient directement sous l'autorité de la Couronne. La loi en pays conquis émanait du roi ou de son représentant local. La Constitution de 1791 corrigea partiellement cette disparité en donnant à la colonie le droit de posséder une assemblée représentative mais sans lui reconnaître la responsabilité ministérielle et le pouvoir de contrôler les dépenses du gouvernement. Cette décision n'est nullement inspirée par des soucis de démocratisation, elle est plutôt commandée par des exigences stratégiques et les intérêts supérieurs de la Grande-Bretagne. En effet, ces quelques concessions à la souveraineté populaire visaient surtout à conserver à l'Angleterre la loyauté de ceux qui avaient combattu ou fui le Révolution américaine qui risquait toujours de se répandre au Nord et de faire sauter le dernier joyau de la Couronne britannique en Amérique du Nord, le Canada. Ce calcul s'avéra juste lors de l'invasion américaine de 1812, les Canadiens prenant la défense des intérêts britanniques.
La première élection au Bas-Canada eut lieu en juin 1792. Les électeurs, c'est-à-dire tous les propriétaires (de terre rapportant au moins deux livres sterling par année) devaient élire 50 députés (ce nombre sera porté à 84 en 1834). La composition sociologique [8] de la première députation canadienne se répartissait comme suit :
- marchands 30 58 %
- professionnels 9 17 %
- seigneurs 9 17 %
- cultivateurs 3 5 %
Selon Henri Brun, « les anglophones jouissaient généralement d'une représentation dépassant en pourcentage leur importance démographique [9]. » Alors que la minorité anglophone ne dominait numériquement aucune circonscription et ne représentait que 7 % de la population totale, elle faisait élire environ un tiers de la députation. De plus, les élus canadiens faisaient leurs premières armes dans le système parlementaire alors que leurs collègues députés anglophones étaient plus familiarises avec la procédure parlementaire et pouvaient ainsi contrôler l'Assemblée même s'ils se trouvaient minoritaires. Il faudra ainsi attendre une dizaine d'années avant que les députés canadiens maîtrisent ce nouveau pouvoir et s'en servent pour affirmer les droits du peuple canadien et revendiquer la démocratisation du pouvoir colonial. Il faudra surtout que se cristallise une conscience collective et que se développe une liaison organique entre le peuple canadien et ses représentants, ce qui nécessitera l'émergence d'une presse libre et d'une opinion publique.
La révolution intellectuelle est, dans toutes les sociétés, le fruit d'une longue maturation car pour changer la commune façon de penser, il faut la conjonction de conditions objectives favorables, la présence d'un groupe social dynamique dont la progression est entravée par des structures sociales rigides et l'existence d'institutions regroupant et coordonnant les volontés de changement et véhiculant les nouvelles valeurs. La société canadienne au début du XIXe siècle amorce ce processus et n'est pas à cet égard déphasée par rapport à la très grande majorité des autres sociétés où règnent l'absolutisme monarchique, le féodalisme et la confusion des pouvoirs spirituel et temporel. La plupart des pays européens sont alors dominés par des régimes autocratiques où les libertés civiles sont inexistantes. La lutte entre l'ancien et le nouveau ne fait que débuter au Canada comme ailleurs.
Partout, les transformations sociales et les révolutions politiques s'accompagneront de nouvelles conceptions du monde qui les appellent et les justifient. Les conflits sociaux mettent certes en jeu des intérêts mais ceux-ci doivent être à leur tour légitimés par des valeurs et des idéaux qui appellent à l'action. Pour cette raison, les intellectuels sont toujours au cœur des mouvements sociaux. Ils les expriment, leur donnent cohérence et efficacité et mobilisent par le discours les énergies individuelles. Cette fonction de conscientisation est indispensable aux mouvements démocratiques qui se réclament de la volonté populaire et qui doivent s'appuyer sur le soutien du peuple pour atteindre leurs buts.
Duvernay, qui fut imprimeur, journaliste, député et fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste, incarne peut-être mieux que tout autre le prototype de l'intellectuel engagé dans l'action par la pensée et la diffusion des idées dans la première moitié du XIXe siècle. Il a surtout exercé son action intellectuelle comme directeur de nombreux journaux qui combattaient la tyrannie du pouvoir colonial. Il était considéré par ses contemporains comme un des chefs de file du mouvement patriotique. Mais s'il a été reconnu par ses concitoyens comme un éveilleur de consciences, il a par la suite été ignoré par la postérité puisqu'aucun biographe n'a cherché à reconstituer de façon systématique sa vie et son œuvre éditoriale. L'homme est indissociable de son époque et en retraçant son itinéraire intellectuel et politique, nous essaierons de mieux comprendre les hommes et les idées qui ont marqué cette période agitée de notre histoire nationale.
[1] George PARDMORE, Panafricanisme et communisme, Paris, Présence africaine, 1960, p. 199.
[2] Voir Claude GALARNEAU, Les Collèges classiques au Canada français, Montréal, Fides, 1978.
[3] Fernand OUELLET, Le Bas-Canada, Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1976, p. 67.
[4] J.-P. WALLOT, « Courants d'idées dans le Bas-Canada à l'époque de la Révolution française » dans L’Information historique, mars-avril 1968, p. 73.
[5] Cité par M. BIBAUD, Histoire du Canada sous la domination anglaise, 1968, p. 138.
[6] Cité par J. P. DE LAGRAVE, Les Journalistes démocrates au Bas-Canada, Montréal, Éditions de Lagrave, 1975, p. 83.
[7] Le Canadien, 13 novembre 1806.
[8] Voir Fernand OUELLET, op. cit., p. 44.
[9] Voir Henri BRUN, La Formation des institutions parlementaires québécoises 1791-1838, Québec, PUL, 1970, p. 93.
|

