[17]
Jorge Niosi
Sociologue, professeur retraité de l’UQAM [- 2023]
“Les classes sociales
au Canada”
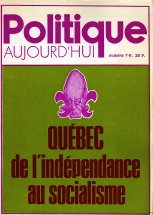 Un article publié dans la revue Politique aujourd'hui, Paris, no 7-8, 1978, pp. 17 à 22. [Dossier: Québec: de l'indépendance au socialisme] Un article publié dans la revue Politique aujourd'hui, Paris, no 7-8, 1978, pp. 17 à 22. [Dossier: Québec: de l'indépendance au socialisme]
Introduction
Les classes sont des groupes sociaux définis par leur rapport de propriété aux moyens de production et de distribution. À l'intérieur du mode de production capitaliste deux grandes classes sociales se distinguent nettement : la bourgeoisie qui est propriétaire de moyens de production et qui emploie du travail salarié, et la classe travailleuse qui ne possède pas d'instruments de production ou de distribution et qui vit de la vente contre salaire de sa force de travail. À part ces deux classes on doit isoler plusieurs autres groupes sociaux. Il y a tout d'abord les petits producteurs indépendants de biens et de services, qui possèdent des moyens de travail et qui les emploient eux-mêmes, avec l'aide occasionnelle d'un ou de plusieurs salariés. La petite production marchande précapitaliste comprend notamment les fermiers, pêcheurs, artisans, vendeurs indépendants, petits commerçants et [18] professionnels indépendants (médecins, avocats, dentistes, pharmaciens, etc.) pour autant qu'ils travaillent à leur compte. Il y a, en deuxième lieu, la bureaucratie de l'État, les fonctionnaires, membres des forces armées et de la police, les enseignants et autres cols blancs du secteur public. Ces quatre groupes sociaux comprennent la quasi totalité de la population active canadienne et nous allons les étudier séparément.
1. La bourgeoisie canadienne
Le Canada est un pays dépendant. De 1760 à la Première guerre mondiale, il était dépendant de la Grande-Bretagne. À partir de la Seconde guerre, il l'est des États-Unis d'Amérique. De là vient la fameuse formule du grand historien canadien Harold Innis : « de colonie à nation, de nation à colonie ».
Assujetti tour à tour par les deux puissances industrielles du globe intéressées à y écouler leurs biens manufacturés, manquant de population et divisé en économies régionales, le Dominion du Canada a toujours connu une importante mainmise étrangère sur son secteur industriel. Aujourd'hui les deux tiers de son industrie minière et manufacturière appartiennent à des sociétés américaines ou européennes. Inversement, les secteurs commercial, financier, agricole, immobilier et des services sont les châteaux forts de la bourgeoisie locale. Au XIXe siècle, le commerce, le transport et la finance, ainsi que quelques industries légères liées à la consommation, sont des branches d'activité où une bourgeoisie canadienne s'est formée. Cette bourgeoisie du XIXe siècle était d'origine anglaise et protestante : l'accès aux marchés britanniques de produits et de capitaux était la voie royale de la fortune. Des familles très puissantes qui sont aujourd'hui à la tête de vastes empires ont leurs racines au XIXe siècle : les Molson (boissons et finances), les Eaton (commerce et finances), les Maclaren (papiers et finances), les Richardsons (commerce et finances), les Meighen (finances), les Weston (aliments, commerce), les Jeffery (assurances) ou les Southam (presse). Une partie des millionnaires du XIXe siècle est retournée en Angleterre, le plus célèbre étant sans doute Donald Smith, Lord Strathcona, qui était au tournant du siècle l'un des principaux propriétaires des trois plus grosses sociétés du Canada : la Banque de Montréal, la Compagnie de la Baie d'Hudson et la Société de chemins de fer du Canadien Pacifique. La bourgeoisie du XIXe siècle était presque uniquement « White Anglo Saxon Protestant » (W.A.S.P.). Les immigrants alimentaient les files croissantes du prolétariat rural et urbain et dans quelques cas obtenaient des moyens de production pour devenir fermiers ou artisans. La population canadienne-française, vivant dans l'agriculture, politiquement subordonnée au Conquérant et culturellement dominée par l'Eglise, n'a presque pas participé au développement du capitalisme canadien initial.
Au XXe siècle on assiste à la croissance de nouveaux secteurs industriels financiers, commerciaux et de services. C'est le boom des industries papetière, sidérurgique, du matériel de transport, de la chimie, des mass-média, du transport routier, du courtage en valeurs, de l'immobilier. Dans plusieurs de ces secteurs le capital américain a acquis une place dominante : c'est le cas dans la chimie et la pétrochimie, lie matériel de transport et dans l'industrie minière et électrique. Dans d'autres cas, de nouveaux capitalistes anglo-saxons [19] du Canada se sont taillés de véritables empires : les Gundy (courtage en valeurs, commerce), les Nesbitt et les Thompson (commerce en valeurs, hydroélectricité), les Searle-Leach (commerce de grains, industrie), etc. Mais la nouveauté, surtout après la Seconde guerre mondiale, c'est l'apparition dans le monde fermé de la haute finance, de capitalistes franco-canadiens et juifs. Parmi les premiers signalons Paul Desmarais (actionnaire majoritaire du conglomérat Power Corporation dont les actifs se rapprochent des dix milliards de dollars), les Bombardier (motoneiges et matériel ferroviaire), Robert Campeau (immobilier), Jean-Louis Lévesque (finances, industrie), les Simard (industrie, finances), etc. Parmi les seconds, rappelons les Bronfman (propriétaires de Seagrams Ltd., la plus grande distillerie du monde, ainsi que de gigantesques sociétés immobilières et financières), les Steinberg (commerce), L. Cohen et L. Ellen (finances), les Ivanier, les Kruger (industrie), les Belzberg (finances), etc.
La bourgeoisie canadienne est fédéraliste parce que ses affaires se font d'un océan à l'autre. Ses préférences politiques varient selon le groupe « ethnique » : les Canadiens-français et Juifs sont majoritairement libéraux, les W.A.S.P. majoritairement conservateurs. Montréal, le centre géographique des affaires franco-canadiennes et juives, est un bastion libéral sur la scène politique fédérale. Le clivage « ethnique » coïncide alors en bonne partie avec un clivage régional et politique.
Les petits et moyens capitalistes sont passablement intégrés économiquement, politiquement et culturellement à la grande bourgeoisie dominante. À la tête des deux grands partis politiques fédéraux, on trouve côte à côte des multimillionnaires comme les Meighen ou les Stevens travaillant de concert avec des industriels moyens, comme les Stanfield, dans le parti conservateur et, dans le parti libéral, de riches hommes d'affaires comme J. Richardson ou Charles Drury côtoyant de « jeunes » millionnaires comme Don Jamieson. Des personnages centraux dans l'organisation des partis politiques bourgeois sont les avocats de compagnies comme Louis St-Laurent, Jean Lesage, John Robarts, John Turner, Bryan Mulroney ou Mitchell Sharp, qui font la navette entre la vie publique et les conseils d'administration : Gramsci dirait que les avocats sont les intellectuels organiques de la classe dominante. Ces deux partis grassement financés par de riches individus et par les grandes entreprises assurent la suprématie politique de la bourgeoisie canadienne au niveau fédéral. En tant que propriétaire des moyens de communication de masse (presse, radio, télévision, revues d'actualité), la bourgeoisie veille à ce que ses idées soient les idées dominantes et dirige ainsi la vie idéologique du pays. La propriété des moyens de communication de masse est très concentrée. C'est ainsi que, au Nouveau Brunswick, un seul homme d'affaires (Kenneth Irving) est propriétaire de tous les journaux de langue anglaise. Au Québec deux hommes d'affaires (Paul Desmarais et Pierre Péladeau) sont propriétaires de la quasi totalité des journaux en langue française. Le premier contrôle, en outre, des chaînes de radio et de télévision.
2. Les petits producteurs
La petite production indépendante a décliné en pourcentage de la main-d'œuvre depuis la Seconde guerre mondiale avec le processus de centralisation [20] et de concentration dans l'industrie, le commerce et l'agriculture. En 1968 près d'un million de personnes, soit 10,9% de la main d'œuvre, pouvait être classé dans la petite bourgeoisie [1]. Certains secteurs parmi eux tendaient à décliner en termes absolus et relatifs : les artisans, les pêcheurs, les fermiers, les commerçants à leur compte. Le déclin des revenus de ces secteurs a commencé depuis longtemps, et les luttes entre les petits producteurs (particulièrement les fermiers) et la bourgeoisie ont occupé le devant de la scène politique pendant des décennies. Les petits producteurs traditionnels ont formé les ailes radicales des partis libéral et conservateur au XIXe siècle. Plus tard ils ont formé leurs propres partis politiques dont le Crédit Social (en Alberta, au Québec et en Colombie Britannique) et la Coopérative Commonwealth Fédération, aujourd'hui le Nouveau Parti Démocratique, ici en alliance avec des partis travaillistes (en Saskatchewan, Ontario, Colombie Britannique et Manitoba). Les coopératives agricoles et de pêcheurs ont été une autre forme de défense des petits producteurs devant le double ciseau des monopoles commerciaux et de la machinerie agricole. Ainsi, au Québec, sur un total de 61.257 fermes dénombrées par le recensement de 1971 il y avait 52.000 fermiers membres de l'une ou l'autre des coopératives agricoles. Toutefois la petite production traditionnelle n'a cessé de diminuer en termes absolus; le nombre total des fermes recensées au Canada est passé de 623.000 en 1951 à 339.000 en 1976, une diminution de 45% en 25 ans.
Mais tous les petits producteurs n'ont pas subi le même sort. Avec l'expansion des services de santé et juridique, les médecins, dentistes, pharmaciens, avocats et notaires ont vu leur nombre et leurs revenus augmenter. La construction urbaine a multiplié les bureaux des architectes et des ingénieurs. Mais même ces services, autrefois des fiefs absolus des professionnels indépendants, commencent à se concentrer et à s'organiser de manière capitaliste. Ainsi par exemple, les plus gros bureaux d'avocats (tels que ceux de Blake, Cassels & Graydon à Toronto ou d'Ogilvy, Cope, Porteous, Montgomery, Renault, Clarke et Kirkpatrick à Montréal) sont devenus de véritables « usines légales » où travaillent jusqu'à 76 avocats et des centaines d'employés subalternes. Ces professionnels adhèrent en général aux partis bourgeois traditionnels et partagent la philosophie politique de la classe dominante canadienne. Leurs revenus (de $80.000 à $100.000 en moyenne pour les médecins, de $50.000 à $80.000 pour les dentistes et les avocats) les placent au-dessus des salariés. En 1971 par exemple, les médecins avaient des revenus moyens plus de sept fois supérieurs à ceux des fermiers, plus de cinq fois supérieurs à ceux des travailleurs textiles et plus de quatre fois supérieurs à ceux des travailleurs de la construction.
Le clivage linguistique (anglophone/francophone) est le principal type de conflit qui divise ces professionnels indépendants modernes. En effet, une bonne partie des avocats, notaires et médecins exercent leur profession en une seule des deux langues officielles. La progression constante de l'anglais, au Québec même, menace directement les intérêts d'une partie au moins de ces professionnels qui se tournent politiquement vers l'indépendantisme ou tout au moins vers une politique de francisation du Québec.
3. La classe travailleuse
Une première caractéristique des travailleurs canadiens est leur distribution par secteur d'activité, distribution où le tertiaire occupe un rôle démesuré. [21] Ainsi, en 1971, 53% de la main-d'œuvre canadienne se trouvait dans quatre grands secteurs : le commerce, les services, la finance et l'administration publique. En revanche seulement 20% de la main-d’œuvre se trouvait dans l'industrie manufacturière : c'est là le pourcentage le plus bas de tous les pays de l'O.C.D.E., à l'exception de l'Irlande. Le caractère retardataire et dépendant de l'industrie manufacturière explique à la fois les hauts taux de chômage du Canada et le gonflement des secteurs « refuge » dans le tertiaire.
Environ deux tiers de la main-d'œuvre canadienne font partie de la classe travailleuse au sens strict, soit celle salariée dans le secteur privé : mines, manufactures, commerce, finances et services privés. Un cinquième est employé dans l'administration publique et la défense, dans l'enseignement et la santé. Il s'agit essentiellement du corps des fonctionnaires dont nous parlerons dans la section suivante.
Les rémunérations des travailleurs canadiens sont comparables à celles payées aux États-Unis, à cause de la haute mobilité de la force de travail entre les deux pays, du taux de syndicalisation élevé et de l'action des syndicats internationaux. On reviendra sur ce dernier point. Cependant, les inégalités interrégionales sont importantes du fait de la localisation inégale de l'activité manufacturière. En effet, à Ontario se concentrent, de plus en plus, les industries les plus dynamiques (matériel de transport, automobiles, sidérurgie, électronique, chimie, produits métalliques) et au Québec les plus traditionnelles (vêtement, textile, cuir, aliments et boissons, etc.).
Cette localisation inégale de l'activité manufacturière se greffe sur le problème national et contribue à la division encore plus nette des travailleurs canadiens. Cette division « ethnique » est on ne peut plus marquée. Sur le plan syndical, la moitié des travailleurs syndiqués du Québec adhèrent à des centrales exclusivement québécoises : la Confédération des Syndicats Nationaux (C.S.N.), la Centrale de l'Enseignement du Québec (C.E.Q.) et la Centrale des Syndicats Démocratiques (C.S.D.). Une seule centrale, affiliée au Congrès du Travail du Canada, la Fédération des Travailleurs du Québec (F.T.Q.), regroupe environ la moitié des effectifs syndiqués du Québec.
Sur le plan politique on retrouve un schisme semblable. Le parti qui représente les travailleurs canadiens anglais, le Nouveau Parti Démocratique (une version radoucie du Labour Party anglais) a de solides assises en Ontario, Saskatchewan, Manitoba et Colombie Britannique, mais il est presque inexistant au Québec. Aux élections fédérales, le Québec vote en masse pour le parti libéral, et ce depuis 1896. En somme, les travailleurs canadiens-français, qui sont par ailleurs très actifs sur le plan syndical, manquent d'une organisation politique autonome et ils servent de base électorale au parti libéral au niveau fédéral et aux partis québécois et libéral sur la scène provinciale.
Par ailleurs, la pénétration du syndicalisme américain (41% des effectifs syndicaux canadiens en 1977 sont membres de l'AFL-CIO) contribue encore davantage à désagréger la force politique du prolétariat. En effet, non seulement les syndicats américains sont partisans de la collaboration des classes sur le plan économique, mais encore, au niveau électoral, ils fournissent un appui non négligeable an Parti Libéral et enlèvent toute velléité de pouvoir au Nouveau Parti Démocratique sur le plan fédéral. Ce dernier a, par ailleurs, administré à plusieurs reprises diverses provinces de l'Ouest : la Saskatchewan, le Manitoba et la Colombie Britannique.
[22]
4. Les fonctionnaires
Un cinquième de toute la main-d'œuvre canadienne est employé dans l'administration publique de défense, dans la santé et l'enseignement. Ce secteur a connu une croissance rapide depuis la Seconde guerre mondiale, mais il tend à stagner en pourcentage de la force de travail depuis 1970. La crise fiscale de l'État canadien, tant sur le plan fédéral que provincial, restreint de plus en plus les possibilités d'emploi et d'amélioration salariale de ces travailleurs. On assiste alors, depuis quelques années, à des luttes syndicales très importantes des employés de la fonction publique. Les Fronts communs intersyndicaux du Québec, en 1972 et 1975, expriment bien la nouvelle combativité des employés de l'État. Après deux décennies d'expansion de l'emploi, d'amélioration des salaires et des conditions de travail, les fonctionnaires subissent, depuis plusieurs années, les conséquences des coupures budgétaires des États fédéral et provinciaux. Ainsi il n'est plus étonnant d'assister à des grèves de pompiers, de policiers (au Québec, ces grèves sont illégales), d'infirmières ou de professeurs d'université. Bien souvent ce sont aujourd'hui les employés de l'État qui possèdent les syndicats les plus militants et qui développent les idéologies les plus radicales.
Conclusion
Le Canada traverse aujourd'hui une double crise. Crise économique d'abord, caractérisée par la faillite de la voie de développement capitaliste dépendant, orchestrée par sa classe dominante, il y a un siècle. En effet, le taux de chômage connaît des sommets sans précédents après la grande récession de 1929-1933 ; les grandes compagnies minières américaines et canadiennes (nickel, cuivre, fer) déménagent vers des pays à bas salaires et à dictatures stables, comme le Guatémala, l'Indonésie, le Brésil et le Chili. Crise politique ensuite : la nation canadienne-française, qui apporte plus que sa part au prolétariat, au chômage et à la marginalité, se réveille sous l'effet de la crise économique mondiale et canadienne.
Devant cette double crise, la classe capitaliste canadienne caresse le projet d'une intégration économique croissante avec les États-Unis, sous la forme d'une association de libre-échange. Mais cette association ne pourrait que nuire à la province dont l'industrie est la moins concurrentielle, le Québec, et risque d'accélérer davantage la désagrégation du Canada. Tout comme en Grande-Bretagne et pour des raisons semblables, la crise mondiale capitaliste peut aboutir, non pas à un renforcement du prolétariat, mais à la séparation des nations opprimées.
[1] L. Jonhson : « The development of Class in Canada in the XXth Century » in G. Teeple (ed.) : capitalism and die National Question in Canada, Presses de l'Université de Toronto, 1972.
|

