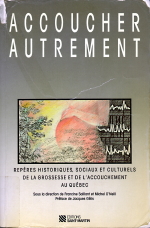 Préface Préface
Jacques Gélis
Université de Paris VIII
L'accouchement, cela va de soi, est d'abord un fait biologique : un corps de femme se « délivre » d'un autre corps, du corps de l'enfant qu'elle a engendré ; l'accouchement, au même titre que la naissance pour l'enfant, est une « libération ».
- Mais l'accouchement, on le sait bien, ne peut être réduit à cette dimension. La naissance est au coeur de toute société ; c'est par l'enfant que constamment celle-ci se renouvelle ; ainsi se trouve surmontée, l'inévitable usure du temps sur la machine humaine. Or, toute société a sa manière à elle de se comporter à l'égard de la femme en couches et de recevoir l'enfant ; l'accouchement s'inscrit toujours dans une culture. La naissance et l'accouchement renvoient à une conscience du corps et à un imaginaire de la vie, à une « manière d'être au monde » qui ne sont pas immuables.
De profonds changements sont intervenus dans les sociétés occidentales ; ils ne peuvent être appréciés que par une plongée dans un passé récent : l'accouchement a aussi une histoire. Cette histoire ne peut certainement pas être réduite à une rétrospective des techniques obstétricales, ni à une étude des rapports entre sages-femmes et accoucheurs, ni non plus à une mainmise des hommes sur le corps des femmes en couches. Elle est tout cela, mais aussi un peu plus.
Deux approches partielles
L'histoire des couches a fait l'objet de deux approches opposées, l'une et l'autre insuffisantes, car trop limitatives. La première est celle des médecins, qui ont été longtemps les seuls à s'intéresser au passé de l'accouchement, cette approche valorise à l'excès l'intervention du praticien ; résolument positiviste, elle insiste sur les progrès réalisés depuis deux siècles, grâce à la médecine, sur la baisse spectaculaire de la mortalité des femmes en couches et des nouveau-nés, qu'elle attribue au perfectionnement des techniques obstétricales. Cette histoire-là, toute à la gloire des grands auteurs et praticiens n'est qu'une avantageuse galerie de portraits, un panorama de découvertes instrumentales, un inventaire des doctrines de l'art obstétrical. Jamais on ne perçoit à la lire les joies et les souffrances des mères, les cris des nouveau-nés ; elle fait l'économie de la dimension sociale des couches ; jamais n'apparaissent les hésitations, les échecs, les erreurs des accoucheurs d'antan. Elle condamne par contre abondamment les « superstitions », et se fait accusatrice lorsqu'il s'agit de juger la conduite des accoucheuses traditionnelles : un ton doctoral qui traduit la vision positiviste de l'évolution des couches ; une histoire épurée, lisse ; une histoire-monument : à la limite, une histoire morte.
La seconde approche est récente, puisqu'elle ne remonte guère qu'aux années 1965-1970. Elle accompagne alors l'émergence d'une sensibilité féministe, sans qu'on puisse la réduire à celle-ci. Son mérite : avoir posé le problème de l'accouchement sous un angle nouveau en cherchant dans l'histoire l'origine de la situation contemporaine. Mais le débat a été moins centré sur l'analyse en profondeur des conditions du passage à l'accoucheur que sur l'opposition homme / femme, sage-femme / accoucheur. L'accoucheuse symbolisait l'accouchement entre femmes, leur solidarité, alors que l'une de leurs compagnes traversait un moment à la fois difficile et exaltant de son existence ; l'accoucheur représentait au contraire l'immixtion d'un pouvoir doublement étranger - puisqu'il était souvent extérieur au milieu et qu'il était homme - dans un domaine qui avait échappé jusqu'alors à son contrôle. En insistant sur le conflit de compétence entre sage-femme et accoucheur, on mettait en évidence un moment décisif de l'histoire des femmes. Il est tout à fait significatif que ce soit surtout des femmes, historiennes, sociologues, ethnologues, qui se soient penchées sur cette question, en insistant d'ailleurs plus sur les aspects institutionnels que sur l'univers mental, l'imaginaire de la vie des femmes d'autrefois. On analysa ainsi le rôle de la politique démographique, de la religion, et l'on porta (cf. les études de Jean Donnisson en Angleterre, ou Claudia Pancino en Italie) une attention particulière aux écoles de sages-femmes, c'est-à-dire à la manière de faire passer parmi les accoucheuses médicalisées le nouveau credo médical.
Cette approche n'a pas toujours su éviter les interprétations rapides et par-là simplificatrices. Les couches auraient été autrefois plus aisées - ce qui est douteux -, plus conviviales qu'aujourd'hui - ce que l'on croit volontiers -. Elles auraient constitué une sorte d'idéal, que l'ambition forcenée des accoucheurs et la volonté du pouvoir politique seraient venues compromettre, dans les villes au moins, à partir de la fin du 17e siècle. Les femmes, éternelles mineures, seraient alors tombées dans la dépendance d'un corps médical masculin.
Sans doute, la trame de l'évolution est-elle correcte ; mais elle paraît aujourd'hui un peu schématique ; tout ce qui touche à la vie, et à la mort, est d'une trop grande complexité pour se plier à une telle interprétation ; ni la volonté de puissance de l'accoucheur, ni la plus grande compétence qu'il prétendait avoir, ne peuvent expliquer à elles seules la relative facilité avec laquelle l'homme de l'art s'est imposé aux femmes en couches. L'historien n'est d'ailleurs pas dans son rôle lorsqu'il assure que l'on accouchait « mieux » hier qu'aujourd'hui ; ou l'inverse. Est-ce « mieux », est-ce « pire » ? En posant le problème de cette façon, on est immanquablement amené à formuler un jugement de valeur. Or, l'accouchement n'était aux siècles passés, ou même il y a 50 ans, ni « meilleur » ni « pire » qu'aujourd'hui : il était différent. Et c'est bien en partant de ce constat de différence que l'étude des conditions de l'accouchement et de la naissance doit être abordée. Seule la démarche anthropologique est ici pleinement satisfaisante, parce qu'elle évite de privilégier un aspect plutôt qu'un autre, et envisage la question dans sa globalité.
Il semble en effet que la demande sociale ait été à l'origine de l'innovation, et que le corps médical, loin d'avoir joué un rôle moteur dans le changement, n'ait fait en ses débuts que l'accompagner, et encore avec retard. Le désir de sécurité des femmes pour leur enfant et pour elles-mêmes a sans doute précédé en effet le moment où les médecins ont été capables d'y répondre. Cette approche ne remet pas en cause le processus du passage à l'accouchement par l'homme sur le long terme, mais elle en modifie singulièrement les prémisses.
Ces comportements nouveaux résultent de la transformation lente, amorcée en Europe à la Renaissance et accélérée au 17e siècle, d'une société à dominante rurale en une société où la ville allait progressivement imposer une autre « manière d'être au monde », la nôtre.
Les trois imaginaires de la vie et du corps
Pendant des siècles se sont opposées deux conceptions de la vie et du corps : celle des populations rurales largement dominantes, influencées par une nature avec laquelle elles vivaient comme en osmose, et celle de l'Église, qui ne voyait dans le corps qu'une enveloppe temporaire de l'âme.
Une conscience « naturaliste »
de la vie et du corps
La conception « naturaliste » de l'existence qui faisait de la terre le vivier où se renouvelaient toutes les espèces, donc l'espèce humaine, n'accordait à l'individu qu'une place minime. Celui-ci n'était qu'un rouage de la chaîne de solidarités qui unissait les hommes, puisque la succession des générations était le seul moyen de surmonter l'inévitable usure du temps, le dépérissement du corps et la mort. Dans ce contexte, il fallait tout faire pour assurer cette pérennité ; une altération même involontaire du cycle, la stérilité du couple par exemple, pouvait avoir des effets désastreux. La lutte pour la vie était lutte pour la survie de la lignée : et tout lui était subordonné.
Dans ce contexte, le concept de liberté individuelle n'avait guère de sens et le corps était en quelque sorte ambivalent. La rupture du cordon signifiait l'autonomie du corps, mais la relation avec la communauté continuait à être charnellement ressentie la vie durant : chaque individu avait donc son corps en propre, et en même temps il éprouvait très fortement son appartenance au grand corps collectif de la lignée. Son corps était le sien et aussi un peu « les autres ». À tel point que la faute commise par un membre, ou au contraire l'affront qu'on lui avait fait, étaient vécus collectivement et mettaient en jeu les mécanismes de solidarité et de responsabilité collectives.
Chaque homme, chaque femme décrivait une sorte d'arc de vie, plus ou moins long, selon la durée de son existence ; on sortait de terre par la conception, on y rentrait par la mort. Sous terre était la résidence des morts, la réserve des âmes en attente d'une réincarnation : âmes des ancêtres qui allaient renaître un jour dans l'un de leurs petits enfants. Dans cet univers, le rôle de l'accoucheuse consistait à assurer pratiquement et symboliquement la permanence du cycle, de construire l'ancestralité : aider à naître c'était aussi « refaire des ancêtres ». Derrière ces croyances et ces comportements émerge la structure circulaire de ce cycle vital original, et transparaît l'idée d'un monde plein, d'une grande famille de vivants et de morts toujours égale en nombre, perdant ici ce qu'elle récupère là.
Dans cet imaginaire, la mort est d'autant mieux acceptée qu'elle n'est pas une vraie mort, mais promesse de renouveau.
L'Église et la conscience du corps :
une évolution significative
L'Église entendit lutter contre cette vision qu'elle jugeait erronée. Elle sentait bien qu'elle pouvait difficilement demander à l'individu de préparer son salut, dont elle prétendait qu'il était, et lui seul, responsable, alors que pesaient sur lui les obligations de la lignée. Il fallait choisir... Sur le long terme l'Église a contribué indiscutablement à l'ébranlement des anciennes structures familiales et communautaires.
En valorisant l'individu, le christianisme, religion du salut personnel, était logiquement amené à s'opposer aux antiques solidarités, où l'individu était enserré en un réseau de dépendances qui bridait sa liberté d'être et d'agir. Mais si la religion introduisait un ferment de liberté, ce n'était pas dans le but de favoriser l'épanouissement de l'homme dans la société d'ici-bas, puisque seule comptait la quête assidue du salut.
L'adoption de l'accoucheur par la société urbaine soulève quelques questions. Celle-ci par exemple : comment se fait-il que dans cette société façonnée par la religion, où filles et femmes reçoivent une éducation qui les met sans cesse en garde contre les manquements à la décence, l'homme-accoucheur ait pu intervenir auprès des femmes en couches sans que l'Église proteste vraiment ? En fait, si l'Église se tait, c'est qu'elle devient de plus en plus perméable à la nouvelle conscience de la vie : sauver l'âme, bien sûr, mais aussi sauver le corps de la souffrance, de la maladie et de la mort prématurée. Aussi l'Église s'engage-t-elle au XVIIe siècle, aux côtés de tous ceux qui peuvent avoir une action positive sur la peuplade, à faire en sorte que les hommes vivent mieux sur cette terre.
La conscience moderne de la vie et du corps
Que la lente émergence de la conscience moderne de la vie et du corps se manifeste d'abord dans les villes est dans l'ordre des choses ; la ville est un milieu construit par l'homme où la perception de la « nature » s'estompe progressivement : disons que l'on ne met plus la même réalité derrière le mot. La conscience d'un rapport avec la Terre-Mère tend ici à disparaître. Cette évolution est d'ailleurs favorisée par le courant humaniste, littéraire et artistique (découverte de la perspective, conscience de la beauté du corps). La solidarité avec la lignée tend à se distendre ; et l'émergence de l'individu s'accompagne d'une individualisation du corps ; l'homme réalise maintenant qu'il peut disposer de son corps, mais que ce corps est fragile et qu'il faut donc le protéger. C'est dans les villes que le rapport aux ancêtres a tendance à se distendre. À la conscience circulaire du cycle de vie succède alors progressivement - d'abord dans les classes aisées, puis dans les catégories sociales moins favorisées - une conscience plus linéaire, plus segmentaire de l'existence, où l'individu pèse son poids, où l'ombre du groupe familial, de la parenté, ne gomme plus la personnalité.
Trois faits ont profondément contribué à cette mutation. D'abord, une nouvelle image du cosmos, avec Copernic, Galilée et Képler ; à la conception d'un « monde clos » se substitue celle d'un « univers infini » ; l'homme, « le petit monde », est placé dans une situation nouvelle par rapport à l'univers, « le grand monde ». Les grandes découvertes, celle du continent américain surtout, sont venues également bouleverser le rapport à l'espace ; alors que le rapport au temps venait justement lui aussi de changer avec l'apparition des premières horloges. Enfin, l'intérêt pour le corps, pour l'intérieur du corps, pour l'anatomie, faisait au même moment l'objet d'un véritable engouement. Explorer la terre, explorer le corps, procédait d'un même désir d'investigation, d'une même volonté de savoir. Les siècles classiques ont été fascinés par les mystères du corps ; du corps de la femme, de la femme enceinte surtout, puisque c'était là que l'humanité sans cesse se renouvelait...
L'idée fait alors son chemin que la maladie, l'accident de grossesse ou d'accouchement n'ont rien d'inéluctable. À la passivité, à une sorte de fatalisme, qui était le propre des sociétés rurales, fait place une aspiration aux soins, une volonté de se sauver, en faisant appel à celui qui fait profession de soigner le corps souffrant, au médecin. Progressivement émergent les comportements contemporains : souci de rompre avec le cycle jugé infernal des maternités à répétition ; désir d'avoir des enfants non plus avec l'obsession de la permanence du cycle vital, mais simplement pour les aimer et en être aimé. Réaliser le couple et non plus privilégier le lignage.
Les médecins n'ont pas senti venir cette mutation des sensibilités, cette volonté ardente de se guérir. Les charges que Molière, et d'autres, leur adressent sont effectivement le reflet d'une situation de carence. Les chirurgiens encouragés en France par le pouvoir royal comprennent alors tout le parti qu'ils peuvent tirer de la situation. Eux, les mal-aimés du corps médical, les « manuels » méprisés par les hommes de culture que sont avant tout les médecins, acquièrent enPréface 13 un demi-siècle (de la fin du 17e au milieu du 18e siècle) les connaissances et la pratique que l'opinion attendait, et obtiennent, grâce à l'appui du pouvoir politique, que les accoucheuses obéissent à leurs directives. Les exemples montrent qu'en ville, un bon chirurgien-accoucheur, après quelques interventions heureuses, est appelé dans tous les milieux sociaux du quartier où il exerce, même lorsqu'il s'agit d'accouchements ordinaires.
Avant l'arrivée de l'accoucheur, les femmes souhaitaient pouvoir compter sur un secours au cas où une difficulté surviendrait ; une fois accepté, et conscient des possibilités que lui offre sa spécialisation obstétricale, le praticien impose vite sa façon de faire ; et c'est tout l'univers des couches qui s'en trouve transformé : il élimine les femmes dont la présence au moment de l'accouchement lui semble superflue, il ne tolère plus que la position couchée, etc. Le processus de médicalisation des couches est dès lors engagé de manière irréversible.
Ce modèle d'évolution des comportements fait une place essentielle à la culture et à l'histoire. Sans doute, sa présentation en est-elle ici trop schématique ; sans doute, le passage de l'accouchement « ancienne manière » à l'accouchement médicalisé s'est-il effectué dans chaque pays selon des modalités particulières, en fonction de situations originales. Mais la trame générale ne s'en trouve pas remise en question pour autant. Et l'émergence de l'individu, la recherche de la sécurité du corps apparaissent ainsi comme deux aspects majeurs et complémentaires de la mutation apparue en Occident au cours des quatre derniers siècles.
Et maintenant ?
Nous vivons aujourd'hui une étape - l'étape ultime ? - de ce processus. Nous savons maîtriser la vie, et nous nous enfermons dans un individualisme forcené. On a moins d'enfants et dans la plupart des pays occidentaux la chute de la natalité est telle que la relève des générations n'est plus assurée. L'époque actuelle est d'ailleurs fait de comportements apparemment contradictoires : on veut moins d'enfants et en même temps, on ressent la stérilité comme une frustration majeure. En vérité, l'insémination artificielle, les mères-porteuses, le bébé-éprouvette étaient prévisibles, dès lors que la médecine en faisait un enjeu et que le public demandait toujours plus de science et de technique. Mais cette fois, on franchissait un cap si important, que l'éthique était en cause.
Nous sentons bien que nous sommes à un carrefour. La baisse spectaculaire de la mortalité en couches et de la mortalité néonatale se paie au prix fort d'une dépendance croissante des femmes vis-à-vis de la technique. Or, la technique, c'est l'évidence, ne peut prétendre résoudre tous les problèmes ; pas ceux en tous cas qui relèvent du psychisme. La technique ne remplacera jamais les sentiments ; elle heurte même parfois violemment les sensibilités.
Ces dernières années, la prise de conscience par les femmes qu'il peut y avoir d'autres formes d'accouchement que l'accouchement médicalisé à outrance, la redécouverte de leur passé professionnel par des sages-femmes qui revendiquent maintenant l'originalité de leur rôle auprès des femmes, les questions que se posent certains praticiens à propos de leur propre exercice, montrent que quelque chose bouge. Oui, mais dans quel sens ? Sans doute est-il trop tôt pour le dire. En tous cas, la complexité de la situation reflète bien l'importance de la mutation culturelle en cours.
Les études qui composent ce dossier sur l'accouchement au Québec témoignent de ce foisonnement et de cette recherche. Par la richesse des analyses, par la diversité des propositions qui sont faites, ce travail collectif peut être avantageusement comparé aux actes du colloque de Milan de janvier 1985, « Le culture del parto », qui a été la plus importante confrontation d'idées de ces 20 dernières années sur l'accouchement en Europe occidentale. Il a d'ailleurs l'avantage d'être mieux centré géographiquement et plus cohérent. Il souligne l'originalité du modèle anglo-saxon d'élimination des sages-femmes par les obstétriciens, depuis le milieu du 19e siècle. Il montre, à travers l'exemple de la césarienne que la technique n'en a jamais fini d'envahir le champ obstétrical. Il illustre bien la méthode de subversion des différentes ethnies, y compris celles qui paraissent les plus éloignées du modèle occidental. Par-delà les différences culturelles, se retrouvent en effet les mêmes préoccupations fondamentales de sécurité du corps et de transmission de la vie ; derrière les particularismes culturels et coutumiers, le même noyau dur de l'Homme.
Le principal mérite d'un tel dossier est de susciter les questions essentielles. Le rituel de l'accouchement renvoie toujours, nous l'avons vu, à un univers mental qui a sa cohérence. Dès lors est-il souhaitable, lorsque cet univers vient à se désagréger d'en faire revivre artificiellement certains éléments, pour les réinsérer dans une autre logique ? N'est-il pas illusoire par exemple d'opposer à la médicalisation des couches, la salle d'accouchement « écologique » ou encore la présence du père ? Est-ce ainsi que les femmes pourront réellement « se réapproprier leur accouchement » ? Les expériences tentées ici et là ne risquent-elles pas justement de demeurer des « expériences » ? Les structures médicales sont suffisamment fortes pour résister à de telles procédures ; quitte à intégrer d'ailleurs certaines propositions qui vont dans le sens d'une « humanisation des couches », mais ne remettent pas en cause l'essentiel du pouvoir médical.
Une société a l'accouchement et la naissance qu'elle mérite. Accouchement et naissance ne sont que des symptômes. La vraie question est bien celle du projet de vie, du devenir de la personne dans une société qui tend à n'être plus qu'une somme d'individus. Le pire serait de prétendre régler, cette fois encore, une question qui relève au moins autant de l'éthique, de la culture, que du biologique, avec des solutions d'ordre technique. Étudier l'accouchement, étudier la maternité, doit permettre de cerner l'image - une image - de la vie qui passe. Réfléchir sur la manière de donner la vie devrait s'accompagner d'une réflexion sur la mort, sur cette mort que l'on refuse aujourd'hui d'assumer dans les sociétés développées, et qui était vécue jadis comme une étape de la vie. Quand retrouverons-nous les deux bouts de la chaîne ? Pourquoi des enfants ? Quel devenir pour l'homme au seuil du troisième millénaire ? Et pour quel Homme ?
Jacques Gélis
Université de Paris VIII
|

